- Archives du BAC (43 531)
- Art (11 061)
- Biographies (6 177)
- Divers (47 455)
- Histoire et Géographie (17 971)
- Littérature (30 273)
- Loisirs et Sports (3 295)
- Monde du Travail (32 158)
- Philosophie (9 544)
- Politique et International (18 653)
- Psychologie (2 956)
- Rapports de Stage (6 975)
- Religion et Spiritualité (1 441)
- Sante et Culture (6 435)
- Sciences Economiques et Sociales (23 576)
- Sciences et Technologies (11 297)
- Société (10 929)
- Page d'accueil
- / Littérature

Le bal des folles
Par Mymy40 • 25 Mai 2022 • Dissertation • 894 Mots (4 Pages) • 2 563 Vues
Dissertation bal des folles
Victoria Mas est une écrivaine française née en 1987. Elle a étudié le cinéma et travaillait en tant qu’assistante de production. Elle publie son premier roman « Le Bal des folles » en 2019. Ce fut un grand succès littéraire. Son courant littéraire est l’hypermodernité. S’intéressant à la place de la femme et à l’évolution de la société à la fin du XIXème siècle, elle découvre ce fameux bal des folles que Jean-Martin Charcot avait instauré pour les femmes internées à l’hôpital de la Salpêtrière. Dans ce Paris des années 1885, en pleine évolution où les plus faibles sont laissées de côté, le roman interpelle sur la place des femmes et le rôle de la médecine. Comment Victoria Mas dénonce-t-elle les injustices sociales dans ce roman ? Dans un premier temps, nous allons observer que Victoria Mas dénonce la domination sexuelle. Dans un deuxième temps, nous allons constater la domination des pères. Enfin, nous allons mettre en exergue la domination des médecins.
Tout d’abord, l’auteur dénonce les abus sexuels. Notamment avec Louise qui y est confrontée deux fois, hors de l’hôpital, et, plus grave encore, dans l’hôpital. Le roman nous en informe par une analepse : « « Louise ne l’entend pas. Son regard est figé. Ce sont les mains de son oncle qu’elle sent maintenant sur son corps. » p.43. Cette figure de style permet de revenir sur un épisode passé de l'histoire afin de mieux expliquer et de prendre conscience de la gravité de ce qu’il se passe encore une fois pour Louise. Au chapitre 3, le jeune interne Jules embrasse Louise malgré sa réticence « car c’est en forçant qu’on fait céder » p. 41. Ces gestes rappellent à Louise le viol que lui a fait subir son oncle. À la fin du roman, au moment du bal, Jules la viole, alors qu’elle est à moitié paralysée. Le roman décrit le phénomène de sidération couramment observé chez les victimes de viol : « Sa bouche s’ouvre pour laisser sortir un cri muet. Tout en elle, soudain, s’éteint » p. 222.
Ensuite, nous constatons la domination des pères. Cela est incarnée par le père d’Eugénie qui l’interne de force. Sa domination s’exerce sur toute la famille, comme le montre cette phrase au chapitre 2 : « Maintenant qu’il a parlé, les autres peuvent prendre la parole » p. 23. Il impose le silence à sa fille dès qu’elle le contredit, mais surtout, il l’emmène à la Salpêtrière dès qu’il apprend l’existence de ses dons : « Tu es une Cléry. Où que tu ailles, tu porteras notre nom. Il n’y a qu’ici que tu ne le déshonoreras pas » p. 72. Pour ce père, sa fille n’a pas d’existence propre. Et de fait, son existence sociale dépend de lui. Les pensées rapportées de Geneviève, au chapitre 5, généralisent cette idée : « C’est bien le sort le plus malheureux : sans mari, sans père, plus aucun soutien n’existe – plus aucune considération n’est accordée à son existence » p. 79‑80. Cette figure de style est une accumulation, qui montre une fois de plus, les pensées des personnages rapportées au point de vue interne et qui traduisent les positions prises par le roman. Geneviève revoit ces pères lorsque le sien la rejette, au chapitre 9 : « Soudain, il ressemble à ces pères, tous ces pères qu’elle a vus s’asseoir dans son bureau, accablés par le mépris et la honte d’une fille dont ils ne voulaient plus, ces pères qui signaient, sans aucun remords, les fiches d’internement d’une enfant déjà oubliée » p. 167‑168. Pourtant, que ce soit Eugénie, qui provoque son père au chapitre 2, puis réussit non seulement à s’échapper de l’hôpital mais surtout à se consacrer à son don, ou Geneviève qui contribue à cette évasion et se place du côté des femmes en restant avec les aliénées, cette domination est contestée par les héroïnes du roman.
Analyse et critique de « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu
Dans cet article, nous nous pencherons sur l’ouvrage intitulé « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu. Publié en 1970, ce livre propose une analyse approfondie et une critique acerbe de la société française de l’époque. Bourdieu, sociologue renommé, utilise son expertise pour décortiquer les différentes strates sociales et les rapports de pouvoir qui les traversent. À travers une plume incisive, il expose les inégalités et les injustices qui caractérisent cette société, mettant en lumière les mécanismes de domination et les conséquences qu’ils ont sur les individus. Au fil de cette analyse, nous explorerons les thèmes abordés par l’auteur, tels que la classe sociale, le genre, la culture et l’éducation, afin de mieux comprendre les enjeux sociaux et politiques qui se dessinent dans « Le Bal des folles ».
Contexte historique et social de « Le Bal des folles »
Le Bal des folles, écrit par Pierre Bourdieu, est un roman qui se déroule dans un contexte historique et social particulier. L’histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, à une époque où la société française était marquée par de profondes inégalités sociales et de fortes tensions politiques.
Le roman se situe plus précisément à l’époque de la Troisième République, qui a duré de 1870 à 1940. Cette période a été marquée par de nombreux bouleversements politiques, notamment la Commune de Paris en 1871 et l’affaire Dreyfus à la fin du siècle. Ces événements ont profondément divisé la société française et ont exacerbé les clivages entre les différentes classes sociales.
Dans ce contexte, Le Bal des folles met en lumière la condition des femmes de l’époque, en particulier celles qui étaient considérées comme « folles » et internées dans des asiles psychiatriques. Bourdieu dépeint avec réalisme et sensibilité la vie de ces femmes, victimes de la société patriarcale et des préjugés de l’époque.
Le roman aborde également la question de la place des femmes dans la société, leur manque d’autonomie et leur soumission aux normes sociales. Bourdieu met en évidence les contraintes et les oppressions auxquelles les femmes étaient confrontées, que ce soit dans leur vie quotidienne ou dans leur accès à l’éducation et à l’emploi.
En explorant ces thématiques, Le Bal des folles offre une critique sociale et politique de l’époque, mettant en lumière les injustices et les inégalités qui régnaient alors. Bourdieu nous invite à réfléchir sur les conséquences de ces inégalités et sur la nécessité de lutter pour une société plus égalitaire et juste.
Analyse des personnages principaux
Dans « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu, les personnages principaux sont présentés de manière complexe et nuancée, ce qui permet au lecteur de plonger au cœur de leurs pensées et de leurs émotions. L’auteur explore les différentes facettes de ces femmes internées à la Salpêtrière au XIXe siècle, offrant ainsi une analyse profonde de leur condition et de leur place dans la société.
L’un des personnages principaux est Eugénie, une jeune femme issue d’une famille bourgeoise qui a été internée à la Salpêtrière par sa propre famille. Bourdieu décrit avec finesse les tourments intérieurs d’Eugénie, sa lutte pour préserver sa dignité et sa volonté de s’affranchir des contraintes imposées par la société. À travers elle, l’auteur met en lumière les injustices et les préjugés auxquels les femmes étaient confrontées à l’époque, ainsi que les conséquences dévastatrices de l’enfermement sur leur santé mentale.
Un autre personnage clé est Geneviève, une infirmière dévouée qui travaille à la Salpêtrière. Bourdieu dépeint Geneviève comme une femme forte et empathique, qui se bat pour améliorer les conditions de vie des patientes et pour leur offrir un traitement plus humain. Son personnage incarne l’espoir et la résistance face à l’oppression, et elle devient rapidement un symbole de courage et de détermination.
En explorant ces personnages principaux, Bourdieu soulève des questions essentielles sur la condition féminine, la psychiatrie et le pouvoir. Il met en évidence les mécanismes de domination et les stigmates associés à la folie, tout en offrant une réflexion profonde sur la place des femmes dans la société. Grâce à son écriture subtile et à sa capacité à créer des personnages complexes, Bourdieu parvient à captiver le lecteur et à l’inviter à réfléchir sur les thèmes universels abordés dans son roman.
Les thèmes de la folie et de la société patriarcale
Dans son roman « Le Bal des folles », Pierre Bourdieu aborde de manière subtile et percutante les thèmes de la folie et de la société patriarcale. À travers l’histoire de femmes internées dans l’asile de la Salpêtrière au XIXe siècle, l’auteur met en lumière les mécanismes de domination et d’oppression qui régissent la société de l’époque.
La folie, tout d’abord, est présentée comme une construction sociale. Bourdieu dénonce le pouvoir médical qui décide arbitrairement de la normalité et de la pathologie mentale. Les femmes internées à la Salpêtrière sont souvent victimes de préjugés et de stigmatisation, simplement parce qu’elles ne correspondent pas aux normes imposées par la société. L’auteur souligne ainsi l’absurdité de ces classifications et remet en question l’autorité des experts en psychiatrie.
Parallèlement, Bourdieu met en évidence les mécanismes de la société patriarcale qui contribuent à la marginalisation des femmes. Les protagonistes du roman sont majoritairement des femmes, enfermées dans un asile où elles sont soumises à la domination masculine. L’auteur dénonce les violences physiques et psychologiques infligées aux femmes, ainsi que leur relégation dans des rôles subalternes. Il met en lumière les inégalités de genre et les préjugés qui limitent la liberté et l’autonomie des femmes.
En analysant ces thèmes, Bourdieu propose une critique sociale et politique de son époque, mais également une réflexion sur les mécanismes de pouvoir qui perdurent encore aujourd’hui. Il invite le lecteur à remettre en question les normes et les structures de domination, et à lutter pour une société plus égalitaire et inclusive. « Le Bal des folles » est ainsi bien plus qu’un simple roman historique, il est une œuvre engagée qui nous pousse à réfléchir sur les enjeux de notre propre société.
La critique de la psychiatrie du XIXe siècle
Dans son ouvrage « Le Bal des folles », Pierre Bourdieu propose une analyse critique de la psychiatrie du XIXe siècle, mettant en lumière les dérives et les préjugés qui ont marqué cette période. L’auteur remet en question les pratiques et les théories psychiatriques de l’époque, soulignant leur manque de rigueur scientifique et leur impact néfaste sur les femmes.
Bourdieu dénonce notamment le concept de « folie » tel qu’il était compris à l’époque, considérant qu’il était souvent utilisé de manière arbitraire pour exclure et marginaliser les femmes. Selon lui, la psychiatrie du XIXe siècle était largement influencée par les normes sociales et les préjugés de l’époque, ce qui a conduit à une medicalisation excessive des comportements féminins jugés déviants.
L’auteur met également en évidence les conditions de vie déplorables dans les asiles psychiatriques de l’époque, où les femmes étaient souvent enfermées sans réelle justification médicale. Il dénonce les traitements inhumains et les violences physiques et psychologiques auxquels elles étaient soumises, soulignant le manque de considération et de respect envers ces femmes.
En remettant en question les fondements de la psychiatrie du XIXe siècle, Bourdieu met en évidence les enjeux de pouvoir et de domination qui étaient à l’œuvre dans cette discipline. Il souligne l’importance de prendre en compte les contextes sociaux, culturels et politiques dans l’analyse des pratiques psychiatriques, afin de mieux comprendre les mécanismes de stigmatisation et d’exclusion qui ont marqué cette période.
En conclusion, l’analyse critique de la psychiatrie du XIXe siècle proposée par Pierre Bourdieu dans « Le Bal des folles » met en lumière les dérives et les préjugés qui ont marqué cette période. En remettant en question les pratiques et les théories psychiatriques de l’époque, l’auteur souligne l’importance de prendre en compte les contextes sociaux et culturels dans l’analyse des comportements jugés déviants, afin de lutter contre les discriminations et les exclusions.
L’utilisation de l’écriture féminine dans le roman
Dans le roman « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu, l’utilisation de l’écriture féminine joue un rôle essentiel dans la construction de l’histoire et la représentation des personnages féminins. L’auteur adopte une approche sensible et empathique pour dépeindre les expériences et les émotions des femmes, ce qui permet au lecteur de s’immerger pleinement dans leur réalité.
L’écriture féminine dans ce roman se caractérise par une attention minutieuse aux détails et aux nuances des sentiments des personnages féminins. Bourdieu explore les différentes facettes de la condition féminine à travers des descriptions détaillées de leurs pensées, de leurs actions et de leurs interactions avec les autres personnages. Cette approche permet de donner une voix authentique aux femmes et de mettre en lumière les défis auxquels elles sont confrontées dans une société patriarcale.
De plus, l’écriture féminine dans « Le Bal des folles » met en évidence les relations complexes entre les femmes. Bourdieu explore les amitiés, les rivalités et les solidarités qui se développent entre les personnages féminins, offrant ainsi une représentation réaliste des dynamiques sociales entre femmes. Cette exploration des relations interpersonnelles permet également de mettre en évidence la diversité des expériences féminines et de montrer que chaque femme a une histoire unique à raconter.
Enfin, l’utilisation de l’écriture féminine dans ce roman contribue à remettre en question les stéréotypes de genre et à déconstruire les normes sociales. Bourdieu met en scène des femmes fortes, indépendantes et résilientes, qui défient les attentes traditionnelles de la société. Cette représentation positive des femmes permet de lutter contre les préjugés et de promouvoir une vision plus égalitaire et inclusive de la société.
En conclusion, l’utilisation de l’écriture féminine dans « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu offre une perspective unique sur la condition féminine et permet de mettre en lumière les expériences et les émotions des personnages féminins. Cette approche sensible et empathique contribue à créer une représentation réaliste et nuancée des femmes, tout en remettant en question les stéréotypes de genre et en promouvant une vision plus égalitaire de la société.
Les relations de pouvoir et de domination dans l’institution psychiatrique
Dans son roman « Le Bal des folles », Pierre Bourdieu met en lumière les relations de pouvoir et de domination qui régissent l’institution psychiatrique du XIXe siècle. À travers une analyse fine et critique, l’auteur dévoile les mécanismes de contrôle et d’oppression qui s’exercent sur les femmes internées, ainsi que les enjeux de pouvoir qui se jouent entre les différents acteurs de cette institution.
L’une des premières observations que l’on peut faire est la hiérarchisation des rôles au sein de l’institution psychiatrique. Les médecins, majoritairement masculins, occupent une position dominante et exercent un pouvoir absolu sur les patientes. Leur parole est considérée comme incontestable et leur diagnostic est souvent accepté sans discussion. Cette asymétrie de pouvoir crée un climat de soumission et de dépendance chez les femmes internées, qui se retrouvent dépossédées de leur autonomie et de leur libre arbitre.
Par ailleurs, Bourdieu souligne également l’importance des enjeux économiques et sociaux dans le fonctionnement de l’institution psychiatrique. Les femmes internées sont souvent issues de milieux modestes et sont considérées comme des « folles » ou des « hystériques » par la société. Leur internement permet ainsi de maintenir l’ordre social en reléguant ces femmes jugées « déviantes » à l’écart de la société. Cette logique de domination sociale se traduit également par des pratiques de maltraitance et d’exploitation, où les patientes sont utilisées comme main-d’œuvre bon marché dans les ateliers de l’institution.
Enfin, l’auteur met en évidence le rôle des normes sociales et des représentations collectives dans la perpétuation de cette domination. Les femmes internées sont stigmatisées et marginalisées en raison de leur « folie », une construction sociale qui les exclut de la norme. Cette exclusion renforce leur vulnérabilité et leur dépendance vis-à-vis de l’institution psychiatrique. Bourdieu dénonce ainsi la manière dont la société participe à la reproduction de ces rapports de pouvoir en acceptant et en légitimant l’enfermement des femmes jugées « anormales ».
En somme, « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu offre une analyse critique des relations de pouvoir et de domination qui caractérisent l’institution psychiatrique du XIXe siècle. À travers son roman, l’auteur met en lumière les mécanismes de contrôle, d’oppression et d’exploitation qui s’exercent sur les femmes internées, tout en pointant du doigt les enjeux économiques, sociaux et normatifs qui sous-tendent ces rapports de pouvoir. Une lecture qui invite à une réflexion profonde sur les dérives de l’institution psychiatrique et sur les luttes nécessaires pour une société plus égalitaire et respectueuse des droits des personnes en situation de vulnérabilité.
La représentation de la condition féminine au XIXe siècle
Dans son roman « Le Bal des folles », Pierre Bourdieu offre une analyse profonde et critique de la condition féminine au XIXe siècle. À travers l’histoire de femmes internées dans l’asile de la Salpêtrière à Paris, l’auteur met en lumière les injustices et les stéréotypes auxquels les femmes étaient confrontées à cette époque.
Bourdieu dépeint un monde où les femmes étaient souvent considérées comme des êtres faibles et fragiles, incapables de prendre des décisions éclairées. L’asile de la Salpêtrière devient ainsi le symbole de l’enfermement et de la marginalisation des femmes, où elles étaient reléguées en raison de leur « folie » supposée. L’auteur souligne ainsi la manière dont la société patriarcale de l’époque utilisait la notion de folie pour contrôler et réprimer les femmes qui ne se conformaient pas aux normes établies.
De plus, Bourdieu met en évidence les inégalités sociales qui existaient entre les femmes de différentes classes sociales. Les femmes issues de milieux défavorisés étaient souvent les plus touchées par la marginalisation et l’oppression. L’auteur dénonce ainsi la manière dont la société perpétuait les inégalités de genre en reléguant les femmes les plus vulnérables dans des institutions telles que l’asile de la Salpêtrière.
Enfin, Bourdieu souligne également le rôle de la médecine et de la psychiatrie dans la construction de la condition féminine au XIXe siècle. Les médecins de l’époque étaient souvent influencés par des préjugés sexistes et utilisaient la science pour justifier l’oppression des femmes. L’auteur met ainsi en garde contre les dangers de l’utilisation de la science pour légitimer les inégalités de genre et appelle à une remise en question de ces discours dominants.
En somme, « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu offre une analyse percutante de la condition féminine au XIXe siècle. À travers l’histoire de femmes internées à la Salpêtrière, l’auteur dénonce les injustices et les stéréotypes auxquels les femmes étaient confrontées, tout en mettant en lumière les inégalités sociales et le rôle de la médecine dans la construction de cette condition. Cet ouvrage constitue ainsi une contribution importante à la compréhension de l’histoire des femmes et de la lutte pour l’égalité des genres.
L’importance de la narration et de la structure dans le roman
Dans le roman « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu, la narration et la structure jouent un rôle essentiel dans la construction de l’histoire et dans la transmission des messages de l’auteur. En effet, la manière dont l’histoire est racontée et organisée permet au lecteur de plonger au cœur de l’univers du XIXe siècle et de comprendre les enjeux sociaux et politiques de l’époque.
Tout d’abord, la narration à la première personne adoptée par l’auteur permet une immersion totale dans l’esprit de l’héroïne, Eugénie Cléry. En suivant ses pensées et ses émotions, le lecteur est témoin de son évolution et de sa lutte pour sa liberté et sa dignité. Cette proximité avec le personnage principal crée une empathie et une connexion émotionnelle qui rendent l’histoire d’autant plus captivante.
De plus, la structure du roman est soigneusement élaborée pour mettre en valeur les thèmes et les idées développés par l’auteur. Le récit est divisé en plusieurs parties, chacune étant consacrée à un aspect spécifique de la condition des femmes à l’époque. Cette structure permet à l’auteur d’approfondir chaque sujet et de les relier entre eux de manière cohérente. Ainsi, le lecteur est amené à réfléchir sur des questions telles que la place de la femme dans la société, les normes sociales oppressives et les conséquences de la marginalisation.
Enfin, la narration et la structure se complètent pour créer un rythme et une tension narrative qui maintiennent l’intérêt du lecteur tout au long du roman. Les retours en arrière et les flashbacks permettent de dévoiler progressivement les secrets et les traumatismes des personnages, tout en maintenant un suspense constant. Cette construction habile de l’intrigue contribue à l’immersion du lecteur et à son attachement aux personnages.
En conclusion, la narration et la structure dans « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu sont des éléments essentiels qui contribuent à la richesse et à la profondeur de l’histoire. Grâce à une narration à la première personne, une structure réfléchie et un rythme captivant, l’auteur parvient à transmettre des messages puissants sur la condition des femmes et à susciter une réflexion chez le lecteur. Ce roman est donc un exemple remarquable de l’importance de la narration et de la structure dans la littérature.
Les influences littéraires et philosophiques dans « Le Bal des folles »
Dans son roman « Le Bal des folles », Pierre Bourdieu puise ses influences dans la littérature et la philosophie pour offrir une analyse profonde et critique de la société du XIXe siècle. En s’appuyant sur des références littéraires et philosophiques, l’auteur parvient à créer une œuvre riche et complexe qui interroge les normes sociales et les rapports de pouvoir.
L’une des influences majeures dans « Le Bal des folles » est sans aucun doute la littérature réaliste du XIXe siècle. Bourdieu s’inspire notamment des romans de Balzac et de Zola pour dépeindre avec minutie la société parisienne de l’époque. Comme ces auteurs avant lui, il dresse un portrait sans concession de la bourgeoisie et de ses hypocrisies, mettant en lumière les inégalités sociales et les injustices qui en découlent. A travers des descriptions précises et détaillées, Bourdieu nous plonge dans un univers réaliste où les conventions sociales étouffent les individus et les empêchent de s’épanouir pleinement.
Mais l’influence littéraire ne s’arrête pas là. Bourdieu fait également référence à des œuvres plus symboliques et allégoriques, telles que « La Divine Comédie » de Dante ou « Les Fleurs du Mal » de Baudelaire. Ces références littéraires viennent enrichir le récit en lui donnant une dimension plus profonde et métaphorique. Elles permettent à l’auteur d’explorer des thèmes universels tels que la folie, la condition féminine ou encore la quête de liberté.
Sur le plan philosophique, Bourdieu s’inscrit dans la continuité de penseurs tels que Michel Foucault ou Pierre Bourdieu lui-même. Il utilise leurs concepts et leurs idées pour analyser les mécanismes de pouvoir et de domination présents dans la société du XIXe siècle. A travers le personnage du docteur Charcot, qui utilise l’hypnose et la manipulation pour contrôler les femmes internées à la Salpêtrière, Bourdieu dénonce les abus de pouvoir et les pratiques médicales douteuses de l’époque.
En conclusion, les influences littéraires et philosophiques dans « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu sont multiples et variées. L’auteur puise dans la littérature réaliste du XIXe siècle pour décrire avec précision la société de l’époque, tout en s’inspirant d’œuvres symboliques pour donner une dimension plus profonde à son récit. Sur le plan philosophique, Bourdieu s’appuie sur les idées de penseurs tels que Foucault pour analyser les rapports de pouvoir et de domination. Cette combinaison d’influences fait de « Le Bal des folles » une œuvre complexe et engagée, qui interroge les normes sociales et les injustices de son époque.
L’impact du roman sur la société contemporaine
Le roman « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu a suscité un vif intérêt au sein de la société contemporaine. En effet, cette œuvre littéraire a réussi à captiver les lecteurs par son analyse profonde et sa critique acerbe de la société du XIXe siècle.
L’impact de ce roman sur la société contemporaine est indéniable. Tout d’abord, il met en lumière les conditions de vie difficiles des femmes à cette époque, en particulier celles qui étaient considérées comme « folles ». Bourdieu dépeint avec réalisme les traitements inhumains et les préjugés auxquels ces femmes étaient confrontées, ce qui a permis de sensibiliser le public à cette réalité souvent méconnue.
De plus, « Le Bal des folles » aborde également des questions plus larges telles que le pouvoir et la domination sociale. L’auteur met en évidence les inégalités de classe et de genre qui régnaient à l’époque, et souligne l’importance de remettre en question les normes sociales établies. Cette critique sociale a permis de susciter des débats et des réflexions au sein de la société contemporaine, incitant les lecteurs à remettre en question les structures de pouvoir et à lutter pour plus d’égalité.
Enfin, ce roman a également eu un impact sur le monde de la littérature contemporaine. En explorant des thèmes tabous et en adoptant une approche novatrice, Bourdieu a ouvert la voie à de nouveaux genres littéraires et a inspiré de nombreux auteurs à repousser les limites de la fiction. Ainsi, « Le Bal des folles » a contribué à enrichir le paysage littéraire contemporain en offrant une perspective unique et en encourageant la diversité des voix.
En conclusion, « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu a eu un impact significatif sur la société contemporaine. En mettant en lumière les injustices sociales et en encourageant la remise en question des normes établies, ce roman a suscité des débats et des réflexions au sein de la société. De plus, il a également contribué à l’évolution de la littérature contemporaine en ouvrant de nouvelles perspectives et en inspirant de nombreux auteurs.
L’analyse des critiques et des réceptions du roman
Le roman « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu a suscité de nombreuses critiques et réceptions depuis sa publication. Cette œuvre, qui plonge le lecteur dans l’univers sombre et oppressant de l’asile de la Salpêtrière au XIXe siècle, a été saluée pour sa capacité à dépeindre avec réalisme la condition des femmes internées à l’époque.
Les critiques ont souligné la force narrative du roman, ainsi que la profondeur des personnages féminins qui y sont présentés. Bourdieu parvient à donner une voix à ces femmes oubliées de l’histoire, dépeignant leurs souffrances et leurs espoirs avec une grande sensibilité. Les lectrices ont particulièrement apprécié la manière dont l’auteur aborde des thèmes tels que la folie, la condition féminine et la lutte pour la liberté.
Cependant, certains critiques ont également relevé certaines faiblesses dans le roman. Certains ont regretté le manque de développement de certains personnages secondaires, qui auraient pu apporter une plus grande richesse à l’histoire. D’autres ont souligné que l’intrigue, bien que captivante, pouvait parfois sembler prévisible.
Malgré ces critiques, « Le Bal des folles » a été largement salué par la critique et a connu un grand succès auprès du public. Il a été traduit dans de nombreuses langues et a été adapté au cinéma, témoignant de son impact durable sur la littérature contemporaine.
En conclusion, « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu a été largement apprécié pour sa capacité à donner une voix aux femmes internées à la Salpêtrière. Malgré quelques critiques mineures, ce roman a réussi à captiver les lecteurs par son récit poignant et sa représentation réaliste de l’époque. Il s’agit d’une œuvre qui mérite d’être lue et étudiée pour sa contribution à la littérature féministe et historique.
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Site Internet
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
- Search Menu
- Sign in through your institution
- CNS Injury and Stroke
- Epilepsy and Sleep
- Movement Disorders
- Multiple Sclerosis/Neuroinflammation
- Neuro-oncology
- Neurodegeneration - Cellular & Molecular
- Neuromuscular Disease
- Neuropsychiatry
- Pain and Headache
- Advance articles
- Editor's Choice
- Author Guidelines
- Submission Site
- Why publish with this journal?
- Open Access
- About Brain
- Editorial Board
- Advertising and Corporate Services
- Journals Career Network
- Self-Archiving Policy
- Dispatch Dates
- Terms and Conditions
- Journals on Oxford Academic
- Books on Oxford Academic

Article Contents
Acknowledgements.
- < Previous
Le Bal des Folles
- Article contents
- Figures & tables
- Supplementary Data
Andrew J. Lees, Le Bal des Folles, Brain , Volume 145, Issue 4, April 2022, Pages 1564–1568, https://doi.org/10.1093/brain/awac089
- Permissions Icon Permissions
In 1868 the dilapidated St Laure building at the Hospice de la Vieillesse-Femmes de la Salpêtrière was closed and its long-stay lunatics transferred to other Parisian hospitals. In the internal reorganization that ensued Jean-Martin Charcot was asked to take over the care of 150 women who had been relocated to the Petites Loges facility of the hospital. Many of these women had convulsive disorders of unknown cause, and Charcot saw his new responsibility as an opportunity to further characterize a group of disorders, which had hitherto been relegated to the custodianship of alienists. Many of these women had been admitted to the Salpêtrière as teenage girls, frequently for their own protection or at the request of others supposedly acting in their best interests. Almost all were from deprived backgrounds, and many were illiterate. Some had been abused physically and sexually, others had been obliged to become surrogate mothers while still children because of neglectful and alcoholic parents, while the illegitimate orphans among them had been raised without love or gentleness in austere, unforgiving religious institutions.

The Mad Women’s Ball By Victoria Mas , 2021 Translated by Frank Wynne Doubleday ISBN: 9780857527035
The Mad Women's Ball A film directed by Mélanie Laurent , 2021 Starring Lou de Laâge , Mélanie Laurent and Emmanuelle Bercot Amazon Prime
At the time Charcot began to study these women’s incoherent behaviour a popularly held medical view was that hysteria resulted from a discontented, wandering uterus, and that compression of the ovaries could sometimes be curative. His own views evolved over 15 years of study, but he remained convinced that hysteria was a brain disorder, which needed to be distinguished from simulation, malingering and imposture. It was sphynx-like, lacking the solidity of nervous disorders where a consistent, circumscribed lesion had been identified at post-mortem, and a malady, which he linked with other ‘neuroses’ such as epilepsy, tics, Parkinson’s disease and chorea. He agreed with Paul Briquet that sexual abuse was a risk factor, and that physical trauma could trigger similar symptoms in men but that there were also hereditary antecedents. In 1892, Pierre Janet introduced Charcot to the notion of hysteria as a dynamic disorder where an idea representing an organ, or its presumed function, anchored itself in a person’s mind, and was then through a process of dissociation converted into a physical symptom.
During Charcot’s lifetime, writers including Émile Zola, Guy de Maupassant and J-K Huysmans described nervous ailments in a few of the characters of their novels, and his views on hypnotism and hysteria were familiar to the general public through wide publicity in newspapers and magazines. Although his reputation as the Father of Neurology has remained secure, influential modern medical historians have been critical of Charcot’s reluctance to acknowledge the importance of psychological factors in hysteria, and of his trenchantly expressed erroneous views on the mode of action of medical hypnosis. Even in France, his name and work now remain as only a distant echo in the public imagination. After his death in 1893 several of his disciples continued to study hysteria, distancing it further from psychosis and thereby reducing its stigma. Babinski believed that hysteria could be brought on by suggestion and improved by persuasion, and discovered ways of distinguishing it from other nervous disorders on physical examination. Freud believed it represented a metamorphosis of psychological problems often arising from repressed sexual conflicts into somatic manifestations, while Janet advanced the notion of the medical interview as a method of cognitive therapy.
In the last 25 years a number of novelists have been attracted by the personality of Charcot, his treatment methods, and the relationship that he had with some of his famous patients like Blanche Wittmann and Louise Augustine Gleizes. Some of them have portrayed him unjustifiably as a charlatan, a misogynist and an abuser, while others have used presentism in an attempt to impugn his medical reputation. 1–4
Victoria Mas’ novel is a dark story that focuses on the emotional bond that develops between a rebellious teenage girl called Eugénie Cléry and Charcot’s long-serving nursing superintendent, Geneviève Gleizes. Since the age of 12 Eugénie has been seeing ghosts that talk to her but are never frightening. As she grows up, she begins to openly challenge her lawyer father’s authority and the suffocating mores of Parisian society. She learns about a book written by Allan Kardec and tracks down a copy to a bookshop selling esoteric and arcane texts on the Rue St Jacques. While her father is preoccupied in finding her a husband, she learns from The Spirit’s Book that there are mediums who, like her, are able to communicate with the dead.
‘She has witnessed patients faint at the touch of Charcot’s hand: seen others feign seizures in order to get his attention. On the rare occasions when he visits the ward, the atmosphere abruptly changes; from the moment he arrives the women simper, some show off, some fake a fever, others sob or plead, still others make the sign of the cross. The nurses giggle like startled schoolgirls. He is at once the man they desire, the father they wish they had had, the doctor they admire, the saviour of minds and souls. As for the doctors, assistants and students who trail behind him as he moves between the beds, they too form a faithful, deferential entourage that further reinforces the status of the man whose authority in the hospital is unchallenged’.
The narrative explores the experiences of the women on the ward and their encounters with Charcot’s retinue, including notables such as Babinski and Gilles de la Tourette. On the ward there is a 16-year-old girl called Louise who confides in Eugénie that one of the young doctors is in love with her. While the two girls are talking, a nurse comes to inform Louise that she has been chosen once again for Charcot’s lesson of the week. The demonstration began as usual with Gilles de la Tourette swinging the pendulum before Louise’s eyes. A tuning fork was then struck, and Louise swooned backwards into the arms of two interns. On Charcot’s orders she then assumed a praying position followed by an attitude of crucifixion, before finally going into a series of ecstatic convulsions. Some of the audience believed her to be possessed and openly made the sign of the cross. When Louise comes around from deep hypnosis, she is unable to move her right arm and leg.
The novel also describes how the relationship between Eugénie and Geneviève evolves. After the donated costumes for the Mardi Gras ball arrive at the hospice, the women busy themselves sewing and adjusting their chosen gowns. Meanwhile in the fashionable salons and cafés men who refer to the occasion as the Mad Women’s Ball have started to imagine nudes running flirtatiously through the long corridors or spreading their legs to welcome imaginary lovers. They remember the year when 15 hysterics simultaneously convulsed at the clash of the cymbals and when a nymphomaniac dressed as a marchioness rubbed her crotch lasciviously against the male guests.
When the night of the Lenten ball finally arrives, and the male guests enter the great hall they are surprised at the calmness and decorum of the mad women standing and talking quietly in groups. The orchestra then strikes up and Geneviève helps Eugénie to escape, but is then apprehended by three doctors. After an internal inquiry she is stripped of her responsibilities and is herself detained as a patient on Charcot’s ward.
The character of Geneviève Gleizes is loosely based on Marguerite Bottard (1822–1906), Charcot’s long serving senior nurse surveillant, 1 while Louise bears a close resemblance to ‘Augustine’ a grande hysterique who in 1880, despite her ‘celebrity’ status, fled from the Salpêtrière, disguised as a man, and was never heard of again ( Fig. 1 ). 2 In The Story of San Michele Axel Munthe wrote that he attended some of Charcot’s lectures while completing his medical studies in Paris and that he had the utmost admiration for him and his powers of observation. It was only after he had qualified and become a médecin en ville that he became critical of Charcot’s inability to see that the young women under his care were almost all histrionic fakes and that hypnosis worked by enhancing suggestibility.

Photographs by Albert Londe of Augustine Gleizes showing her at rest ( left ) and when adopting ‘ une attitude passionnelle ’ ( right ). Courtesy of BIU Santé Paris.
He goes on to describe how he hatched a plan to rescue a grande hystérique , called Geneviève from Charcot’s clutches and return her to her family. One day in La Salle St Agnès he hypnotized Geneviève, instructing her that she must leave the ward and proceed by carriage to his apartment, where a nurse would be waiting to escort her back to her parents’ farm in Normandy. Munthe’s plan was foiled by an observant nurse, and an incandescent Charcot banned him from ever attending the hospital again. Munthe who became a fashionable doctor in Rome never let a good story get in the way of the truth, but it is likely that there is some substance to this escapade.
In the late 19th century Parisians flocked to masked carnival balls, which served as catharsis, releasing them for a night from the unbending rules of the Republic and temporarily subverting the social order. Dr Gilbert Fredet, a physician from Clermont, was invited as a guest to Le Bal des Folles on 28 March 1889. On entering a spacious, brightly lit hall decorated with flowers, the first thing which caught his eye was groups of beautiful women dressed as Circassian princes, Spanish ladies, musketeers, chimney sweeps and peasants of Bourbonnais. From time to time a nurse, dressed all in black, would glide silently among the women, like a mother mourning the loss of her children. There were rows of uncommunicative, elderly women hunched over benches and a long trestle table piled high with cakes and pastries.
In marked contrast to the impeccable manners of the hospice’s female residents, many of the guests behaved in a rowdy and agitated manner leading Fredet to observe that an outsider would guess that it was the men who were the mental patients. At the call of the band the women took their places sedately on the dance floor and danced quadrilles and polkas in a fashion that would have graced any high society ball. Not a single woman had a hysterical crisis during the event, leaving him to conclude that it would be in the interest of the authorities at the Salpêtrière to consider having more frequent balls as a form of therapy ( Fig. 2 ). 3

The Mad Women’s Ball at the Salpêtrière: a sketch by Paul-Eugène de Mesples. Courtesy of Musée d’Histoire de la Médecine, Paris.
The capacity of dance to improve mental health is also illustrated by the life of Jane Avril (born Jeanne Louise Beaudon, 1868–1943), Henri de Toulouse-Lautrec’s muse. Fifty years after her internment at the Salpêtriere she wrote in her published memoirs that while still a child she had shared a dormitory with some of Charcot’s famous hysterics. In 1884, dressed in an elegant carnival frock provided by Charcot’s daughter, she attended a transvestite ball at the hospice where, transported by the music, she felt compelled to spring up like a fawn, and dance a waltz with a rhythmical grace that earned her acclamations from many of the male guests. This light-bulb moment showed her that she could channel her symptoms into creative choreography and thereby alter her destiny. After the ball her nervous symptoms rapidly abated and she was discharged from the hospital. She began to frequent Parisian dance halls, and at the Closerie des Lilas, a bar and restaurant in Montparnasse, she came into contact with influential intellectuals in the art and literary world, who supported and encouraged her. In 1889 she began to dance at the Moulin Rouge under the patronage of its proprietor, Charles Zidler, and rapidly rose to become one of the cabaret’s most popular can-can dancers. One observer defined her dancing style as like ‘an orchid in frenzy’, another as having an attitude of ‘depraved virginity’.
In her memoirs Jane Avril described her neurological diagnosis as ‘predestination’. From the few available photographs and Toulouse-Lautrec’s lithographs ( Fig. 3 ) it seems likely that her highly distinctive dance style was a gift associated with her psychopathology (she had been diagnosed by Charcot as suffering from la danse de St Guy , a generic term used to describe grimaces, contortions, and abnormal sinuous movements of unknown cause) but she also incorporated into her dancing the passionate attitudes she had witnessed in some of the women with whom she had shared a ward for 18 months. She makes a brief appearance in the Mad Women’s Ball, when an increasingly disillusioned Geneviève visits her in search of reassurance. Jane tells her that the Salpêtrière had been the first place where she had ever felt anyone cared about her.

Lithograph (1899) by Henri de Toulouse-Lautrec of Jane Avril, emphasizing her serpentine choreography and swaying body.
Allan Kardec (born Hippolyte Leon Denizard Rivail) (1804–69) considered his ‘Spiritist Doctrine’ to be a science. His research on mediums led him to conclude that we are all immortal spirits, obliged to temporarily inhabit bodies in order to attain moral and intellectual advancement. Charcot and his clinical assistant Gilles de la Tourette were also keen to find rational explanations for miracles but were critical of Kardec’s views. 4 In the 16th lecture in his Oeuvres Complètes , Charcot warns that attempting to contact the dead can lead to hysteria in genetically susceptible individuals. 5 Despite continuing concerns from the medical profession, Spiritism based on Kardec’s codification has survived as a religion and a philosophy in 35 countries and now has four million adherents in Brazil.
Eugénie’s ability to see and talk with the dead made me mull over what might happen today to a young person who tells her parents that she is able to see and talk to dead people. I suspect neurologists and psychiatrists would soon be involved, brain scans and EEGs ordered, and when no structural cause was found, a period of observation in the Maudsley Hospital or The Priory recommended.
‘Charcot has helped bring back a little light and cleanliness inside the hospital, and to bring conditions of care a little more decent. Before, there was not even the idea of treating’.
Unfortunately, the same cannot be said of Mélanie Laurent’s highly anticipated screen adaptation of the book, which despite its lavish trappings and handsome production, comes over as a shallow costume melodrama. The grisly scenes depicting women being treated with ice-cold baths and vaginal cautery seem unreal to the clinical gaze and the adapted rape scene where a doctor assaults Louise while the ball is going on comes over as contrived. Hysteria lends itself to the moving camera but none of the scenes on the ward replicated the clown-like antics and pseudo-seizures described in such detail by Charcot and his associates. The portrayal of Charcot himself and the format of his Friday lecture are sensationalized and lack genuineness. Perhaps most damningly the film adaption makes no attempt to get inside the emotions of Eugénie, Louise and Geneviève (played by Laurent) who end up coming across as uninteresting and unsympathetic ciphers.
‘Nobody appreciates a consulting room more than a doctor. For those whose minds are steeped in science, it is here that diseases are diagnosed, that medicine progresses. They relish wielding instruments that terrify those on whom they are used. For the patients, who are forced to undress, the consulting room is a place of fear and uncertainty. Those who meet here are not equals; the doctor announces the fate of the patient; the patient takes him at his word. For the doctor what is at stake for him is his career, for the patient it is life itself. This rift is all the more pronounced when a woman enters the consulting room. When she offers up her body to be examined, a body simultaneously desired and misunderstood by the man conducting the examination’.
‘John is a physician, and perhaps—(I would not say it to a living soul, of course, but this is dead paper and a great relief to my mind)—perhaps that is one reason I do not get well faster’.
History matters, but the best novels boast a sort of truth that scholarship can never claim. Victoria Mas’ book made me reflect that while unquestionable progress has been made in our understanding of hysteria (now known as functional neurological disorder) it remains one of the most challenging conditions in the whole of neurology. The Mad Women’s Ball and The Yellow Wallpaper are salutary reminders of how some methods used to treat inconvenient behavioural disorders by well-meaning physicians have the capacity to aggravate mental and physical distress and push people to the verge of insanity. If more successful outcomes are to be achieved in functional neurological disorder, the potential power of the therapeutic interview in rehabilitation must be exploited to its limit and judgemental errors of the past avoided.
I would like to thank Drs Jon Stone and Alan Carson from Edinburgh University for generously sharing their views about the importance of Jean-Martin Charcot’s work on hysteria.
Walusinski O . Marguerite Bottard (1822-1906), nurse under Jean-Martin Charcot, portrayed by G. Gilles de la Tourette . Eur Neurol . 2011 ; 65 ( 5 ): 279 – 285 .
Google Scholar
Walusinski O . The girls of La Salpetriere . Front Neurol Neurosci . 2014 ; 35 : 65 – 77 .
Fredet GE . Un Bal à la Salpêtrière. Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne publié par l’Academie des Sciences, Belles-Lettres et Art de Clermont-Ferrand Melanges Historiques et Scientifiques; 1889 .
Kardec A . The spirits’ book containing the principles of spiritist doctrine . Livraria Allan Kardec Editora ; 1972 .
Google Preview
Charcot JM , Sigerson G . Lectures on the diseases of the nervous system, delivered at la Salpêtrière. Translated from the 2d edition by George Sigerson. H. C. Lea ; 1879 . In-8°, XII-271, fig. p.
Email alerts
Citing articles via, looking for your next opportunity.
- Contact the editorial office
- Guarantors of Brain
- Recommend to your Library
Affiliations
- Online ISSN 1460-2156
- Print ISSN 0006-8950
- Copyright © 2024 Guarantors of Brain
- About Oxford Academic
- Publish journals with us
- University press partners
- What we publish
- New features
- Open access
- Institutional account management
- Rights and permissions
- Get help with access
- Accessibility
- Advertising
- Media enquiries
- Oxford University Press
- Oxford Languages
- University of Oxford
Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University's objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide
- Copyright © 2024 Oxford University Press
- Cookie settings
- Cookie policy
- Privacy policy
- Legal notice
This Feature Is Available To Subscribers Only
Sign In or Create an Account
This PDF is available to Subscribers Only
For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.
- Analyses de livres
- Questionnaires
- Commentaires de texte
- Bac Français 2024
- LePetitLittéraire.fr
Le Bal des folles - Analyse du livre
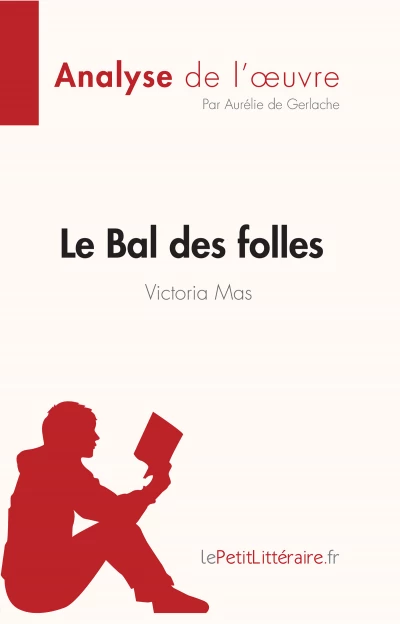
de Victoria Mas
- Description de cette analyse
- Table des matières
- Infos techniques
À propos de l'analyse de livre sur Le Bal des folles
Le premier roman de Victoria Mas, Le Bal des folles , paru aux éditions Albin Michel en 2019, a été salué par la critique et a reçu le prix Renaudot des lycéens le 14 novembre 2019. C’est un roman fictionnel qui s’inscrit dans le contexte historique de l’hôpital de la Salpêtrière à Paris et du service du docteur Charcot à la fin du xix e siècle.
L’analyse du roman vous entrainera à travers les méandres de ce bâtiment historique et des vies de ses pensionnaires aliénées. Victoria Mas nous offre dans ce roman une réelle danse des mots qui met en scène des robes délacées, des châles tricotés, des chemises de nuit errantes, mais aussi des âmes esseulées, des voix oubliées, des vies humiliées et condamnées. L’analyse va retracer le destin de ces femmes victimes d’une société masculine qui aliène toutes celles qui dérangent l’ordre établi. Parmi elles, Geneviève, intendante dévouée corps et âme au Docteur Charcot, endeuillée par la mort de sa jeune sœur ; Louise, une jeune fille abusée par son oncle ; Thérèse, une prostituée au grand cœur ; et enfin Eugénie qui, parce qu’elle dialogue avec les morts, sera internée par sa famille. Nous sommes en 1885 et Le Bal des folles met en scène la préparation du fameux bal qui a lieu chaque année à la Mi-Carême dans le service du docteur Charcot à la Salpêtrière à Paris. Parmi les séances publiques, telles que les séances d’hypnose, que Charcot expérimente sur ses femmes, ce bal n’est autre qu’une de ses expériences. Le temps d’un soir, deux mondes opposés, celui du haut Paris et celui de ces folles se mélangeront.
C’est un véritable hymne à la liberté pour toutes les femmes que le xix e siècle a essayé de faire taire.
À travers ce roman, nous analyserons trois clés de lecture autour de la condition féminine au xix e siècle, du contexte des recherches scientifiques et psychiatriques, mais aussi du rapport au monde invisible avec les débuts du mouvement spirite.
Le roman met en exergue le terreau de beaucoup de certitudes héritées du passé et l’analyse du Bal des folles de Victoria Mas nous invite à déconstruire ces idées reçues et à nous confronter à de nombreuses questions :
Quel pouvoir attribue-t-on à la science ? Comment se fier à la médecine sans perdre de vue son jugement propre ?
En quoi la place de la femme à la fin du xix e siècle fait-elle écho au combat féministe et aux revendications sur la place de la femme dans le monde d’aujourd’hui ?
Le monde psychiatrique a toujours suscité beaucoup de fantasme et de voyeurisme. Dans le Bal des folles , le nom d’Augustine (patiente atteinte d’hystérie sévère qui a existé et entretenu des liens étroits avec le docteur Charcot à la fin du xix e siècle) est évoqué. La jeune Louise, sujet de prédilection des séances d’hypnose en public, en a fait son égérie. Il en est question dans le film Augustine d’Alice Winocour, sorti en 2012 avec la chanteuse Soko dans le rôle d’Augustine et Vincent Lindon dans le rôle du docteur Charcot. La relation controversée et douteuse de cette patiente et de son docteur y est abordée ainsi que les séances publiques d’hypnose et différentes recherches psychiatriques du docteur Charcot.
L’adaptation au cinéma du Bal des folles par et avec la réalisatrice, Mélanie Thierry dans le rôle de Geneviève, Lou de Lâage dans le rôle d’Eugénie, Grégoire Bonnet dans le rôle de Jean-Martin Charcot est sortie le 17 septembre 2021 en France.
Structure de cette analyse du livre
LE BAL DES FOLLES (2 pages)
Un roman qui met en scène les femmes internées à l’hôpital psychiatrique de la Salpêtrière à la fin du XVIIIe siècle à Paris.
VICTORIA MAS (2 pages)
Écrivaine française
RÉSUMÉ (6 pages)
ÉTUDE DES PERSONNAGES (7 pages)
Eugénie Cléry Geneviève Louise Thérèse Le Docteur Charcot Théophile Cléry François Cléry La Salpêtrière
CLÉS DE LECTURE (10 pages)
Un roman qui fait réfléchir sur la condition féminine à la fin du XIXe siècle Contexte historique et débuts des avancées dans la recherche médicale en neurologie et psychiatrie Le rapport au monde invisible
PISTES DE RÉFLEXION (2 pages)
Quelques questions pour approfondir sa réflexion…
POUR ALLER PLUS LOIN (1 pages)
Édition de référence Études de référence Sources complémentaires Adaptations
Que puis-je trouver dans cette analyse sur Le Bal des folles
Dans cette fiche de lecture, vous trouverez d'abord une présentation générale du roman de fiction historique Le bal des folles et de sa réception , suivie de la biographie de son auteure, Victoria Mas . L'analyse se poursuit avec un résumé détaillé de l'intrigue du roman, ainsi qu'une étude approfondie des personnages principaux intervenant dans l'histoire. Ensuite, cette fiche vous propose d'envisager le roman sous différents angles par le biais de trois clés de lecture , en analysant entre autres le contexte historique et la place et la condition de la femme à la fin du XIXe siècle. Enfin, vous pourrez approfondir l'analyse avec des questions ouvertes servant de pistes de réflexion ainsi qu'avec des sources complémentaires.
À propos du livre Le Bal des folles
À travers ce premier roman, Victoria Mas relate les évènements du mois qui précède le 18 mars 1885, jour auquel aura lieu le Bal des folles. Chaque année, à la Mi-Carême, se tient, à la Salpêtrière, hôpital psychiatrique pour femmes, le très mondain Bal des folles. Le temps d’un soir, le Tout-Paris bourgeois s’encanaille en compagnie des internées, déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres danseuses espagnoles. Ce bal est l’une des expériences du célèbre neurologue, le docteur Charcot, adepte de l’exposition des fous.
Victoria Mas choisit dans son ouvrage de retracer le destin de ces femmes victimes d’une société masculine qui aliène toutes celles qui dérangent l’ordre établi. Parmi elles, Geneviève, intendante dévouée corps et âme au Docteur Charcot ; Louise, une jeune fille abusée par son oncle ; Thérèse, une prostituée au grand cœur ; et enfin Eugénie qui, parce qu’elle dialogue avec les morts, est internée par son père.
Si, comme les personnages, c’est le bal que l’on attend impatiemment, au fil des pages, le lecteur assiste à une réelle danse des mots qui met en scène des robes délacées, des châles tricotés, des chemises de nuit errantes, mais aussi des âmes esseulées, des voix oubliées, des vies humiliées et condamnées. C’est un véritable hymne à la liberté pour toutes les femmes que le xix e siècle a essayé de faire taire.
Informations techniques
ISBN numérique : 9782808024297
Analyse de : Aurélie de Gerlache
Partager cette analyse
Ces analyses du livre "Le Bal des folles" pourraient également vous intéresser
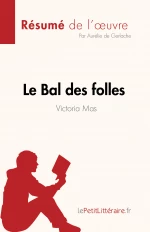
Pourquoi s'abonner ?
Avec l'abonnement lePetitLitteraire.fr, vous accédez à une offre inégalée d’analyses de livres :
Ceux qui ont téléchargé cette analyse du livre "Le Bal des folles" ont également téléchargé
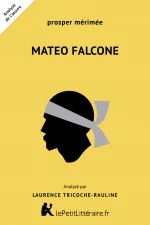
Réussis tes études avec des analyses faites par des professeurs !
Dès 0,99 € par fiche de lecture
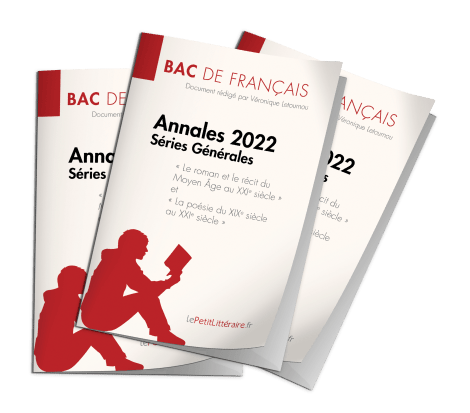
Extrait de l'analyse du livre Le Bal des folles
Structure de cette analyse de livre.
LE BAL DES FOLLES
VICTORIA MAS
ÉTUDE DES PERSONNAGES
CLÉS DE LECTURE
PISTES DE RÉFLEXION
POUR ALLER PLUS LOIN
Ce document a été rédigé par Aurélie de Gerlache
Née en 1981, après des études de communication, Aurélie de Gerlache a travaillé dix ans dans la production audiovisuelle à Bruxelles, puis trois années au département du mécénat du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Adepte d’ateliers d’écriture sous toutes ses formes et passionnée de lecture depuis longtemps, elle a cofondé le projet littéraire « Dédicaces » en 2018. Ce projet invite à faire (re)découvrir la littérature à travers le bien qu’elle nous fait en invitant tout lecteur à dédicacer, à ceux qui ne l’auraient pas encore lu, le livre qui a changé leur vie.
Validé par des experts en littérature
En savoir plus
Aurélie de Gerlache
Analyses rédigées par ce rédacteur.
- Le Bal des folles (Analyse du livre)
- L'Art de la victoire (Analyse du livre)
- L'Art de la victoire (Résumé du livre)
- Le Bal des folles (Résumé du livre)
- Couleurs de l'incendie (Analyse du livre)
- Passions (Analyse du livre)
- Couleurs de l'incendie (Résumé du livre)
- Passions (Résumé du livre)
Analyses littéraires
Manuscrit trouvé dans une bouteille
Si c'est un homme
Les Cerfs-volants
Toutes les analyses
Fédor Dostoïevski
Umberto Eco
Henri Troyat
Jean-Claude Mourlevat
Tous les auteurs
Aide et support
Sécurité des paiements
Conditions générales
Règles de confidentialité
Contacter le support
Toutes les FAQs
Exemples de résumés gratuits
Copyright © LEMAITRE Éditions, 2024
- 50minutes.fr
- 50minutes.com
Analyse Approfondie: Fiche de Lecture sur ‘Le Bal des Folles’
Symbols: 3707
=== Dans cet article, nous allons entreprendre une analyse approfondie de l’oeuvre "Le Bal des Folles" de Victoria Mas. C’est un roman historique qui se déroule dans le Paris du 19e siècle et qui est centré sur l’histoire de femmes internées dans l’hôpital de la Salpêtrière. La fiche de lecture sera notre outil principal pour comprendre et analyser les thèmes principaux du livre.
Analyse détaillée de ‘Le Bal des Folles’
Le "Bal des Folles" est un roman historique captivant qui nous fait découvrir la condition des femmes internées dans l’asile de la Salpêtrière à Paris à la fin du 19e siècle. L’auteure, Victoria Mas, retrace avec brio la vie de ces femmes, réduites à l’état de bêtes de foire, exposées lors du fameux "Bal des Folles" organisée une fois par an. A travers une analyse approfondie, nous allons comprendre que ce livre est une dénonciation forte des inégalités sociales et du traitement inhumain réservé aux femmes à cette époque.
C’est à travers les yeux de Eugénie, une jeune femme enfermée contre son gré par sa famille, que nous découvrons l’horreur de cet asile. Cette protagoniste, dotée du don de voir les morts, représente le symbole de la femme libre, indépendante et non-conforme, en opposition directe avec les normes de la société de l’époque. Sa lutte pour sa liberté et sa dignité tout au long du livre est une critique poignante de l’oppression, de la domination masculine et de la stigmatisation des femmes.
Le personnage du Dr Charcot, directeur de l’hôpital, est également très intéressant à analyser. Le célèbre neurologue, qui utilise les patientes pour ses expériences, est le symbole de la science sans éthique, de l’exploitation et de l’abus de pouvoir. Son personnage illustre parfaitement le manque d’empathie et de respect de la société de l’époque envers les femmes.
Comprendre les thèmes principaux à travers une fiche de lecture
La lecture de "Le Bal des Folles" révèle plusieurs thèmes principaux qui peuvent être analysés en détail. Le premier thème majeur est celui de la condition féminine. En effet, le roman met en lumière la manière dont les femmes étaient traitées et perçues dans la société du 19e siècle. L’auteure dépeint avec une grande précision la condition des femmes de l’époque, enfermées, opprimées et réduites à des objets de spectacle.
Le thème de la folie est également très présent dans ce roman. Victoria Mas explore la manière dont la société de l’époque définissait la folie, souvent pour enfermer
Enfin, le thème de la résistance et de la rébellion est omniprésent. Les femmes de l’asile se révoltent, se battent et luttent pour leur dignité et leur liberté. C’est à travers le personnage d’Eugénie que ce thème est le plus visible. Elle refuse de se soumettre, de se conformer et lutte jusqu’à la fin pour sa liberté et son indépendance.
=== En conclusion, "Le Bal des Folles" de Victoria Mas est une œuvre complexe et profonde qui nous fait découvrir l’histoire sombre de la Salpêtrière. A travers une analyse détaillée et une compréhension des thèmes principaux, nous pouvons apprécier la richesse de ce roman. Il est une dénonciation forte de l’injustice, de l’oppression et de l’exploitation des femmes. Il sert aussi de rappel des progrès accomplis en matière de droits des femmes, tout en soulignant le chemin qu’il reste à parcourir.
“Le Bal des folles” : histoire de la folie à l’âge de la sororité
Le Bal des folles , dernier film de Mélanie Laurent adapté du livre de Victoria Mas , nous plonge dans l’univers baroque et mystérieux de l’asile au XIX e siècle. Au fil des images, le spectateur dépasse le stade « esthétique » de la folie, pour se poser des questions éthiques, humanisant la figure misogyne de « la folle hystérique ».
L’esthétique de la folie
Eugénie (Lou de Laâge) communique avec les esprits. En 1885, c’est une raison suffisante pour qu’elle aille rejoindre « les filles comme elle » à l’hôpital de la Salpêtrière. Le choix d’un don occulte comme motif d’internement n’est pas anodin et installe de plain-pied le spectateur dans le monde fascinant et mystérieux de la folie.
« Pas l’hôpital, pas ça ! » , hurle-t-elle lorsqu’elle se rend compte que c’est là que son frère et son père l’emmènent. Rien ne manque au tableau : ni la folle livide en robe de chambre blanche sur le bord du jardin, ni les râles rauques que l’on entend au loin, ni la sévère infirmière ( Mélanie Laurent ) qui l’ausculte sans ménagement. Dans les dortoirs collectifs de l’asile, les corps difformes et échevelés achèvent de compléter le tableau un brin attendu de ce long métrage qui, de prime abord, a tout d’un Shutter Island au féminin.
Nous sommes habitués à une telle représentation de l’asile, alors pourquoi continue-t-elle de nous happer ? Cette question de la fascination liée à la folie, Michel Foucault la posait déjà dans son Histoire de la folie à l’âge classique (1961) à propos de l’homme du XVI e siècle, animé par une attirance mêlée de répulsion face à la figure du fou dont « la silhouette de cauchemar […] est à la fois le sujet et l’objet de la tentation ; […] qui fascine le regard de l’ascète ». Le terme de « silhouette » n’est pas choisi au hasard : dans la folie, c’est le corps peut-être plus que l’esprit qui fascine ceux qui sont présumés « sains », sur un mode quasi esthétique.
Car tout se passe comme si les démons psychologiques des patients venaient habiter les traits de leur visage. « Tu ressembles à tes fantômes, ils ressemblent à ça non ? Tristes et livides » , lance ainsi Jeanne – une infirmière glaçante incarnée par Emmanuelle Bercot – à Eugénie. Dès le Moyen Âge, nous avons perçu « l’existence de la déraison » dans « cette sorte de physionomie commune qu’il faut bien reconnaître dans les visages de tous les internés » , explique Foucault. C’est entre autres cette mise en miroir du spirituel et du corporel qui nourrit l’imaginaire asilaire.
Qui est le plus fou ?
À en croire le film , les médecins étaient particulièrement conscients de ce pouvoir hypnotique du corps fou. Ainsi voit-on le neurologue français Jean-Martin Charcot (1825-1893) en train de photographier le corps des « folles » pour capter l’attention d’un auditoire lors d’un congrès. Pire : il fait de leurs convulsions épileptiques (volontairement provoquées par l’hypnose), un spectacle destiné à divertir la communauté scientifique. Les corps en ressortent blessés, meurtris, paralysés. La folie ainsi esthétisée et mise en scène devient un cruel divertissement.
« Il est bien difficile de savoir qui est fou ce soir » , lance Geneviève lors du « bal des folles ». Cette fête préparée pendant des semaines où sont conviés patientes, médecins et personnages de la bourgeoisie parisienne, perd petit à petit de son éclat mondain pour devenir le théâtre macabre des violences sexuelles perpétrées par l’un des médecins. Sa remarque est une façon de dénoncer les terribles méthodes des psychiatres dépeints comme cruels et fous d’orgueil, mais c’est aussi une manière classique de redessiner la frontière entre « le savoir » et « la folie ». Au savoir balbutiant et dangereux du corps médical s’oppose ainsi le « savoir » mystique et sensible de certaines patientes.
Ce savoir est à lui seul un motif d’internement parce qu’il risque de perturber de l’ordre social. C’est ce qui arrive à Eugénie lorsque sa famille découvre qu’elle communique avec les défunts. Son don entre à ce titre dans la catégorie de ce que Foucault appelle les « savoirs interdits », considérés comme occultes et dangereux. Il effraie parce qu’il est à la fois insaisissable intellectuellement et moralement ambivalent. « Il prédit à la fois le règne de Satan, et la fin du monde ; le dernier bonheur et le châtiment suprême ; la toute-puissance sur terre, et la chute infernale. » En un mot, le savoir du fou terrifie parce qu’il rend fous les bien-portants.
Sœurs d’asile
Mais le film est aussi un éloge d’un autre type de savoir : celui qui consiste à soigner et à se soigner. Tout passe par des gestes salutaires de réconfort. Au fil des séquences, une douceur et une forme de sororité s’installent, humanisant les patientes. Entre elles, les femmes se lavent, se coiffent, se mettent de la poudre, s’habillent et se tiennent la main. Si c’est par le corps que les femmes souffrent, c’est aussi par lui que les liens se tissent. Grâce à cette solidarité, les patientes ne sont plus perçues comme des esprits malades dans des corps souffrants, mais comme des sujets conscients et sensibles.
Ensemble, patientes et infirmières combattent la société corsetée de leur époque. Une scène très forte montre ainsi Geneviève, l’infirmière impeccable, et Eugénie, la patiente « exaltée » , en train d’enlever leur corset. L’une crie, l’autre le retire calmement. Mais toutes les deux se libèrent en même temps et d’un même geste de cette structure rigide qui les empêche de respirer. L’humanisation de la folie passe donc aussi par la critique des conditions sociales et historiques dans lesquelles elle est désignée et réprimée.
L’empêchement du corps et la sujétion de l’esprit sont des thèmes chers à Mélanie Laurent. Respire (2014), un autre film de la réalisatrice avec Lou de Laâge en rôle principal, renvoyait lui aussi – à notre époque et dans un autre registre – à l’oppression liée à l’emprise psychique et corporelle. Mais si l’amitié dans Respire était précisément irrespirable, celle qui s’installe progressivement dans Le Bal des folles est un bol d’air frais et d’espoir, justement parce qu’elle parvient (brièvement) à déstabiliser la rigidité des structures oppressives établies.
Expresso : les parcours interactifs

Quel(le) amoureux(se) êtes-vous ?
Sur le même sujet, « hystérie », par andré comte-sponville.
En partenariat avec les Presses universitaires de France, Philosophie magazine propose chaque jour une entrée du «Dictionnaire philosophique» d'André Comte-Sponville. Aujourd'hui: « Hystérie ».
Le “gaslighting” ou la manipulation par la folie
Détruire l’autre à petit feu : c’est le principe du « gaslighting ». Et pour cause, le film réalisé en 1944 par George Cukor tire…

Jeanne Balibar. Voix enchantée
Comédienne et chanteuse, Jeanne Balibar possède un timbre reconnaissable entre mille. Cette normalienne, fille du philosophe Étienne Balibar et de la physicienne Françoise Balibar, a abandonné ses études d’histoire pour entrer au…
Irrelohe (Feu follet)
Un opéra tragique et incandescent, signé du compositeur Franz Schreker, mis en scène par David Bösch, sous la direction musicale de Benrhard…

“Seinfeld”, une série culte qui n’a peur de rien
La série américaine Seinfeld fait son entrée sur la plateforme Netflix. Une émission devenue culte, alors qu’elle parle ouvertement et…

On peut donner deux sens au mot histoire : ce que l’homme a vécu, et le récit qu’il en fait. En tant que récit, l’histoire suppose l’écriture, dont l’invention marque le passage de la préhistoire à l’histoire. Tournée vers le passé,…

“Squid Game” : Sodome et tas d’or
Attention, succès fulgurant. La série Squid Game, diffusée sur Netflix depuis le 17 septembre, est celle qui a connu le meilleur démarrage de…

Andreï Tarkovski contre le “speed-watching”
Depuis 2019, la plateforme de streaming Netflix offre à ses spectateurs la possibilité d’accélérer la vitesse de la vidéo regardée. Fonctionnalité…

- Accueil culture
- Festival de Cannes 2024
- Les stars du tapis rouge
- Critiques Cannes 2024
- Direct tv TV
- Direct radio Radio
- Le live Live
- Mon franceinfo
Recevez l'essentiel de l'actualité et restez à jour avec nos newsletters
- France 3 régions (nouvelle fenêtre) France 3 régions
- Outremer la 1ère (nouvelle fenêtre) Outremer la 1ère
- france TV france TV
- radio france radio france
- Newsletters (nouvelle fenêtre) Newsletters
- Météo (nouvelle fenêtre) Météo
- Jeux (nouvelle fenêtre) Jeux
- Transparence
- Nous contacter
- Chargement...
- Chanson française
- Eurovision 2023
- Fête de la musique 2024
- Johnny Hallyday
- Michael Jackson
- Rock en Seine 2024
- Vieilles Charrues
- Les Eurockéennes
- Lollapalooza
- Jazz à Vienne
- Festival Interceltique de Lorient
- Le Printemps de Bourges 2022
- Main Square festival 2018
- Les Francofolies
- Festivals d'été
- Sorties de films
- Documentaires
- Films d'animation
- Films pour enfants
- Festival de Cannes 2023
- Festival de Deauville
- Festival d'Annecy
- Festival de Berlin
- Oscars 2024
- Golden Globes
- Meilleurs films
- Gérard Depardieu
- Mort de Jean-Paul Belmondo
- Alain Delon
- Catherine Deneuve
- Fabrice Luchini
- Brigitte Bardot
- Clint Eastwood
- Catherine Frot
- Angelina Jolie
- Jean-Louis Trintignant
- Agnès Varda
- Emmy Awards
- "Game of Thrones"
- Art contemporain
- Photographie
- Architecture
- Meilleures expositions
- Musée du Louvre
- Grand Palais
- Musée d'Orsay
- Centre Pompidou
- Fondation Louis Vuitton
- Pablo Picasso
- Comédies musicales
- Les Molières
- Comédie-Française
- Opéra Garnier
- Livres pour enfants
- Essais/Histoire
- Beaux livres
- Meilleurs livres
- Festival du livre de Paris 2024
- La rentrée littéraire
- Prix littéraires
- Harry Potter
- Houellebecq
- Patrick Modiano
- J. M. G. Le Clezio
- Pierre Lemaitre
- Joël Dicker
- Guillaume Musso
- Michel Bussi
- Elena Ferrante
- J. K. Rowling
- Stephen King
- Christine Angot
- Franco-belge
- Romans graphiques
- Festival de BD d'Angoulême
- Riad Sattouf
- Jacques Tardi
- Street wear
- Fashion Week
- Haute couture
- Yves Saint Laurent
- Mort de Karl Lagerfeld
- Jean Paul Gaultier
- Christian Dior
- Musée des arts décoratifs
- Archéologie
- Journées du patrimoine
- Loto du patrimoine
- Francophonie
- Chateau de Versailles
- Cuisine et Gastronomie
- France 2 (nouvelle fenêtre) France 2
- France 3 (nouvelle fenêtre) France 3
- France 4 (nouvelle fenêtre) France 4
- France 5 (nouvelle fenêtre) France 5
- Lumni (nouvelle fenêtre) Lumni
- Okoo (nouvelle fenêtre) Okoo
- France tv & vous (nouvelle fenêtre) France tv & vous
- France tv le club (nouvelle fenêtre) France tv le club
- France tv lab (nouvelle fenêtre) France tv lab
- Les Médiateurs (nouvelle fenêtre) Les Médiateurs
- France Inter (nouvelle fenêtre) France Inter
- France Bleu (nouvelle fenêtre) France Bleu
- France Culture (nouvelle fenêtre) France Culture
- France Musique (nouvelle fenêtre) France Musique
- Fip (nouvelle fenêtre) Fip
- Mouv' (nouvelle fenêtre) Mouv'
- Maison de la Radio et de la Musique (nouvelle fenêtre) Maison de la Radio et de la Musique
- La Médiatrice (nouvelle fenêtre) La Médiatrice
"Le bal des folles", un premier roman fort de ses personnages signé Victoria Mas
La primo-romancière signe un roman riche et inspiré sur les internées de la Pitié Salpêtrière, symbole de l'oppression des femmes au XIXe siècle.
Le bal des folles (Albin Michel) est le premier roman de Victoria Mas, auteure de cinéma et fille de la chanteuse Jeanne Mas. Un belle première fois pour la romancière qui a été couronnée du prix Première plume, du prix Stanislas et figure dans la première sélection du prix Renaudot .
L'histoire s'ouvre à Paris, en mars 1885. Louise est ce qu'on appelle une "aliénée". Elle est internée depuis trois ans à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, dans le treizième arrondissement de Paris. La jeune fille souffre de "crises d'hystérie" après avoir été victime d'un viol. Elle est l'une des patientes favorites du professeur Charcot, célèbre neurologue et chef du " service des hystériques ".
Les folles en spectacle
Toutes les semaines, le médecin opère sur la jeune fille de spectaculaires séances d'hypnose pour animer ses cours publics qui " volaient la vedette aux pièces de boulevard" . En parallèle, un grand événement agite les couloirs de l'hôpital : le bal de la mi-carême, surnommé le "bal des folles", se prépare. Le tout Paris y vient pour voir valser ces "folles" craintes et fantasmées, déguisées pour l'occasion. Les internées attendent avec impatience cette soirée de gloire : " la perspective de ce bal costumé tranquillise le corps et apaise les visages. Il y a enfin quelque chose à espérer ".
Alors que Louise se prépare pour la fête, Eugénie Cléry, jeune fille de bonne famille rêvant d'émancipation, tente de cacher à sa famille un lourd secret : elle peut communiquer avec les morts. Un don qu'elle tait pour une raison simple : en parler lui vaudrait un aller simple pour la Pitié Salpêtrière où elle serait internée pour hérésie. Le roman débute avec ces deux histoires parallèles qui vont finir par s'entremêler.
Des héroïnes fortes
Ce sont les personnages, Eugénie, Louise, puis Madame Geneviève, intendante de la Salpêtrière et idolâtre des médecins, qui habitent ce roman avec force. Attachantes, ces patientes de la Salpêtrière incarnent l'oppression quotidienne dont sont victimes les femmes de l'époque, celles qui osent un mot trop haut sont taxées d'hystérie. " Entre l'asile et la prison, on mettait à la Salpêtrière ce que Paris ne savait pas gérer : les malades et les femmes ". Le narrateur est externe mais suit à tour de rôle ces personnages animés pour certains de convictions, pour d'autres de doutes. L'intrigue tendue, dominée par le parcours d'Eugénie, happe le lecteur jusqu'à l'attendu "bal des folles" où tout se dénoue.
L'hôpital est érigé en symbole. Ancienne prison pour les "filles de joie", il constitue un enfer pour les "normales", car " chargé de fantômes, de hurlements et de corps meurtris ". C'est aussi un lieu d'asile pour les marginales n'ayant plus leur place dehors. La plume de Victoria Mas habille richement le texte en couleurs, textures et sentiments. Le contexte historique est savamment contenu pour ne pas envahir le récit. Victoria Mas l'utilise seulement comme un décor au service de son imagination. Avec un scénario bien ficelé, l'auteure signe un beau premier roman, qui nous fait frémir au rythme des mésaventures des personnages.

"Geneviève sent Louise nerveuse. L'adolescente marche tête baissée, les bras tendus le long du corps, le souffle rapide. Les filles du service sont toujours anxieuses de rencontrer Charcot en personne – d'autant plus lorsqu'elles sont désignées pour participer à une séance. C'est une responsabilité qui les dépasse, une mise en lumière qui les trouble, un intérêt si peu familier pour ces femmes que la vie n'a jamais mises en avant qu'elles en perdent presque pied – à nouveau."
Partager : l'article sur les réseaux sociaux
La Quotidienne Culture
Musique, cinéma, arts & expos, littérature & BD, mode… Tous les jours, le meilleur de l’actualité culturelle
Découvrez nos newsletters
les mots-clés associés à cet article
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.
Toute l’actu en direct et en continu, où et quand vous voulez.
- Sauvegardez vos articles à lire plus tard
- Recevez les alertes uniquement sur ce qui vous intéresse
Tout France Info, et bien plus. Sauvegardez vos articles à lire plus tard et filtrer l’actualité qui vous intéresse
Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne. En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Français FR
Ressources numériques en sciences humaines et sociales
Nos plateformes
Bibliothèques
Suivez-nous
Redirection vers OpenEdition Search.
- Presses universitaires de Franche-Comté... ›
- Annales littéraires ›
- Genèse des seuils ›
- Première partie. Genèse des paratextes ... ›
- Intitulation et intertitrage ou donner ...
- Presses universitaires de Franche-Comté...
Genèse des seuils
Ce livre est recensé par
- Josefa Terribilini, Genesis , mis en ligne le 7 janvier 2020. URL : https://journals.openedition.org/genesis/4352 ; DOI : https://doi.org/10.4000/genesis.4352
Intitulation et intertitrage ou donner vie à l’informe : Le Bal des folles de Copi
Plan détaillé, texte intégral.
1 Le Bal des folles (1977) de l’écrivain argentin Copi – célèbre auteur de La Femme assise et dramaturge – est un roman délirant, une autofiction excessive qui s’ouvre par un des incipits les plus originaux de la littérature argentine contemporaine :
C’est la troisième fois depuis un an que je commence à écrire ce roman dont le sujet ne doit pas m’intéresser tellement, quand j’arrive au bout d’un cahier (j’écris sntintqr à la pointe Bic dans des cahiers à spirale), je les perds le jour même. 1
2 Cette entame est l’annonce d’une écriture tortueuse et pulsionnelle, où Copi n’a de cesse de perdre ses manuscrits et d’oublier la trame de son récit. Follement amoureux de Pietro, un jeune Romain, il s’embarquera dans une aventure aux mille rebondissements structurée autour de sa rivalité avec une femme, Marylin, qui veut lui prendre son amant. Le roman est d’autant plus important dans l’œuvre de l’Argentin qu’il est incontestablement celui où va se forger la forme romanesque de Copi ; des romans déjantés, au rythme effréné et aux renversements de situations incroyables, où les morts violentes sont de mise, sans compter les scènes gore, d’une sexualité sans tabou ni limites.
3 Le dossier génétique du Bal des folles , conservé à l’IMEC, est constitué du seul et unique brouillon de l’œuvre, écrit sur huit cahiers grand format. On y découvre une écriture laborieuse qui cherche à faire avancer le roman, construite sur la dynamique de la perte de ses cahiers et de l’oubli du fil de l’histoire. Nous avons également en marge de cette écriture éminemment informe sept feuillets qui représentent différentes campagnes d’intitulation et d’intertitrage. Ces pages se prêtent à la lecture et au regard tant leur mise en page est signifiante d’autant plus qu’elles sont écrites par un dessinateur. Elles semblent agglomérer des énoncés étriqués, dans un désordre signifiant que nous devons essayer de lire car des réseaux se dressent involontairement, formant des figures, qui nous laissent de prime abord une certitude, à savoir à quel point titrer est un exercice complexe capable de donner forme à un texte.
L e bal des titres
4 Les différentes campagnes de titrage se trouvent dans les cahiers un et trois. Pourtant ils sont chronologiquement inversés. Copi commence à rechercher un titre pour son œuvre dans le troisième cahier et achève celle-ci, après de successives mises au propre, dans le premier cahier. Nous avons numéroté les feuillets en ordre chronologique :
Recto première page du cahier #3
Deuxième de couverture du cahier #3
Troisième de couverture du cahier #3
Deuxième de couverture cahier #1
Feuille volante cahier #1
Recto première page cahier #1
Troisième de couverture cahier #1
5 L’essentiel de la recherche du titre se fait dans le cahier #3 puis dans le #1 avec trois mises au propre de la table des matières, ce qui n’empêchera pas l’auteur de faire des galops d’essai pour mettre à l’épreuve son titre dans des feuillets isolés. C’est à l’intérieur du cahier #3 que la campagne d’intitulation démarre avec une particularité : l’auteur est à la recherche d’un titre pour son œuvre mais se lance également dans l’organisation du contenu de son roman alors que visiblement il est dans la phase rédactionnelle. Cette double campagne est intéressante à plusieurs égards. Elle montre les différentes étapes pour essayer d’arrêter un titre pour l’ensemble de l’œuvre mais encore la recherche d’une architecture pour sa matière romanesque. Dès lors, donner un titre et donner forme au roman, lui apporter une architecture visible qui va évoluer jusqu’au nombre de chapitres définitifs, vont de pair. Cette double mise en chantier implique une double logique que nous verrons évoluer au fil des brouillons. Aussi l’auteur ne dissociera pas, contrairement à nous, ces deux recherches. Dans un premier temps nous allons analyser la recherche du titre de l’œuvre, incontestablement le seuil d’un roman, pour nous arrêter ensuite dans la recherche de structuration et de chapitrage de la matière romanesque.
6 Le [1] est un feuillet d’une rare expressivité qui mérite une lecture attentive d’autant plus qu’elle est représentative de la pratique d’intitulation de Copi. Quand bien même elle montre à quel point la déclinaison et l’expansion de différents énoncés constellés dans la page font sens, dans le rapport que chaque élément garde avec le tout, une analyse des syntagmes n’est cependant pas inutile. Noyau polysémique s’il en est [l’expression est de Duchet], la recherche d’un titre est ici une instance dramatique, d’autant plus lorsqu’elle pose comme tableau central une pietà , autour de laquelle vont graviter une centaine d’énoncés, à la recherche d’un « équilibre entre le vouloir-dire de l’écrivain et les lois du marché » 2 .
7 Soixante et un énoncés émaillent ce premier feuillet et occupent l’espace de la page autour de cette pietà , se posant tous comme des titres potentiels. La variété est de prime abord frappante. Les titres reprennent des noms de personnages (cinq fois parmi lesquelles deux Pierre et une Pietro), des titres dans d’autres langues, en anglais par exemple (« Thank you America ! ») et en italien (« Pietro, l’umbilico ») mais jamais en espagnol, une série de substantifs (« Le Nombril », « La Jalousie », « La Calomnie », « Le Prématuré », « Les Hormones », « La Société », …), ou encore un titre à conjonction adversative « Marielle de Lesseps ou la folie des grandeurs ». Nous remarquons également deux répétitions comme « Le Nombril » ou l’« Histoire de quatre villes », sans pour autant qu’elle soient barrées. Les énoncés reprennent souvent des sujets ou des scènes du roman et tournent autour de quelques répétitions : « bal » et « nombril » (quatre fois), l’adjectif « dernier » (quatre fois) mais surtout, et à douze reprises, le mot « folle ».
8 Avec Leo H. Hoek, nous voulons inscrire également l’analyse du titre du roman dans une double logique syntaxique et sémantique. Au niveau syntaxique, et cela est valable pour les cent vingt-cinq titres alternatifs qui composent le dossier génétique, Copi hésite pour le titre entre le substantif et le substantif et son déterminant, mais ne sort jamais du syntagme nominal. La structure qui prime est plus précisément celle de substantif et son complément de nom prépositionnel. Si nous observons les variantes qui utilisent le substantif « folle », retenu pour le titre, Copi part du plus court, « La Folle », hésitant avec le pluriel « Les Folles ». L’enjeu est de taille car au singulier la question de l’identité de cette folle se pose alors, à savoir s’il s’agit de Pierre ou de Copi, et au pluriel elle fait visiblement référence à une communauté. Si nous observons de plus près – sur l’ensemble du dossier – les déclinaisons qui se font du substantif, genettien s’il en est, nous constatons que parmi les trente-deux coïncidences le singulier revient dix-huit fois 3 , c’est-à-dire plus souvent que le pluriel qui sera pourtant retenu. Sur les trente-deux variantes, seize reprennent le terme « folle » dans le complément de nom prépositionnel, dix utilisent la structure « folle » et adjectif, et trois « folle » avec déterminant ; ce qui traduit une hésitation à mettre « les folles » au premier plan ou non. D’autre part, nous lisons seulement douze apparitions du substantif « bal ». Ce qui est également frappant c’est que neuf d’entre elles sont précédées de l’adjectif « dernier » qui ne sera pas finalement retenu. En somme, la syntaxe du titre la plus fréquente est construite autour d’un nom. Le titre nominal 4 , qui présente une allitération en « l », est composé du déterminant « le » et du complément prépositionnel ou adnominal « des folles » : le bal est ici limité aux folles ; singulier et pluriel s’opposent.
9 Cette première page de titres mérite plusieurs commentaires. Parmi toutes ces alternatives nous retrouvons des scènes, des ambiances ou des sujets, en rapport avec le roman sauf exception, comme avec le substantif « hyperréaliste » qui revient à plusieurs reprises. Le terme reflète sans doute une auto-construction sur la teneur de l’œuvre réalisée par l’auteur et inscrit le récit non plus dans le thématique comme il le fait avec les autres énoncés mais dans le rhématique 5 comme dirait Genette – aux côtés des titres alternatifs comme « La Chronologie des folles », « Histoire des trois/quatre villes », « Le Roman d’une folle ». La projection du terme « hyperréaliste » donne une dimension à l’œuvre que n’ont pas les autres titres, mais affirme surtout la représentation que Copi pouvait avoir de sa propre fiction. La tournure veut signaler sans doute la présence dans la fiction des scènes crues, des descriptions détaillées de rapports sexuels homo-sado-masochistes et bien sûr la présence de drogues. Une influence indirecte de la Beat Generation , alors que nous savons que l’écriture du roman est initiée aux États Unis en 1976 lors de la tournée de Copi avec Loretta Strong pour le bicentenaire des festivités de l’Indépendance, n’est pas à exclure ; une autre plus directe pourrait être celle des peintres hyperréalistes nord-américains, en vogue ces années-là, comme Chuck Close ou Richard Estes. L’influence de Jean Genet, qui avait déjà publié son Journal du voleur , ayant inspiré de fait Bukowski et Kerouac, n’est pas impossible non plus.
10 Si cette page de titres offre l’image de scènes qui se connectent toutes à cette pietà , conçue à ce stade comme le climax du roman, il faut dire qu’elle reflète à la perfection le sentiment de lecture du Bal , roman effréné. Aussi, elle n’est pas la seule dans le fonds Copi. Nous trouvons notamment des campagnes aussi intenses pour deux de ses pièces de théâtre écrites en espagnol rioplatéen, La sombra de Wenceslao et Cachafaz , mais encore pour sa célèbre pièce Le Frigo , avec plus de neuf pages de titres et cent trente variantes. Plus que la déclinaison du titre qui semble proliférer à l’infini par des différences minimes, ce qui est surprenant c’est que Copi ne biffe que très rarement. Pour rechercher un titre, il semble ainsi disposer de trois procédés. Le premier consiste à utiliser des majuscules là où l’énoncé pourrait se poser comme une bonne option de titre, contrairement aux minuscules qui semblent avancer des tentatives ou des modifications. Le deuxième consiste à souligner ou à encadrer pour mettre en relief tel titre ou tel autre. Le troisième, qui n’est pas incompatible avec les précédents, consiste à investir un espace vierge de la feuille. La recherche d’un titre chez Copi ne fonctionne donc pas par refoulement des variantes et des titres alternatifs mais par accumulation. C’est ce qui se dégage de la première page de titres du Bal des folles . Il n’y a ici que de très rares titres biffés, pas de surcharges, mais des majuscules et des encadrements jusqu’à saturation de la page.
11 Dans ce premier feuillet, réseau de signifiants intriqué, des tensions se dégagent pourtant car les titres semblent se bigarrer vers les bords de la feuille. Cette saturation ne cède pourtant pas à une élimination de titres mais déborde tout simplement sur la feuille contiguë [2], la deuxième de couverture. Là, « La dernière boîte où l’on danse » est posé comme point de départ et biffé, alors qu’il avait été entouré et même souligné. La recherche du titre se poursuit ici pour soulager la feuille de droite et pour poser pour la première fois celui qui sera le titre définitif du roman, en majuscules et entouré : « Le Bal des folles ». Nous pourrions penser qu’il s’agit là d’une mise au propre, mais entre [1] et [2] il n’y a qu’un seul titre qui soit repris, « La Misogynie », alors qu’un autre est une variante linguistique « Grazie America ». Aussi, le même procédé semble être mis en route, celui de marquer un énoncé au centre, puis de commencer à combler le blanc de la feuille.
12 Nous retrouvons ici vingt-deux nouvelles alternatives au titre du roman bien que l’intérêt soit ailleurs car au milieu du feuillet se produit une cassure. Si la page prolonge la recherche d’un titre pour l’œuvre, à la manière de Copi – c’est-à-dire en constellant des idées et à force de répétitions avec de légères variantes – celle-ci progresse le long de la page puis cède et ouvre un espace à une deuxième recherche. Dans la partie inférieure de la page nous avons une énumération d’épisodes disposés en colonne avec des corrections en marge qui forment une deuxième colonne encore plus intéressante. À partir d’ici la recherche de Copi va donc être double, continuer à soumettre des titres possibles pour le roman, lister différents épisodes qui jalonnent le récit et qui deviendront des chapitres afin d’attribuer une structure à son roman. Nous y reviendrons.
13 Nous lisons donc de nouveaux titres alternatifs qui explorent les mêmes substantifs (« bal », « hyperréalistes », « America », « nombril »…), ont encore recours à d’autres langues et affichent l’écriture d’un roman (« Le Roman d’une rêveuse »). Les titres de cette deuxième de couverture [Ill. 2] gardent par ailleurs les mêmes structures substantivées que le feuillet précédent à quelques détails près. Nous lisons cependant ce titre quelque peu mystérieux, peut-être métaphorique, de « La Pomme verte » dont il n’est fait aucune mention dans le roman. Puis, deux annotations qui ressemblent fortement à des notes de régie attirent particulièrement notre attention. L’une d’entre elles apparaît en haut à gauche, en majuscules et entourée : « Pas un mot d’Argentine ». La notation semble assez énigmatique, car nous pouvons aussi bien penser qu’elle fonctionne comme un constat sur le roman en phase de rédaction que comme une sorte de consigne dans un roman qui fait à peine une référence au tango et une au cinéma argentin, il est vrai peu glorieuse (« C’est la saison morte, il n’y a dans la ville qu’un seul cinéma d’ouvert où on passe des films argentins absolument stupides », p. 63). Aussi, moins importante mais tout aussi intrigante nous lisons, « Tous ces personnages ensemble ». Là encore, il ne s’agit pas d’un titre ou d’une option au titre de l’œuvre, mais bien d’une annotation, d’une idée pour le titre alors que comme nous le savons, c’est « Le Bal des folles » qui sera retenu et qui suit « à la lettre » cette indication. Un dernier commentaire s’impose car dans cette feuille, et toujours dans cet espace suprapaginal, nous retrouvons la dédicace à Marielle de Lesseps, qui ne variera pas dans les mises au propre de la table des matières et qui est, rappelons-le, un des personnages du roman et une amie de Copi.

14 À partir de cette double page du cahier numéro trois, la recherche de Copi va donc suivre un double parcours, continuer à peaufiner le titre du roman et mettre en chantier un chapitrage. Nous allons nous limiter à observer les hésitations concernant le titre dans les trois mises au propre du plan de l’œuvre présentes dans le dossier génétique. Signalons toutefois que dans les huit cahiers qui constituent le seul manuscrit du roman – le brouillon étant le manuscrit final, il n’y a pas de mise au net – nous ne trouvons aucun galop d’essai à la dérobée, aucune réécriture d’une phrase, en somme aucune recherche d’un style ; par contre, pour la recherche d’un titre nous trouvons en marge du corps d’analyse que nous avons élaboré trois essais. L’utilisation du verso d’une feuille, d’un contre-plat, d’un espace vierge est le lieu idéal pour mettre le titre au banc d’essai 6 . Dans la première mise au propre du plan, la recherche d’un titre se poursuit sans pour autant que « Le Dernier Bal des folles » soit posé comme titre de départ. Les options s’éloignent même ici du titre final. Ce n’est que dans la deuxième mise au propre que « bal » et « folles » vont se poser comme substantifs du titre définitif malgré les hésitations persistantes. Copi commence plus précisément par « Le Dernier Bal des folles », idée qui mélange une certaine mélancolie et qu’il reprend dans un des titres de ses bédés « Le Dernier Salon où l’on cause » (1973), et qui revient à douze reprises dans les brouillons.
15 Bien que « Le Bal des folles » soit, dans cette dernière mise au propre, posé comme point de départ et écrit en majuscules, le titre subit une nouvelle fois des modifications. Ces hésitations qui accompagnent le choix d’un titre jusqu’à la fin traduisent la difficulté de la tâche, d’autant qu’à aucun moment le titre de l’œuvre n’est posé d’avance, ne serait-ce que comme working title. Non seulement le titre subira des modifications mais, chose rare comme nous l’avons vu jusqu’à présent, Copi se met à biffer les titres inutiles. Les titres contenant le substantif « folle » sont barrés au bénéfice de ceux faisant référence au « serpent ». Le premier changement biffe le « bal » au bénéfice de « territoire », référence spatiale qui ghettoïse et connote une passivité. Mais ce qui fait plus radicalement basculer le titre est l’apparition de ce « serpent » qui rappelle à tous égards Marylin, ennemie jurée, fille à pédales, tortionnaire de folles, rivale, bien que finalement épouse de Copi, dont le serpent mord l’auteur à New-York. Par ailleurs, à la fin de la table des matières qui est loin d’être arrêtée et qui, de manière plutôt confuse, déborde sur une autre feuille, l’auteur continue de proposer trois nouveaux titres, marquant un retour du substantif « folle » : « La Vieille Folle », « La Folle hétérosexuelle » et « Le Treap des folles ». Nous y retrouvons également cette mystérieuse note de régie présente lors de la mise en chantier de la structuration du roman dans le troisième cahier [Ill. 2] : « Pas un mot d’Argentine ». Nous lisons également deux notes d’édition, des plus saugrenues il est vrai, de Copi. La première indique « Pierre y Pietro toujours en majuscules » ; la deuxième, en espagnol, unique fois que Copi utilise cette langue dans tout le manuscrit, que le mot « treap » doit toujours être écrit en gras. Si le mot n’apparaît qu’à quatre reprises dans le roman, l’indication à l’éditeur est assez originale, d’autant plus que « treap » est mal écrit.
16 Les deux titres qui apparaissent dans l’en-tête de ce feuillet manuscrit en majuscules, « Le Bal des folles » et « Le Territoire du serpent », sont confrontés en marge, au propre, dans le recto de la première feuille du cahier numéro sept, sans qu’aucun soit barré ou éliminé. Fort visiblement il s’agirait là de deux titres les plus intéressants pour Copi. Cependant le dilemme semble départagé sur la couverture de ce même cahier, où nous lisons en majuscules : Le Bal des folles 7 .
17 La nécessaire analyse du titre au niveau sémantique est riche en lectures, car s’il évoque un événement dynamique, il construit une ambiguïté. Le Bal des folles ouvre un horizon d’attente qui n’est rempli qu’à moitié. Avant la lecture du roman, de manière isolée, le substantif « bal » est aussi bien connoté positivement par son aspect festif si on le lit comme une danse, que négativement lorsqu’on l’entend dans son acception argotique dans le sens de « donner le bal à quelqu’un » pour dire « le maltraiter » ou « le frapper ». De même, le nom « folle » porte un double sens, opposant la connotation sociale et clinique à l’argotique qui désigne un homosexuel très efféminé ou un travesti au comportement tapageur ; terme en 1977 très répandu, non seulement par Jean Genet mais surtout par le succès sans frontières de la célèbre pièce de théâtre (Jean Poiret, 1973), puis du film, de Molinaro, La Cage aux folles . Le lecteur peut passer donc d’une « danse de femmes folles » à la « rossée de travestis ». Mais le titre n’est pas autonome, et la relation qu’il établit avec le co-texte, c’est à dire le roman, est cruciale. Il suffit de lire le roman pour comprendre que le thème central est bien le milieu des folles et que la violence qui y règne fait bien sûr du Bal , aussi, un roman politique. Si nous reprenons la logique de Duchet selon laquelle « le titre fonctionne comme embrayeur et modulateur de lecture » 8 , le choix du Bal des folles semble bien être le plus dynamique et le plus éloquent sans pour autant choquer le lecteur.
18 Il nous reste une lecture pour essayer de cerner le titre, cette fois en rapport aux autres titres de Copi. Jusque-là Copi a déjà publié avec des titres assez provocateurs faisant référence à la sexualité comme dans sa pièce L’Homosexuel ou sa difficulté à s’exprimer , titre emblématique, ou dans sa bande-dessinée, Et moi pourquoi j’ai pas une banane. Plus tard il publiera un roman sous le titre La Guerre des pédés qui fera encore une référence, certes plus directe, à l’homosexualité. Aux côtés de ces titres plus explicites mais aussi plus politisés, nous voudrions revendiquer d’autres titres, plus poétiques, comme celui du roman qui nous occupe mais encore La Vie est un tango , ou La journée d’une rêveuse.
L’ intertitrage face à l ’ informe
19 Les travaux de Claude Duchet, dans une optique sémantique et communicationnelle, ou ceux de Leo Hoek, dans son approche sémiotique du titre, sont incontournables à l’heure de penser l’instance du titre. Malheureusement ni l’un ni l’autre n’orientent leur étude vers l’analyse systématique des intertitres des œuvres. Gérard Genette, bien qu’il se limite à transposer son étude sur le titre aux sous-titres, offre cependant une réflexion intéressante lorsqu’il affirme qu’historiquement l’intertitre est essentiellement descriptif 9 . Il est vrai que l’intertitre, contrairement au titre, pourrait paraître superflu. Dans [Ill. 2] nous voyons la recherche de Copi se dédoubler, prolonger celle du titre mais encore lister par ordre d’apparition différentes scènes du roman. Cette recherche, longue et tortueuse, aboutit au chapitrage définitif du Bal et n’a d’autre but que celui de structurer un roman à l’incipit laborieux, à l’écriture hésitante et à l’explicit non moins difficile. En somme, chapitrer se traduit ici par donner une forme à une écriture éminemment pulsionnelle et sans projet d’écriture qui plus est pour le premier roman de Copi.
20 Pourtant, l’élaboration d’une table des matières n’est pas le seul geste de l’auteur en quête d’une structure pour sa matière romanesque. C’est ce que dénote ce brouillon de bi-partition dans le recto de la première feuille du cahier #6, dont voici la transcription diplomatique :
LE DERNIER BAL DES FOLLES 1 ère partie LA PIETÀ DE MICHEL-ANGE 2 ème Partie LE DERNIER <LE> BAL DES HIPPIES LA DEUXIÈME LA PIÉTÀ INCONCLUSE
21 Cette bi-partition semble montrer clairement que le chapitrage de Copi pourrait être accompagné d’une partition du roman ou qu’il projetterait tout simplement de structurer le récit en deux parties. Cette division de l’œuvre nous laisse à penser, en tenant compte du titre, apposé en majuscules, qu’elle a été posée une fois le titre pratiquement arrêté. Ce qui est impossible à déterminer c’est de savoir si cette bi-, peut-être même tri-partition annule le chapitrage en cours. Dans la mise au propre définitive, [5] et [6], par contre, alors que le chapitrage est pratiquement bouclé, Copi projette nouvellement des parties à l’aide de grands crochets regroupant des chapitres :
Première partie L es m é mo i res Deuxième partie L es r ê ves Troisième partie L a d ern iè re par ti e Ell e L a r é a lité
22 Cette tripartition, qui montre des titres ultérieurement biffés, est ensuite abandonnée. Elle cherche visiblement un équilibre en trois parties à cinq chapitres ; ce qui explique peut-être une numérotation de son roman en quinze chapitres qui vient bouleverser le chapitrage en cours. Avec ces deux tentatives de subdivision du roman en parties nous savons donc que la recherche d’une forme n’est pas exclusive au chapitrage. Mais revenons au feuillet [Ill. 2], au moment où Copi aligne dans une colonne les épisodes de son roman et pose le germe du chapitrage dont voici la transcription diplomatique :
23 Nous lisons dans la deuxième colonne, apposée à cette première mouture, des corrections qui marquent un tournant biographique étonnant autour de la figure d’auteur. Ici, contrairement à sa manière de procéder avec les titres, Copi barre et corrige sur un même plan. Cette deuxième liste est recopiée dans le même cahier, en troisième de couverture [3], pour être à son tour modifiée :
24 Dans cette mise au propre, Copi part de cette idée d’inter-titrage autour de l’auteur et du lecteur, en en faisant un axe de construction du roman. Le romanesque pour Copi – avec un clin d’œil évident à sa nouvelle L’Uruguayen (1973) où il établit un curieux contrat avec le lecteur invité à barrer le texte au fur et à mesure qu’il le lit – semble être construit sur la relation directe avec le lecteur, qui équivaut ici à un spectateur. Il est important de signaler que jusque-là les chapitres ne sont pas numérotés. Copi en est encore entre l’ordination d’épisodes et un véritable titrage qui donnera une structure satisfaisante au roman.
25 Si nous reproduisons la séquence des premiers chapitres du Bal , nous passons donc de deux épisodes « Le Travello romain de Rome » et « La Fille à pédales de Paris » [2], à trois « L’Auteur se présente », « L’Auteur parle au lecteur » et « L’Auteur présente sa rivale » [2’], puis à quatre en rajoutant « Quelques mots au lecteur Pietro Gentiluomo » [3]. « Auteur » et « lecteur » disparaissent, au bénéfice du « roman » qui apparaît comme forme autonome dans cet intertitre provisoire « Le Roman se présente ». Rappelons que finalement l’ouverture occupe deux chapitres : « Pietro Gentiluomo » et « Confession ». Le découpage même de la longue ouverture du roman est hésitant.
26 La mise au propre suivante est élaborée sur la deuxième de couverture du premier cahier [4], où l’auteur copie au net la table de son roman. Ici pour la première fois les chapitres vont être numérotés mais seulement onze d’entre eux trouvent leur place et leur énoncé, alors que la fin du roman semble être confuse. Un douzième chapitre est inscrit et barré visiblement autour de cette scène de pietà tant annoncée. C’est dans une nouvelle feuille volante [5] que nous trouvons la troisième et dernière mise au propre. Cette table des matières définitive est numérotée et déborde sur la première page du cahier [6]. La séquence d’élaboration de la table des chapitres est la suivante : énumération d’une suite d’épisodes [2], tournant méta-narratif [3], organisation et numérotation des chapitres [4], inter-titrage définitif [5-6]. Dans ce dernier état textuel, la table des matières, hormis deux chapitres, est celle que nous retrouvons dans l’édition princeps.
27 Alors que nous voyons dans ces pages comment s’effectue la recherche des intertitres, une question essentielle se pose, à savoir : à quel moment Copi réalise-t-il la segmentation de son récit : une fois le brouillon achevé ? Ou au contraire pose-t-il cette partition comme une trame pour écrire ensuite les chapitres ? Tout d’abord, concernant le titre, tout porte à penser que l’auteur se lance dans sa recherche une fois lancée l’écriture du roman, plus précisément lorsqu’il est en train de rédiger le troisième chapitre. Copi écrit sans projet de roman, sans une trame préétablie, le découpage en chapitres se faisant en cours de route. La présence d’épisodes dans la première mouture [2], notamment « Le Guérrillero d’Uruguay » et « La Lettre de ma mère », dont il n’est jamais question dans le Bal , vont dans ce sens. De fait, nous pensons même que les coupures entre chapitres sont pratiquées une fois le roman achevé car nous trouvons plusieurs d’entre elles effectuées dans le manuscrit même. Si parfois un début de cahier correspond à un nouveau chapitre, c’est parfois le début d’une feuille qui opère la coupure, pour les chapitres 3 et 11, par exemple, mais nous voyons également qu’un simple trait de séparation vient segmenter la narration en plein milieu de la ligne. La coupure peut être frustrée comme lorsque nous lisons dans l’espace suprapaginal un titre provisoire dans le cahier #3 : « 4 l’auteur se confesse », dont nous ne trouvons aucune trace dans les tables d’intertitrages et qui ne formera donc pas un chapitre. Parfois même les coupures imposées au manuscrit par Copi ne marquent que de simples alinéas comme nous les retrouvons dans le chapitre 5, 6, 7 et 11 du Bal , réalisées avec des lignes en forme de bulles pour marquer un flashback ou un changement de plan narratif, parfois brusques. Parmi ces segmentations nous retrouvons même une note d’édition qui ne sera pas respectée dans l’édition princeps qui propose « 2 pages plus tard » pour signifier fort visiblement un saut temporel 10 .
28 Pour revenir à la forme du roman, plus que la difficulté à asseoir sa trame, ce sont ici les différentes tentatives de Copi pour structurer son récit qui à tous égards tend à l’informe qui nous intéresse. Que ce soit par une partition ou par une segmentation, cette recherche vise à donner une forme à son roman. Le geste le plus remarquable reste cette volonté, sous l’influence certaine du théâtre, de donner une tournure méta-narrative à son récit où l’auteur et le lecteur seraient les personnages principaux du roman.
29 Ces coupures opérées sur le manuscrit traduisent bien que le chapitrage a pour but de charpenter avec des scansions l’ensemble du roman. Il essaie de lui imposer un rythme et de rendre plus intelligible ce récit en proie au délire. Il n’y a donc chez Copi, dans l’écriture du Bal des folles , ni simulation préalable ni exposé de méthodologie, ni maquette ni ébauche, ni esquisse pour mettre en chantier l’écriture 11 . La forme du roman n’est en rien fantasmée avant l’écriture comme structure mais comme une action pure d’écriture autour du « je » dans un exercice « hyperréaliste ». La mise en titre, cet embrayeur et modulateur de lecture, comme dit Duchet 12 , est dans les manuscrits du Bal doublée d’une mise en forme à travers l’élaboration a posteriori d’un échafaudage du roman. Dans ce dossier génétique mieux que dans d’autres nous comprenons aussi bien l’enjeu d’un titre que l’importance d’un chapitrage : deux logiques complexes qui engagent d’un côté des réseaux de sens – parfois contradictoires – mais qui visualisent le magnétisme des énoncés comme la portée d’un titre ou d’un intertitre.
Notes de bas de page
1 Copi [Raúl Damonte Botana], dit, Le Bal des folles [1977], Paris, Christian Bourgois, 1999, p. 10.
2 Claude Duchet, « La Fille abandonnée et La Bête humaine , éléments de titrologie romanesque », Littérature , nº 12, 1973, p. 51.
3 Le Dernier Bal des folles - Au bal des folles - La Folle de l’ours - La Folle - Les Souvenirs d’une folle - Les Folles - Un Treap de folle - La Folle des grandeurs - Le Roman d’une folle - La Chronologie des folles - La Dernière Folle - La Folle d’antan.
4 Leo H. Hoek, La Marque du titre. Dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle , La Haye-Paris-New York, Mouton, 1981, p. 72 et sqq .
5 Gérard Genette, Seuils , op. cit ., p. 98.
6 Dans le verso d’une feuille du cahier numéro 7, nous avons des titres alternatifs pour l’œuvre alors que Copi est en train de rédiger les derniers chapitres du roman : Le dernier bal d’été Au bord de la piscine Le bal ultime Rue de Jappe La Seine La deux chevaux brûle sous la pluie Dans la deuxième de couverture du cahier 8 : La pietà de Michel-Ange [Le territoire du serpent] D u c ôté d u T ampax La rivale. Le serpent court toujours Mais encore dans [7]
7 Un autre exemple de mise à l’épreuve du titre général est lisible dans la troisième de couverture du cahier numéro quatre où nous retrouvons ces trois titres disposés en triangle, tous trois en majuscules : LA MYTHOMANE LE BAL DES FOLLES L’INNOCENCE SUSPECTE La recherche du titre de l’œuvre, si ce dernier est le résultat de ces formulations constellées et serrées dans une feuille, passe également par cette confrontation qui équivaut à une mise à l’épreuve dans une feuille vierge.
8 Claude Duchet, op. cit ., p. 50.
9 Gérard Genette, op. cit. , p. 279 sqq .
10 Nous devons cependant signaler une entorse à ce chapitrage effectué a posteriori car nous lisons dans le manuscrit, tard il est vrai et sans suite, en vedette et en milieu de page : Ch ap it re 7 Ci n é ma, c i n é ma La tentative est frustrée et biffée, et l’écriture se poursuit d’un trait jusqu’à l’explicit ; preuve que si Copi engage après-coup le découpage du roman, il essaie à un moment de structurer dans la rédaction, en vain, la suite de son récit.
11 Roland Barthes, La Préparation du roman I et II , Paris, Seuil, 2003, p. 230.
12 Claude Duchet, op. cit. , p. 52.
Université de Toulouse Jean Jaurès, Ceiiba
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books . Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Discours et événement
L’histoire langagière des concepts
Jacques Guilhaumou

La gauche évolutionniste
Spencer et ses lecteurs en France et en Italie

Michelet, à la recherche de l’identité de la France
De la fusion nationale au conflit des traditions
Aurélien Aramini

La notion de “formule” en analyse du discours
Cadre théorique et méthodologique
Alice Krieg

Paul Claudel
Partage de Midi . Autobiographie et histoire
Anne Ubersfeld

La femme et son image dans l’œuvre de Victor Segalen
Laurence Cachot

Littérature et médecine
Marie Miguet-Ollagnie et Philippe Baron (dir.)

Mythe et littérature
Jacques Houriez (dir.)

Claudel metteur en scène
La frontière entre les deux mondes
Yehuda Moraly

Fantastique et événement
Étude comparée des œuvres de Jules Verne et Howard P. Lovercraft
Florent Montaclair

L’inspiration scripturaire dans le théâtre et la poésie de Paul Claudel
Les œuvres de la maturité
Jacques Houriez

Aspects de la critique
Ian Pickup et Philippe Baron (dir.)

Accès ouvert freemium
PDF du chapitre
Édition imprimée
Merci, nous transmettrons rapidement votre demande à votre bibliothèque.
Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books . Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.
Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.
La syntaxe de l’email est incorrecte.
Le captcha ne correspond pas au texte.
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Référence numérique du livre
Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser .
Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.
- We're Hiring!
- Help Center

Recension "Victoria Mas, Le bal des folles, Paris, Albin Michel, 2019."

2021, Psychiatrie, sciences humaines, neurosciences
Related Papers
Céline Eidenbenz
Pulsions. Art et déraison
Laurence Brogniez
Isabelle Perreault
Ph.D. en histoire, Université d'Ottawa, 2009
Stéphane Malysse
Nella Arambasin
Thibaud Trochu
Homosexualité et parenté
Jerome Courduries
Marie-Claude Garneau
Le présent mémoire en recherche-création interroge la question de la génération symbolique féministe et lesbienne au moyen de l'écriture dramatique, à partir d'ouvrages de l'auteure québécoise Jovette Marchessault et de l'écrivaine française Violette Leduc. Il s'agit de développer un discours féministe et lesbien dans un texte dramatique, de démontrer en quoi le théâtre représente un lieu d'historicisation et de mémoire pour la création féministe et d'explorer des procédés intertextuels, notamment l'usage spécifique de la citation (Compagnon, 1979) comme fil conducteur de la génération symbolique. Le premier chapitre pose les bases théoriques de la génération symbolique, concept philosophique développé par Françoise Collin, et approfondit diverses théories de l'intertextualité générale et de l'intertextualité féministe. La mise en relation de l'intertextualité féministe, de la citation et de la génération symbolique sert ensuite de point d'ancrage à l'analyse de trois textes dramatiques de Jovette Marchessault. Le poème dramatique lieu(x) possible(s) figure au deuxième chapitre et constitue le volet création de ce mémoire. Il est construit sous la forme d'un triptyque inspiré de citations tirées des œuvres de Violette Leduc et de Jovette Marchessault et c'est à partir des thèmes du désir, de l'acte d'écriture et de la mémoire féministe que j'aborde la génération symbolique. lieu(x) possible(s) propose trois récits indépendants; d'abord, celui d'une écrivaine en quête de l'héritage féministe de Jovette Marchessault et de Violette Leduc; ensuite, celui de la rencontre entre deux amoureuses, où est approfondie la question politique du désir et des identités lesbiennes; enfin, celui de l'union, dans la troisième partie, de voix féministes de divers horizons au cœur d'une conversation à la fois engagée et intemporelle. Le dernier chapitre retrace d'abord les principales étapes du processus de création, notamment à la lumière des réflexions sur la poïétique de René Passeron (1996). Il présente ensuite une étude des trois sections de lieu(x) possible(s) à partir des catégories d'analyse dramatique de la voix, du récit et des formes du discours (Pruner, 2009; Pavis, 1996; Sarrazac et al, 2010). Cette analyse, combinée à une réflexion féministe sur la représentativité, le rapport à l'histoire féministe ainsi que l'intentionnalité féministe derrière le discours au théâtre (Keyssar, 1996; Plana, 2012; Wittig, 2013), permet de comprendre de quelles façons la génération symbolique de lieu(x) possible(s) s'est construite.
Revue Haitienne de Sante Mentale
Jean-Claude Dutès
Abstract: This article addresses some of the challenges confronting mental health professionals working with Haitians and persons of Haitian descents in the United States of America. The different of barriers to treatment, as well suggestions to address them, are discussed. Key words: barriers, bias, challenges, culture, language. Résumé (Défis et embûches dans l’évaluation et le traitement des immigrants et descendants haïtiens aux États-Unis): Cet article aborde certains défis auxquels les professionnels en santé mentale sont confrontés à l’égard des Haïtiens et des personnes de descendance haïtienne aux États-Unis. Les auteurs discutent des obstacles au traitement et présentent certaines suggestions pour y remédier. Mots clés : obstacles, préjugés, défis, culture, langue
RELATED PAPERS
Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online)
Ana Karla Olimpio Pereira
PLOS Genetics
Giorgio Monti
Richard Glashoff
Fermin Ciaurriz
African Economic History
Enocent Msindo
Journal of dairy science
Mohamed Hassan
1比1仿制英国萨里大学 surrey毕业证学历证书GRE成绩单原版一模一样
Hussein Daood
M. S.-w. Su
The Day After the CoFoE (Act II): The EU Treaty Revision at the Mercy of Enlargement?
Anna Fiorentini
Histórias do design em Minas Gerais II
Gabriella N . F . N . Pinto
Michael Lockwood
Journal of neurology
Melissa Bondy
Frontiers in Marine Science
Barbara John
arXiv (Cornell University)
Sheldon Goldstein
Intan Ismail
Revista Ciência Agrícola
Marta Barbosa
卡尔加里大学毕业证书办理成绩单购买 加拿大文凭办理卡尔加里大学文凭学位证书
RELATED TOPICS
- We're Hiring!
- Help Center
- Find new research papers in:
- Health Sciences
- Earth Sciences
- Cognitive Science
- Mathematics
- Computer Science
- Academia ©2024

Le bal des folles : explication et résumé de la fin du livre
28 novembre 2023
Une plongée dans l’univers du « Bal des folles »
Sur l’étroit chemin qu’emprunte le mélange fascinant de l’histoire et de la fiction, Victoria Mas nous invite à danser au rythme du « Le Bal des folles ». Cette œuvre remarquablement bien documentée jette la lumière sur une époque révolue où les frétillements de la société sont posés sur l’échiquier de la lutte des sexes et de la santé mentale. Avant d’analyser la fin révélatrice, il est nécessaire de se référer au contexte et à l’histoire qui se déroule page après page.
1876, Paris. L’auteur nous emmène dans les salles de l’Hôpital de la Salpêtrière, un dépotoir pour les femmes que la société a jugées folles ou tout simplement dérangeantes. Certaines de ces femmes sont aliénées, tandis que d’autres sont abandonnées par des maris, des frères ou des pères mal à l’aise à cause de leur indépendance et de leur force de caractère.
Femmes oubliées, femmes réduites au silence
Parmi les personnages principaux, on trouve la très pieuse Louise et la séduisante et indépendante Eugénie. Toutes deux sont des patientes, mais leurs maladies sont radicalement différentes. Louise croit qu’elle est la fille de la Sainte Vierge, alors qu’Eugénie communique avec les morts. Puis il y a Geneviève, une infirmière qui a choisi ce chemin par amour pour Théophile, un ambitieux médecin aspirant à la renommée.
Nous voyageons à travers leurs vies jusqu’au « Bal des folles », un événement grotesque et misogyne où le Paris high-life vient regarder ces femmes arborant de somptueux costumes dans une mascarade d’humiliation publique. Ce bal donne son titre au livre et symbolise l’inégalité et l’injustice auxquelles ces femmes sont confrontées.
Le dénouement: un cri de libération
Le dénouement est une clôture à la fois prévisible et surprenante. Après le « Bal des folles », Eugénie est trahie par sa famille. Son père et son frère la renvoient à l’hôpital pour « hérésie » – en d’autres termes, pour sa capacité à comprendre et à refuser l’injustice.
Ceci conduit à l’un des moments les plus émouvants de l’histoire. Au sommet de son désespoir, Eugénie est sauvée par Louise et Geneviève. Ces trois femmes, bien que différentes, sont unies par le système oppressif auquel elles sont soumises, et elles font preuve d’un courage et d’une solidarité redoutables en choisissant de défier leur destin.
L’espoir et l’évasion
La fin de « Le Bal des folles » voit Geneviève orchestrer l’évasion d’Eugénie de l’hôpital. Au cours de ce processus, elle se libère de sa propre cage en se rendant compte de l’injustice inhérente à la Salpêtrière. Simultanément, Louise se sacrifie en restant à l’arrière, ce qui permet aux autres de fuir.
Un dernier bal
L’évasion nocturne d’Eugénie est une danse de liberté et d’espoir. C’est là que le livre trouve sa conclusion lumineuse dans les ténèbres – une lueur de libération pour ces femmes oubliées.
En définitive, « Le Bal des folles » est une critique acérée et émouvante de la façon dont la société a historiquement réduit au silence et marginalisé les femmes sous prétexte de folie. La fin du livre donne enfin une voix à ces femmes, un cri de liberté qui résonne encore longtemps après la fermeture du livre.
L'équipe Litteratur
Les co-fondateurs de Literatur, forment un duo complémentaire passionné par la littérature et la création. Jules, rédacteur en chef, partage ses découvertes littéraires avec verve et érudition, captivant les lecteurs par sa passion des mots. Claire, directrice artistique, apporte sa sensibilité dans la conception visuelle du média, créant une esthétique raffinée et inspirante. Ensemble, ils fusionnent leur amour pour les lettres et l'art pour offrir aux lecteurs une expérience littéraire unique et enrichissante.

Le Bal des folles - Victoria Mas - Dossier pédagogique
by Le Livre de Poche
Séquence pédagogique 1 Victoria Mas Le Bal des folles Dossier réalisé par Julie Chaintron Le Livre de Poche, n° 36078, 240 pages. Introduction L’étude de ce roman prend parfaitement place dans l’objet d’étude de Seconde : « Le roman et le récit du XVIIIe... More
Séquence pédagogique 1 Victoria Mas Le Bal des folles Dossier réalisé par Julie Chaintron Le Livre de Poche, n° 36078, 240 pages. Introduction L’étude de ce roman prend parfaitement place dans l’objet d’étude de Seconde : « Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle », mais aussi, selon l’œuvre et le parcours associé, dans celui de Première consacré au roman et au récit du Moyen Âge au XXIe siècle, en lecture cursive. On pourrait par exemple le proposer pour le parcours lié à La Princesse de Clèves : « Individu, morale et société. » Le Bal des folles suit le destin de trois personnages féminins liés au secteur des aliénées dites hystériques de l’hôpital de la Salpêtrière : une jeune femme de bonne famille qui a le don de communiquer avec les morts, Eugénie, qui y fera un court séjour ; une infirmière, Gene- viève, qui y travaille et y restera comme aliénée ; et une jeune malade, Louise, qui espère en sortir en se mariant avec un jeune interne, mais dont ce dernier Less
Séquence pédagogique 1 Victoria Mas Le Bal des folles Dossier réalisé par Julie Chaintron Le Livre de Poche, n° 36078, 240 pages. Introduction L’étude de ce roman prend parfaitement place dans l’objet d’étude de Seconde : « Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle », mais aussi, selon l’œuvre et le parcours associé, dans celui de Première consacré au roman et au récit du Moyen Âge au XXIe siècle, en lecture cursive. On pourrait par exemple le proposer pour le parcours lié à La Princesse de Clèves : « Individu, morale et société. » Le Bal des folles suit le destin de trois personnages féminins liés au secteur des aliénées dites hystériques de l’hôpital de la Salpêtrière : une jeune femme de bonne famille qui a le don de communiquer avec les morts, Eugénie, qui y fera un court séjour ; une infirmière, Gene- viève, qui y travaille et y restera comme aliénée ; et une jeune malade, Louise, qui espère en sortir en se mariant avec un jeune interne, mais dont ce dernier abusera. Le point d’orgue du roman réside dans le célèbre « bal des folles » de la mi-carême, organisé chaque année à la Salpêtrière, où des aliénées viennent danser, déguisées, mêlées à un public de gens « normaux », et qui verra la vie de ces femmes basculer définitivement. Le roman propose parallèlement une description de la vie menée par les aliénées du docteur Charcot. C’est d’abord son caractère réaliste et documentaire qui offre l’intérêt de l’étude de ce roman, la découverte de l’hôpital de la Salpêtrière et des méthodes d’observation et de soin du docteur Charcot. Ensuite, les portraits de ces trois femmes qui évoluent tout au long du roman au contact les unes des autres constituent une piste d’étude d’autant plus intéressante que la structure et le rythme du roman mettent en valeur leur évolution. Enfin, la dimension argumentative incontestable de ce roman féministe et qui interroge le terme même de la folie fournit un autre axe d’analyse. La problématique pourrait être : comment ce récit exploite-t-il le cadre de la Salpêtrière au XIXe siècle pour proposer une réflexion féministe contemporaine ?
Plan de la séquence 2 e I. Un roman documentaire sur la Salpêtrière au XIX siècle ? 1. La Salpêtrière et le bal des folles 2. Charcot 3. Jane Avril 4. Le don d’Eugénie : l’irruption du fantastique ? II. Le bal des personnages 1. Dans la structure et le rythme du roman 2. Dans l’évolution des personnages féminins III. Un roman féministe 1. Un roman féministe qui dénonce la domination et la violence masculines exercées sur les femmes 2. Un roman qui remet en question notre regard sur la folie et fait l’éloge des femmes singulières Conclusion Pour aller plus loin Filmographie
I. Un roman documentaire sur la Salpêtrière 3 au XIXe siècle ? Par de multiples aspects, Le Bal des folles est un roman réaliste, ancré dans le réel : le titre lui-même provient d’une expression employée au e siècle, probablement d’origine jour- nalistique pour désigner un bal dont l’existence est avérée. La description de la Salpêtrière, son histoire, celle des leçons médicales témoignent de recherches documentaires précises et détaillées. La description de Paris à l’aube ou des danseuses de cabaret à Pigalle renforce l’illusion réaliste. La présence de figures historiques ayant réellement existé comme Charcot, Babinski ou la danseuse Jane Avril intègre le réel à la fiction. Ce souci de réalisme dans la description des aliénées va à l’encontre du fantasme et de l’excès et sert le projet de l’écrivain qui est de « normaliser » les aliénées, et de leur rendre hommage. 1. La Salpêtrière Le roman montre un travail de documentation soucieux d’exactitude et de précision, et le bal qui immerge le lecteur dans une époque et, surtout, dans l’hôpital de la Salpêtrière. Le chapitre 6 offre ainsi un aperçu historique précis et exact de la naissance de la Sal- des folles pêtrière au e siècle jusqu’au e siècle. Gigantesque hôpital, ville dans la ville, elle renfermait au départ les mendiants pour abriter ensuite, entre autres, les prostituées au e siècle, puis des malades psychiatriques au e. Le roman montre, notamment à travers le personnage de Thérèse, que pour les prostituées, sortir de l’hôpital équivalait à retourner sur le trottoir : l’hôpital est une prison, mais aussi un refuge. Quant au bal, la description qu’en donne le chapitre 12 correspond aux comptes rendus des journaux de l’époque, et décrit notamment la « normalité » du comportement des aliénées. Une forme de déception, et peut-être de soulagement, apparaît dans ces articles, face au caractère peu débridé de ces bals ! 2. Charcot Même si le neurologue apparaît très peu dans le roman, son prestige immense auprès des soignants comme des malades et du public est bien visible. Dès le premier chapitre, on assiste à une démonstration d’hypnose commentée par Charcot. Ce sont ses élèves qui hypnotisaient, jamais Charcot – dans le roman, c’est Babinski qui le fait – et le récit montre bien comme les malades se donnaient complaisamment en spec- tacle : Louise « n’a plus peur : c’est son moment de gloire et de reconnaissance. Pour elle, et pour le maître » (p. 12). Suit la description de ses postures que Louise adopte docilement, puis d’elle-même, selon un « rituel » bien établi, qui s’apparente à un « grand spectacle ». D’ailleurs, le prestige extraordinaire de Charcot attirait un public composé non seulement de médecins, mais aussi de gens du monde, d’artistes et d’écrivains. En 1884, Charcot continue ses descriptions de l’hystérie avec les paralysies hystériques, et utilise un aimant pour réduire ces paralysies. L’épisode de la paralysie de Louise à l’issue de la séance d’hypnose dans le chapitre 9 y fait écho. Proposition d’activité 1. Faire une recherche sur Charcot et ses démonstrations d’hypnose. 2. Analyse du tableau de Brouillet : Une leçon clinique à la Salpêtrière. En quoi le récit du « rituel » dans le chapitre 1 correspond à ce tableau ? 3. Jane Avril Jane Avril (Jeanne, dans le roman) est l’ancienne internée que vient voir Geneviève au chapitre 10, place Pigalle. C’est une danseuse de cabaret qui garde un bon souvenir de la Salpêtrière : « C’est la première fois que j’ai senti qu’on m’aimait, là-bas », confie-t-elle à Geneviève (p. 180). Le fait qu’elle ait réellement existé accroît l’effet de réel du roman tout en offrant un exemple supplémentaire de femme résiliente. Le choix de ce personnage est donc symbolique.
4 Proposition d’activité Faire un exposé sur Jane Avril, chercher notamment des images iconographiques la repré- sentant et en analyser une. En quoi son séjour à la Salpêtrière auprès des hystériques l’a-t-il marquée, y compris dans son art ? Le bal de la mi-carême lui a permis de découvrir par la valse qu’elle était folle de danse. Plus tard, au bal Bullier, puis au Moulin Rouge, elle stupéfie son public par ses danses atypiques, qui reprennent d’une certaine manière les mouvements chaotiques observés chez les hystériques. Le fait qu’elle danse seule constitue également un fait nouveau. Sa célébrité et son originalité sont telles qu’elle fréquente des artistes, dont Henri de Toulouse-Lautrec, qui dessine pour elle des affiches, la rendant célèbre dans tout Paris. 4. Le don Dans ce cadre réaliste, le personnage d’Eugénie se révèle inattendu et intrigant. En effet, ses d’Eugénie : visions de personnages morts, son don de communication avec eux n’est à aucun moment mis en doute. Le fait qu’elle découvre un livre authentique sur le spiritisme, Le Livre des l’irruption Esprits d’Allan Kardec, renforce la vraisemblance de ce don et l’ancre dans une certaine du fantastique ? réalité. On comprend que le rationalisme de Geneviève, et partant son existence, sera bou- leversé par le don d’Eugénie, mais on peut s’étonner que la narratrice le présente comme avéré et ne remette jamais en question la santé mentale de l’héroïne. Au contraire, Thérèse, puis Geneviève affirment plusieurs fois leur conviction qu’Eugénie n’est pas une aliénée. De manière très originale, qui donne matière à réflexion, le roman présente sur le même plan des éléments incontestables, ayant existé, avec des éléments sujets à caution, qu’on trouverait dans un récit fantastique voire merveilleux. Rappel sur le récit fantastique au XIXe siècle Le fantastique est créé par l’irruption d’un événement inexplicable dans un univers réaliste et quotidien. C’est l’impossibilité même de trancher sur la nature de cet événement qui crée le fantastique : soit l’événement a une explication rationnelle et on tombe alors dans l’étrange, soit elle est irrationnelle et il s’agit du merveilleux. Le merveilleux des contes néanmoins est différent car l’existence de créatures magiques est en général tout à fait acceptée et présentée comme normale dans cet univers. II. Le bal des personnages 1. Dans la structure et le Questions Pour chaque chapitre, indiquez la date par laquelle il commence, le ou les personnages rythme du roman principaux et le ou les lieux où se situe l’action. Que constatez-vous sur le rythme du récit ? Quels personnages sont tour à tour au centre du roman ? Quelle alternance remarquez-vous, que ce soit pour les lieux ou les personnages ? En quoi le roman est-il construit en deux parties symétriques ?
5 On constate que la durée de l’histoire racontée est courte : un mois à peine – sur les 12 chapitres. Le roman se focalise donc sur ce mois qui bouleverse la vie d’au moins trois personnages féminins. On remarque que jusqu’au chapitre 5, les chapitres alternent entre la Salpêtrière et la demeure des Cléry, autrement dit entre Geneviève et Louise d’une part et Eugénie d’autre part, qui constitue le personnage central de la première moitié du récit. Les chapitres 6 et 7, centraux, pivots du roman, sont aussi particulièrement denses puisqu’ils réunissent pour la première fois les trois personnages féminins principaux qui se rencontrent à la Salpêtrière et communiquent ensemble. C’est également au chapitre 7 qu’intervient Théophile, le frère d’Eugénie, en demandant à Geneviève de transmettre le Livre des Esprits à sa sœur. À partir de ces chapitres, le roman se concentre davantage sur Geneviève, qui effectue alors le parcours inverse d’Eugénie : alors que cette dernière est passée de sa demeure à l’hôpital, Geneviève, elle, finit à l’hôpital, après une série de « voyages » qu’on peut qualifier d’ini- tiatiques dans différents lieux. C’est ainsi que chaque chapitre se focalise en alternance sur les visites de Geneviève (à la chapelle Saint-Louis, chez son père, à Pigalle chez Jane Avril, et enfin chez les Cléry) puis sur les personnages féminins de la Salpêtrière, essentiellement Eugénie, Louise, et Thérèse la tricoteuse. Le dernier chapitre, qui se déroule pendant le fameux bal, raconte un autre bal, celui des personnages qui changent de place : Geneviève prend la place d’Eugénie. Elle est d’ailleurs désignée comme « aliénée » dans les dernières lignes du chapitre. Dans l’épilogue, Louise a pris la succession de Thérèse, décédée : c’est elle à présent qui tricote pour les autres et que l’on redoute. Le rythme du roman fonctionne, à la manière d’une danse, sur un rythme binaire d’alter- nance entre la Salpêtrière et l’extérieur, entre un personnage principal d’un côté et un duo ou trio de l’autre, avec en son centre la rencontre déterminante des deux figures féminines principales. L’hôpital demeure le fil directeur central du récit autour et au sein duquel s’organisent les parcours et métamorphoses des personnages. Il n’est d’ailleurs pas anecdotique que l’ancienne aliénée à laquelle Geneviève rend visite soit une danseuse, Jane Avril, que la danse a sauvée, et qui s’est servie de son expérience durant son internement pour créer une danse atypique qui lui a apporté un grand succès. Les personnages réalisent une forme de chorégraphie géographique de plus en plus rapide qui les libère, les révèle à elles-mêmes, pour l’une en la sortant de l’hôpital, pour les autres en les y ramenant définitivement. 2. Dans l’évolution des Questions Choisissez un des trois personnages féminins principaux (Geneviève, Eugénie et Louise) personnages et indiquez son origine sociale, les événements principaux de son passé ainsi que son féminins évolution dans le roman. Relevez des citations qui montrent le changement du personnage. Le roman offre trois portraits de femme très différents et évolutifs. Exemple de celui de Geneviève : Geneviève est vraisemblablement le personnage principal, parce qu’elle occupe le plus de place dans le roman et parce qu’elle connaît l’évolution la plus importante : c’est à un véritable bal intérieur qu’on assiste. Elle est déjà au centre du premier chapitre : on suit la scène d’hypnose à travers ses yeux, puis on la suit jusque chez elle. Elle est « l’Ancienne » (p. 8), un pilier dans le service, mais dès ce premier chapitre une fêlure apparaît : on apprend qu’elle s’est endurcie avec le temps, et qu’elle a pris ses distances avec les malades. On devine aussi la présence d’un drame familial avec l’écriture d’une lettre à sa sœur, qu’on imagine morte ou disparue. Au
6 fur et à mesure des chapitres, la tension entre ses deux pôles, l’un solide, rationnel, froid et l’autre, souffrant, empathique et protecteur s’amplifie, le second prenant progressivement l’ascendant sur le premier. Elle est ainsi décrite comme « mère enseignante pour les infirmières » au chapitre 2 (p. 47), au chapitre 5 on apprend qu’elle déteste la religion et croit en la médecine, au chapitre 7 elle est désignée comme « pilier du secteur » (p. 123), au chapitre 9 elle est décrite comme « tuteur du service », « la femme qui retient toutes les autres » (p. 170), autant d’images insistant sur la solidité de son caractère et son rôle indispensable au bon fonctionnement du service. Mais d’un autre côté, on apprend que la mort de sa petite sœur, Blandine, a causé chez elle une immense culpabilité et a influé sur sa décision de ne pas se marier avec un jeune médecin. La seule personne qui semble, vivante ou morte, à l’origine des changements de Geneviève est bien Blandine. C’est lorsqu’Eugénie évoque Blandine que Geneviève se trouble : d’abord au chapitre 5, puis au chapitre 6, quand Eugénie lui parle des lettres qu’elle écrit à sa sœur. D’ailleurs, au chapitre 6, le point de vue interne d’Eugénie sur Geneviève souligne la tension entre l’être et le paraître de Geneviève : « Sa personnalité rigoriste est le résultat d’un travail, non d’une nature. Eugénie l’a vu dans ses yeux » (p. 93). Autre étape de son évolution : au chapitre 7, lorsqu’elle reçoit la visite du frère d’Eugénie, elle accepte de prendre le livre qu’il est venu apporter à sa sœur, ce qui constitue une trans- gression. La narratrice effectue un retour sur le passé de Geneviève pour insister encore sur son intérêt pour les ouvrages scientifiques et sa méfiance envers les ouvrages de fiction. De cette tension naît à nouveau un basculement vers le pôle sensible et irrationnel de sa per- sonnalité : après bien des hésitations, Geneviève ouvre le livre d’Allan Kardec et le chapitre suivant nous apprend qu’elle n’a pas dormi de la nuit pour le lire. Là encore, le regard d’Eugénie souligne son changement : « Quelque chose en elle s’est relâché » (p. 140), ce que confirmera Jeanne au chapitre 10. Au chapitre 11, c’est le point de vue de Théophile qui confirmera à son tour l’évolution de Geneviève perçue avant comme intimidante, à présent comme une alliée maternelle. Le chapitre 9 explique la nature de ce relâchement : en se rendant au chevet de son père suite au message transmis par sa sœur, elle ressent enfin du bonheur : « elle sait finalement ce qu’est croire » (p. 163) – en l’occurrence, à la présence de sa sœur après sa mort. Parallèlement, elle passe du côté des gens anormaux, suspectés de folie. C’est ce qu’exprime son malaise en partant précipitamment de l’hôpital dans sa tenue d’infirmière, regardée par les autres voyageurs : « Il lui semblait qu’on avait déjà un avis sur elle, qu’on jugeait son attitude anormale, et rien de ce qu’elle pourrait dire ou défendre ne changerait l’opinion à son égard » (p. 156). Le roman semble annoncer son enfermement final. Ceci est confirmé par la condamnation de son père à qui elle se confie, qui la considère comme folle et lui ordonne de partir : il lui rappelle alors les pères qui viennent interner leurs filles. L‘échange de position entre Geneviève et Eugénie s’amorce. L’une prépare son arrivée chez les aliénées tandis que l’autre prépare son départ. Et il est révélateur qu’à la fin du chapitre 9, lorsqu’elle surgit aux côtés de Louise paniquée par son hémiplégie, sa réaction soit de l’enlacer : sa nature compréhensive et empathique se révèle enfin. Cette proximité nouvelle est un indice supplémentaire de son futur internement. Elle se double d’une remise en question des pratiques et comportements des médecins. Sa visite chez Jeanne, ancienne internée qui a un bon souvenir de son séjour, lui fait voir la Salpêtrière autrement, du point de vue des malades, mais l’inertie des médecins la veille devant la crise de Louise la choque et la fait douter. Le coup de grâce est porté par « l’humiliation à huis clos » (p. 196) que lui fait vivre Charcot qui ne tient compte ni de son expérience, ni de sa loyauté et de ses compétences lorsqu’elle vient mettre en doute la folie d’Eugénie. Il la remet littéralement à sa place : « Votre place ici se limite à la prise en charge des aliénées, non à leur diagnostic » (p. 196) et dénie la légitimité de son intervention. Au chapitre 11, la narratrice signale la fin de la métamorphose : « La veille, sur le chemin du retour, le changement intérieur qui s’annonçait depuis un moment s’était définitivement opéré » (p. 201).
7 Aux trois trajets initiatiques (chez son père, chez Jeanne puis chez Charcot) succède un dernier « voyage » au chapitre 11 qui a plus trait à l’action, qui procède d’une décision : aller chez Théophile pour aider Eugénie à s’échapper. Geneviève n’est plus seulement une alliée maternelle, elle est une sœur, comme le montre la « gravité fraternelle » (p. 223) que perçoit en elle Eugénie. Et c’est en tant qu’« aliénée » qu’elle est désignée par la narratrice quand elle prend la parole à l’issue du chapitre et qu’elle est emmenée par les infirmières. L’épilogue confirme son appartenance à la Salpêtrière non plus comme soignante mais comme internée qui a trouvé sa place : « Elle n’était pas la même femme non plus : quelque chose semblait s’être adouci, apaisé en elle. Maintenant qu’elle était une folle parmi les folles, elle paraissait enfin normale » (p. 232), « Je crois… que je n’ai jamais été dehors. J’ai toujours été ici » (p. 235). Il est intéressant à ce titre que l’autrice ait choisi de lui attribuer le nom de famille d’une authentique malade, Louise Augustine Gleizes, et pas des moindres : Augustine était une célèbre patiente – Louise espère d’ailleurs être « la nouvelle Augustine », chapitre 3 – du docteur Charcot, beaucoup photographiée à la Salpêtrière car très photogénique, star de ces leçons du mardi où ses crises sous hypnose étaient commentées devant un public avide. III. Un roman féministe Questions En quoi peut-on dire que Le Bal des folles est un roman engagé ? Quelles positions adopte-t-il ? À quoi font-elles écho dans notre actualité contemporaine ? On pourra proposer aux élèves de faire un exposé sur un mouvement féministe actuel ou sur un des mouvements nombreux qui visent à changer notre regard sur la différence (handicap, poids, par exemple). 1. Un roman On l’a vu, trois femmes sont les héroïnes de ce roman, qui se battent et font preuve de féministe résilience, que ce soit hors de l’hôpital ou à l’intérieur, confrontées à plusieurs formes de violence et de domination masculines. Chacune d’elles illustre un ou plusieurs aspects de qui dénonce l’oppression féminine, et forme plus ou moins le porte-parole de l’autrice. Quant aux la domination hommes, à l’exception de Théophile, ils sont particulièrement violents et nocifs. Le tableau et la violence qu’en fait Victoria Mas est très sombre. masculines • La domination sexuelle : Louise y est confrontée deux fois, hors de l’hôpital, et, plus grave encore, dans l’hôpital. Le roman nous en informe par une analepse, comme souvent, exercées dans une démarche qui n’est pas étrangère à la démarche psychanalytique du retour sur sur les femmes son enfance. Au chapitre 3, le jeune interne Jules embrasse Louise malgré sa réticence « car c’est en forçant qu’on fait céder » (p. 41). Ces gestes rappellent à Louise le viol que lui a fait subir son oncle. À la fin du roman, au moment du bal, Jules la viole, alors qu’elle est à moitié paralysée. Le roman décrit le phénomène de sidération couramment observé chez les victimes de viol : « Sa bouche s’ouvre pour laisser sortir un cri muet. Tout en elle, soudain, s’éteint » (p. 222) L’épilogue nous apprend qu’après deux ans d’immobilité et de silence, quand Thérèse meurt, Louise s’éveille et se met à tricoter pour les autres internées, et que « désormais, on la redoutait » : le roman montre la violence des hommes et la puissance des femmes. Il n’est pas anodin qu’elle prenne la succession de Thérèse, autre personnage victime de la violence masculine : battue par son amant et proxénète, et par ses clients, elle dit à Eugénie au chapitre 6 : « Les hommes m’ont maltraitée. […]
8 Tant qu’les hommes auront une queue, tout l’mal sur cette terre continuera d’exister » (p. 105). Elle énumère ensuite les internées présentes autour d’elles, toutes victimes de vio- lences masculines. Plus loin, grâce à l’ambiguïté du point de vue interne, la dénonciation de cette violence semble prise en charge à la fois par le personnage et la narratrice : « Mais la folie des hommes n’est pas comparable à celle des femmes : les hommes l’exercent sur les autres ; les femmes sur elles-mêmes » (p. 107). • La domination des pères : elle est incarnée par le personnage de Cléry, le père d’Eugénie qui l’interne de force. Sa domination s’exerce sur toute la famille, comme le montre cette phrase au chapitre 2 : « Maintenant qu’il a parlé, les autres peuvent prendre la parole » (p. 23). Il impose le silence à sa fille dès qu’elle le contredit, mais surtout, il l’emmène à la Salpêtrière dès qu’il apprend l’existence de ses dons : « Tu es une Cléry. Où que tu ailles, tu porteras notre nom. Il n’y a qu’ici que tu ne le déshonoreras pas » (p. 72). Pour ce père, sa fille n’a pas d’existence propre. Et de fait, son existence sociale dépend de lui. Les pensées rapportées de Geneviève, au chapitre 5, généralisent cette idée : « C’est bien le sort le plus malheureux : sans mari, sans père, plus aucun soutien n’existe – plus aucune considération n’est accordée à son existence » (p. 79 80). Une fois de plus, les pensées des personnages rapportées au point de vue ‑ interne traduisent les positions prises par le roman. Geneviève revoit ces pères lorsque le sien la rejette, au chapitre 9 : « Soudain, il ressemble à ces pères, tous ces pères qu’elle a vus s’asseoir dans son bureau, accablés par le mépris et la honte d’une fille dont ils ne voulaient plus, ces pères qui signaient, sans aucun remords, les fiches d’internement d’une enfant déjà oubliée » (p. 167 168). Pourtant, que ce soit Eugénie, qui provoque ‑ son père au chapitre 2, puis réussit non seulement à s’échapper de l’hôpital mais sur- tout à se consacrer à son don, ou Geneviève qui contribue à cette évasion et se place du côté des femmes en restant avec les aliénées, cette domination est contestée par les héroïnes du roman. Proposition d’activité On peut faire relever aux élèves dans les passages qui rapportent les pensées de Gene- viève les éléments qui généralisent son propos et ne le limitent pas au père d’Eugénie ou au sien. • La domination des médecins : dans le roman, le comportement des médecins reflète pour certains toutes les formes de domination et d’oppression masculines. On trouve une forme d’oppression sexuelle, à travers le viol commis par l’interne Jules, mais aussi dans l’attitude libidineuse des internes lors de l’examen d’Eugénie au chapitre 7. On remarque aussi la domination non seulement scientifique, professionnelle mais aussi paternelle et en un sens maritale du docteur Charcot à travers les métaphores de la description faite par le point de vue interne de Geneviève (chapitre 10). « Il est à la fois l’homme qu’on désire, le père qu’on aurait espéré, le docteur qu’on admire, le sauveur d’âmes et d’esprits. […] celui qui règne en maître à l’hôpital » (p. 193). Cette description reflète le prestige réel et la célébrité de Charcot à l’époque, mais révèle et dénonce également la toute-puissance masculine qu’on trouve au sein de l’hôpital, justement par l’emploi des termes « père » et « maître ». • Là encore, le roman met en scène la rébellion des femmes : Eugénie invective les médecins au chapitre 7, remet en question leurs analyses, et Geneviève est révoltée après la scène avec Charcot. Si elle ne lui tient pas tête, elle décide d’agir en faveur de ses protégées.
9 2. Un roman Par le personnage d’Eugénie, taxée de folle seulement parce qu’elle n’est pas comme qui remet en les autres, mais aussi et surtout par le cadre fourni par le service des hystériques, le roman est un vibrant hommage aux femmes, particulièrement aux femmes rejetées par question notre la société. regard sur la folie • Victoria Mas a révélé dans un entretien s’être inspirée de Camille Claudel pour créer le et fait l’éloge personnage d’Eugénie : comme Camille, Eugénie est une femme singulière, brillante, rebelle, des femmes placée par sa famille dans un « asile » parce qu’elle dérange. Son don n’est pas artistique, comme Camille Claudel, mais appartient au domaine du spiritisme. Or, dès son apparition singulières dans le roman, au chapitre 2, on apprend qu’elle cache précisément ce don pour ne pas aller à la Salpêtrière. La page 35 énumère d’ailleurs des cas de femmes enfermées pour avoir voulu vivre comme elles l’entendent et conclut ainsi sur cet hôpital : « Un dépotoir pour toutes celles nuisant à l’ordre public. Un asile pour toutes celles dont la sensibilité ne répondait pas aux attentes. Une prison pour toutes celles coupables d’avoir une opinion. » Par la voix de ce personnage, l’autrice remet totalement en question la folie des aliénées. Il est d’ailleurs significatif que, excepté sa grand-mère, aucune des femmes qui croiseront le chemin d’Eugénie ne croiront à sa folie. • Les aliénées de la Salpêtrière : dès le premier chapitre, la description de ces femmes vise à combattre d’éventuels préjugés tout en critiquant indirectement ceux de l’époque. Elle insiste sur leur calme et leur mélancolie pour se focaliser finalement sur les indices de leur souffrance ou leur pathologie (certaines contractions de leurs membres, par exemple), et les crises sont décrites comme ponctuelles. Deux phrases à la construction symétrique montrent la volonté de l’autrice de remettre en question la représentation fausse de ce pavillon : « Loin de l’ambiance dépravée qui se fantasme en dehors, le dortoir ressemble plus à une maison de repos qu’à une aile dédiée aux hystériques » (p. 14) et « Loin d’hystériques qui dansent nu-pieds dans les couloirs froids, seule prédomine ici une lutte muette et quotidienne pour la normalité » (p. 15). Proposition d’activité Montrez en quoi la description des aliénées au chapitre 1, p. 14 15 (« Dans le large ‑ dortoir […] pour la normalité »), est à la fois réaliste et polémique. En écho au premier chapitre, le dernier (avant l’épilogue), consacré au bal, décrit les aliénées déguisées et se donnant en spectacle. Cette fois, non seulement leur normalité est signalée, mais leur singularité et leur beauté sont mises en avant : « On s’attendait à voir apparaître des démentes, des maigres, des tordues, mais les filles de Charcot partagent une aisance et une normalité qui étonne. […] prestance digne de comédiennes de théâtre […]. Ces filles-là viennent de tous les secteurs confondus, elles sont hystériques, épileptiques et nerveuses, jeunes et moins jeunes, toutes charismatiques, comme si autre chose que la maladie et les murs de l’hôpital les distinguait – une manière d’être et de se placer dans le monde. […] spectacle de grâce surprenant » (p. 213 214). Le récit ne fait plus seulement la défense de ‑ ces femmes, il en fait l’éloge, en prenant habilement le point de vue des spectateurs, dont les gloussements et l’attitude prêtent à confusion : finalement, qui sont les fous dans ce bal, reflet de la société ? Proposition d’activité Demander aux élèves de comparer la description des aliénées au premier et au dernier chapitre.
10 Il est significatif que le chapitre 6, au milieu du roman, offre un aperçu historique exact sur la Salpêtrière, mais dont le but final est de remettre en question la folie supposée des internées. L’autrice écrit ainsi : « Entre l’asile et la prison, on mettait à la Salpêtrière ce que Paris ne savait pas gérer : les malades et les femmes » (p. 96). Lorsqu’elle aborde l’évolution de l’hôpital au e siècle, et notamment les cours publics d’hypnose, c’est toujours l’erreur et l’excès qui dominent dans le regard porté sur les malades : « Car les folles pouvaient désormais susciter le désir. Leur attrait était paradoxal, elles soulevaient les craintes et les fantasmes, l’horreur et la sensualité » (p. 98). On remarque que certains termes appartiennent à l’univers de la tragédie, « crainte » et « horreur », insistant ainsi sur la possibilité de spec- tacle qu’elles représentent alors. Finalement, c’est une véritable critique sociale que propose Victoria Mas : à travers le mot « fantasmes », elle suggère que la véritable folie réside dans le regard que le public pose sur les malades. Conclusion Le Bal des folles permet ainsi un nouveau regard rétrospectif sur le e siècle, riche en romans offrant des portraits de femmes souvent malheureuses, tout en faisant écho aux débats et combats féministes actuels. Le cadre de la Salpêtrière et du bal, miroirs de la société, met en valeur la problématique du corps féminin de toutes conditions, malade, exhibé, contraint ou abusé. La dimension documentaire du roman se double ainsi d’une dimension polémique qui nourriront réflexions et débats en classe. Pour aller plus loin La Folie. Histoire et dictionnaire, docteur Jean Thuillier, Robert Laffont, 1996. L’Hystérie sur scène. Des leçons de Charcot à l’enseignement de Freud et de Lacan, sous la direction d’Anne Bourgain, de Marie-Laure Abécassis et Pascale Molinier, Hermann, 2016. Filmographie The Magdalene Sisters, de Peter Mullan (2002). Augustine, d’Alice Winocour (2012). Camille Claudel, 1915, de Bruno Dumont (2013).
- More by this publisher
- Add to favorites
"Le bal des folles" : l'enfer des femmes jadis enfermées à la Salpêtrière

Paris au 19ème siècle. La ville Lumière aime danser, s'ennivrer, s'encanailler. Elle fourmille de centaines de bals. C'est le grand défouloir, la distraction majeure. Toutes les classes sociales se pressent à ces bals masqués ou travestis, qui charment les ouvriers, ravissent les bourgeois, affolent les aristocrates. Des étudiants y oublient leurs études et les militaires leur rigidité. Dans ces tourbillons endiablés, au rythme des polkas, valses et mazurkas, on traque la bonne aventure auprès des blanchisseuses, des "gigolettes" et autres courtisanes. Le "bal des folles", attire, lui, un public trié sur le volet. Il a lieu le Mardi gras, fin février.

La démence et la raison
Dans Le Voleur , Georges Darien écrit de ce bal : " C'est le jour béni où toutes ces pauvres créatures, les vraies, cette fois, qu'un amour malheureux, le perte d'un être cher, des chagrins de famille, des revers de fortune ou d'autres causes incongrues ont fait échouer dans ce purgatoire dont la porte ne se rouvre guère".

De son côté, le journaliste Albert Wolff relate dans Le Figaro : "Le visiteur se demande si c'est la raison qui fait danser la folie, ou la démence qui reçoit la raison. Les intelligences se confondent avec les cerveaux vides. Le costume, qui est de rigueur, établit une triste égalité entre les folles et leurs gardiennes, et, au milieu de ces groupes de masques, on distingue la tenue sévère de la surveillante toute de noir habillée, qui se promène à travers ce beau bal, comme une mère en deuil qui pleure la raison absente de ses enfants". Voulu et encouragé par le docteur Charcot , ce bal permet, le temps d'une soirée, une rencontre entre "malades" et "gens de la haute". Le neurologue est respectueux et animé d'une sincère compassion. Il ne veut pas un "zoo humain" où les nantis raillaient les pauvres malheureuses. Nulle exposition indécente, d'ailleurs, au bal des folles - il y avait aussi, à même époque, un bal des enfants épileptiques.

"On pensait que l'hystérie était liée à leur sexe"
En 2019, Victoria Mas, fille de la chanteuse Jeanne Mas , signait son tout premier roman. Chaque page de son Bal des folles irradie une touchante compassion pour ces malheureuses enfermées à vie. En 2021, l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent adapte le texte de l'écrivaine dans un film diffusé à partir du 17 septembre, dont chaque instant laisse transparaître l'indignation d'une femme investie par son sujet, même si elle explique sur l'antenne de France Inter avoir eu "envie de faire un film non pas féministe, mais fait de portraits de femmes".
Le film nous fait suivre le parcours de la jeune Louise, une "aliénée" qui souffre de "crises d'hystérie" après avoir été victime d'un viol. Nous faisons aussi connaissance avec Eugénie, qui possède un don singulier, celui de communiquer avec les morts, et découvrons les méthodes strictes de l’infirmière en chef, Geneviève, incarnée dans le film par la réalisatrice elle-même, Mélanie Laurent.
Un plaisir inouï et un honneur d’assister à la première mondiale du film de Mélanie Laurent "Le bal des folles" au @TIFF_NET ! Un casting parfait, une mise en scène puissante pour l’adaptation réussie du roman de Victoria Mas. @uniFrance @cameron_tiff @ActuML @AlbinMichel pic.twitter.com/o1KSMhtppQ — Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) September 13, 2021
Le livre de Victoria Mas s'appuie sur des faits bien réels. "En me rendant un jour à la Salpêtrière, nous confie l'autrice, j'ai été interpellée par les lieux et je me suis intéressée à l'histoire de cet hôpital que j'ignorais complètement. Concernant ce "bal des folles", j'ai pu trouver des écrits de l'époque, des coupures de journaux. Toutes les méthodes de traitement dont je parle dans mon roman, qu'il s'agisse des pressions sur les ovaires ou d'introduction de fer chaud dans le vagin, tout cela était pratiqué à l'époque. On ne savait pas trop comment soigner ces femmes et on pensait que l'hystérie était liée à leur sexe. Tout ce qui se passe en arrière-plan, au sein de l'hôpital, est véridique."
Bains glacés et flagellation

Jusqu'à la Révolution, la Salpêtrière n'a aucune fonction médicale. Les malades parisiens sont alors envoyés à l'Hôtel-Dieu. Et puis les 3 et 4 septembre 1792, l'établissement est le théâtre de scènes sanglantes. Plusieurs centaines d'hommes armés pénètrent dans l'hospice, libèrent 186 femmes, mais en violent et massacrent une trentaine.

Aux 18ème et 19ème siècles, le lieu souffre d'une réputation effrayante. Un journaliste témoigne : "La force, la violence, la brutalité, la férocité même, y régnaient en souveraines. Les bains glacés, la flagellation, les privations absolues de nourriture étaient les moyens sans cesse employés contre les accès de la démence furieuse, moyens barbares et stupides qui, bien loin d'arrêter le mal, l'avivaient au contraire et le rendaient incurable."

Identification
> Créer mon compte (pour les exercices seulement, procédure accélérée)
> Créer mon compte "professeur" (votre demande sera soumise à filtrage)
> Mot de passe perdu ?
Cours et séquences

Collège
Lycée général
> Outils et méthodes
- Progressions annuelles (25)
- Accompagnement personnalisé (4)
- * Écriture poétique (164)
- Hugo : mémoires... (19)
- Baudelaire : alchimie poétique (62)
- Apollinaire : modernité poétique ? (37)
- * Roman et récit (213)
- Mme de La Fayette : individu, morale...... (26)
- Stendhal : le personnage de roman... (29)
- Yourcenar : soi-même comme un autre (10)
- Sarraute : récit et connaissance de soi (6)
- Verne : science et fiction (10)
- Prévost : personnages en marge... (12)
- Balzac : raison et sentiments (5)
- Balzac : création et destruction (6)
- Colette : célébration du monde (11)
- * Théâtre (150)
- Marivaux : maîtres et valets (26)
- Lagarce : crise personnelle, crise familiale (16)
- Molière : spectacle et comédie (21)
- Marivaux : théâtre et stratagème (7)
- Archives : Racine : passion et tragédie (9)
- Archives : Beckett : théâtre de la condition humaine (5)
- Archives : Molière : comédie et satire (8)
- * Littérature d'idées (84)
- Rabelais (18)
- La Bruyère : peindre les hommes... (9)
- Olympe de Gouges : l'égalité (19)
- Archives : Montaigne... (21)
- Archives : La Fontaine (49)
- Archives : Montesquieu (6)
- Archives : Voltaire (53)
- Réécritures (ancien programme) (21)
- Archives : Progressions annuelles (16)
- Archives : L'Autobiographie (57)
- Archives : Etude d'un mouvement littéraire et culturel (11)
- Archives : Convaincre, persuader et délibérer (23)
- Archives: T.P.E. (4)
> Épreuves Anticipées de Français
> Lycée International
> Archives : Classes prépas
> GT Humanités, Littérature et Philosophie (39)
> GT Terminale L (1308)
> GT BTS (910)
> Questionnaires de lecture (284)
Lycée professionnel
Langues et Cultures de l'Antiquité
Cinéma
Français Langue Étrangère / Langue Seconde / Langue de scolarisation
> GT Capes (80)
> GT Agrégation (628)

Première > Olympe de Gouges : l'égalité
> Laclos, Les Liaisons dangereuses , lettre LXXXI Document envoyé le 09-04-2024 par Claude Montels Introduction, plan en mouvements et conclusion pour une lecture linéaire.
> Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme Document envoyé le 09-04-2024 par Claude Montels Fiche sur quelques notions essentielles sur l'œuvre et quelques exemples de textes pouvant être travaillés en parallèle ou cités dans une dissertation.
> Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Document envoyé le 12-12-2023 par Nicolas Tréhel Dissertation corrigée. Elle nécessite en prérequis la révision d'éléments de rhétorique, comme les types d'arguments.
> Olympe de Gouges : proposition de corrigé (dissertation) Document envoyé le 22-08-2023 par Antoine JAYAT Voici un sujet de dissertation ainsi que son corrigé rédigé. Ce sujet a été donné à une classe de première générale.
> Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme Document envoyé le 08-07-2022 par Laure Moreau Analyse linéaire rédigée sur le postambule.
> Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme Document envoyé le 08-07-2022 par Laure Moreau Questions d'analyse linéaire sur le postambule.
> Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme Document envoyé le 08-07-2022 par Laure Moreau Travail préparatoire à l'analyse du préambule. Questions d'analyse linéaire.
> Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Document envoyé le 18-05-2022 par MOREAU LAURE Etude du début du postambule - Texte + questions d'analyse préparant l'étude linéaire.
> Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Document envoyé le 13-05-2022 par Moreau Laure Étude linéaire du préambule -Questions préparatoires à l'analyse - Étude linéaire rédigée.
> Olympe de Gouges, dissertation Document envoyé le 12-05-2022 par Valérie JEANNOT Corrigé de dissertation intégralement rédigé. Sujet : En quoi la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que signe Olympe de Gouges est-elle un texte engagé ?
> Lecture linéaire du postambule d'Olympe de Gouges Document envoyé le 16-11-2021 par Enola Duvallet Lecture linéaire du début du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, inspirée d'un manuel Bordas en ligne.
> Théroigne, Discours prononcé à la Société fraternelle des minimes, 1792 Document envoyé le 06-11-2021 par Murielle Taïeb Explication linéaire d'un extrait de discours de Théroigne de Méricourt dans le cadre du parcours.
> Olympe de Gouges, fin du postambule Document envoyé le 06-11-2021 par Murielle Taïeb Explication linéaire de la fin du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
> Olympe de Gouges, préambule Document envoyé le 06-11-2021 par Murielle Taïeb Explication linéaire du préambule et des deux premiers articles de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
> Olympe de Gouges, début du postambule Document envoyé le 06-11-2021 par Murielle Taïeb Explication linéaire du début du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
> Louise Labé, « Epitre dédicatoire à Mademoiselle Clémence de Bourges, Lyonnaise » (1555) Document envoyé le 06-11-2021 par Murielle Taïeb Explication linéaire du texte de Louise Labé, dans le cadre du parcours.
> Victoria Mas, Le Bal des folles Document envoyé le 01-09-2021 par Jessika Berthe Dossier pour la première lecture cursive de l'année donnée en lien avec le parcours Olympe de Gouges. L'idée est que ce dossier, comme une sorte de matrice /modèle engendre l'autonomie des élèves sur les autres cursives à venir d'où sa richesse. Le dossier cité dans mon document est le dossier pédagogique trouvé ici : https://www.museerops.be/22-09-2012-06-01-2013-pulsion-s
> La femme et le désir d'émancipation Document envoyé le 28-07-2017 par Françoise Latour Descriptif de la séquence dans le cadre de l'objet d'étude "Le personnage de roman".
> L'éducation des filles Document envoyé le 09-08-2009 par Murielle Taïeb Problématique : Comment l'éducation des filles est-elle considérée ? Pourquoi représente-t-elle un enjeu pour la société ? Groupement de textes de Rousseau, Hugo, Zola, Simone de Beauvoir.
Contact - Qui sommes-nous ? - Album de presse - Adhérer à l'association - S'abonner au bulletin - Politique de confidentialité

- Bahasa Indonesia
- Eastern Europe
- Moscow Oblast
Elektrostal
Elektrostal Localisation : Country Russia , Oblast Moscow Oblast . Available Information : Geographical coordinates , Population, Area, Altitude, Weather and Hotel . Nearby cities and villages : Noginsk , Pavlovsky Posad and Staraya Kupavna .
Information
Find all the information of Elektrostal or click on the section of your choice in the left menu.
- Update data
Elektrostal Demography
Information on the people and the population of Elektrostal.
Elektrostal Geography
Geographic Information regarding City of Elektrostal .
Elektrostal Distance
Distance (in kilometers) between Elektrostal and the biggest cities of Russia.
Elektrostal Map
Locate simply the city of Elektrostal through the card, map and satellite image of the city.
Elektrostal Nearby cities and villages
Elektrostal weather.
Weather forecast for the next coming days and current time of Elektrostal.
Elektrostal Sunrise and sunset
Find below the times of sunrise and sunset calculated 7 days to Elektrostal.
Elektrostal Hotel
Our team has selected for you a list of hotel in Elektrostal classified by value for money. Book your hotel room at the best price.
Elektrostal Nearby
Below is a list of activities and point of interest in Elektrostal and its surroundings.
Elektrostal Page

- Information /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#info
- Demography /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#demo
- Geography /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#geo
- Distance /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#dist1
- Map /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#map
- Nearby cities and villages /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#dist2
- Weather /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#weather
- Sunrise and sunset /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#sun
- Hotel /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#hotel
- Nearby /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#around
- Page /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#page
- Terms of Use
- Copyright © 2024 DB-City - All rights reserved
- Change Ad Consent Do not sell my data

IMAGES
COMMENTS
Dissertation: Le bal des folles. Recherche parmi 298 000+ dissertations. Par . Mymy40 • 25 Mai 2022 • Dissertation • 894 Mots (4 Pages) • 2 549 Vues. Page 1 sur 4. Dissertation bal des folles. Victoria Mas est une écrivaine française née en 1987. Elle a étudié le cinéma et travaillait en tant qu'assistante de production.
Le roman « Le Bal des folles » de Pierre Bourdieu a suscité un vif intérêt au sein de la société contemporaine. En effet, cette œuvre littéraire a réussi à captiver les lecteurs par son analyse profonde et sa critique acerbe de la société du XIXe siècle. L'impact de ce roman sur la société contemporaine est indéniable.
Andrew J. Lees, Le Bal des Folles, Brain, Volume 145, Issue 4, April 2022, Pages 1564-1568, ... She began to frequent Parisian dance halls, and at the Closerie des Lilas, a bar and restaurant in Montparnasse, she came into contact with influential intellectuals in the art and literary world, who supported and encouraged her. ...
POUR COMPRENDRE Réponses et commentaires. Étape 1 [Une journée à la Salpêtrière] Lire. 1. La naatice plonge le lecteu diectement dans l'action pa une épliue au discous diect, sans aucun vebe de paole intoducteu. La phase suivante intoduit l'action d'emblée, avec des vebes d'action. Il s'agit d'un éveil au matin.
À propos de l'analyse de livre sur Le Bal des folles. Le premier roman de Victoria Mas, Le Bal des folles, paru aux éditions Albin Michel en 2019, a été salué par la critique et a reçu le prix Renaudot des lycéens le 14 novembre 2019.C'est un roman fictionnel qui s'inscrit dans le contexte historique de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris et du service du docteur Charcot à la ...
Analyse détaillée de 'Le Bal des Folles'. Le "Bal des Folles" est un roman historique captivant qui nous fait découvrir la condition des femmes internées dans l'asile de la Salpêtrière à Paris à la fin du 19e siècle. L'auteure, Victoria Mas, retrace avec brio la vie de ces femmes, réduites à l'état de bêtes de foire ...
Clara Degiovanni publié le 02 octobre 2021 4 min. Le Bal des folles, dernier film de Mélanie Laurent adapté du livre de Victoria Mas, nous plonge dans l'univers baroque et mystérieux de l ...
Le bal des folles (Albin Michel) est le premier roman de Victoria Mas, auteure de cinéma et fille de la chanteuse Jeanne Mas. Un belle première fois pour la romancière qui a été couronnée du ...
1 Copi [Raúl Damonte Botana], dit, Le Bal des folles [1977], Paris, Christian Bourgois, 1999, p. 10. 2 Claude Duchet, « La Fille abandonnée et La Bête humaine, éléments de titrologie romanesque », Littérature, nº 12, 1973, p. 51. 3 Le Dernier Bal des folles - Au bal des folles - La Folle de l'ours - La Folle - Les Souvenirs d'une folle - Les Folles - Un Treap de folle - La Folle ...
PSN volume 19, n° 1/2021 ANALYSE D'OUVRAGE Victoria Mas, Le bal des folles, Paris, Albin Michel, 2019. Alexandre Klein (Université d'Ottawa) Pour son tout premier roman, Victoria Mas visite la Salpetrière de Charcot, en plein âge d'or de l'hystérie et de l'hypnose.
Le programme 2024; Une dissertation sur chaque oeuvre au programme ! Méthode. Stage en ligne Objectif bac de français (écrit) Stage express : objectif 20/20 à l'oral de français ! ... Voici le résultat de ta recherche le bal des folles. A la musique, Rimbaud : analyse. 28 décembre 2017. 3 commentaires . Par Amélie Vioux. Ophélie ...
De Victoria Mas. «Le bal des folles» est le premier roman de Victoria Mas, publié en 2019. Un premier roman qui rencontre immédiatement son public et remporte tour à tour le Prix Première plume, le Prix Stanislas, le Prix Patrimoines de la Banque Privée BPE et le très convoité Prix Renaudot des Lycéens. Victoria Mas est une jeune ...
La fin de « Le Bal des folles » voit Geneviève orchestrer l'évasion d'Eugénie de l'hôpital. Au cours de ce processus, elle se libère de sa propre cage en se rendant compte de l'injustice inhérente à la Salpêtrière. Simultanément, Louise se sacrifie en restant à l'arrière, ce qui permet aux autres de fuir.
Title: Le Bal des folles - Victoria Mas - Dossier pédagogique, Author: Le Livre de Poche, Length: 10 pages, Published: 2021-03-29. Séquence pédagogique 1 Victoria Mas Le Bal des folles Dossier réalisé par Julie Chaintron Le Livre de Poche, n° 36078, 240 pages. Introduction L'étude de ce roman prend parfaitement place dans l'objet d ...
Au 19ème siècle, le "bal des folles" était une attraction très prisée, un rendez-vous mondain qui réunissait le Tout-Paris autour de femmes atteintes de démence, abandonnées ou simplement fragiles. L'actrice et réalisatrice française Mélanie Laurent adapte à l'écran le roman éponyme de Victoria Mas, et nous plonge dans l'antre du célèbre neurologue Jean-Martin Charcot, où il ...
Document envoyé le 06-11-2021 par Murielle Taïeb Explication linéaire du texte de Louise Labé, dans le cadre du parcours. > Victoria Mas, Le Bal des folles Document envoyé le 01-09-2021 par Jessika Berthe Dossier pour la première lecture cursive de l'année donnée en lien avec le parcours Olympe de Gouges.
Colette, préparation à la dissertation . Cette fiche, vous permettra de découvrir les passe-temps favoris de Colette, tout en étudiant l'œuvre : Sido et Les vrilles de la vigne, dans le cadre du Bac de français :) ... elle Après une licence en langues publie son premier roman "Le Bal des Folles", en 2019, qui eu un succes et lui vaut ...
IntroLe Bal des follesJ'ai choisi de présenter l'œuvre intitulée « Le Bal des folles » écrite par Victoria Mas, autricecontemporaine du 21ème siècle et publié en 2019. L'intrigue de Cette fiction historique se déroule àParis et a pour cadre l'hôpital de la Salpêtrière à la fin du 19e siècle. elle décrit les recherchesdu docteur ...
596K subscribers in the vexillology community. A subreddit for those who enjoy learning about flags, their place in society past and present, and…
Elektrostal , lit: Electric and Сталь , lit: Steel) is a city in Moscow Oblast, Russia, located 58 kilometers east of Moscow. Population: 155,196 ; 146,294 ...
Elektrostal Geography. Geographic Information regarding City of Elektrostal. Elektrostal Geographical coordinates. Latitude: 55.8, Longitude: 38.45. 55° 48′ 0″ North, 38° 27′ 0″ East. Elektrostal Area. 4,951 hectares. 49.51 km² (19.12 sq mi) Elektrostal Altitude.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.