L’Économie pour Terminale SES
, sous licence CC BY-SA 3.0.](https://www.sciencespo.fr/department-economics/econofides/terminale-ses/images/web/chapter-02-header.jpg)

Chapitre 2 Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?
2.1 sensibilisation .
En décembre 1899, le bateau à vapeur Manila , en provenance d’Inde, s’arrima au port de Gênes en Italie et y déchargea sa cargaison de céréales.
Le canal de Suez avait ouvert trente ans plus tôt, réduisant considérablement les coûts d’importation des produits de base agricoles en provenance d’Asie du Sud pour les marchés européens. Les boulangers et les clients italiens étaient ravis de ces importations à faible coût qui induisaient une baisse de prix. Les agriculteurs italiens, eux, ne l’étaient pas. Si les boulangers de Gênes et leurs clients avaient appris que des céréales bon marché étaient disponibles à bord du Manila , ils auraient acclamé l’entrée du bateau dans le port, tandis que les fermiers locaux auraient secrètement prié pour que le bateau coule.

Illustration 2.1 Canal de Suez (vers 1890–1910).
Division des gravures et des photographies de la librairie du Congrès , Washington (district de Columbia), États-Unis. Note : la photo montre le navire Golconda , inauguré en 1887, entrant dans le canal depuis la mer Rouge.
En Europe, les États ont peiné à s’adapter à la baisse du prix des céréales.
En France et en Allemagne, les agriculteurs et leurs défenseurs l’ont emporté. Malgré l’intérêt que représentait la baisse du prix des céréales pour la population et pour d’autres producteurs (les boulangers, les éleveurs qui nourrissent leurs bêtes avec des céréales), des droits de douane (des taxes sur les importations ) ont été instaurés pour protéger les revenus des céréaliers.
Le Danemark, parmi d’autres pays, a apporté une réponse bien différente. Le gouvernement danois a choisi d’aider les agriculteurs à passer d’une production céréalière à un élevage laitier, plutôt que de les protéger contre les importations de céréales peu onéreuses. Les éleveurs ont utilisé les céréales importées à faible coût comme consommations intermédiaires pour produire du lait, des fromages et d’autres marchandises qu’il n’était pas possible de transporter à bas coût sur de longues distances. La population a ainsi pu à la fois profiter d’une baisse du prix des céréales et augmenter sa consommation de produits laitiers.
La baisse des prix des céréales a été rendue possible par des progrès techniques (Cf. Chapitre 1 ). Ceux-ci (par exemple, l’invention de la machine à vapeur) ont permis une révolution dans les moyens de transport : l’ouverture du canal de Suez, l’extension du système ferroviaire vers les champs d’Amérique du Nord, la plaine de Russie et le nord de l’Inde, ainsi que l’essor du transport par bateaux à vapeur, comme le Manila , ont réduit les coûts de transport des céréales vers des marchés lointains. Les progrès techniques ont été aussi massifs dans l’agriculture : par exemple, de nouvelles variétés de blé, de nouvelles moissonneuses et semeuses, ainsi que des techniques d’irrigation améliorées ont permis de créer, à travers les vastes plaines du Midwest américain, une agriculture de pointe, intensive en capital , très productive .
La plupart de ces changements se justifiaient d’un point de vue économique : les céréales pouvaient désormais être cultivées dans les lieux où l’agriculture était la plus productive, donc la moins coûteuse, et exportées dans le reste du monde. Face à cette concurrence, les pays dont l’agriculture était moins productive ont subi des pertes d’emploi dans le secteur agricole, mais les individus dont les emplois disparaissaient pouvaient se reconvertir dans des industries alors en plein essor. Par exemple, en Italie, les enfants de certains agriculteurs ont commencé à travailler dans l’industrie du textile, qui exportait vers le reste du monde.
Cependant, les droits de douane conçus pour protéger les céréaliers allemands et français ont retardé cette réallocation de main-d’œuvre depuis le secteur agricole vers le secteur industriel.
La baisse du prix des céréales a ainsi fait des gagnants et des perdants. La ligne de fracture n’opposait pas les riches et les pauvres, les propriétaires terriens et les métayers (qui louent et exploitent des terres) ou les employeurs et les salariés. Le conflit opposait les producteurs des biens manufacturés qui ont accueilli positivement l’accroissement des échanges commerciaux de céréales avec les États-Unis aux agriculteurs qui produisaient des céréales : les premiers bénéficiaient de la réallocation de main-d’œuvre en provenance du secteur agricole et pouvaient faire pression à la baisse sur les salaires du fait des gains de pouvoir d’achat que permettait la baisse du prix des céréales ; les seconds subissaient la concurrence de céréales importées à bas prix.
Après quelques mois passés à Gênes, le Manila fit route vers l’ouest. Il transportait 69 personnes dans ses entreponts (l’espace du bateau où sont logés ceux qui ont payé le prix le plus faible pour leur voyage) ; elles abandonnaient leur terre natale en quête d’une vie meilleure aux États-Unis.
Environ 750 000 Européens ont fait ce voyage chaque année au cours de la décennie suivant l’accostage du Manila à Gênes. De nombreux agriculteurs ayant fait faillite ont émigré aux États-Unis. Ils dormaient sur les ponts de cargos vides qui avaient transporté des céréales en Europe et faisaient route vers les États-Unis pour embarquer une nouvelle cargaison. Certains des petits-enfants de ces migrants sont eux-mêmes devenus cultivateurs de céréales dans le Kansas.
Le terme de mondialisation est communément utilisé pour décrire la tendance à un degré accru d’interconnexion entre les économies.
Cette notion renvoie non seulement au commerce des céréales et aux migrations de part et d’autre des frontières illustrés par le Manila , mais également à l’ internationalisation de la production des entreprises. Par exemple, en 2014, l’entreprise Ford Motor avait des bureaux et usines dans 22 pays en dehors des États-Unis. Le Graphique 2.1 montre que sur les presque 201 000 salariés de cette entreprise « américaine », plus de 144 000 vivaient en dehors des États-Unis.
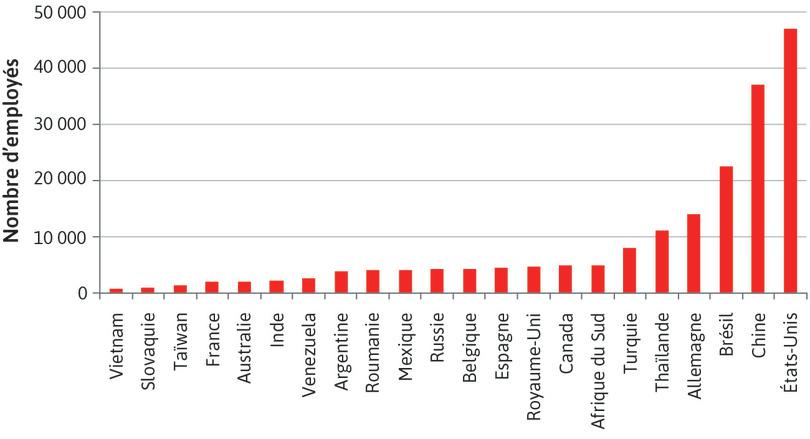
Graphique 2.1 Nombre de salariés de l’entreprise Ford à travers le monde en 2014.
Ford Motor Company.
Cette entreprise a commencé à internationaliser sa production un an après sa création, d’abord en 1904 au Canada, puis a rapidement produit dans de nombreux autres pays les années suivantes, par exemple en Australie (1925) et même en Union soviétique (1930).
Exercice 2.1 Questions sur la sensibilisation Quelles sont les deux révolutions à l’origine de l’essor du commerce international et de la baisse du prix des céréales ? Quels sont les avantages tirés de la baisse du prix des céréales pour les consommateurs européens ? Pourquoi assiste-t-on à une augmentation des inégalités de revenus entre producteurs en Europe ? Quels sont les intérêts de la réponse danoise à la concurrence des céréales à bas prix ? En quoi les réponses française et allemande diffèrent-elles de la réponse danoise ? Quels sont les problèmes de long terme induits par ces réponses ?
Tableau 2.1 Objectifs d’apprentissage et plan du chapitre.
- 2.2 Quels sont les déterminants des échanges internationaux ?
Le commerce de biens, parfois appelé commerce de marchandises, existe depuis des millénaires, bien que le type de biens échangés et les distances parcourues aient considérablement évolué au fil du temps. Des échanges de cette nature concernent les produits qui sont physiquement transportés à travers les frontières par la route, le train, l’eau ou les airs.
Le commerce de services est un phénomène plus récent. Les services qui sont le plus souvent échangés entre pays sont le tourisme, les services financiers, les services éducatifs (par exemple, des personnes viennent du monde entier pour étudier dans les universités américaines ou européennes) ou des services liés aux logiciels informatiques. Mais le commerce des marchandises reste bien plus important que celui des services, qui sont par nature plus locaux : à moins d’être une rock star, vous allez chez votre coiffeur du coin plutôt qu’à New York pour votre coupe de cheveux !
Comment pouvons-nous mesurer l’étendue de la mondialisation des biens et services ?
Une approche consisterait à simplement mesurer le volume des échanges d’un pays, d’une région ou du monde dans son ensemble au cours du temps. Si une augmentation est observée, nous pouvons en conclure que le pays, la région, voire le monde, sont de plus en plus mondialisés.
L’évolution de la part des importations ou des exportations ou du commerce total (importations plus exportations) dans le PIB est un indicateur courant de la mondialisation. Le Graphique 2.2 représente les exportations de marchandises (ce qui exclut les services) à l’échelle mondiale, exprimées en pourcentage du PIB mondial entre 1820 et 2011.
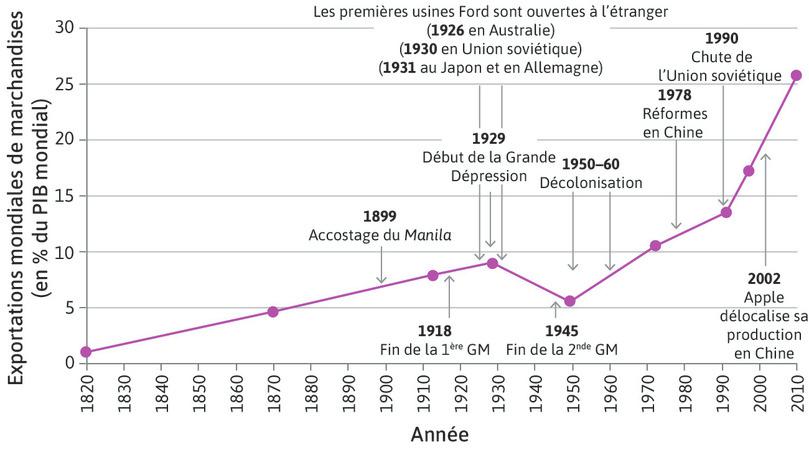
Graphique 2.2 Exportations mondiales de marchandises en pourcentage du PIB mondial (1820–2011).
(1) Appendix I in Angus Maddison. 1995. Monitoring the World Economy, 1820–1992 . Washington, DC : Development Centre of the Organization for Economic Co-operation and Development; (2) Table F-5 in Angus Maddison. 2001. The World Economy: A Millennial Perspective (Development Centre Studies) . Paris : Organization for Economic Co-operation and Development; (3) World Trade Organization. 2013. World Trade Report . Geneva: WTO ; (4) International Monetary Fund. 2014. World Economic Outlook Database: October 2014 .
Question 2.1 Choisissez les bonnes réponses
Sur la première période (1820–1929) :
- Les exportations de marchandises représentaient 1 % du PIB mondial en 1820 et 8 % du PIB mondial en 1929.
- Les exportations de marchandises ont augmenté de 700 % de 1820 à 1929.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a été multipliée par 8 de 1820 à 1929.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a augmenté de 7 % de 1820 à 1929.
- Les exportations mondiales sont exprimées en pourcentage du PIB mondial.
- C’est la part des exportations dans le PIB mondial qui a augmenté de 700 %.
- La part a été multipliée par (8/1) = 8 de 1820 à 1929.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a augmenté de 7 points de 1820 à 1929.
Question 2.2 Choisissez les bonnes réponses
Sur la deuxième période (1929–45) :
- La part des exportations mondiales de marchandises dans le PIB mondial a ralenti d’environ 3 points.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a baissé de 37,5 % de 1929 à 1945.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a été divisée par 1,6 de 1929 à 1945.
- Les exportations de marchandises dans le PIB mondial ont baissé de 3 points de 1929 à 1945.
- La part a baissé de 3 points.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a baissé de [(5-8)/8] × 100 = - 37,5 %.
- La part a été divisée par (8/5) = 1,6 de 1929 à 1945.
- C’est la part des exportations de marchandises dans le PIB mondial qui a baissé de 3 points.
Question 2.3 Choisissez les bonnes réponses
Sur la dernière période (1945–2011) :
- La part des exportations mondiales de marchandises dans le PIB mondial a été multipliée par 2,8 de 1945 à 1990 et par 1,9 de 1990 à 2011.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a augmenté de 21 % de 1945 à 2011.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial en 2011 représente 420 % de cette même part en 1945.
- Base 100 en 1945, l’indice de la part des exportations de marchandises dans le PIB mondial est de 520 en 2011, ce qui signifie que cette part a été multipliée par 5,2.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a été multipliée par (14/5) = 2,8 de 1945 à 1990 et par (26/14) = 1,9 de 1990 à 2011.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial a augmenté de [(26-5)/5] × 100 = 420 % de 1945 à 2011.
- La part des exportations de marchandises dans le PIB mondial en 2011 représente (26/5) × 100 = 520 % de cette même part en 1945.
- L’indice est de (26/5) × 100 = 520, soit un coefficient multiplicateur de (520/100) = 5,2.
Les données sur les exportations de marchandises indiquent d’importantes ruptures au cours des 150 dernières années. À long terme, la tendance est à la hausse, avec une accélération importante des exportations mondiales de marchandises depuis les années 1990. Cependant, cette tendance fut interrompue entre 1914 et 1945, période au cours de laquelle se déroulèrent les deux guerres mondiales et la Grande Dépression . L’internationalisation des échanges qui avait débuté au 19 e siècle fut donc brièvement interrompue, avant de reprendre après la Seconde Guerre mondiale. Ces deux périodes d’internationalisation des échanges sont appelées Première et Seconde Mondialisations .
En somme, l’internationalisation des échanges a considérablement progressé depuis le 19 e siècle, malgré une brève période de « démondialisation » entre les deux guerres mondiales. Comment expliquer cette internationalisation des échanges ? Quels intérêts les pays qui échangent y trouvent-ils ?
Comment expliquer le commerce entre pays spécialisés ?
Avantages comparatifs et intérêt de la spécialisation internationale.
Peut-on vivre en n’utilisant que des produits français ? C’est la question qui a poussé Benjamin Carle, un jeune journaliste de 25 ans, à faire l’expérience de vivre pendant un an en consommant exclusivement des produits conçus et fabriqués principalement en France.

« Made in France – L’année où j’ai vécu 100 % français »
Exercice 2.2 Made in France Regardez la vidéo « Made in France – L’année où j’ai vécu 100 % français ». Indiquez où sont conçus et fabriqués les produits qu’utilise Benjamin Carle au cours d’une journée ordinaire.
Vous-même, connaissez-vous la personne qui a fabriqué les produits que vous utilisez quotidiennement ?
Imaginez maintenant que nous sommes en 1776, l’année où Adam Smith, un économiste écossais (1723–1790), a écrit La Richesse des nations . Les mêmes questions, posées n’importe où dans le monde, auraient eu une réponse bien différente. 1
Nombre des produits que vous auriez observés à l’époque d’Adam Smith auraient été réalisés par un membre de la famille ou du village. À cette époque, de nombreuses familles produisaient une grande variété de biens pour leur propre consommation, dont de la viande, des produits agricoles, des vêtements et même des outils. Vous auriez vous-même fabriqué quelques objets, d’autres auraient été conçus localement ou achetés sur le marché du village.
L’un des changements en cours à la période où Adam Smith a vécu, mais qui s’est grandement accéléré depuis, est la spécialisation (appelée aussi la division du travail ) dans la production de biens et de services. Les individus ne produisent pas en général la diversité des biens et des services qu’ils utilisent ou consomment au quotidien. Ils se spécialisent, certains produisant un bien ou service, d’autres produisant d’autres biens et services, certains travaillant comme fermiers, d’autres comme enseignants, médecins ou codeurs.
Le raisonnement peut être étendu à l’échelle internationale : les machines-outils (comme les outils de coupe de précision) fabriquées dans le sud de l’Allemagne sont utilisées dans la production d’ordinateurs sur la côte sud de la Chine. Ces ordinateurs utilisent des logiciels produits à Bangalore en Inde et en Californie. Ils sont ensuite distribués à travers le monde grâce à des avions construits près de Seattle, aux États-Unis, pour être vendus à leurs utilisateurs dans le monde entier. Les producteurs de ces marchandises mangent des aliments cultivés au Canada ou en Ukraine et portent des chemises fabriquées à l’île Maurice.
Ces exemples montrent que la spécialisation et l’échange sont les deux faces d’un même processus :
- La spécialisation implique l’échange, car en produisant moins de variétés de biens et de services que vous n’en utilisez, vous devez échanger pour acquérir ce que vous ne produisez pas. En l’absence d’échange, les ouvriers fabriquant des machines-outils à Stuttgart ne pourraient pas manger le pain produit grâce au blé importé d’Ukraine ou du Canada, ni porter les vêtements confectionnés à l’île Maurice. Si les individus ne pouvaient pas échanger, ils devraient pourvoir eux-mêmes à leurs propres besoins et ne pourraient pas se spécialiser.
- Inversement, s’il n’y avait pas de spécialisation, il y aurait peu à échanger. L’Allemagne, spécialisée pour partie dans les machines-outils, n’a pas besoin pour sa propre production de toutes les machines-outils qu’elle produit : elle dispose donc d’un surplus de machines-outils qu’elle doit échanger pour se procurer les biens et les services dont elle a abandonné la production. L’échange international résulte donc de la spécialisation des pays.
Aujourd’hui, presque tous les pays font partie d’une économie mondiale caractérisée par :
- La spécialisation : chaque pays se spécialise dans la production de certains biens et services.
- L’échange : ces biens et services sont ensuite échangés avec d’autres pays, eux-mêmes spécialisés dans la production d’autres biens et services.
À ce stade du raisonnement, vous avez compris que, sans échange, la spécialisation serait impossible ; réciproquement, la spécialisation implique l’accroissement des échanges. Mais quels sont les fondements de la spécialisation et les avantages qu’en tirent les producteurs et les pays spécialisés ?
Pour aborder cette explication, imaginez un monde dans lequel vivent deux individus seulement, Greta et Carlos, qui ont chacun besoin de deux biens, des pommes et du blé, pour survivre. Imaginez que Greta habite sur l’île des Délices et Carlos sur l’île du Bonheur. La terre sur chaque île peut être utilisée pour cultiver du blé et des pommes.
Carlos dispose d’une terre moins fertile que Greta : le Tableau 2.2 en décrit les conséquences.
Tableau 2.2 Nombre d’heures de travail nécessaire à Greta sur l’île des Délices et Carlos sur l’île du Bonheur pour produire une tonne de pommes et une tonne de blé.
Les économistes distinguent les avantages dont dispose un producteur de deux manières : l’ avantage absolu et l’ avantage comparatif .
Avant d’aborder ces notions dans un contexte économique, appuyons-nous sur un exemple dans le domaine de la musique. Connaissez-vous le groupe de musique The Beatles ? Il a rythmé la jeunesse de vos parents ou de vos grands-parents. Le chanteur Paul McCartney était le plus doué du groupe, au chant mais aussi à la batterie. Il avait un avantage absolu dans les deux domaines, car il chantait mieux et jouait mieux de la batterie que le batteur du groupe, Ringo Starr.
Si vous avez compris cet exemple relatif à la musique, appliquons le concept d’avantage absolu aux productions de Greta et Carlos dans le domaine économique.
Question 2.4 Complétez le texte
Le temps consacré par Greta à chacune des deux productions est plus aussi moins élevé que le temps qu’y consacre Carlos : la productivité de Greta est donc moins plus aussi élevée ; elle dispose d’un avantage absolu désavantage comparatif désavantage absolu dans les deux productions. Quant à Carlos, sa productivité est plus aussi moins élevée que celle de Greta : il subit un avantage absolu avantage comparatif désavantage absolu dans les deux productions.
Ces différences de productivité se traduisent par des différences de coûts (qualifiés d’absolus) : puisque la productivité de Greta est plus aussi moins élevée dans les deux productions, ses coûts sont aussi moins aussi plus faibles. Les productions de Greta sont aussi plus moins autant compétitives en termes de prix que celles de Carlos.
À ce stade du raisonnement, vous comprenez bien que Greta, disposant d’un avantage absolu et de coûts plus faibles dans les deux productions, n’a aucun intérêt à se spécialiser dans l’une des productions et à abandonner l’autre : il faudrait alors qu’elle importe le produit dont elle a abandonné la production à un prix plus élevé que si elle l’avait produit elle-même. Carlos aurait quant à lui tout intérêt à cesser la production de pommes et de blé et à les importer depuis l’île des Délices puisque ces productions y sont moins coûteuses. Mais, il n’aurait rien à échanger contre les pommes et le blé importés. La spécialisation et les échanges sont impossibles : chaque producteur reste en autarcie , autrement dit Greta comme Carlos continuent de produire les pommes et le blé dont ils ont besoin.
Nous allons reprendre l’exemple du groupe de musique The Beatles : Ringo Starr subissait un désavantage absolu dans les deux domaines de la batterie et du chant ; cependant, si Ringo Starr était moins bon batteur, il chantait surtout « comme une casserole ». À l’inverse, Paul McCartney jouait mieux de la batterie, mais il était surtout bien meilleur que Ringo Starr au chant. Résultat : l’avantage comparatif de McCartney était au chant, celui de Ringo Starr à la batterie, et le groupe devint mondialement célèbre.
Appliquons désormais cette notion d’avantage comparatif aux exemples de Greta et Carlos.
Question 2.5 Complétez le texte
Le temps consacré par Greta à la production d’une tonne de pommes représente 16,7 % 26,7 % 36,7 % du temps que Carlos consacre à cette même production ; le temps consacré par Greta à la production d’une tonne de blé représente 56,7 % 66,7 % 76,7 % du temps que Carlos consacre à cette même production. La productivité de Greta par rapport à celle de Carlos est donc relativement ou comparativement plus élevée dans la production de blé la production de pommes aucune production que dans la production de blé la production de pommes aucune production : elle détient un désavantage comparatif désavantage absolu avantage comparatif dans cette production. Carlos, quant à lui consacre 4 5 6 fois plus de temps que Greta à la production d’une tonne de pommes et 1,5 2,5 3,5 fois plus de temps que Greta à la production d’une tonne de blé : sa productivité, par rapport à celle de Greta, est relativement ou comparativement plus forte moins faible aussi élevée dans la production de blé que dans la production de pommes. Même s’il ne détient aucun avantage absolu, Carlos détient donc un désavantage comparatif avantage comparatif désavantage absolu dans la production de blé.
Ces différences de productivité relative se traduisent par des différences de coûts relatifs :
Le coût relatif d’une tonne de pommes produite par Greta sur l’île des Délices est plus élevé plus faible aussi élevé que le coût relatif d’une tonne de blé : Greta détient un avantage de compétitivité-prix dans cette production par rapport à celle du blé. En revanche, le coût relatif d’une tonne de blé produite par Carlos sur l’île du Bonheur est plus faible plus élevé aussi élevé que le coût relatif d’une tonne de pommes : Carlos détient un avantage de compétitivité-prix dans cette production par rapport à celle des pommes.
Contrairement à ce que nous avons vu concernant les avantages absolus, il semblerait désormais que la spécialisation internationale de Greta et de Carlos en fonction de leurs avantages comparatifs présente un intérêt pour chacun d’eux.
- D’après vos réponses à la Question 2.5 , Greta aurait sans doute intérêt à se spécialiser dans la production de pommes : sa productivité y est plus élevée, par conséquent le coût relatif d’une tonne de pommes par rapport à une tonne de blé est plus faible sur l’île des Délices, qui est ainsi plus compétitive en termes de prix. Si elle se spécialise dans la production de pommes, elle abandonne la production de blé, qu’elle importera depuis l’île du Bonheur (nous verrons ci-dessous les avantages qu’elle en tire).
- Pour les mêmes raisons que Greta, Carlos aurait intérêt à se spécialiser dans la production de blé et à abandonner la production de pommes.
Nous allons désormais envisager les effets bénéfiques d’une telle spécialisation internationale selon les avantages comparatifs, en comparant les situations de Greta, de Carlos et du monde (qui, rappelez-vous, ne comporte que deux îles) en autarcie et après la spécialisation et l’échange.
Question 2.6 Complétez le tableau
Avant de compléter le tableau, veillez à lire les conseils suivants :
- Reportez-vous aux données du Tableau 2.2 pour évaluer la production en autarcie et après la spécialisation.
- Pour calculer la production une fois la spécialisation réalisée, vous reprendrez le temps total que consacrait Greta à la production agricole, soit 30 heures, et le temps total que consacrait Carlos à la production agricole, soit 90 heures.
La spécialisation en fonction des avantages comparatifs présente un premier intérêt majeur : l’allocation des ressources (la manière dont Greta et Carlos utilisent leurs facteurs de production, travail, capital et terres) est optimale puisque chacun s’est spécialisé dans la production dans laquelle il était relativement le plus productif. Par conséquent, la productivité s’accroît, ainsi que la production : il y a croissance économique sur chacune des deux îles, ainsi qu’au niveau mondial.
À la suite de cette augmentation de la production, Greta décide de conserver la moitié de son surplus, soit une tonne de pommes : elle envisage ainsi de développer un élevage porcin (les cochons sont friands de ces fruits). Le reste de son surplus, soit une tonne de pommes, sera exporté sur l’île du Bonheur. Quant à Carlos, il conserve également la moitié de son surplus, soit une tonne de blé, afin de mettre en place une activité de minoterie (production de farine). Le reste de son surplus, soit une tonne de blé, sera exporté sur l’île des Délices. Vous découvrirez dans la Section 2.4 que chacun se procure ainsi davantage que s’il avait lui-même tout produit.
Finalement, la spécialisation selon les avantages comparatifs permet la hausse de la productivité et de la production (croissance économique) : chaque agent économique spécialisé dispose d’une quantité au moins aussi importante pour sa propre consommation (Greta a ainsi conservé pour son propre usage une tonne de pommes et Carlos une tonne de blé) et peut exporter le surplus pour se procurer le produit dont il a abandonné la production.
Les agents économiques qui se spécialisent et échangent produisent et consomment plus de biens et services que s’ils tentaient d’être autosuffisants : ils réalisent ainsi un gain à l’échange. Ces gains apparaissent pour l’ensemble des producteurs ou pays échangistes : le commerce international est donc un jeu à somme positive .
Dans l’exemple précédent, sans vous en douter, vous avez découvert deux théories : celle d’Adam Smith (1723–1790) relative aux avantages absolus et celle de David Ricardo (1772–1823) concernant les avantages comparatifs. L’œuvre la plus importante de Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt (publiée en 1817), a défini le principe des avantages comparatifs selon lequel deux pays pourraient échanger de façon mutuellement avantageuse, même si dans l’absolu l’un des deux est meilleur dans la production de tous les biens. 2
Regardez la vidéo « Qu’est-ce que l’avantage comparatif ? » de Dessine-moi l’éco : pendant la lecture de la vidéo, prenez en note le nombre de personnes nécessaires pour produire une pièce de drap et un tonneau de vin au Portugal d’une part, en Angleterre d’autre part.

« Qu’est-ce que l’avantage comparatif ? » – Vidéo issue de Dessine-moi l’éco : vidéos produites par Sydo, société de conseil en pédagogie.
Question 2.7 Choisissez la bonne réponse
Dans l’exemple pris par Ricardo :
- Le Portugal détient un avantage absolu dans la production de vin et l’Angleterre détient un avantage absolu dans la production de drap.
- Le Portugal détient un avantage absolu dans la production de drap et l’Angleterre détient un avantage absolu dans la production de vin. Ces deux pays peuvent se spécialiser et échanger entre eux.
- Le Portugal détient un avantage absolu dans les deux productions. Aucune spécialisation ni aucun échange n’est donc possible.
- L’Angleterre détient un avantage absolu dans les deux productions. Aucune spécialisation ni aucun échange n’est donc possible.
- Il faut 100 personnes en Angleterre pour produire une pièce de drap contre seulement 90 personnes au Portugal. Le Portugal détient par conséquent un avantage absolu dans la production de drap.
- Il faut 120 personnes en Angleterre pour produire un tonneau de vin contre seulement 80 personnes au Portugal. Le Portugal détient par conséquent un avantage absolu dans la production de vin.
- Le nombre de personnes nécessaires pour produire une pièce de drap et un tonneau de vin est plus faible au Portugal qu’en Angleterre.
- Le nombre de personnes nécessaires pour produire une pièce de drap et un tonneau de vin est plus élevé en Angleterre qu’au Portugal.
Question 2.8 Complétez le tableau
Choisissez les bonnes réponses pour vérifier vos acquis sur les avantages comparatifs.
Finalement, vous l’aurez compris, la théorie la plus adaptée pour expliquer le commerce international est celle des avantages comparatifs développée par David Ricardo. Un producteur comme Carlos sur l’île du Bonheur ou un pays comme l’Angleterre qui subit un désavantage absolu dans toutes les productions a tout de même intérêt à se spécialiser dans la production dans laquelle son désavantage comparatif est le plus faible, autrement dit dans celle pour laquelle sa productivité est comparativement la moins faible, et à échanger. Parallèlement, un producteur comme Greta sur l’île des Délices ou un pays comme le Portugal se spécialise dans la production pour laquelle il est comparativement plus productif, exporte ce bien ou service et importe les autres biens et services. La spécialisation internationale est ainsi le processus par lequel chaque producteur ou pays choisit de consacrer ses ressources productives à une activité pour laquelle il dispose d’un avantage comparatif et d’abandonner les autres productions.
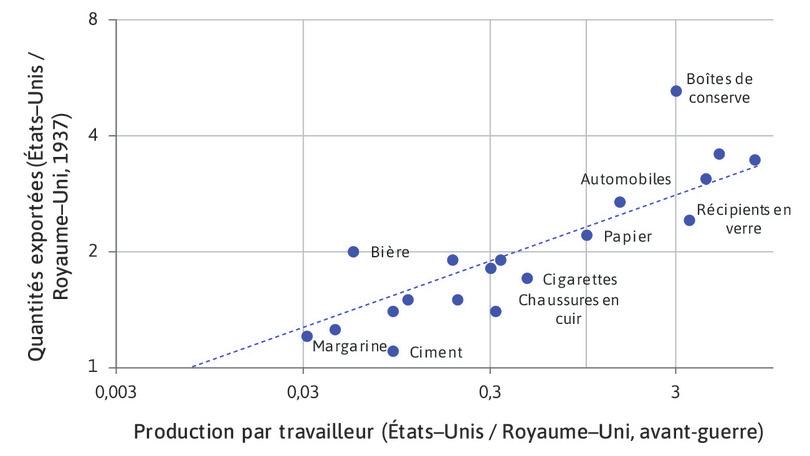
Graphique 2.3 Productivité du travail et avantage comparatif : États-Unis et Royaume-Uni.
MacDougall, G. D. A. 1951. “British and American Exports: A Study Suggested by the Theory of Comparative Costs. Part I.” The Economic Journal 61 (244) : pp. 697–724. Note : les axes des abscisses et ordonnées sur ce graphique sont gradués selon une échelle logarithmique et non arithmétique.
Le Graphique 2.3 présente sur l’axe des abscisses le rapport entre la productivité d’un travailleur américain et celle d’un travailleur britannique ; l’axe des ordonnées présente le rapport entre les exportations de ces deux mêmes pays. Le graphique montre tout d’abord que la productivité d’un travailleur américain est supérieure dans toutes les industries considérées, puisque le ratio des productivités est toujours supérieur à 1 : les États-Unis détiennent donc un avantage absolu dans toutes ces productions par rapport au Royaume-Uni. En revanche, les exportations américaines sont plus élevées seulement dans certaines industries (le ratio des exportations est alors supérieur à 1) : les machines, les voitures, les récipients en verre, par exemple. C’est parce que le désavantage absolu du Royaume-Uni dans toutes les productions ne l’empêche pas de se spécialiser dans une production où il est deux fois moins productif : la bière. En effet, le Royaume-Uni a intérêt à se spécialiser dans la production de bière pour importer des voitures pour la production desquelles il est trois fois moins productif : c’est la comparaison de la productivité relative dans la production de bières par rapport à la production de voitures qui permet au Royaume-Uni de détenir un avantage comparatif dans la production de bières. Il exporte ainsi 20 fois plus de bière que les États-Unis.
Les dotations factorielles et technologiques à l’origine des avantages comparatifs
Les dotations factorielles à l’origine des avantages comparatifs.
Appuyons-nous de nouveau sur les exemples de Greta et Carlos : Greta est plus productive dans les productions de pommes et de blé parce que la terre de l’île des Délices est de meilleure qualité et plus fertile.
De même, les ressources naturelles et le climat des pays diffèrent. Pour des raisons climatiques, produire des bananes en Allemagne serait très coûteux. C’est pour cela que les Allemands se spécialisent dans d’autres productions.
Le modèle Heckscher-Ohlin, élaboré par deux économistes suédois, Eli Heckscher (1879–1952) et Bertil Ohlin (1899–1979), affirme que « chaque pays doit se spécialiser dans la production utilisant les facteurs de production dont il dispose en abondance et importer les biens produits avec des facteurs qu’il possède en moindre quantité ». Les pays se distinguent par des dotations factorielles , des quantités de facteurs de production (terres, travail, capital mesuré par le stock de machines, les bâtiments et d’autres d’équipement par travailleur) variables, certains facteurs étant plus ou moins abondants ou rares. Par exemple, le Canada et les États-Unis disposaient de terres abondantes par rapport au facteur travail (dont ils étaient moins dotés avant les grandes vagues d’immigration de la seconde moitié du 19 e siècle), et devaient donc se spécialiser dans la production et l’exportation de produits agricoles. Aujourd’hui, l’Allemagne, comparativement à la Chine, dispose d’une dotation factorielle plus abondante en capital et d’une dotation factorielle moins abondante en main-d’œuvre : l’Allemagne exporte des biens intensifs en capital vers la Chine ; la Chine exporte des biens intensifs en travail vers l’Allemagne.
La logique sous-jacente à ce principe est la suivante :
- Si l’offre d’un facteur de production, donc la dotation factorielle, est abondante dans un pays, le prix relatif de ce facteur de production est faible.
- Si ce pays se spécialise dans une production qui mobilise intensivement ce facteur de production bon marché, il bénéficie d’un coût relatif faible.
- Par conséquent, il pourra pratiquer des prix plus faibles et être compétitif : il bénéficie d’un avantage comparatif.
- En revanche, le pays abandonne les productions intensives en facteur de production rare sur le territoire : le prix relatif de ce facteur est élevé. Si le pays se spécialisait dans une production intensive dans ce facteur, il subirait un désavantage comparatif (coût relatif et prix de vente élevés).
Vous allez mettre en application vos acquis sur les dotations factorielles en comparant la composition des exportations chinoises et américaines en 1992 et en 2018, présentées dans les Tableaux 2.3a et 2.3b .
Tableau 2.3a Exportations chinoises et américaines en 1992.
World Integrated Trade Solution. Note : les totaux ne sont pas toujours égaux à 100 en raison des arrondis.
Tableau 2.3b Exportations chinoises et américaines en 2018.
World Integrated Trade Solution.
Question 2.9 Complétez le texte
Le Tableau 2.3a montre qu’en 1992 la Chine exportait relativement plus de produits de l’industrie électronique textile des transports qui sont intensifs en facteur travail facteur capital aucun facteur . Ces chiffres traduisent, selon le modèle Heckscher-Ohlin, une rareté présence abondance du facteur travail en Chine à l’époque. À l’inverse, ce tableau montre qu’en 1992 les États-Unis exportaient relativement plus de matériel de transport machines et produits électroniques produits chimiques , en raison d’une abondance relative du facteur travail d’aucun facteur du facteur capital dans ce pays. Conformément au modèle Heckscher-Ohlin, le volume des facteurs de production disponible dans une économie explique la spécialisation et les échanges.
Cependant, les facteurs de production sont aussi de qualité différente. La spécialisation de la Chine peut aussi s’expliquer par une dotation factorielle abondante en main-d’œuvre qualifiée non qualifiée moyennement qualifiée , dont le prix relatif est élevé moyen faible . Quant à la spécialisation des États-Unis, elle peut aussi s’expliquer par une dotation factorielle abondante rare pauvre en main-d’œuvre qualifiée.
Presque 30 ans plus tard, la Chine semble désormais avoir un avantage à l’exportation dans les tissus et vêtements machines et produits électroniques métaux . Cette évolution traduit une hausse du niveau de qualification productivité compétitivité de la main-d’œuvre chinoise, désormais plus présente rare abondante .
Pour aller plus loin : le paradoxe de Leontief
Observant le commerce extérieur des États-Unis (1947–1952), un économiste américain, Wassily Leontief (1906–1999), met en évidence un paradoxe (dit « de Leontief ») : si l’on suit le modèle Heckscher-Ohlin, les États-Unis devraient être spécialisés dans les productions à forte intensité capitalistique. Or, ils sont davantage spécialisés dans les productions intensives en main-d’œuvre.
L’explication de ce paradoxe se trouve dans les caractéristiques du facteur travail aux États-Unis : selon Leontief, les États-Unis seraient un pays relativement abondant en facteur travail, car il faut prendre en compte non seulement le nombre de salariés, mais aussi leur productivité. Or, la productivité des salariés américains est trois fois plus élevée qu’ailleurs en raison de leur niveau de qualification et de la qualité de l’organisation du travail (généralisation du fordisme).
Une autre manière de résoudre le paradoxe consiste à considérer que le capital ne se limite pas au capital physique (machines, locaux, biens d’équipement), mais inclut également le capital humain (les dispositions physiques et intellectuelles incorporées aux individus qui sont sources de productivité) : si l’on intègre le capital humain dans le capital total, il apparaît que les États-Unis exportent effectivement des produits relativement intensifs en capital. Le paradoxe est levé !
Les dotations technologiques à l’origine des avantages comparatifs
L’Organisation de coopération et de développement économiques regroupe des pays développés et des pays émergents.
Les pays se distinguent non seulement par leurs dotations factorielles, mais aussi par leurs dotations technologiques . C’est ce que nous allons comprendre en comparant la situation de la Corée du Sud à celle des pays membres de l’OCDE.
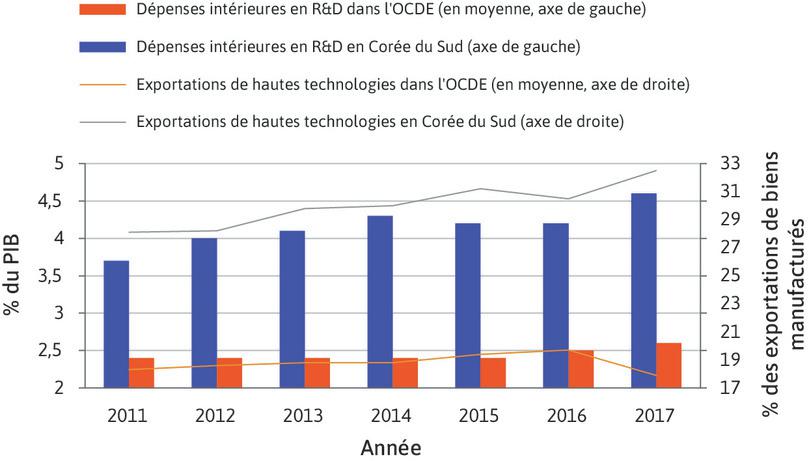
Graphique 2.4 Dépenses intérieures en recherche-développement et exportations de haute technologie (2011–17).
Banque mondiale.
Question 2.10 Choisissez les bonnes réponses
En Corée du Sud :
- Les dépenses de recherche-développement représentent 3,7 % du PIB en 2011 et 4,6 % du PIB en 2017.
- Les exportations de haute technologie représentent 3,9 % du PIB en 2011 et 32,5 % des exportations de biens manufacturés en 2017.
- Les exportations de haute technologie représentent 28,1 % des exportations de biens manufacturés en 2011 et 32,5 % des exportations de biens manufacturés en 2017.
- Les dépenses de recherche-développement représentent 3,7 % du PIB en 2011 et 32,5 % des exportations de biens manufacturés en 2017.
- Les données concernant les dépenses de recherche-développement se lisent sur l’axe de gauche.
- En 2011, les données concernant les exportations se lisent sur l’axe de droite et elles sont exprimées en pourcentage des exportations de biens manufacturés.
- Les données concernant les exportations se lisent sur l’axe de droite.
- En 2017, les données concernant les dépenses de recherche-développement se lisent sur l’axe de gauche.
Question 2.11 Choisissez les bonnes réponses
En 2017 :
- La part des dépenses de recherche-développement dans le PIB en Corée du Sud est supérieure de 176,9 % à la moyenne de l’OCDE.
- La part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en Corée du Sud est 1,8 fois plus élevée que la moyenne des pays de l’OCDE.
- Les exportations de haute technologie sont plus élevées en Corée du Sud que dans les pays de l’OCDE en moyenne.
- La part des dépenses de recherche-développement dans le PIB en Corée du Sud est 1,8 fois plus élevée qu’en moyenne dans les pays de l’OCDE.
- La part des dépenses de recherche-développement dans le PIB en Corée du Sud représente (4,6/2,6) × 100 = 176,9 % de la moyenne de l’OCDE. Elle est donc supérieure de 76,9 % à la moyenne.
- La part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en Corée du Sud est 32,5/17,9 = 1,8 fois plus élevée que la moyenne de l’OCDE.
- C’est la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés qui est supérieure en Corée du Sud.
- La part des dépenses de recherche-développement dans le PIB en Corée du Sud est 4,6/2,6 = 1,8 fois plus élevée que la moyenne dans les pays de l’OCDE.
Question 2.12 Choisissez les bonnes réponses
De 2011 à 2017 :
- La comparaison des données de la Corée du Sud avec la moyenne de l’OCDE ne permet pas d’observer de corrélation positive entre la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB et la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés.
- Il y a une corrélation positive entre la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB et la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en Corée du Sud.
- Il n’y a pas de relation de causalité entre l’évolution de la part des dépenses de recherche-développement en Corée du Sud et celle de la part des dépenses de recherche-développement dans les pays de l’OCDE.
- Il n’y a pas de relation de causalité entre l’évolution de la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB et celle de la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en Corée du Sud.
- Il y a bien une corrélation positive entre ces deux parts en Corée du Sud puisque les deux variables augmentent. En moyenne dans les pays de l’OCDE, la corrélation est positive jusqu’en 2016, mais elle devient négative en 2017 puisque la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB augmente, alors que celle des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés baisse.
- Les deux variables augmentent toutes deux.
- Ce n’est pas parce que la Corée du Sud augmente ses dépenses de recherche-développement que les autres pays de l’OCDE font de même.
- La hausse de la part des dépenses de recherche-développement dans le PIB peut contribuer à la hausse de la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés.
L’importance de l’investissement de la Corée du Sud en recherche-développement lui donne une avance technologique en termes d’innovation. Vous le savez peut-être, certains géants de l’électroménager et de l’électronique sud-coréens sont à la pointe de la recherche et comptent révolutionner la domotique en créant des logements et équipements de logement entièrement connectés (il serait même envisagé de pouvoir divertir son chien à distance !). Ces entreprises innovatrices détiennent un avantage comparatif, car elles sont en position de monopole temporaire. Apparaissent alors des échanges internationaux liés à l’écart technologique : la demande étrangère est satisfaite par des exportations en provenance de la Corée du Sud. Lorsque l’innovation se diffuse, les pays anciennement importateurs peuvent se mettre à produire eux-mêmes le produit. Cependant, la première entreprise innovatrice conserve souvent un avantage de notoriété (pensez ici à l’entreprise Dyson qui a été la première à commercialiser des aspirateurs sans sac) ou de coût qui lui permet de continuer à exporter dans le reste du monde.
Les dotations technologiques de la Corée du Sud l’amènent à se spécialiser dans les biens de haute technologie et à les exporter. Cependant, des biens considérés aujourd’hui comme hautement technologiques vont peu à peu perdre cette caractéristique. C’est sur ce constat que s’appuie Raymond Vernon (économiste américain, 1913–1999) dans les années 1960 pour montrer le lien entre le cycle de vie des produits et le commerce international. Sa thèse s’applique aux échanges de biens de consommation entre les firmes américaines et les pays européens de 1945 à la fin des années 1960. Après cette date, le différentiel d’innovation et de coûts est moindre entre les États-Unis et l’Europe. Mais sa thèse sur l’innovation comme déterminant des échanges, telle qu’elle est présentée dans l’ Illustration 2.2 , peut être étendue à d’autres pays.
Illustration 2.2 Phases du cycle de vie du produit et phases du commerce international.
Au vu de cette illustration, une dotation technologique ne donne pas un avantage comparatif définitif à un pays. La diffusion des connaissances et les transferts de technologies permettent à des pays suiveurs ou imitateurs d’acquérir un avantage comparatif dans des produits en maturité ou en déclin. Les pays innovateurs doivent donc développer de nouveaux produits pour lesquels leur dotation technologique leur procure un nouvel avantage comparatif.
Synthèse Les échanges internationaux et la spécialisation internationale s’expliquent en premier lieu par des différences entre les pays : différences de productivité (Ricardo), différences de dotations factorielles (Heckscher-Ohlin) et différences de dotations technologiques. Ces différences sont à l’origine d’avantages comparatifs qui conduisent les producteurs ou les pays à se spécialiser dans certaines productions, à exporter et à importer les produits dont ils ont abandonné la production. Le commerce international qui résulte de la spécialisation selon les avantages comparatifs est un jeu à somme positive, car il profite à l’ensemble des pays participant aux échanges.
Comment expliquer le commerce entre pays comparables ?
Les théories qui ont été étudiées dans la partie précédente ont pour point commun d’expliquer le commerce international par l’existence de différences entre pays : différences de productivité (Ricardo), de dotations factorielles (Heckscher-Ohlin) ou technologiques. Le commerce international est alors un échange de différences (on parle d’ échanges interbranches ) : les pays échangent ce qu’ils ne produisent pas eux-mêmes ou ce que les autres produisent mieux.
On a ainsi longtemps pensé que si tous les pays avaient les mêmes caractéristiques productives (productivité, dotations), aucun n’aurait d’avantage comparatif dans la production de quelque bien ou service que ce soit, et qu’aucun n’aurait de raison de se spécialiser et d’échanger.
Mais il y a bien d’autres raisons de se spécialiser. Au cours des années 1980, les économistes Avinash Dixit, Elhanan Helpman et Paul Krugman ont développé des modèles du commerce international dans lesquels les échanges ne sont pas dus à des différences entre les pays, mais aux rendements d’échelle croissants .
Pour le démontrer, revenons à l’exemple de Greta sur l’île des Délices et de Carlos sur l’île du Bonheur : supposons que chacun soit aussi productif et ait les mêmes dotations factorielles (terres en même quantité et de qualité identique). Ils sont tous les deux capables de produire des pommes et du blé, mais la production des pommes et la production du blé sont sujettes à des rendements d’échelle croissants. Cela impliquerait, par exemple, que doubler la quantité de terre et le temps de travail consacrés à la production, disons, des pommes, ferait plus que doubler la quantité de pommes produites.
Dans le Tableau 2.4 , vous pouvez observer que si 25 hectares et un quart du temps de travail sont consacrés à la production de pommes, 625 tonnes de pommes seront produites. Si l’on double la surface de terre jusqu’à 50 hectares et le temps de travail, la production de pommes est multipliée par 4, soit 2 500 tonnes de pommes. Quant à la production de blé, elle correspond, pour chaque surface, à un dixième du nombre de pommes produites.
Tableau 2.4 Économies d’échelle dans les productions de blé et de pommes.
Imaginez que Carlos et Greta restent en autarcie, chacun disposant de 100 hectares et divisant leur terre et leur force de travail de façon égale entre les pommes et le blé : ils produiraient chacun 250 tonnes de blé et 2 500 tonnes de pommes. La production mondiale serait alors de 500 tonnes de blé et de 5 000 tonnes de pommes.
Cependant, si l’un d’eux se spécialisait dans le blé et l’autre dans les pommes et qu’ensuite Greta et Carlos partageaient la production en parts égales, ils obtiendraient chacun deux fois plus de blé et de pommes qu’en l’absence de spécialisation. En effet, la production mondiale serait de 1 000 tonnes de blé et de 10 000 tonnes de pommes.
L’avantage de la spécialisation ne vient pas ici d’un avantage comparatif lié à une différence de productivité ou de dotations entre Greta et Carlos. Cet avantage est dû aux rendements d’échelle croissants permis par la spécialisation dans une seule production. Carlos et Greta sont plus efficaces en produisant chacun une grande quantité d’un seul bien, peu importe lequel.
Les économistes utilisent les notions de rendements d’échelle croissants et d’ économies d’échelle pour décrire les avantages tirés de la production à grande échelle. Les rendements d’échelle sont croissants si une hausse des quantités de facteurs de production (travail et capital) entraîne une hausse plus importante de la production : dans le cas de Greta et Carlos, doubler la quantité de facteurs affectée à une seule production provoque le quadruplement de la production. Par conséquent, les coûts unitaires de production baissent et le producteur réalise des économies d’échelle : il peut en profiter pour baisser ses prix et ainsi gagner en compétitivité-prix.
Pour comprendre pourquoi des rendements d’échelle croissants et des économies d’échelle apparaissent, il faut mobiliser la distinction entre économies d’échelle internes et externes mise en évidence par Alfred Marshall (économiste anglais, 1842–1924).
Les économies d’échelle internes apparaissent au sein même de l’entreprise. En premier lieu, la hausse de la taille de l’entreprise, mesurée par sa production en volume, permet d’amortir les coûts fixes sur une quantité plus importante, d’où une baisse des coûts unitaires. Reprenons l’exemple de la technologie sud-coréenne permettant de divertir son chien à distance que nous appellerons Entertain dog ( Tableau 2.5 ) : le coût fixe lié à la mise au point de cette technologie est élevé, car il faut investir en recherche-développement et mobiliser une main-d’œuvre qualifiée (chercheurs, ingénieurs, techniciens) ; le coût variable par unité produite et vendue est ensuite beaucoup plus faible.
Tableau 2.5 Coûts liés à la production d’ Entertain dog .
Vous le constatez, plus le nombre d’unités produites et vendues augmente, plus le coût unitaire baisse, ce qui donne un avantage très important aux producteurs qui sont les premiers à entrer sur le marché, produisent et vendent le plus. Ils bénéficient de surcroît d’effets d’apprentissage (on parle aussi d’ apprentissage par la pratique ) : les producteurs présents sur le marché, avec l’expérience, acquièrent des compétences, par exemple en matière d’organisation de la production et du travail, ce qui leur permet de gagner en productivité, donc de bénéficier d’une baisse des coûts unitaires. Les salariés eux-mêmes deviennent plus habiles et plus productifs.
La baisse des coûts unitaires liée aux économies d’échelle internes est d’autant plus importante que la taille du marché est large. Ainsi, le producteur qui a mis au point Entertain dog doit-il tenter non seulement d’inonder le marché sud-coréen de sa nouvelle technologie, mais aussi de séduire les propriétaires de chiens du monde entier : plus la taille du marché est large, plus les coûts unitaires sont faibles et plus la compétitivité-prix s’accroît si l’entreprise répercute cette baisse des coûts unitaires sur les prix.
Les économies d’échelle externes s’observent au niveau de bassins industriels (appelés aussi clusters ou pôles de compétitivité) où des entreprises, souvent de la même branche, se concentrent au sein d’une même zone géographique. Aujourd’hui, l’archétype en est la Silicon Valley. En Corée du Sud, les bassins industriels sont très spécialisés (équipement de transport, matériel informatique, mécanique, son et communication, optique et électronique, entre autres). Dans ces zones, l’activité de chaque entreprise peut générer des externalités positives sur celle de toutes les autres : on parle d’ effets d’agglomération . Marshall identifie plusieurs facteurs à l’origine de ces externalités :
- La présence d’un réseau de fournisseurs spécialisés, ce qui évite des coûts liés à la recherche de tels fournisseurs et au transport.
- Le recours plus aisé à une main-d’œuvre qualifiée, incitée à se concentrer dans la zone géographique en raison du grand nombre d’employeurs potentiels.
- La diffusion de la connaissance, des compétences et des idées entre les salariés de ces entreprises.
C’est donc en raison de l’existence d’économies d’échelle internes et externes, et non de l’existence d’un avantage comparatif, que certains pays comparables se spécialisent.
Par ailleurs, les théories que vous avez étudiées dans la première partie de la section sont impuissantes à expliquer l’existence d’ échanges intrabranches , tels que ceux qui se pratiquent entre la France et l’Allemagne.
Tableau 2.6 Échanges intrabranches entre la France et l’Allemagne (2019).
leblogauto.com. auto-infos.fr.
Ce tableau montre que la France et l’Allemagne échangent des véhicules automobiles. Or, ce sont des pays comparables : la productivité diffère peu entre ces deux pays. Leurs dotations factorielles et technologiques sont proches : la France, tout comme l’Allemagne, sont bien dotées en capital et en main-d’œuvre qualifiée et maîtrisent la technologie permettant de produire des automobiles. Les échanges intrabranches ne s’expliquent donc pas par des différences entre pays, mais par d’autres facteurs.
La différenciation et la qualité des produits
Les échanges entre pays comparables sont souvent des échanges intrabranches portant sur des biens et services similaires, mais pas strictement identiques. Si l’on s’appuie sur l’exemple évoqué plus haut de la branche automobile, toutes les voitures ne sont pas identiques : ce sont des produits différenciés . Chaque marque et chaque modèle produits par une seule et même entreprise ont des caractéristiques uniques en termes de conception, de performances, qui les différencient des voitures fabriquées par d’autres entreprises.
Les marchés de produits différenciés reflètent des différences de préférences des consommateurs, différences qui portent sur les caractéristiques des produits et non sur les produits eux-mêmes.
La différenciation des produits prend deux formes : la différenciation horizontale et la différenciation verticale .
Intéressons-nous d’abord à la différenciation horizontale. Dans le Tableau 2.7 vous sont présentés deux modèles de voitures, produits l’un par une entreprise allemande, l’autre par une entreprise française. Ces modèles font partie de la même gamme, celle des citadines, sont offerts à des prix proches (19 550 euros pour la Polo et 18 800 euros pour la Clio) et visent donc le même segment de clientèle, à pouvoir d’achat comparable. Comment expliquer que la France et l’Allemagne échangent de tels produits ? Tout simplement par le fait que si ces deux modèles présentent des caractéristiques proches (chevaux, motorisation, sièges…), ils diffèrent par la couleur, le design, les équipements optionnels, la marque.
Tableau 2.7 Différenciation horizontale.
Tableau 2.8 Différenciation verticale.
La logique est différente dans le cas de la différenciation verticale ( Tableau 2.8 ) : vous le savez, certains consommateurs peuvent se permettre d’avoir des goûts de luxe en matière automobile alors que le consommateur moyen cherche avant tout à acquérir un véhicule qui satisfait son besoin de se déplacer. La demande de ces consommateurs porte donc sur des produits différenciés verticalement (effet de gamme, qualité différente) que les entreprises nationales ne fabriquent pas nécessairement.
Le commerce international entre pays comparables est motivé par le fait qu’il augmente la variété des produits disponibles pour les consommateurs : ceux-ci ont en effet une préférence pour la variété. Supposons que deux pays soient strictement identiques : ils n’ont chacun aucun avantage comparatif, donc aucun intérêt à se spécialiser et à échanger. En situation d’autarcie, le nombre de variétés et de gammes offertes dans chaque pays est limité : il est en effet impossible pour les entreprises de dégager des économies d’échelle sur un grand nombre de produits différenciés. En revanche, en situation de libre-échange, les consommateurs peuvent se procurer à la fois les variétés et gammes nationales et étrangères : des pays comparables ont donc intérêt à échanger, même en l’absence d’avantage comparatif, car cela contribue au bien-être des consommateurs.
Les produits échangés à l’échelle internationale se distinguent aussi par leur qualité . Observez le Tableau 2.9 et le Graphique 2.5 avant de faire la Question 2.13 .
Tableau 2.9 Classement des dix premiers exportateurs mondiaux de biens de consommation en termes de qualité.
www.rexecode.fr, « Enquête Compétitivité 2018 : classement des 10 principaux exportateurs mondiaux de biens de consommation », 11 juin 2019. Note : enquête menée auprès de 480 importateurs dans six pays européens (France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie, Espagne) auprès de la personne qui décide du choix des fournisseurs en matière d’importation.
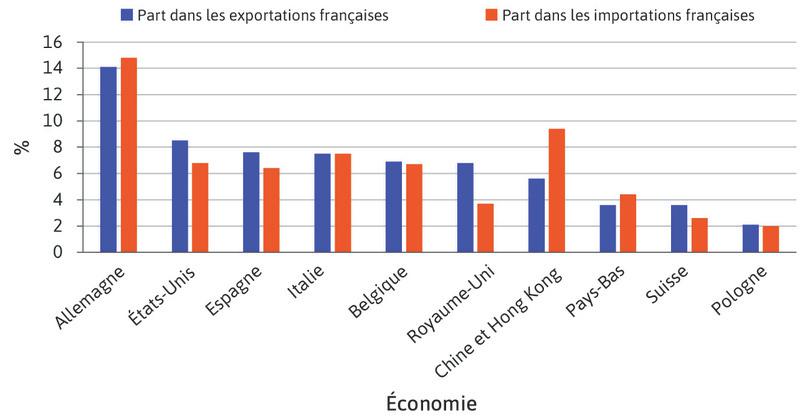
Graphique 2.5 Les dix premiers partenaires commerciaux de la France (cumul octobre 2018–septembre 2019 en pourcentage).
lekiosque.finances.gouv.fr, consulté le 4.12.2019.
Question 2.13 Complétez le texte
Hormis la Chine et la Pologne, les principaux partenaires commerciaux de la France sont des pays de niveau de développement comparable différent varié . Par exemple, 14,1 % des exportations françaises sont à destination des États-Unis du Royaume-Uni de l’Allemagne et 14,1 % 14,8 % 16 % des importations françaises proviennent de ce même pays, qui est donc le deuxième troisième premier partenaire commercial de la France. Ainsi que nous l’avons vu dans la partie précédente, ces échanges peuvent s’expliquer par la différenciation différence similitude des produits échangés, mais aussi par leur proximité qualité quantité : l’Allemagne est ainsi au deuxième troisième premier rang du classement pour les produits des branches équipement du logement, les produits agro-alimentaires et ceux de pharmacie hygiène-beauté ; la France est également bien mal moyennement classée pour la qualité des produits de ces branches. Il y a donc des échanges entre branches intrabranches inter-branches de produits en raison de leur qualité. Le deuxième partenaire commercial de la France en termes d’importations est l’Espagne l’Italie la Chine mais ces échanges ne s’expliquent pas par la qualité des produits, car ce pays n’est classé qu’au septième dixième neuvième rang du classement.
Vous l’aurez compris dans cette sous-section, les échanges intrabranches entre pays comparables s’expliquent par la demande de différenciation et de qualité exprimée par les agents économiques.
La fragmentation de la chaîne de valeur
Ces échanges intrabranches entre pays comparables peuvent aussi s’expliquer par des facteurs liés à l’offre, notamment par l’intérêt, pour les entreprises, de procéder à une fragmentation de la chaîne de valeur .
Pour comprendre pourquoi une entreprise a intérêt à répartir les étapes de la production des composants et du bien final dans différents pays, revenons d’abord à Adam Smith et à une phrase célèbre tirée de son ouvrage Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) : « Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la plus grande partie de l’habileté, de l’adresse, et de l’intelligence avec laquelle il est dirigé ou appliqué, sont dues, à ce qu’il semble, à la division du travail. » Autrement dit, un producteur spécialisé qui se concentre sur un nombre limité de tâches ou de produits est plus productif.
Cet accroissement de la productivité lié à la spécialisation est l’une des raisons de la fragmentation de la chaîne de valeur au sein de l’entreprise Airbus. Observez le Tableau 2.10 : vous constaterez que les composants des Airbus sont produits dans quatre pays comparables et assemblés en partie en Allemagne, en partie en France, à Toulouse. Airbus est un bon exemple d’échanges liés à une chaîne de valeur complexe, échanges facilités par la libre-circulation des biens et des travailleurs au sein de l’Union européenne.
Tableau 2.10 La répartition de la production de l’entreprise Airbus dans l’Union européenne.
C’est pour bénéficier de rendements d’échelle croissants qu’Airbus fragmente la chaîne de valeur au niveau européen et confie les différentes étapes de la production des composants de ces avions et de leur assemblage à des sites spécialisés.
- Chaque producteur spécialisé des composants des Airbus réalise des économies d’échelle internes, car il peut amortir ses coûts fixes sur une quantité produite plus importante et profite d’effets d’apprentissage qui le rendent plus productif.
- Sur chacun des sites de production spécialisés, des économies d’échelle externes apparaissent grâce à la présence de réseaux de fournisseurs et d’une main-d’œuvre qualifiée et à la diffusion des connaissances et des compétences entre entreprises.
Grâce à la fragmentation de la chaîne de valeur, Airbus bénéficie ainsi d’une baisse des coûts unitaires de ses avions.
Vous vous posez peut-être à ce stade la question de savoir comment les entreprises procèdent pour fragmenter la chaîne de valeur mondiale : si vous vous reportez au Tableau 2.10 , vous constaterez qu’Airbus recourt à des filiales (Airbus Allemagne, par exemple) qu’elle détient en partie ou en totalité, mais qu’elle fait aussi appel à d’autres entreprises, comme Rolls-Royce pour ses moteurs. Vous aurez une réponse plus précise à cette question dans la Section 2.3 car la fragmentation de la chaîne de valeur ne s’effectue pas seulement entre pays comparables, mais aussi à l’échelle internationale, entre pays de niveaux de développement différents.
Synthèse Les échanges internationaux et la spécialisation internationale ne s’expliquent pas seulement par des différences entre les pays : des flux d’échanges ont lieu entre des pays comparables en termes de niveau de développement, de productivité, de dotations factorielles et technologiques ; ces échanges sont souvent de type intrabranche. Ils s’expliquent par des facteurs liés à la demande (la différenciation, horizontale et verticale, des produits, et leur qualité) et des facteurs liés à l’offre (la fragmentation de la chaîne de valeur qui permet de dégager des rendements d’échelle croissants et des économies d’échelle).
- 2.3 Quels sont les déterminants de la compétitivité ?
Pourquoi la productivité des firmes sous-tend-elle la compétitivité d’un pays ?
Qu’est-ce que la compétitivité d’un pays .
Regardez la vidéo « La compétitivité, c’est quoi ? Et comment l’améliorer ? » de Dessine-moi l’éco. En vous appuyant sur cette vidéo, répondez aux Questions 2.14 à 2.17 .

« La compétitivité, c’est quoi ? Et comment l’améliorer ? » – Vidéo issue de Dessine-moi l’éco : vidéos produites par Sydo, société de conseil en pédagogie.
Question 2.14 Choisissez les bonnes réponses
Qu’apporte la compétitivité de ses entreprises à un pays ?
- Elle lui permet de produire plus avec les mêmes quantités de facteurs de production.
- Elle lui permet d’exporter ses produits.
- Elle lui permet de limiter les importations de produits étrangers.
- Elle lui permet de limiter le nombre d’entreprises concurrentes sur le marché.
- Il s’agit ici de la productivité.
- Les produits de ses entreprises sont attractifs.
- Les produits des entreprises nationales sont plus attractifs.
- La compétitivité permet d’affronter la concurrence, mais elle n’élimine pas les concurrents.
Question 2.15 Choisissez les bonnes réponses
Quelles sont les sources de la compétitivité-prix ?
- La productivité.
- Le coût des facteurs de production.
- L’innovation.
- L’image de marque de l’entreprise.
- Les gains de productivité permettent de réduire les coûts unitaires de production et d’augmenter la compétitivité-prix.
- Leur baisse permet à la firme de baisser ses prix et d’être plus compétitive.
- Les produits innovants se vendent bien même si leur prix est supérieur.
- Une firme qui a une bonne image de marque parviendra à vendre ses produits à un prix plus élevé que ses concurrents.
Question 2.16 Choisissez les bonnes réponses
Quelles sont les sources de la compétitivité hors-prix ?
- Le taux de change, c’est-à-dire la valeur relative de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies.
- L’intensité de la concurrence.
- La qualité du produit.
- L’innovation du produit
- Une baisse du taux de change permet de baisser les prix des produits dans la monnaie étrangère : c’est la compétitivité-prix qui s’améliore.
- L’intensité de la concurrence pousse les entreprises à améliorer leur compétitivité (prix et hors-prix), mais n’est pas une source de compétitivité hors-prix.
- Un produit de meilleure qualité peut être attractif même si son prix est plus élevé.
- Un produit innovant se différencie des autres et se vend même à des prix plus élevés.
Question 2.17 Complétez le texte
Comment améliorer la compétitivité d’un pays .
- La compétitivité-prix
Il faut agir sur le taux de change, la qualification des travailleurs, le niveau des salaires et les taux d’intérêt qui vont dépendre du monde dans son ensemble du pays dans son ensemble de chaque firme du pays ainsi que sur l’organisation efficace de la production, l’incorporation du progrès technique aux machines qui dépendent plus du monde dans son ensemble du pays dans son ensemble de chaque firme du pays .
- La compétitivité hors-prix
Il faut agir sur la qualité des produits ou leur positionnement en gamme, ce qui dépend du monde dans son ensemble du pays dans son ensemble de chaque firme du pays mais aussi sur la constitution de pôles de compétitivité ou l’environnement réglementaire qui dépendent du monde dans son ensemble du pays dans son ensemble de chaque firme du pays .
La compétitivité désigne donc l’attractivité des biens et services que les entreprises produisent pour les autres entreprises ou pour les consommateurs étrangers. Elle mesure ainsi l’aptitude des entreprises à faire face à la concurrence et, par conséquent, la capacité d’un pays à exporter.
La compétitivité-prix dépend des prix des exportations, déterminés par les coûts de production et de la productivité. Elle désigne l’aptitude à faire face à la concurrence que se livrent les entreprises sur les prix. À produit ou service équivalent, la plus compétitive est celle qui propose les prix les plus faibles.
La compétitivité hors-prix relève de la stratégie des entreprises. Elle désigne la capacité d’une entreprise à résister à la concurrence sans baisser les prix de ses produits. Ainsi, elle continue à être compétitive et à vendre ses produits malgré des prix équivalents, voire supérieurs, parce qu’ils sont innovants, de meilleure qualité ou qu’ils se différencient des autres.
Comment la productivité peut-elle améliorer la compétitivité d’une entreprise ?
Productivité et compétitivité-prix.
Illustration 2.3 Productivité et compétitivité-prix.
Pour améliorer sa compétitivité-prix, une entreprise doit pouvoir maîtriser le coût de production moyen ou unitaire de ses produits, on parle de compétitivité coût. Le coût unitaire dépend à la fois des coûts de production et de la productivité , c’est-à-dire du rapport entre la valeur ajoutée et le volume des facteurs de production mobilisés pour produire.
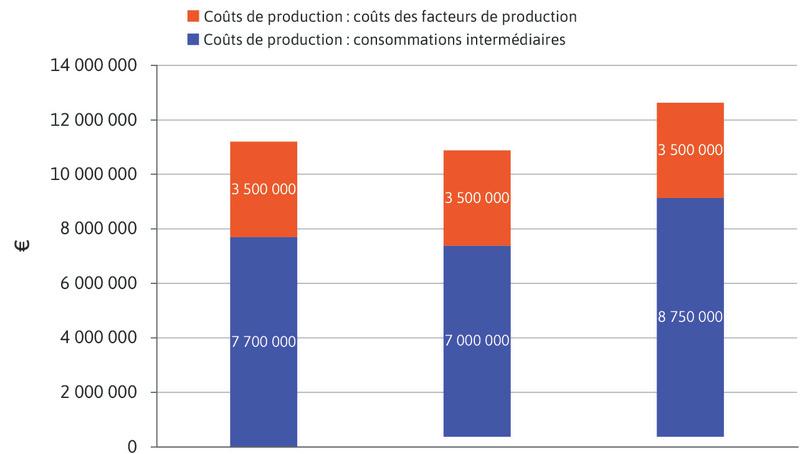
Graphique 2.6 Comment une firme de cosmétique peut-elle améliorer sa compétitivité-prix ?

Maîtriser son coût unitaire et améliorer sa compétitivité-prix ?
Cette entreprise a un coût unitaire (ou moyen) inférieur au prix du marché : ce profit lui permettrait de pratiquer un prix inférieur au prix mondial et d’être compétitive. Comment faire pour encore augmenter sa compétitivité-prix ?
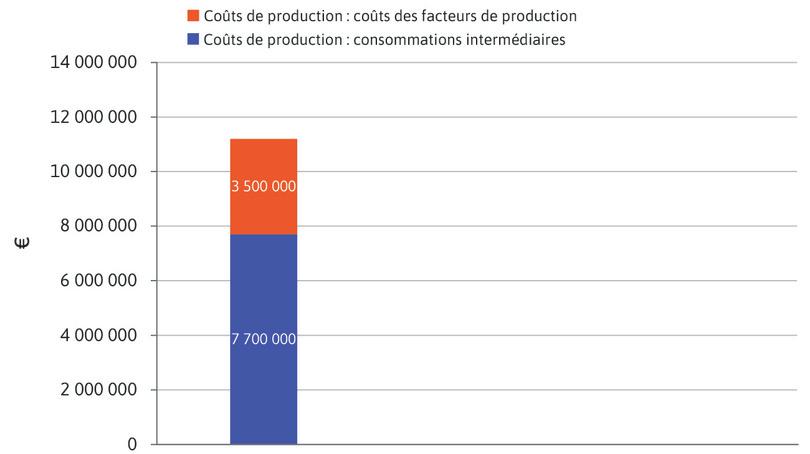
Maîtriser son coût unitaire et améliorer sa compétitivité-prix ? Réduire ses coûts de production
Cette entreprise a des coûts liés à ses consommations intermédiaires (détruites ou transformées lors du processus de production), au travail et au capital fixe (facteurs de production) qu’elle utilise pour produire.
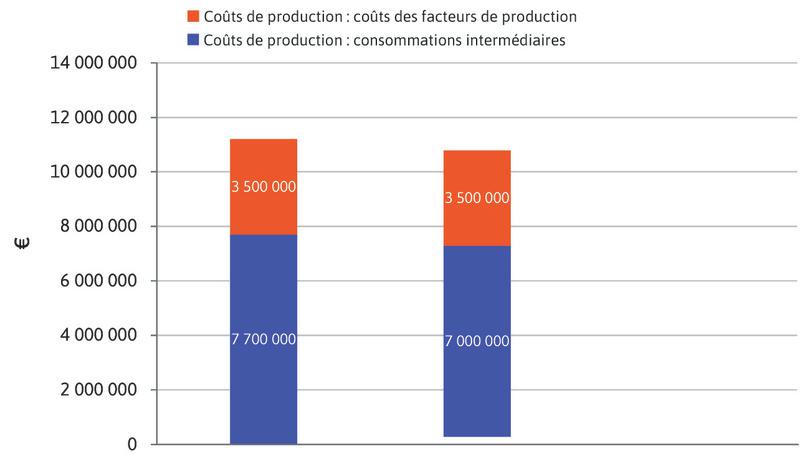
Si l’entreprise obtient une réduction de 700 000 euros des factures de ses fournisseurs, le total de ses coûts de production baisse et le coût unitaire va baisser proportionnellement, car le volume produit ne change pas. La compétitivité-prix s’améliore.

Maîtriser son coût unitaire et améliorer sa compétitivité-prix ? Accroître sa productivité
La productivité mesure le rapport entre la valeur ajoutée par l’entreprise et le volume des ressources qu’elle mobilise, en particulier ses facteurs de production : le travail et le capital. En accroissant la productivité de 25 %, que se passe-t-il ?
Même production avec moindre quantité de facteurs de production ou plus de production avec les mêmes quantités de facteurs de production. Choisissons d’accroître la production. Le volume des facteurs et leurs coûts n’augmentent pas. Il faut cependant augmenter la quantité de consommations intermédiaires utilisées. Le coût unitaire baisse puisque les coûts augmentent moins vite que la production. La compétitivité-prix s’améliore encore… ce qui devrait permettre de vendre la production supplémentaire.
Productivité et compétitivité hors-prix
Nous avons vu en quoi la productivité permettait de baisser les prix en raison d’une augmentation des quantités produites. Voyons maintenant en quoi la qualité, l’innovation et la différenciation des produits sont liées à la productivité.
Afin de vendre ses produits sans avoir à baisser leurs prix, une entreprise doit différencier ses produits de ceux des concurrents. Il peut s’agir d’une différence objective du produit du fait de sa qualité ou de son caractère innovant, mais aussi d’une différence subjective que perçoit le consommateur du fait de l’image de l’entreprise ou de ses marques.
Ainsi, comme nous l’avons vu dans la Section 2.2 , il y a de nombreuses différences objectives de qualité et d’innovation entre une Ferrari 599XX et une Peugeot 208 : c’est une différenciation verticale. Ici, la compétitivité se caractérise par la capacité de Ferrari à vendre ce modèle cent fois plus cher que la Peugeot 208 : il s’agit bien de compétitivité hors-prix, d’une aptitude à résister à la concurrence d’un modèle vendu cent fois moins cher.
Prenons un exemple de produits ne se différenciant ni par la qualité ni par l’innovation, deux paquets de 500 grammes de spaghettis : ils sont fabriqués dans la même usine, avec les mêmes ingrédients et la même recette.
Tableau 2.11 Productivité et compétitivité hors-prix.
Examinons en détail la productivité dans ce cas précis. On voit que la seule différence (à quantité produite égale) est le prix :
En effet, les facteurs de production sont les mêmes puisque les deux paquets de spaghettis sont produits dans la même usine, à Marseille. Comme il s’agit de la même recette, les consommations intermédiaires sont strictement identiques. La différence de productivité, pour la même quantité produite, provient donc seulement du prix.
La productivité supérieure de Panzani est donc indissociable de sa compétitivité hors-prix. Ce n’est que parce que les consommateurs préfèrent cette marque que la firme parvient à vendre ses spaghettis plus cher et à maintenir une meilleure productivité.
Revenons à l’exemple de la Ferrari 599XX et de la Peugeot 208. Dans ce cas aussi la préférence des consommateurs permet à Ferrari de vendre sa voiture beaucoup plus cher, mais cette préférence est basée sur des éléments objectifs qui jouent sur la productivité de cette entreprise.
La qualité de cette voiture exige des consommations intermédiaires beaucoup plus coûteuses, un moteur cinq fois plus puissant, un aspirateur intégré au coffre pour assurer la stabilité contre de simples amortisseurs…
L’innovation est omniprésente et exige des facteurs de production très différents : une fabrication artisanale dans un laboratoire de haute technologie pour Ferrari, une production standardisée à la chaîne pour Peugeot.
Cette stratégie de Ferrari dépend de sa capacité à maintenir des prix presque cent fois plus élevés sans que ses consommations intermédiaires ni ses facteurs de production lui coûtent cent fois plus cher. C’est ainsi que sa productivité contribue à sa compétitivité hors-prix.
La productivité d’une firme fournit donc une mesure de sa capacité à gagner des parts de marché et à faire croître son activité à long terme, c’est-à-dire de sa compétitivité.
Ces vingt dernières années, l’Allemagne a su améliorer son attractivité, notamment en renforçant sa compétitivité-prix. Il apparaît tout d’abord que l’Allemagne, premier pays exportateur d’Europe, a creusé l’écart avec ses partenaires européens, dont la France. En effet, de 2000 à 2016 ses exportations ont augmenté de 150 % contre 75 % seulement pour les exportations françaises ( Graphique 2.7a ).
Cette tendance s’explique en partie, grâce au Graphique 2.7b qui montre l’évolution de la productivité du travail (une approximation de la productivité globale des facteurs). La productivité en Allemagne a bien augmenté plus qu’en France, ce qui sous-tend sa compétitivité-prix et sa compétitivité hors-prix.
Le Graphique 2.7c apporte une information complémentaire : le coût unitaire du travail a beaucoup moins augmenté en Allemagne que dans les pays européens concurrents du fait d’une politique de modération salariale. Ceci améliore la compétitivité allemande.
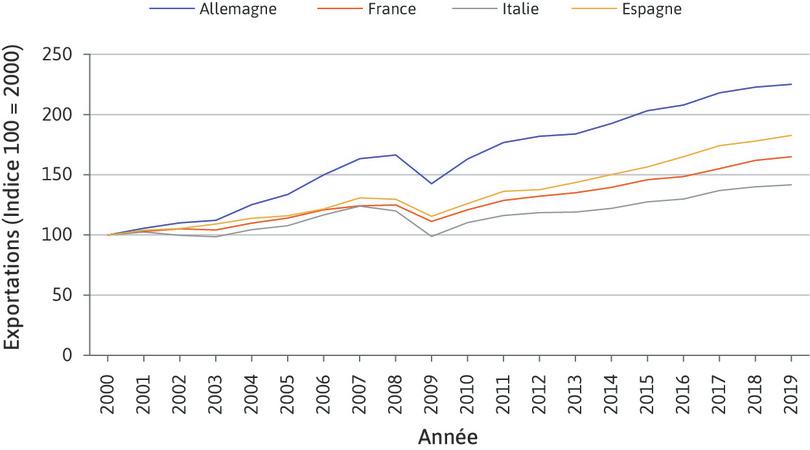
Graphique 2.7a Indice des exportations des principaux pays de la zone euro base 100 en 2000 (2000–16).
Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux.
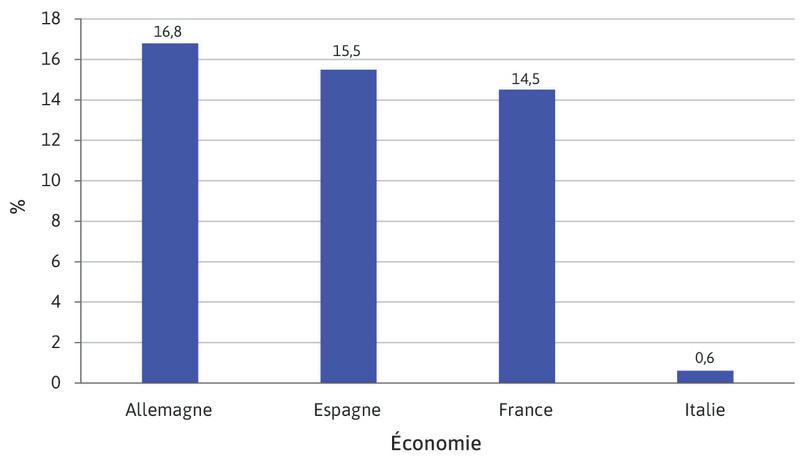
Graphique 2.7b Évolution de la productivité réelle du travail par heure travaillée, en pourcentage (2000–16).
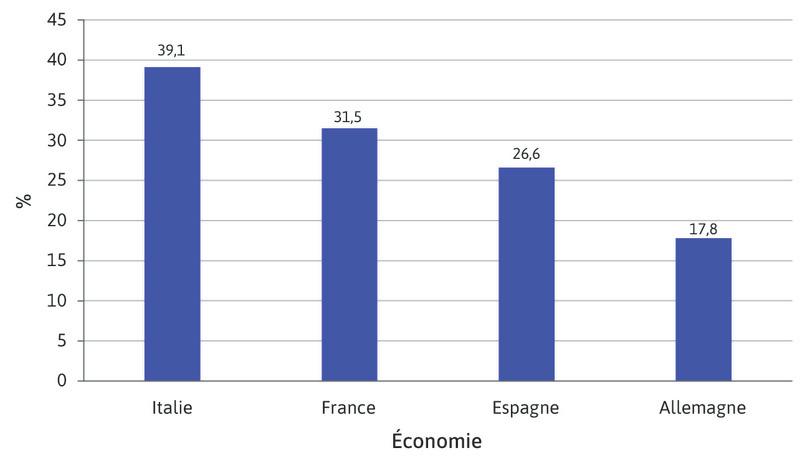
Graphique 2.7c Évolution du coût unitaire de main-d’œuvre en pourcentage (2000–16).
Il y a cependant une exception : l’Italie. En effet, la productivité italienne n’a quasiment pas augmenté durant la période et le coût unitaire de la main-d’œuvre a été à la hausse bien plus qu’en France, or les exportations italiennes ont davantage augmenté que les exportations françaises. C’est dire que l’Italie bénéficie d’une compétitivité hors-prix supérieure à la France, que les produits de ses firmes se différencient et se vendent mieux malgré un double handicap de productivité et de coût du travail ; il peut s’agir de leur qualité comme de leur image.
On voit donc que les pouvoirs publics peuvent contribuer à la compétitivité-prix de leur pays (en veillant à la modération des salaires, des taux d’intérêt et du taux de change) et à sa compétitivité hors-prix (en favorisant l’innovation, la qualité et en cultivant une image différenciée et valorisante). Cependant, l’essentiel de la compétitivité d’un pays provient de la productivité de ses entreprises ; Paul Krugman qualifiait la compétitivité de « mot poétique pour exprimer la productivité d’un pays ». 3
Synthèse L’attractivité des biens et services des entreprises d’un pays dépend à la fois de la compétitivité-prix et de la compétitivité hors-prix. Cette compétitivité traduit la capacité qu’a un pays à exporter. La compétitivité-prix d’une firme s’appuie sur la maîtrise des coûts unitaires. Maîtriser les coûts unitaires suppose, de la part d’une entreprise, de limiter ses coûts de production davantage que ses concurrents, d’améliorer sa productivité plus rapidement que ses concurrents ou de combiner ces deux aspects. La compétitivité hors-prix des entreprises s’appuie sur la différenciation de leurs produits du fait de la qualité ou de l’innovation de leurs produits ou d’une perception différente de leurs produits par les consommateurs. Cette capacité à vendre son produit même si son prix est plus élevé suppose un accroissement de leur productivité tant que le surcroît de valeur ajoutée (venant du surcroît de prix) ne nécessite pas un surcroît trop élevé en termes de facteurs de production. Les pouvoirs publics contribuent enfin à la compétitivité des entreprises d’un pays en améliorant leur environnement réglementaire.
Pourquoi les firmes internationalisent-elles la chaîne de valeur ?
Qu’est-ce que l’internationalisation de la chaîne de valeur .
« Designed by Apple in California, assembled in China », cette indication, qui apparaît sur la plupart des produits de cette marque, montre bien que les échanges internationaux ne consistent plus seulement à produire dans un pays des biens ou des services destinés à des consommateurs finals à l’étranger.
Vous avez déjà observé dans la Section 2.2 que les chaînes de valeur se fragmentent. Or, près de la moitié des échanges internationaux repose sur des chaînes de valeur , c’est-à-dire des flux de matières premières, de produits intermédiaires, de services de transport, de conception ou de marketing ou autres qui traversent les frontières une ou plusieurs fois avant que le produit fini ne soit vendu à son consommateur. On parle alors d’ internationalisation des chaînes de valeur ou de chaînes de valeur mondiale.
« Ainsi, un smartphone assemblé en Chine peut inclure des éléments de conception graphique en provenance des États-Unis, du code informatique élaboré en France, des puces électroniques fabriquées à Singapour et des métaux précieux extraits en Bolivie. » 4
Question 2.18 Choisissez les bonnes réponses
La Figure 0.1 du Rapport sur le développement dans le monde 2020 abrégé de la Banque mondiale illustre l’internationalisation croissante des chaînes de valeur dans le monde de 1970 à 2015. Que peut-on conclure des données de ce graphique ?
- De 1970 à 2015, les échanges internationaux liés aux chaînes de valeur mondiales ont augmenté de 11 points.
- En 2015, les échanges internationaux liés aux chaînes de valeur mondiales représentent 11 points de plus qu’en 1970 dans l’ensemble des échanges mondiaux.
- Rien ne semble pouvoir freiner l’internationalisation des chaînes de valeur depuis 1970 dans le monde.
- La crise financière de 2008 a eu des effets sur l’internationalisation des chaînes de valeur.
- C’est la part des chaînes de valeur mondiales dans les échanges internationaux qui a augmenté de 11 points.
- Leur part était de 37 % en 1970 et de 48 % en 2015, soit 11 points de plus.
- On observe que depuis la crise financière de 2008 la part des chaînes de valeur dans les échanges internationaux ne croît plus.
- En effet, depuis la crise financière de 2008 la part des chaînes de valeur dans les échanges internationaux ne croît plus.
Nous allons voir tout d’abord les raisons de cette internationalisation, puis les formes de ces chaînes de valeur mondiales.
Pourquoi les firmes participent-elles à l’internationalisation de la chaîne de valeur ?
Dans la sous-section précédente, nous avons mentionné des entreprises comme Apple, qui choisissent de réaliser certaines étapes de fabrication de leurs produits dans des régions du monde où les coûts sont peu élevés. Dans la plupart des industries manufacturières, les entreprises implantées dans les pays développés transfèrent une part significative de leur production, auparavant fabriquée localement, dans des pays émergents ou en développement où les salaires sont plus faibles.
D’autres industries, notamment l’habillement, ont localisé leur production essentiellement dans des pays à bas salaires. Plus de 97 % des vêtements et plus de 98 % des chaussures vendus aux États-Unis par des marques et détaillants américains sont fabriqués à l’étranger. La Chine, le Bangladesh, le Cambodge, l’Indonésie et le Vietnam sont devenus les principaux exportateurs mondiaux de textile et de vêtements. À l’époque de la Révolution industrielle , le plus gros exportateur de textile au monde était le Royaume-Uni.
De plus, dans les pays en développement, les coûts additionnels liés aux règles sanitaires et de sécurité sont beaucoup moins élevés, la fiscalité sur les entreprises est faible pour attirer les investissements étrangers et les réglementations environnementales sont souvent moins strictes ; ces pays mènent une politique de dumping social, fiscal et environnemental .
Pourtant, l’objectif d’Apple et des autres entreprises ne se réduit pas à la recherche de la main-d’œuvre la moins chère possible. Les salaires de certains pays où Apple implante une partie de sa production, comme l’Allemagne, sont plus élevés qu’aux États-Unis.
Le Graphique 2.8 montre la destination des investissements directs à l’étranger (IDE) des entreprises américaines lorsqu’elles ont investi dans d’autres entreprises à l’étranger entre 2001 et 2012. Ils ont pour but d’exercer un contrôle sur l’utilisation des ressources au sein de l’entreprise étrangère.
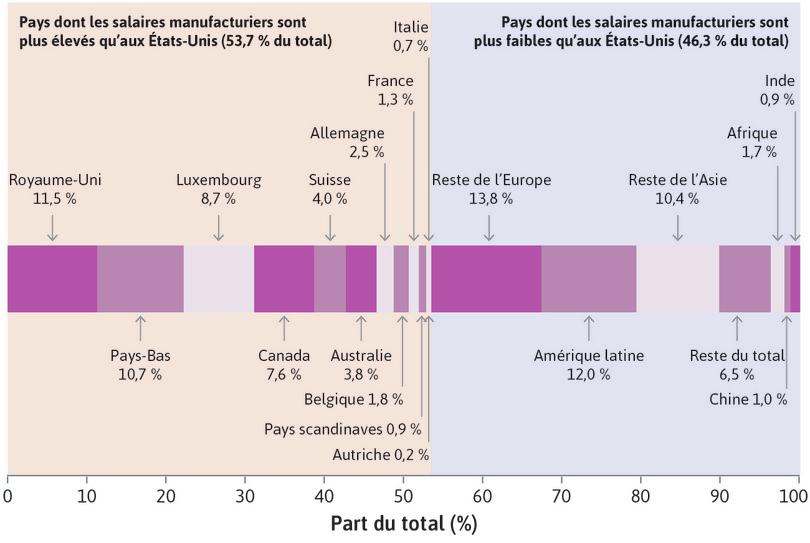
Graphique 2.8 Part des investissements directs à l’étranger des entreprises américaines dans d’autres pays en fonction du niveau des salaires par rapport aux États-Unis (en pourcentage du total des IDE) (2001–12).
United Nations Conference on Trade and Development. 2014. Bilateral FDI Statistics. Note : les données concernent les flux d’IDE américains. Les pays identifiés comme ayant des salaires manufacturiers supérieurs à ceux des États-Unis sont les pays dans lesquels, selon le département du Travail des États-Unis (US BLS International Labor Comparisons), la moyenne du salaire horaire dans le secteur manufacturier sur la période 2005–09 est supérieure à la moyenne américaine observée sur la même période.
De façon surprenante, lorsque les entreprises américaines ont décidé de produire hors des États-Unis, elles se sont majoritairement orientées vers l’Europe, principalement dans des pays où les salaires étaient plus élevés qu’aux États-Unis. Les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont à eux seuls reçu plus d’investissements américains que l’Asie et l’Afrique réunies. De ce point de vue, la localisation des usines Ford dans le monde présentée dans le Graphique 2.1 est atypique, puisque Ford a bien plus de salariés en Chine, au Brésil, en Thaïlande et en Afrique du Sud qu’en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada, en Belgique et en France.
La localisation de chaque activité des chaînes de valeur n’a donc pas comme seul fondement le coût de la main-d’œuvre :
- Le coût du facteur capital va lui aussi jouer sur les coûts de production : des taux d’intérêt modérés et l’accès aux marchés financiers sont des facteurs importants dans la décision de localiser une activité dans un pays.
- La productivité des facteurs de production permet, elle aussi, de réduire le coût unitaire de production. C’est pourquoi le niveau d’éducation d’un pays, sa densité technologique et la propension à innover expliquent le maintien des activités de conception, de recherche-développement dans les pays développés.
- Les autres coûts de production, liés aux consommations intermédiaires, vont être pris en compte, en particulier lorsque les matières premières ne sont pas produites sur place.
- La possibilité d’accéder à un marché élargi est enfin un déterminant essentiel en particulier pour la localisation des activités de distribution, de marketing et de services après-vente du produit fini.
Là encore, les politiques des États peuvent favoriser la localisation de certaines activités, par la signature de traités de libre-échange et l’harmonisation de normes techniques avec d’autres pays pour élargir le marché accessible, ou la protection de la propriété intellectuelle pour attirer des activités innovantes notamment.
L’internationalisation de la chaîne de la valeur s’explique donc par les mêmes raisons que les échanges internationaux dans leur ensemble : par les différentes dotations factorielles et technologiques des pays d’implantation, par les différences de coûts relatifs de production, par les économies d’échelle et par l’accès au marché. La spécificité des échanges des chaînes de valeur mondiales réside dans le fait que ceux-ci font suite à une spécialisation sur la production d’un élément d’un produit fini et pas sur la production du produit fini lui-même.
Comment les firmes participent-elles à l’internationalisation de la chaîne de valeur ?
L’internationalisation de la chaîne de valeur se réalise de différentes manières.
Des firmes achètent des produits intermédiaires ou vendent leurs produits à des firmes étrangères parce que les prix mondiaux du marché concerné les y incitent.
Tableau 2.12 Les pays exportateurs des principaux composants d’une bicyclette.
OECD, Trading for Development in the Age Of Global Value Chains , 2020
Le Tableau 2.12 montre que le marché de la bicyclette est un marché mondial où s’échangent des composants provenant de nombreux pays. Par exemple, l’entreprise française Lapierre conçoit et assemble des bicyclettes qu’elle distribue dans le monde entier à partir de cadres qu’elle achète en Chine, de freins et de dérailleurs qu’elle achète au Japon et de selles italiennes. À tout moment, selon l’évolution du prix et de la qualité des composants, elle peut choisir de se fournir dans d’autres pays.
Des firmes externalisent certaines de leurs activités auprès de firmes étrangères avec lesquelles elles signent des partenariats stratégiques (parfois exclusifs).
Lorsqu’une entreprise externalise une partie de son activité, elle en confie la production à une entreprise partenaire indépendante avec laquelle elle signe un contrat à long terme. Ce contrat précise les quantités et les prix de ce qui doit être fourni (bien ou service), mais aussi d’autres éléments (secret industriel, techniques de production, par exemple). Il peut s’agir d’un contrat exclusif : dans ce cas l’entreprise partenaire ne produit que pour l’entreprise qui a externalisé.
Question 2.19 Choisissez les bonnes réponses
Quelles sont les affirmations correctes d’après cette page d’un rapport publié par Apple ?
- Apple externalise toutes ses activités, même la conception de ses produits.
- Les fournisseurs d’Apple lui vendent des biens, pas des services.
- Le contrat qui lie Apple et ses fournisseurs ne porte pas uniquement sur les produits.
- Apple contrôle que ses fournisseurs respectent des normes sociales et environnementales.
- Dans le rapport, aucune activité de conception ni de recherche n’apparaît ; celles-ci restent intégrées et produites par Apple.
- L’assemblage, la logistique, la vente et le recyclage sont des services qui ajoutent de la valeur aux produits d’Apple.
- En effet, Apple détermine non seulement les biens et services fournis mais aussi certaines conditions dans lesquelles il faut les produire (pas de travail des enfants, par exemple).
- Apple affirme évaluer ses fournisseurs, veiller à l’application de règles portant sur « les personnes et les communautés » et pas seulement les produits.
La franchise est une forme fréquente d’externalisation des activités de distribution d’une entreprise, celles qui sont les plus proches du consommateur final. Voyons, par exemple, comment une entreprise indépendante peut signer un partenariat de franchise avec Starbucks. En France, la firme Starbucks va exiger un droit d’entrée de 35 000 euros et occasionner 500 000 euros d’investissement pour ouvrir un salon de café. Bien évidemment, la franchise est un partenariat exclusif, l’entreprise indépendante ne peut pas vendre d’autres produits que ceux de Starbucks. S’ajoutent ensuite deux redevances : 6 % du chiffre d’affaires au titre de l’exploitation et 3 % au titre de la publicité. Le droit d’entrée et les redevances permettent de financer la conception du design et des procédures d’opération, le marketing, la formation du personnel. Une fois le contrat signé et le site d’implantation validé par Starbucks commence un programme d’immersion de ces franchisés indépendants.
Grâce à des investissements directs à l’étranger (IDE), les firmes multinationales localisent à l’étranger des filiales qui réalisent une partie de leur valeur ajoutée.
Une filiale est une entreprise qui appartient à un groupe : son capital est détenu à plus de 50 % par une société mère. Si un groupe possède une ou des filiales qui produisent à l’étranger, il s’agit d’une firme multinationale (ou firme transnationale). Une firme multinationale implante des filiales à l’étranger grâce à des investissements directs à l’étranger : absorption d’une entreprise étrangère (par l’achat de la majorité de ses actions), réinvestissement des bénéfices de la filiale ou création à l’étranger d’une nouvelle filiale du groupe.
Le Tableau 2.13 indique que la firme multinationale L’Oréal a de nombreuses filiales à l’étranger, essentiellement constituées d’entreprises produisant à proximité des principaux marchés. Les échanges entre ces filiales sont appelés commerce intrafirme, car ils ne transitent pas par le marché. Par exemple, L’Oréal Égypte n’offre pas ses produits à son concurrent Estée Lauder, mais les vend à d’autres filiales au prix déterminé par la société mère.
Tableau 2.13 L’implantation des usines du groupe L’Oréal.
L’Oréal, Rapport annuel , 2019.
L’internationalisation de la chaîne de valeur s’effectue donc de trois manières (Cf. Tableau 2.12 ) :
- La production d’entreprises totalement autonomes qui importent des produits intermédiaires, y ajoutent de la valeur et les réexportent sous une forme plus élaborée.
- L’externalisation d’une étape de production auprès d’autres entreprises dans différents pays avec lesquelles s’opéreront des échanges internationaux.
- Les échanges intrafirmes entre les filiales des firmes multinationales.
Un contrat de franchise est une des formes de l’externalisation.
L’internationalisation des chaînes de valeur est en grande partie maîtrisée par des firmes multinationales. Un groupe mondial peut s’appuyer à la fois sur des filiales et sur l’externalisation auprès de partenaires indépendants. Starbucks opère ainsi à l’étranger par l’intermédiaire de 5 860 salons de café qu’elle détient directement (filiales), mais aussi grâce à 7 329 salons de café franchisés (externalisation). 5
Synthèse L’internationalisation des chaînes de valeur a contribué à multiplier les échanges internationaux. Il s’agit de la production dans des pays différents des étapes successives qui vont de la conception d’un produit à sa vente au consommateur final. Elle implique qu’une partie des importations de chaque pays va être exportée de nouveau sous une forme plus élaborée après qu’une valeur aura été ajoutée au produit sur place. Les choix de localisation internationale des étapes d’élaboration d’un produit s’expliquent par : Le coût de production unitaire, c’est-à-dire surtout par les coûts des facteurs de production, en particulier de la main-d’œuvre, et par leur productivité. L’accès au marché. Cette internationalisation des chaînes de valeur s’effectue de plusieurs manières, mais elle est grandement dominée par des firmes multinationales qui externalisent certaines activités auprès d’entreprises partenaires ou qui, préférant une plus forte intégration, les produisent dans des filiales implantées à l’étranger.
- 2.4 Quels sont les effets du commerce international qui, pour une part, posent les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme ?
Quels sont les effets induits par le commerce international ?
Des gains moyens en termes de baisse de prix.
Dans la Section 2.2 , vous avez fait connaissance avec Greta sur l’île des Délices et Carlos sur l’île du Bonheur, qui produisent et consomment tous les deux des pommes et du blé. Vous avez compris qu’il est avantageux pour chacun d’eux de se spécialiser parce que leur productivité diffère. Dans cette section, nous nous intéresserons aux effets que cette spécialisation induit, en prolongeant l’analyse de la Section 2.2 .
Supposons que Carlos peut produire au cours d’une année 3 tonnes de blé ou 1,5 tonne de pommes. Puisqu’il faut la même quantité de facteurs de production (terre et travail) pour produire 3 tonnes de blé que pour produire 1,5 tonne de pommes, chaque tonne de blé coûte autant que 0,5 tonne de pommes (1,5/3). Ainsi, le prix relatif du blé par rapport aux pommes est de 0,5, c’est-à-dire que la tonne de blé vaut 500 kg de pommes sur l’île du Bonheur.
Greta, quant à elle, peut produire 3 tonnes de pommes par an ou 1,5 tonne de blé. Le prix relatif du blé par rapport aux pommes sur l’île des Délices est donc de 2 (3/1,5).
L’île du Bonheur a donc un avantage comparatif dans la production du blé. Rappelez-vous les acquis de la Section 2.2 : une économie a un avantage comparatif dans la production d’un bien lorsqu’il est relativement moins coûteux dans cette économie (en l’absence de commerce).
Le prix relatif des pommes est simplement l’inverse du prix relatif du blé, donc si l’île du Bonheur a un avantage comparatif dans la production du blé, l’île des Délices aura un avantage comparatif dans la production de pommes. Le Tableau 2.14 synthétise les chiffres clés de cet exemple. Les prix relatifs du bien dans lequel chaque île a un avantage comparatif sont indiqués en gras.
Tableau 2.14 Prix relatifs du blé et des pommes sur chacune des îles.
Supposons à présent qu’il n’existe pas de coûts à l’échange (transport gratuit, absence de droits de douane) : les pommes et le blé s’échangent alors sur un seul marché unifiant les deux îles ; le prix relatif du blé et des pommes deviendra donc le même dans les deux îles. Quel sera le nouveau prix ?
En cas de commerce entre ces îles, les prix se situeront donc à un niveau intermédiaire des prix des deux économies quand elles étaient en autarcie (entre 0,5 et 2).
Si Greta était la seule équipée d’une barque pour établir ce commerce, elle pourrait négocier ses pommes le plus cher possible sans que Carlos ne puisse se rendre sur l’île des Délices et voir qu’il en coûte sur place seulement 0,5 tonne de blé pour une tonne de pommes. Greta dispose donc d’un pouvoir de marché ; pour augmenter ses gains à l’échange , elle choisira un prix supérieur à 0,5. Cependant, si elle atteignait un prix de 2 tonnes de blé par tonne de pommes, elle éliminerait complètement les gains à l’échange de Carlos. À ce prix, Carlos aurait tout intérêt à produire ses pommes lui-même plutôt que les acheter à Greta. Un raisonnement identique aboutirait à un résultat symétrique si Carlos était le seul à disposer d’une barque. Les nouveaux prix s’établissent donc entre ces deux extrêmes (< 2 et > 0,5) et se rapprochent d’un pays à l’autre ; les prix des biens importés baissent dans tous les cas.
Si, contrairement à notre hypothèse, les échanges entre deux marchés nationaux sont coûteux du fait du fret, des tarifs douaniers ou d’autres coûts, les prix relatifs auront moins tendance à se rapprocher d’un pays à l’autre.
Pour illustrer les effets du commerce international sur les prix, prenons l’exemple des écarts de prix du blé entre le Royaume-Uni et les États-Unis (exprimé en pourcentage). Avant 1840, les échanges étaient faibles, l’ écart de prix fluctuait beaucoup et restait important, oscillant autour de 100 % : le prix du blé était donc deux fois supérieur au Royaume-Uni. Il commença ensuite à diminuer au moment même où les coûts d’expédition se réduisaient, en raison de l’introduction de bateaux à vapeur capables d’effectuer des trajets sur une longue distance. Les échanges entre les deux pays s’intensifièrent : les quantités de blé américain importées par le Royaume-Uni augmentèrent. L’écart de prix avait presque disparu en 1914, période à laquelle le volume de blé importé par le Royaume-Uni augmenta considérablement.
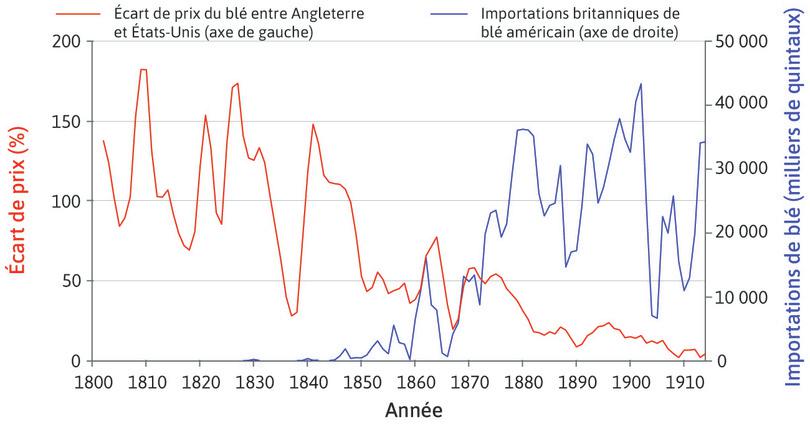
Graphique 2.9 Écart de prix entre le Royaume-Uni et les États-Unis (en pourcentage) et importations britanniques de blé américain (en milliers de quintaux) (1800–1914).
Figure 3 dans Kevin H. O’Rourke et Jeffrey G. Williamson. 2005. ‘From Malthus to Ohlin: Trade, Industrialization and distribution since 1500’. Journal of Economic Growth 10 (1) (March) : pp. 5–34.
Le commerce transatlantique du blé n’est pas un exemple isolé. Les écarts de prix internationaux de nombreuses marchandises ont beaucoup diminué entre 1815 et 1914, la première ère de la mondialisation moderne qui voit s’ouvrir de nouvelles routes commerciales.
La diminution moins importante des écarts de prix à la fin du 19 e siècle tient souvent à l’augmentation des droits de douane dans de nombreux pays pour des raisons que nous expliquerons plus tard, qui a contrebalancé les effets de la baisse des coûts de transport.
Puisque chaque pays se spécialise dans une production, dont le prix relatif est plus faible que dans le reste du monde, la mondialisation devrait conduire à une baisse des prix relatifs des importations. En effet, un moteur de la spécialisation réside dans le fait que chaque pays se procure davantage de produits importés que s’il les avait produits en autarcie.
Cette réduction des prix des produits échangés s’explique par la spécialisation selon la dotation factorielle et technologique de chaque pays. Cette meilleure allocation mondiale des facteurs de production sous-tend la baisse des prix observée.
Question 2.20 Complétez le texte
Supposez qu’il y ait seulement deux pays dans le monde, l’Allemagne et la Turquie, chacun ayant le même nombre de travailleurs. Au cours d’une période donnée, chaque travailleur en Allemagne peut produire trois automobiles ou vingt télévisions, chaque travailleur en Turquie peut produire deux automobiles ou trente télévisions.
- En Allemagne, le prix relatif des automobiles en l’absence de commerce international est de 0,15 3 6,67 automobiles par télévision télévisions par automobile euros alors qu’en Turquie il est de 0,07 2 15 automobiles par télévision télévisions par automobile euros .
- Supposez maintenant que l’Allemagne et la Turquie s’ouvrent à l’échange : le prix relatif mondial des automobiles sera alors compris (en l’absence de coûts à l’échange) entre 3 6,67 15 et 15 20 30 .
- Si le prix relatif mondial des automobiles est de 10, dans quel bien l’Allemagne va-t-elle se spécialiser ? La production d’automobiles de télévisions des deux produits .
De plus, vous l’avez découvert dans la Section 2.2 , dans certains secteurs, la production de biens ou de services à grande échelle donne lieu à une baisse du coût unitaire (ou moyen), à des économies d’échelle. Le commerce international est favorable aux entreprises de ces secteurs, car il leur donne accès à de vastes marchés mondiaux, quelle que soit la taille de leur marché intérieur. À terme, le commerce international va être, dans ces secteurs, favorable au développement d’entreprises de très grande taille qui vont avoir des coûts de production unitaires très faibles et qui vont ainsi pouvoir baisser leurs prix.
L’accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays
Carlos sur l’île du Bonheur et Greta sur l’île des Délices ont tous deux intérêt à commercer, alors pourquoi la question des importations et exportations est-elle souvent controversée ?
Contrairement à l’histoire de Greta et Carlos, il n’y a pas un seul habitant par pays et les échanges internationaux nés de la spécialisation des pays génèrent presque toujours à la fois des gagnants et des perdants dans chaque pays. Les processus de spécialisation et d’échange affectent différemment les régions, les industries et les ménages.
Dès lors, pour comprendre les problèmes liés à la mondialisation, il faut considérer au moins deux types d’individus à l’intérieur de chaque pays : simplifions en considérant seulement les détenteurs de capital qui vivent des profits que génèrent leurs capitaux et les salariés qui ne vivent que des salaires que génère leur travail. Commençons par un modèle à deux pays, le pays A et le pays B, dont la spécialisation est fondée sur les dotations factorielles.
Supposez, pour simplifier, que le pays A et le pays B ne produisent que deux biens, pour lesquels les rendements d’échelle sont constants : des avions commerciaux et des produits électroniques grand public (comme des consoles de jeux, des ordinateurs personnels et des télévisions).
On considère que la production d’avions est à forte intensité capitalistique alors que les produits électroniques grand public exigent relativement plus de main-d’œuvre. Supposons enfin que le travail est abondant relativement au capital dans le pays B, et qu’au contraire, dans le pays A, le capital est relativement abondant.
Compte tenu de ces hypothèses, le pays B a un avantage comparatif dans la production du bien intensif en facteur de production dont elle est davantage dotée, les biens électroniques grand public dont la production intensive en travail , et un désavantage comparatif dans la production d’avions (intensif en facteur capital). Lorsque ces économies auront la possibilité de commercer entre elles, le pays A se spécialisera dans la production d’avions et le pays B dans la production de biens électroniques grand public.
Cela aura des conséquences différentes sur les détenteurs du capital et sur les salariés.
L’emploi
L’augmentation de la production d’avions dans le pays A induit un accroissement de la demande pour le facteur de production utilisé de façon intensive dans cette industrie, le capital. En revanche, le facteur travail va être relativement moins demandé et des emplois risquent d’être détruits.
Dans le pays B, c’est la demande pour le facteur travail qui augmente, les besoins en capitaux sont relativement moindres. De nombreux emplois vont être créés du fait de cette spécialisation dans l’électronique grand public.
Les inégalités de revenu
- Les gagnants dans le pays A : les détenteurs du capital bénéficient davantage de l’ouverture au commerce international que les salariés. En effet, le capital devient relativement rare à mesure que la production d’avions augmente et relativement peu d’emplois sont créés. Par conséquent, les revenus du travail baissent relativement aux revenus du capital.
- Les gagnants dans le pays B : la demande de travail augmente, car beaucoup d’emplois sont créés dans l’électronique grand public. Les salaires augmentent avec l’intensité de la concurrence que se livrent les entreprises pour recruter des salariés. Cette augmentation se réalise au détriment de la part relative des profits qui rémunèrent les détenteurs du capital.
Cet exemple permet de comprendre, dans une certaine mesure, la situation relative des États-Unis et de la Chine, pour peu que l’on assimile la situation états-unienne à celle du pays A et la situation chinoise à celle du pays B. Les salariés chinois, du fait de la spécialisation de leur pays, obtiennent des salaires croissants, qui leur permettent de sortir de la pauvreté. Par ailleurs, les inégalités de revenus entre les détenteurs du capital et les salariés s’accroissent aux États-Unis du fait de leur spécialisation dans un secteur à forte intensité capitalistique.
La situation des détenteurs du capital en Chine est cependant, dans la réalité, plus complexe, car la production d’électronique grand public n’est pas financée uniquement par des capitaux chinois du fait de l’internationalisation des chaînes de valeur.
Les consommateurs, qu’ils soient salariés ou détenteurs de capitaux, vont tous bénéficier de la baisse des prix des biens importés que nous avons démontrée plus haut. De ce point de vue, le cas le plus intéressant est celui des salariés des États-Unis. En tant que consommateurs de biens électroniques, les salariés américains bénéficient des importations d’électronique grand public en provenance de Chine, car le prix des biens électroniques baisse. Ainsi, un salarié y perd en tant que travailleur, mais y gagne en tant que consommateur. Reste à savoir s’il y a compensation, cela dépend à la fois de l’évolution de son salaire et de la structure de sa consommation.
Question 2.21 Choisissez les bonnes réponses
Dans l’exemple concernant le pays A et le pays B, nous avons décrit l’impact de la mondialisation sur les inégalités de revenus entre détenteurs de capital et salariés. La même logique continuerait à s’appliquer si nous considérions d’autres facteurs de production. Par exemple, considérez deux industries qui ont besoin de travailleurs avec des niveaux de qualification différents : une industrie intensive en travail qualifié (technologies de l’information) et une industrie intensive en travail non qualifié (l’assemblage d’articles électroniques).
Que devrait-il se passer si un pays développé qui dispose d’une dotation relativement abondante en main-d’œuvre qualifiée échange avec un pays en développement qui dispose d’une dotation relativement abondante en main-d’œuvre non qualifiée ?
- Le pays développé se spécialise dans les technologies de l’information et le pays en développement dans l’assemblage d’articles électroniques.
- Les inégalités entre les salaires des actifs qualifiés et des actifs non qualifiés augmentent dans le pays en développement.
- Les inégalités entre les salaires des actifs qualifiés et des actifs non qualifiés augmentent dans le pays développé.
- Le niveau de qualification augmente dans le pays développé.
- Chaque pays se spécialise dans l’activité la plus intensive dans le facteur de production dont il est le plus doté. Ainsi, les pays développés, qui disposent d’une main-d’œuvre plus qualifiée, se spécialisent dans les technologies de l’information qui sont intensives en travail qualifié.
- Elles devraient diminuer, car la demande de main-d’œuvre non qualifiée est forte ce qui pousse les salaires des actifs non qualifiés à la hausse.
- À la suite de la spécialisation, la demande de travail qualifié augmente, ce qui pousse les salaires les plus qualifiés à la hausse, alors que les salaires déjà plus bas des travailleurs non qualifiés diminuent du fait de la faible demande de travail non qualifié.
- Pas à court terme car, même si les travailleurs non qualifiés ont intérêt à essayer de répondre à la forte demande de travail qualifié, cela n’est possible qu’en acquérant des compétences nouvelles, ce qui est long et difficile.
Lors de la première phase de mondialisation à la fin du 19 e siècle, le commerce impliquait l’échange de biens agricoles nécessitant une grande quantité de terre (nourriture et matières premières, comme le coton) contre des biens manufacturés intensifs en travail. Les biens agricoles étaient exportés par des pays où la terre était abondante (et la main-d’œuvre rare), comme les États-Unis, le Canada, l’Australie, l’Argentine et la Russie. Les biens manufacturés étaient exportés par des pays du nord-est de l’Europe où la main-d’œuvre était abondante (et la terre rare), comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Dans ce contexte, les grands perdants étaient les propriétaires terriens européens et les travailleurs des régions où la terre était abondante.
C’est pourquoi les propriétaires terriens européens se sont opposés au libre-échange et ont réussi, dans des pays comme la France et l’Allemagne, à obtenir de l’État la mise en place de droits de douane sur les importations agricoles.
Il faut noter que les échanges internationaux entre pays comparables mobilisent les mêmes facteurs de production des deux côtés de la frontière et qu’ils ne font donc ni gagnants ni perdants : ils n’ont pas d’effets sur les inégalités au sein des pays concernés.
La réduction des inégalités entre pays
Les États-Unis sont un pays développé avec une longue tradition de production de biens manufacturés. La Chine est moins développée, mais est devenue la deuxième économie du monde en exportant également des biens manufacturés. Le Graphique 2.10 montre, entre autres, l’évolution des salaires versés aux travailleurs du secteur manufacturier chinois rapportés aux salaires versés aux travailleurs du secteur manufacturier américain. Il indique, par exemple, que, en 2002, le salaire des travailleurs chinois représentait encore moins de 3 % du salaire reçu par les travailleurs américains, mais qu’en 2010 leur salaire représentait 10 % du salaire des travailleurs américains.
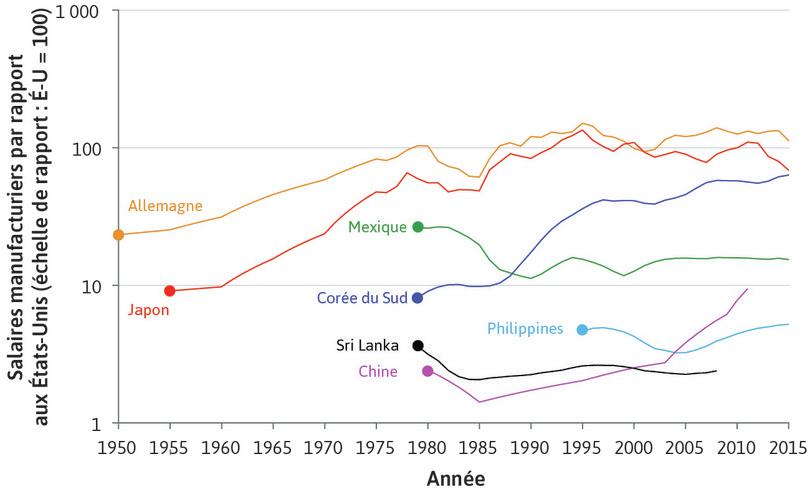
Graphique 2.10 Indice des salaires dans l’industrie manufacturière dans différents pays par rapport aux États-Unis entre 1950 et 2015 (salaires dans l’industrie manufacturière aux États-Unis base 100).
Andrew Glyn. 2006. Capitalism Unleashed: Finance, Globalization, and Welfare. Oxford: Oxford University Press; (2) National Bureau of Statistics of China. Annual Data; (3) Bank of England; (4) US Bureau of Labor Statistics. 2015. International Labor Comparisons. Remarque : les données annuelles du BLS (Département du Travail) américain relatives au Mexique, aux Philippines et au Sri Lanka ont été lissées à l’aide d’une moyenne mobile établie sur les cinq dernières années. Note de lecture : il s’agit d’un graphique semi-logarithmique comme le montre l’axe des ordonnées. Cette représentation minore le rattrapage des salaires par rapport aux États-Unis mais permet de comparer les rythmes d’évolution de pays très différents.
Le Graphique 2.10 permet de tirer trois conclusions principales pour l’industrie manufacturière :
- Les écarts de salaires sont très élevés d’un pays à l’autre. Ils sont tellement considérables qu’il a fallu adopter ce type de représentation graphique semi-logarithmique. Ainsi, en 1985, les salaires chinois sont plus de cinquante fois (indice < 2) plus faibles que les salaires aux États-Unis.
- La spécialisation de certains pays dans l’industrie manufacturière s’accompagne généralement d’une réduction des écarts avec les salaires aux États-Unis. Le rattrapage est complet en Allemagne et au Japon dans les années 1980 et l’est presque en Corée en 2015. L’écart concernant les salaires chinois se réduit lui aussi.
- Il n’y a pas de rattrapage pour certains pays dont les salaires restent très éloignés des salaires états-uniens, voire dont l’écart avec les États-Unis s’accroît, comme c’est le cas pour le Mexique malgré l’accord de libre-échange qui lie ces deux pays (et le Canada) depuis 1994.
Les deux premières conclusions coïncident bien avec la logique des avantages comparatifs. En effet, ces avantages proviennent d’écarts entre les coûts unitaires de production, dont les salaires font partie. De même, comme nous l’avons vu avec le modèle simplifié du commerce entre la Chine et les États-Unis, la spécialisation chinoise dans les biens manufacturés exerce une pression à la hausse des salaires, car la demande de travail augmente.
Pourquoi y a-t-il des exceptions ? Pourquoi les salaires de l’industrie manufacturière au Mexique sont-ils de plus en plus éloignés de ceux des États-Unis ?
L’exemple des exportations automobiles du Mexique vers les États-Unis permet de mieux comprendre cette situation. En effet, sur 100 dollars de véhicules exportés du Mexique vers les États-Unis, une valeur de 37 dollars seulement a été ajoutée au Mexique ; 63 dollars proviennent de l’étranger… dont 38 dollars proviennent des États-Unis eux-mêmes. 6 L’internationalisation de la chaîne de valeur de l’industrie automobile est maîtrisée, dans ce cas, par des firmes multinationales qui localisent par exemple des activités de conception, de marketing aux États-Unis et des activités d’assemblage au Mexique. Les qualifications exigées et les salaires versés pour chacune de ces activités sont bien sûr très différents et contribuent à maintenir un écart de salaires entre ces deux pays. De plus, le Mexique est incité à maintenir des salaires faibles, voire à pratiquer un dumping social , afin d’éviter que les firmes multinationales ne localisent cette activité dans un autre pays (Cf. Pour en savoir plus ci-dessous).
Question 2.22 Choisissez les bonnes réponses
La spécialisation entre pays comparables peut être basée sur les économies d’échelle obtenues sur certains marchés. Reprenons l’exemple de la France et de l’Italie, mais supposons maintenant que seule la production de véhicules utilitaires permette de réaliser des économies d’échelle (car il y a moins de modèles différents). Quelles sont les caractéristiques du pays qui va être gagnant d’une telle spécialisation sur ce type de marché ?
- Un pays qui développe l’espionnage industriel pour éviter les coûts liés à la recherche-développement sur ce marché.
- Un pays qui a une demande intérieure assez importante sur ce marché.
- Un pays qui développe des pôles de compétitivité où centres de recherche, universités et entreprises travaillent sur des projets communs.
- Un pays qui favorise la concurrence entre les entreprises et empêche les fusions-absorptions sur ce marché.
- L’espionnage représente un coût qui peut être supérieur à celui de la recherche-développement, en particulier en cas de mesures de rétorsion des pays partenaires et de condamnation par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
- Les entreprises nationales peuvent commencer à réaliser des économies d’échelle et à gagner en compétitivité avant même d’exporter.
- Cela permet de baisser les coûts de la recherche et développement et favorise l’innovation.
- Pour qu’il y ait des économies d’échelle, les entreprises doivent accroître leur taille.
Question 2.23 Complétez le texte
Vous pourrez effectuer votre choix à partir de ce que nous venons d’étudier, et ainsi restituer la citation de l’économiste américain Paul Krugman.
« Une décision courageuse petite avance spécialisation prise par une région se cumulera au fil du temps, les exportations importations économies d’échelle de la région de tête région peuplée zone à la traîne évinçant le secteur industriel des régions de tête régions peuplées zones à la traîne . » 7
Pour en savoir plus : une internationalisation inégalitaire de la chaîne de valeur peut-elle être favorable ?
Nous avons vu que, en termes d’inégalités, la situation du Mexique était due à un partage inégalitaire de la valeur ajoutée le long de la chaîne de valeur mondiale de la production automobile.
Examinons l’évolution de la situation du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de l’industrie des équipements électriques et optiques dans le Graphique 2.11 . Cette production est surtout destinée au marché mondial et est en très grande partie exportée.

Graphique 2.11 Valeur ajoutée du secteur des équipements électriques et optiques au Vietnam (en pourcentage et en millions de dollars).
Ana Paula Cusolito, Raed Safadi et Daria Taglioni, Inclusive Global Value Chains : Policy Options in Trade and Complementary Areas for GVC Integration by Small and Medium Enterprises and Low-Income Developing Countries , OCDE - La Banque mondiale, 2017.
La part de la valeur qui a été ajoutée au Vietnam a beaucoup baissé, perdant presque 14 points en passant de 44,7 % en 1995 à 30,8 % en 2011. Cela signifie qu’en 2011 près de 70 % de la valeur de cette production n’est pas destinée aux salariés ou aux investisseurs vietnamiens contre 55,3 % en 1995. En 16 ans, les inégalités entre le Vietnam et les autres pays participant à cette production ont donc nettement augmenté.
Cependant, la partie droite du Graphique 2.11 montre que les entreprises qui ont localisé leur activité au Vietnam ont tellement développé leur activité que la valeur ajoutée sur place a été multipliée par 19 (3,8/0,2). Autrement dit, ce partage inégal a été favorable à l’emploi au Vietnam, ainsi qu’aux salariés sur place, aux fournisseurs locaux et aux éventuels investisseurs vietnamiens.
Pour illustrer cette idée, on pourrait affirmer que le Vietnam a bénéficié d’une plus petite part d’un gâteau bien plus gros.
Synthèse Le commerce international induit des effets importants sur les prix et les revenus, c’est-à-dire sur le partage des richesses dans le monde. Il réduit tout d’abord le prix des produits importés du fait de la spécialisation en fonction des prix relatifs ou bien grâce aux économies d’échelles dues à certaines spécialisations (ce qui peut aussi réduire le prix de certains produits nationaux). Il réduit les écarts de prix entre les pays qui commercent entre eux. Il tend, mais d’autres causes sont également à prendre en compte, à augmenter les inégalités de revenus au sein des pays : Il augmente les revenus des personnes qui apportent les facteurs de production recherchés pour satisfaire les besoins de la spécialisation du pays (par exemple dans les pays avancés, il peut s’agir des acteurs qui apportent le capital et la main-d’œuvre qualifiée). Il baisse la part des revenus des personnes qui apportent les facteurs de production peu recherchés (par exemple dans les pays avancés, il peut s’agir des acteurs qui apportent un travail non qualifié). Il réduit les inégalités entre les pays qui participent à l’échange même si cette évolution est parfois freinée par les imperfections du marché qui accompagnent l’internationalisation des chaînes de valeur.
Quels sont les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme ?
Quels avantages et inconvénients le libre-échange présente-t-il .
Regardez la vidéo « Comprendre les enjeux du Tafta (Transatlantic Free Trade Agreeement, ou Traité de libre-échange transatlantique) » de Dessine-moi l’éco. En vous appuyant sur cette vidéo, répondez à la Question 2.24 .
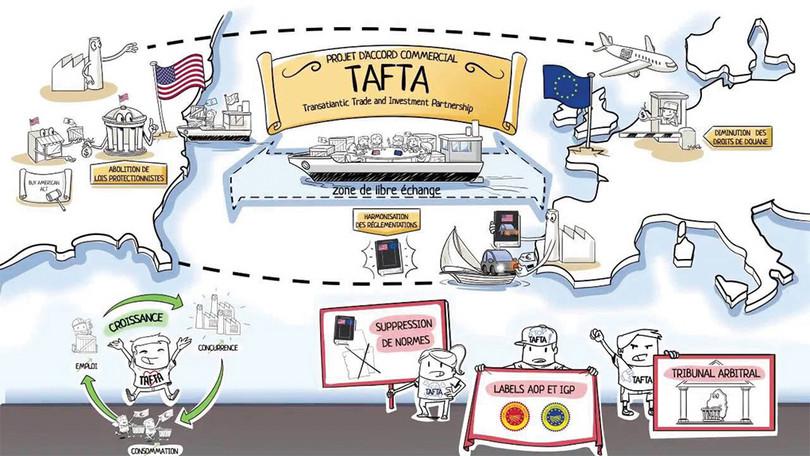
« Comprendre les enjeux du Tafta » – Vidéo issue de Dessine-moi l’éco : vidéos produites par Sydo, société de conseil en pédagogie.
Question 2.24 Choisissez les bonnes réponses
Quels sont les effets positifs que pourrait générer l’adoption du Tafta ?
- Cet accord permettrait de réduire les droits de douane encore existants et de supprimer certaines lois protectionnistes.
- Cet accord permettrait d’harmoniser les réglementations entre les États-Unis et l’Union européenne et de mieux protéger les consommateurs.
- L’adoption de cet accord permettrait de stimuler la concurrence et pousser les prix à la baisse au bénéfice de tous les consommateurs.
- Cet accord, du fait de la baisse des prix, relancerait la consommation ce qui favoriserait la croissance et l’emploi.
- C’est vrai, mais il s’agit des moyens mis en œuvre par le Tafta, pas des effets qu’il produit.
- L’accord prévoit d’harmoniser les réglementations, par exemple en supprimant certaines normes sanitaires ou techniques qui protègent les consommateurs.
- C’est bien la logique de l’élargissement du marché à ces deux zones qui obligera les entreprises soumises à davantage de concurrence à accroître leur productivité et à baisser leur prix.
- C’est bien un cercle vertueux de hausse de la consommation et d’accélération de la croissance économique que vise le traité en cours de négociation.
Quelles sont les meilleures politiques que les gouvernements peuvent mettre en place, au sujet des échanges internationaux, pour promouvoir la croissance des niveaux de vie à long terme ?
Pour certains, le choix s’opère entre deux politiques extrêmes :
- Fermer totalement les frontières nationales et se retirer de l’économie mondiale : le protectionnisme absolu.
- Laisser les biens et services, les individus et les capitaux circuler librement à l’échelle mondiale sans aucune intervention des pouvoirs publics : le libre-échange absolu.
Très peu d’économistes (voire aucun) soutiennent l’une ou l’autre de ces politiques. Cependant, les États adoptent des mesures de politique commerciale qui vont dans ces deux directions opposées :
- Les mesures protectionnistes limitent certains échanges internationaux, par des tarifs douaniers ou des restrictions quantitatives, par exemple.
- Les mesures de libre-échange favorisent certains échanges internationaux, en supprimant des barrières réglementaires, par exemple.
Quelle est la direction la plus favorable à la croissance du niveau de vie du pays à long terme ?
Quels sont les arguments en faveur du développement du libre-échange ?
Le premier argument est celui qui a été développé par David Ricardo : les avantages comparatifs liés aux prix relatifs.
Le Graphique 2.12 représente les écarts de prix entre les États-Unis et le Royaume-Uni (à l’inverse du Graphique 2.9 ) pour un certain nombre de marchandises entre 1870 et 1913. Durant cette période, le commerce entre ces deux pays s’est développé en raison de la baisse des droits de douane (de 45 % en 1870 à 21 % en 1910 pour les importations des États-Unis) et à la réduction des coûts du transport (en baisse de 53 % de 1870 à 1913 sur les voies maritimes de la côte est des États-Unis).
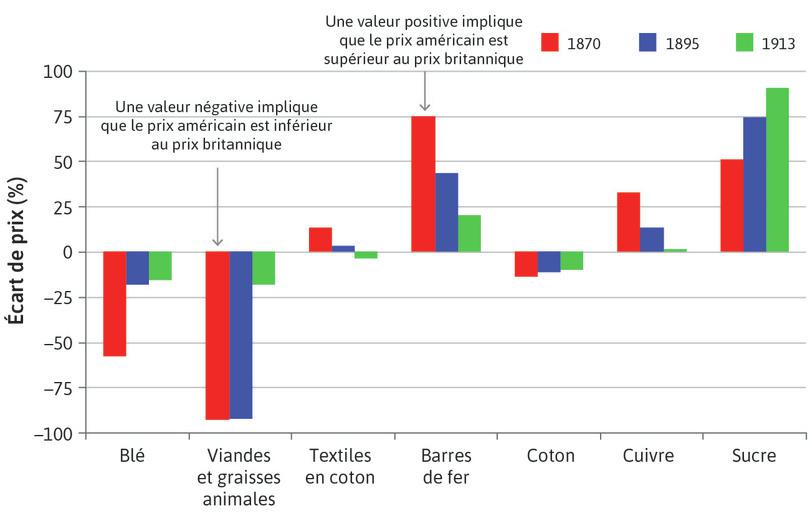
Graphique 2.12 Écarts de prix de certaines marchandises entre les États-Unis et le Royaume-Uni (1870–1913).
Tableau 2 in Kevin O’Rourke and Jeffrey G. Williamson. 1994. ‘Late Nineteenth-Century Anglo-American Factor-Price Convergence: Were Heckscher and Ohlin Right?’ The Journal of Economic History 54 (04) (December): pp. 892–916.
Question 2.25 Choisissez les bonnes réponses
Quel est le lien entre les échanges internationaux et le niveau des prix ?
- Pour les biens agricoles tels que le blé et les produits d’origine animale, les prix britanniques qui étaient supérieurs aux prix américains en 1870 leur sont presque devenus équivalents en 1913.
- Les États-Unis importent beaucoup moins de viande et de graisses animales du Royaume-Uni en 1913 qu’en 1895 ou qu’en 1870.
- Dans le cas de l’industrie métallurgique (cuivre et barres de fer), les prix américains étaient supérieurs aux prix britanniques en 1870 et s’en sont beaucoup rapprochés jusqu’en 1913.
- Dans tous les cas, les écarts de prix ont diminué, ce qui indique que les marchés des biens de part et d’autre de l’Atlantique devenaient de plus en plus intégrés.
- Sur le graphique, les valeurs négatives inférieures à - 50 % signifient qu’en 1870 les prix britanniques étaient au moins deux fois plus élevés.
- Il s’agit d’un écart de prix, pas d’un solde des échanges. La convergence est tardive, car les navires frigorifiques (inventés par Charles Tellier en 1876) ne se répandent qu’à la fin du 19 e siècle.
- Les écarts de prix référencés indiquent, par exemple, que le prix des barres de fer était plus élevé de 75 % aux États-Unis qu’au Royaume-Uni alors qu’en 1913 leur prix n’était plus supérieur que de 20 %.
- Il y a une exception notable, le sucre, dont l’écart de prix s’accroît lors de la période : il est 90 % plus élevé aux États-Unis qu’au Royaume-Uni en 2013.
Cette convergence des prix entre les États-Unis et le Royaume-Uni est loin d’être un exemple isolé. Des données attestant d’une convergence similaire des prix existent pour les prix du coton entre Liverpool et Bombay, de la toile de jute entre Londres et Calcutta et du riz entre Londres et Rangoon.
Cette évolution des prix conduit, dans la plupart des cas, à une hausse du pouvoir d’achat des exportations en produits importés.
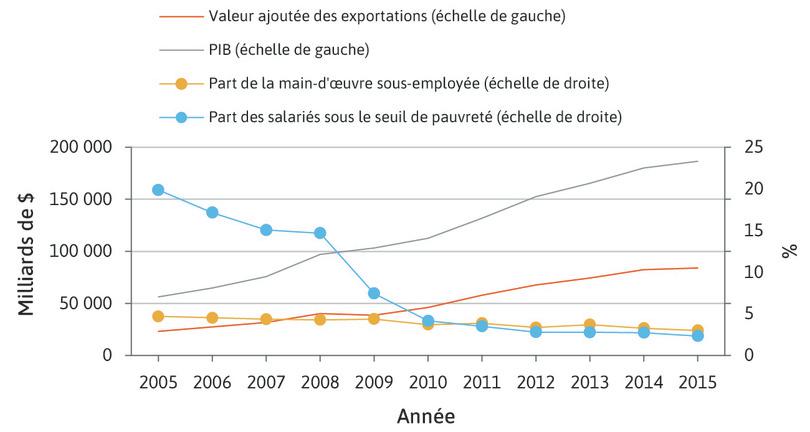
Graphique 2.13 Mesurer les effets du commerce international au Vietnam.
OECD.Stat de l’OCDE et ILOStat du BIT consultés en mai 2020.
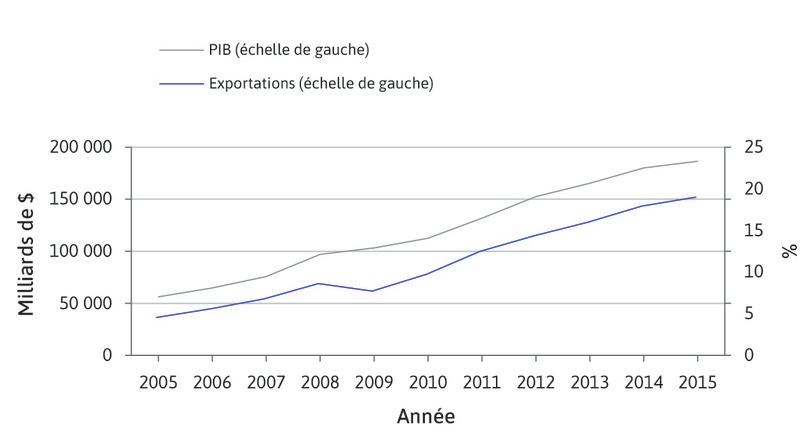
Exportations et PIB du Vietnam de 2005 à 2016
Cette première observation donne l’impression que les exportations ont été le facteur essentiel de l’augmentation du PIB : l’accès aux marchés extérieurs semble donc essentiel. Cela donne l’impression que l’économie est orientée uniquement vers la demande étrangère et que presque toute la production intérieure est exportée.
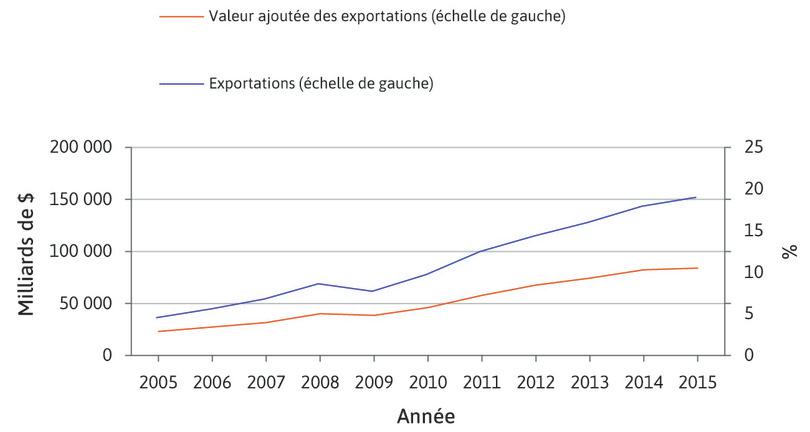
Exportations et valeur ajoutée sur place des exportations au Vietnam de 2005 à 2016
Une partie seulement de la valeur des exportations a été ajoutée au Vietnam (nous en avions vu un exemple précédemment, avec les équipements électriques et optiques). Cette part décroît, elle est passée de 64 % en 2005 (36 079/56 150 × 100) à 55 % en 2016 (92 794/164 835 × 100).
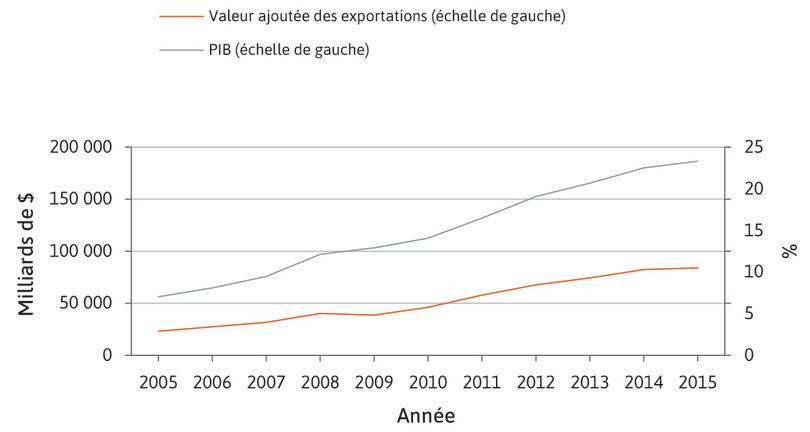
Valeur ajoutée des exportations et PIB au Vietnam de 2005 à 2016
Même si la part de la valeur ajoutée sur place des exportations baisse, cette valeur ajoutée des exportations reste croissante, car le pays exporte bien plus. Elle représentait 41 % du PIB en 2005 et 45 % du PIB en 2016 et explique une grande partie de la croissance du pays. Les échanges contribuent donc bien à accroître les richesses produites et distribuées au Vietnam.
Exportations, croissance et utilisation du facteur travail au Vietnam de 2005 à 2016
Les courbes avec marques, dont il faut lire les données sur l’axe de droite, montrent que l’explosion des échanges au Vietnam est fondée sur une utilisation intensive de la main-d’œuvre. En effet, seuls 2,7 % des actifs sont au chômage ou en sous-emploi, soit deux points de moins qu’en 2005 (tandis qu’en France cette part atteint 17 %) et cette forte demande de travail contribue à augmenter les salaires au point que la part des travailleurs disposant de moins de 1,90 dollars par jour a été divisée par dix.
Outre la baisse des prix relatifs des importations, les arguments favorables au libre-échange sont donc les suivants :
- Le libre-échange permet la spécialisation selon les avantages comparatifs : le pays tire ainsi mieux parti des facteurs de production dont il est doté (par exemple, la main-d’œuvre au Vietnam).
- Le libre-échange permet d’accéder à des marchés plus importants, qu’ils soient des marchés à forte demande, comme les pays développés, ou des marchés à forte croissance des dépenses de consommation, comme les pays émergents.
Le libre-échange favorise aussi des échanges entre pays comparables, comme le prouve le dynamisme du commerce entre les pays faisant partie d’une zone de libre-échange comme l’Union européenne. Ces échanges, à l’origine d’économies d’échelle, permettent d’accroître la production globale de ces zones et les revenus qui en découlent.
Quels sont les arguments favorables aux mesures protectionnistes ?
La mondialisation n’est ni un phénomène nouveau ni un phénomène irrémédiable. En période de crise en particulier, comme dans les années 1930, les pays ont parfois tendance à fermer leurs frontières. Une telle période de tension est à l’œuvre dans le monde depuis la crise financière de 2007. La même politique commerciale de hausse des droits de douane et des taxes sur les biens importés est à l’œuvre actuellement, comme l’illustre la hausse récente des tarifs douaniers aux États-Unis décidés par le président Donald Trump sur les produits en provenance de Chine et d’Europe. En 2018, les États-Unis ont relevé de 3 à 25 % leurs tarifs douaniers sur l’acier européen, mexicain et canadien et à 10 % sur l’aluminium, dans le but de protéger l’industrie sidérurgique du pays. Les États-Unis ont également introduit une hausse des droits de douane sur les produits technologiques (téléviseurs, composants électroniques, voitures, par exemple) importés de Chine, avec une taxe de 25 %.

« Guerre commerciale contre la Chine : Trump a-t-il raison ? »
Regardez la vidéo « Guerre commerciale contre la Chine : Trump a-t-il raison ? » du Monde . En vous appuyant sur cette vidéo, répondez aux questions suivantes :
Pourquoi le président Donald Trump a-t-il initié une « guerre commerciale » avec la Chine ?
Alors qu’il avait promis durant la campagne présidentielle qu’il remettrait de l’ordre dans les accords commerciaux des États-Unis, en janvier 2018 Donald Trump déclare une guerre commerciale à la Chine. Le déficit de la balance commerciale envers la Chine atteint alors 375 milliards de dollars. Il accuse notamment la Chine de ne pas respecter les règles du commerce international et de pratiquer une concurrence déloyale. Il reproche également à la Chine de subventionner massivement ses entreprises nationales et de réserver ses marchés publics seulement aux entreprises chinoises. De plus, les pratiques chinoises de « pillage » technologique et de transfert technologique après le rachat d’entreprises étrangères ou d’entreprises s’installant en Chine sont mises en cause.
Quels peuvent être les intérêts des mesures protectionnistes ?
La stratégie de Donald Trump consiste à pénaliser les exportations de la Chine : les taxes les rendent moins compétitives par rapport aux produits américains. Le protectionnisme peut aussi avoir l’avantage de protéger les entreprises naissantes de la concurrence extérieure pour leur laisser le temps de se développer et de créer des emplois sur le territoire. Ainsi, l’entreprise chinoise Alibaba s’est développée à l’abri de la concurrence d’Amazon et est devenue un géant national et désormais international du commerce électronique.
Quels sont les risques de telles mesures ?
Tout d’abord, le risque de ce type de mesure dans une économie mondialisée, c’est que les adversaires répliquent à leur tour. C’est ce qu’a fait la Chine en augmentant à son tour les taxes sur certains produits agricoles américains, le soja, le porc ou encore le coton, mettant en difficulté les agriculteurs américains. De plus, cette hausse des taxes finit par désavantager les consommateurs, car les entreprises répercutent la hausse du coût des produits importés (par exemple, l’aluminium qui sert à produire les canettes de Coca-Cola) dans leur prix de vente. Enfin, les mesures protectionnistes peuvent être contre-productives, car elles n’entraînent pas nécessairement le développement des entreprises nationales : certains produits ne peuvent pas être produits sur le territoire national si la main-d’œuvre, les matières premières ou d’autres composants ne sont pas disponibles. Il faut alors importer ces produits en provenance d’autres pays, ce qui ne contribue pas à réduire le déficit de la balance commerciale.
Les mesures protectionnistes sont souvent prises pour protéger les industries nationales face à la concurrence internationale (d’où le terme de protectionnisme). De telles mesures incluent les droits de douane qui augmentent le prix intérieur des importations et des restrictions sur la quantité de biens importés ( quotas ).
Les États peuvent développer des stratégies, d’une part pour développer des spécialisations avantageuses pour leur pays en adoptant des mesures temporaires de protection de certaines branches, et d’autre part pour se défendre contre certains effets du commerce international en adoptant des mesures de protection appelées à perdurer.
Un protectionnisme ciblé pour améliorer sa position commerciale
Protéger les industries naissantes par des tarifs douaniers peut donner aux entreprises de ces branches le temps et l’échelle de production nécessaires pour devenir compétitives. L’économiste allemand Friedrich List (1789–1846) élabore la théorie du « protectionnisme éducateur ».
Le protectionnisme précoce de l’Allemagne et des États-Unis en est un exemple : ces pays ont développé des secteurs manufacturiers modernes par le biais notamment de tarifs douaniers élevés qui les ont protégés de la concurrence britannique. À la fin du 19 e siècle, on notait une corrélation positive entre les tarifs douaniers et la croissance économique des pays relativement riches. Les droits de douane plus élevés dans le secteur manufacturier étaient donc associés à une croissance plus forte, ce qui tend à montrer que le protectionnisme de ces pays était favorable à leur croissance.
Ce protectionnisme éducateur ne remet pas en cause fondamentalement le libre-échange, car il vise à développer la compétitivité d’une branche avant de la soumettre à la concurrence internationale. Il suppose que le marché intérieur soit assez grand pour que des économies d’échelle soient possibles.
Lorsque la spécialisation est fondée sur les économies d’échelle, le gouvernement peut intervenir en adoptant une politique commerciale stratégique .
En effet, dans ces cas-là, il suffit qu’une entreprise ait une petite avance sur les autres pour qu’elle commence à réaliser des économies d’échelle et qu’elle développe sa compétitivité-prix. L’innovation est un facteur essentiel pour que les entreprises d’un pays puissent être les premières sur le marché et donc les moins chères parce qu’elles vendent davantage que les autres et réalisent des économies d’échelle.
L’État peut choisir d’intervenir par des mesures protectionnistes non tarifaires de façon à assurer l’avance de ses entreprises. Les États-Unis et l’Union européenne s’accusent ainsi mutuellement de favoriser respectivement Boeing et Airbus. Les mesures protectionnistes que les gouvernements adoptent prennent plusieurs formes : il peut s’agir de subventions publiques accordées à leurs entreprises exportatrices pour les aider à se lancer en premier sur l’un des segments du marché des avions commerciaux, mais aussi de préférence nationale lors de commandes publiques même si les prix sont prohibitifs.
Ce protectionnisme stratégique est temporaire, comme le protectionnisme éducateur, et ne remet pas en cause fondamentalement le libre-échange.
Le protectionnisme défensif
La mondialisation peut toutefois être sa propre ennemie. Une plus grande liberté de circulation des capitaux dans le monde, dont les détenteurs cherchent à obtenir des profits, permet aux entreprises de s’installer dans des pays où les impôts sont peu élevés – il s’agit de dumping fiscal–, et où les salariés n’ont pas le droit de s’organiser en syndicats et sont peu protégés, il s’agit de dumping social. Les entreprises veillent aussi à s’implanter dans des pays qui ne leur demanderont pas de prendre en charge tous les coûts de la pollution qu’elles engendrent, il s’agit de dumping environnemental. Cela implique que les investisseurs cherchent constamment à investir dans des endroits où le travail et l’environnement sont moins protégés. Ainsi, les pays qui souhaitent attirer les investissements étrangers sont souvent poussés à ne pas adopter de mesures en réponse aux problèmes de justice sociale ou de protection de l’environnement.
Par conséquent, le protectionnisme peut être défensif. Dans les pays avancés, en particulier aux États-Unis, se développe un protectionnisme visant la défense des emplois et des salaires des travailleurs les moins qualifiés. Sans parler ouvertement de protectionnisme, l’Union européenne défend un commerce libre et équitable. Cela la conduit à s’attaquer à la distorsion de concurrence introduite par le dumping (vendre ses produits à l’étranger à un prix inférieur au prix national). L’Union européenne impose, dans ce cas, des droits de douane compensateurs.
Ce protectionnisme n’a pas seulement pour objet de résister à une concurrence déloyale :
- Il peut s’agir aussi de protéger des industries vieillissantes soumises à la concurrence de pays en développement ayant une dotation factorielle et technologique plus adaptée (voir la phase de déclin de l’ Illustration 2.2 du cycle du produit dans la Section 2.2 ).
- Il peut s’agir enfin d’assurer la sécurité nationale, c’est-à-dire d’assurer l’approvisionnement dans certains produits stratégiques, comme les composants de l’armement. La pandémie de 2020 a montré que l’absence de production nationale de certains produits pharmaceutiques pouvait aussi être un enjeu de sécurité sanitaire. Le protectionnisme se développe donc aussi pour défendre la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, voire la souveraineté économique.
Ce protectionnisme défensif remet en cause beaucoup plus frontalement le libre-échange ; même les pays les moins protectionnistes ciblent certains produits, en particulier des produits agricoles, et leur appliquent des droits de douane élevés. L’Union européenne impose ainsi des droits de douane de 35,4 % sur les produits laitiers afin de défendre ses éleveurs, alors que ses droits de douane sont en moyenne de 5,2 %.
Le commerce international s’est développé du fait de la réduction, voire la quasi-disparition des coûts du transport qui représentent la plupart du temps moins de 5 % de la valeur de la marchandise transportée. Cependant, le transport de marchandises engendre des externalités négatives très importantes, en particulier des émissions de gaz à effet de serre, externalités dont le coût n’est pris en charge ni par le transporteur ni par le consommateur final.
L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) estime ainsi que le nombre de tonnes-kilomètres de marchandises devrait tripler entre 2015 et 2050 du fait de l’augmentation du volume de marchandises et de la distance moyenne parcourue. Même si une baisse des émissions d’un tiers est prévue, le total des émissions devrait doubler (3 × 2/3). 8 C’est pourquoi se développent des projets de protectionnisme écologique, en particulier en Europe.
Un arbitre engagé en faveur du libre-échange : l’OMC
L’OMC (Organisation mondiale du commerce) est une organisation internationale chargée de favoriser les échanges commerciaux entre ses membres et d’arbitrer les différends qui les opposent.
Le débat entre le libre-échange et le protectionnisme est influencé enfin par l’existence d’un arbitre favorable au libre-échange : l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’OMC est une organisation internationale qui a élaboré des règles commerciales communes aux pays membres. L’existence de règles communes montre la volonté des 164 pays membres de développer des échanges entre eux et permet d’éviter l’apparition de mesures de rétorsion (une mesure protectionniste qui n’a pour but que de répondre à une mesure protectionniste d’un pays partenaire).
Deux règles ont permis le développement du libre-échange dans le cadre du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, soit l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui précède l’OMC) depuis 1947 et de l’OMC depuis 1995 :
- La clause de la nation la plus favorisée : tout avantage consenti à l’un des pays partenaires doit être étendu à tous les autres, ce qui a poussé les droits de douane à la baisse.
- Le principe du traitement national : les produits importés doivent être traités par les pays membres comme les produits de fabrication nationale une fois qu’ils ont été admis, ce qui a permis de lutter contre les barrières protectionnistes non tarifaires.
L’OMC est dotée d’un organisme de règlement des différends qui permet d’arbitrer des désaccords entre ses États membres. Cet organisme rend les règles communes plus contraignantes pour les gouvernements qui veulent développer des politiques protectionnistes.
Synthèse Le développement des échanges internationaux de biens et de services entraîne un débat sur la politique commerciale des États, c’est-à-dire sur la régulation qu’ils imposent à ces échanges. Le protectionnisme propose des mesures (tarifs douaniers, barrières non tarifaires et subventions à l’exportation) visant à limiter certains de ces échanges. Effets d’une ouverture limitée des frontières : Abriter les industries naissantes pour qu’elles développent leur compétitivité. Favoriser les entreprises innovantes pour qu’elles soient leaders. Préserver les emplois et les salaires des actifs les moins qualifiés. Limiter les externalités négatives dues au transport de marchandises. Le libre-échange est une politique qui vise à limiter ces mesures protectionnistes, voire à en démanteler certaines. Effets de l’ouverture accrue des frontières : Baisse des prix et hausse du pouvoir d’achat. Meilleure utilisation des facteurs de production dans le monde. Accès à des marchés plus larges que le marché national. Accroissement de la production et des revenus du fait des économies d’échelle.
- 2.5 Conclusion
Les échanges internationaux et la spécialisation internationale ne s’expliquent pas seulement par des différences entre les pays (différences de productivité, différences de dotations factorielles et différences de dotations technologiques) : ils s’expliquent par des facteurs liés à la demande (la différenciation, horizontale et verticale, des produits, et leur qualité) et des facteurs liés à l’offre (la fragmentation de la chaîne de valeur qui permet de dégager des rendements d’échelle croissants et des économies d’échelle).
Le commerce international induit des effets importants sur les prix et les revenus, c’est-à-dire sur le partage des richesses dans le monde. Le protectionnisme propose des mesures visant à limiter certains de ces échanges. Le libre-échange est une politique qui vise à limiter ces mesures protectionnistes, voire à en démanteler certaines.
L’internationalisation des chaînes de valeur a contribué à multiplier les échanges internationaux. Elle s’effectue de plusieurs manières, mais elle est grandement dominée par des firmes multinationales qui externalisent certaines activités auprès d’entreprises partenaires ou qui, préférant une plus forte intégration, les produisent dans des filiales implantées à l’étranger.
L’attractivité des biens et services des entreprises d’un pays dépend à la fois de la compétitivité-prix et de la compétitivité hors-prix. Cette compétitivité traduit la capacité qu’a un pays à exporter.
Concepts introduits dans le Chapitre 2 Avant de continuer, revoyez ces définitions : dotations factorielles dotations technologiques avantage comparatif échanges commerciaux spécialisation internationale différenciation des produits qualité des produits fragmentation de la chaîne de valeur productivité des firmes compétitivité chaîne de valeur commerce international libre-échange protectionnisme
- 2.6 Références bibliographiques
- L’équipe CORE. 2018. L’économie , Unité 1 , Unité 7 , Unité 18 , Unité 19 . Paris : Eyrolles
Adam Smith. (1776) 2003. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . New York, NY: Random House Publishing Group. ↩
David Ricardo, On The Principles of Political Economy and Taxation , London : John Murray, 1817. ↩
Paul Krugman, La mondialisation n’est pas coupable , La Découverte, 1998. ↩
OCDE, « Les implications des chaînes de valeur mondiales pour la politique commerciale », OCDE.org, 2019. ↩
Starbucks Corporation, Annual Report , 2019. ↩
Alonso de Gortari, « Disentangling Global Value Chains », Harvard University Job Market Paper, 2017. ↩
Paul Krugman, L’Âge des rendements décroissants , Économica, 2000. ↩
Forum international des transports, Perspectives des transports 2019 , OCDE, 2020. ↩
- Table des matières
- Préface
- Note à destination des enseignants
- Vidéos
- 1.1 Sensibilisation
- 1.2 Quelles sont les sources du processus de croissance économique ?
- 1.3 En quoi le progrès technique présente-t-il un caractère endogène, notamment par l’innovation que les institutions favorisent ?
- 1.4 Comment le progrès technique peut-il engendrer des inégalités de revenus ?
- 1.5 En quoi une croissance économique soutenable se heurte-t-elle à des limites écologiques que l’innovation peut faire reculer ?
- 1.6 Conclusion
- 1.7 Références bibliographiques
- 2.1 Sensibilisation
- 3.1 Sensibilisation
- 3.2 Comment définir le chômage, l’emploi et le sous-emploi et comment les mesurer ?
- 3.3 Quelles peuvent être les différentes causes du chômage ?
- 3.4 Quelles sont les principales politiques qu’il est possible de mettre en œuvre pour lutter contre le chômage ?
- 3.5 Conclusion
- 3.6 Références bibliographiques
- 4.1 Sensibilisation
- 4.2 Quelles sont les principales caractéristiques de la crise financière des années 30 et de celle de 2008 ?
- 4.3 Comment expliquer les crises financières par la formation et l’éclatement d’une bulle spéculative ?
- 4.4 Quels sont les principaux canaux de transmission d’une crise financière à l’économie réelle ?
- 4.5 Quels sont les principaux instruments de régulation du système bancaire et financier ?
- 4.6 Conclusion
- 4.7 Références bibliographiques
- 5.1 Sensibilisation
- 5.2 Quelles sont les grandes caractéristiques de l’intégration européenne et ses effets sur la croissance ?
- 5.3 Quels sont les objectifs, les modalités et les limites de la politique européenne de la concurrence ?
- 5.4 Comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent-elles sur la conjoncture ?
- 5.5 Quelles sont les difficultés soulevées par le défaut de coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire dans la zone euro ?
- 5.6 Conclusion
- 5.7 Références bibliographiques
- Glossaire d’examen
- Bibliographie
- Crédits iconographiques

- Terminale ES
- Cours : Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?
Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ? Cours
Le développement des échanges et l'interdépendance croissante des économies caractérisent le processus de mondialisation. Le commerce international se justifie par les gains obtenus lors de l'échange : prix plus faible, plus grande diversité. Les fondements du commerce international font l'objet de différentes analyses, dont la théorie des avantages comparatifs et la dotation factorielle. Le libre-échange a quelques limites qui peuvent justifier l'apparition du protectionnisme, cherchant à protéger la production nationale. Les sociétés s'internationalisent et favorisent la mondialisation des économies, notamment grâce aux investissements directs à l'étranger. L'un des enjeux majeurs de cette concurrence internationale est donc de développer une position compétitive.
Les caractéristiques des échanges
L'ouverture croissante des économies, l'essor des échanges internationaux.
L'essor des échanges internationaux dès le XIXe siècle est le résultat d'une ouverture croissante des économies : on parle d' internationalisation.
Internationalisation
L'internationalisation est un processus caractérisant le développement des relations économiques entre les nations.
- À partir de 1945, l'internationalisation prend une telle ampleur que la croissance des échanges internationaux est plus rapide que la croissance des PIB.
- À partir des années 1960, il est accompagné et accéléré par le développement des firmes multinationales (FMN).
Firme multinationale
Une firme multinationale est une grande entreprise nationale qui possède ou contrôle plusieurs filiales de production dans plusieurs pays. Elle est composée d'une société-mère (dans le pays d'origine) et d'entreprises détenues ou contrôlées à l'étranger, appelées filiales.
La mondialisation
Le développement des échanges s'est accompagné d'une libéralisation des marchés (c'est-à-dire un abaissement des barrières à l'échange, comme les barrières douanières) ainsi que d'une accélération des échanges de tous types. La nature même des produits échangés a évolué.
- Les échanges internationaux de services se sont développés (par exemple les services bancaires).
- Les mouvements internationaux de capitaux ont connu une croissance sans précédent. Par exemple, les investissements à l'étranger ont été multipliés par 12 entre 1980 et 2002.
- Si la Triade domine toujours les échanges, les courants d'échange entre différentes zones géographiques ont profondément évolué. Un certain nombre de pays émergents participent désormais activement au commerce international et se sont spécialisés dans des activités industrielles (comme l'Inde ou la Chine) énergétiques (les pays pétroliers) ou agricoles (comme le Brésil).
- Des zones de libre-échange se sont développées : UE (Union européenne, qui a finalisé la mise en place d'un marché commun en 1968), ALENA (Amérique du nord et le Mexique en 1994), MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, en 1991), ASEAN (regroupe certains pays d'Asie, à l'origine, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande en 1967).
Cela participe à la mondialisation des économies.
Mondialisation
La mondialisation va au-delà de l'internationalisation, elle désigne le passage d'un cadre national à un cadre international pour les agents économiques, et une interdépendance croissante entre les acteurs économiques à l'échelle du globe.
Comment expliquer cet essor ?
Plusieurs explications permettent de comprendre l'essor du commerce international :
- Les progrès techniques ont permis une diminution des coûts de communication et de transport.
- L'ouverture des économies au libre-échange a permis un accroissement des échanges à moindre coût.
- Le développement des échanges a été favorisé par l'accroissement du commerce intra-firme .
Libre-échange
Le libre-échange est une doctrine économique qui prône la liberté de circulation de tous les biens économiques (produits, services, capitaux, monnaie) entre les pays.
Commerce intra-firme
Le commerce intra-firme désigne les échanges entre filiales d'une même FMN ou entre la société-mère et ses filiales.
Les déterminants des échanges internationaux et de la spécialisation
La spécialisation et l'avantage comparatif, spécialisation.
La spécialisation désigne la répartition des activités entre les différentes économies.
Avantage comparatif
Un avantage comparatif désigne le processus de spécialisation par lequel un pays a intérêt à se spécialiser dans la production où il possède le plus grand avantage (il est relativement le meilleur) ou le plus petit désavantage (il est relativement le moins mauvais).
La dotation factorielle
Dotation factorielle.
La dotation factorielle représente la quantité de facteurs de production (travail, capital, terre) présents dans un pays.
Par exemple, en Australie, la terre est un facteur en abondance, car cette île gigantesque dispose d'une surface agricole potentielle sans égal. Alors, selon le théorème HOS, l'Australie a intérêt à se spécialiser dans la production de biens qui nécessite de la terre. Et en effet, l'Australie s'est notamment spécialisée dans la production de biens agricoles, dont elle exporte plus des trois quarts.
Il faut toutefois prendre garde à ne pas considérer les facteurs de production uniquement d'un point de vue quantitatif, mais aussi prendre en compte la productivité des facteurs de production (on peut disposer de tout le Sahara, soit un immense espace terrien, sans pouvoir se spécialiser dans l'agriculture, car la surface du Sahara est peu propice à cette activité).
Le taux de change et ses effets
La détermination du taux de change, taux de change.
Le taux de change est le prix (on dit le "cours") d'une monnaie dans une autre devise étrangère.
Si le cours de l'euro en dollar est de 1,10 il faut céder 1,10 $ pour obtenir 1 € sur les marchés monétaires internationaux et chez les agents de change.
Depuis l'adoption du régime des changes flottants, le cours des principales monnaies du monde fluctue en fonction de l'offre et de la demande sur les marchés monétaires et selon les politiques monétaires menées par les grandes banques centrales notamment leur politique des taux d'intérêt (FED au Etats-Unis, BCE en Europe) :
- Lorsque la demande de monnaie est supérieure à l'offre, la monnaie s'apprécie, c'est-à-dire que son cours en devise étrangère augmente.
- Lorsque la demande de monnaie est inférieure à l'offre, la monnaie se déprécie, c'est-à-dire que son cours en devise étrangère diminue.
Ses effets sur le commerce
Le taux de change a des effets importants sur le commerce international en influençant les importations et exportations :
- Lorsque le cours de la monnaie nationale s'apprécie (sa valeur en devise étrangère augmente) cela diminue le prix des importations et augmente le prix des exportations. Ainsi lorsque le dollar s'apprécie face à l'euro (le dollar vaut davantage d'euros), les importations de produits européens aux Etats-Unis vont augmenter. En revanche les exportations de produits américains vers l'Europe vont diminuer.
- Lorsque le cours de la monnaie nationale se déprécie (sa valeur en devise étrangère diminue) cela augmente le prix des importations et diminue le prix des exportations. Ainsi lorsque le dollar se déprécie face à l'Euro (le dollar vaut moins d'euro), les importations de produits européens aux Etats-Unis vont diminuer et les exportations de produits américains en Europe vont augmenter.
Un lundi, 1 € vaut 3 $. Pour un consommateur américain, l'importation d'une tasse européenne à 1 € coûte 3 $, et pour un consommateur européen, l'importation d'un drapeau américain à 1 $ coûte 0,33 €.
Le lendemain, 1 € vaut 4 $. L'euro s'est apprécié et le dollar s'est déprécié. Pour le consommateur américain, la tasse européenne à 1 € coûte désormais 4 $. Pour les Européens, le prix de cette exportation a donc augmenté , et cela défavorise les producteurs européens. Pour le consommateur européen, l'importation du drapeau américain coûte désormais 0,25 €. Pour les Européens, le prix de l'importation a diminué , cela favorise les producteurs américains.
La fluctuation à la hausse (appréciation) ou à la baisse (dépréciation) d'une monnaie n'est donc ni positive ni négative mais les deux à la fois selon que l'on se place du point de vue des importateurs ou des exportateurs. Les politiques monétaires qui cherchent à influencer les cours monétaires se basent donc sur une analyse de la structure du commerce international de leur pays respectif (puissance importatrice ou au contraire exportatrice).
Les avantages et inconvénients du commerce international
Les avantages et limites du libre-échange, les avantages du commerce international.
Le libre-échange présente un certain nombre d'avantages pour les consommateurs et producteurs :
- Il permet d'accéder à une plus grande variété de produits.
- Il permet de faire diminuer le prix des produits, et donc de gagner du pouvoir d'achat.
- Il permet d'ouvrir de nouveaux débouchés à la production. Le producteur peut augmenter son volume de production, et donc diminuer les coûts de production s'il existe des économies d'échelle.
- Les biens de production sont aussi échangés internationalement, et permettent donc aux producteurs de bénéficier de technologies étrangères.
D'une manière plus générale, le développement du commerce international pousse les entreprises à améliorer leur compétitivité prix et leur compétitivité hors-prix .
Compétitivité prix
La compétitivité prix est la capacité d'une entreprise à proposer un bien ou un service à un prix inférieur au concurrent, à qualité égale.
En bénéficiant d'économies d'échelles grâce à l'ouverture de marchés étrangers et à l'augmentation de la production, une entreprise productrice d'électricité peut améliorer sa compétitivité prix.
Compétitivité hors-prix
La compétitivité hors-prix est la capacité d'une entreprise à offrir des produits différenciés des concurrents : qualité, innovation, design, marque, etc.
En pouvant s'implanter sur un marché étranger où le fait d'être d'origine française est perçu comme un gage de qualité, une entreprise française qui produit des nœuds papillon de luxe peut améliorer sa compétitivité hors-prix.
Les inconvénients du commerce international
Le commerce international et son développement via le libre-échange présente toutefois des inconvénients, pour les producteurs comme pour les consommateurs :
- Risque de disparition de productions locales : face à la concurrence étrangère, des productions locales qui ne sont pas assez compétitives peuvent disparaître, même si elles ont une qualité particulière aux yeux des consommateurs.
- Risque de "dumping social" : la concurrence des pays à bas salaires constitue une pression à la baisse pour les salaires des autres pays, et peut dégrader les conditions de vie des employés dans ces derniers (diminution des salaires, licenciements).
- Risque de délocalisation d'activité : s'il est possible de produire dans un autre pays à moindre coût, les entrepreneurs peuvent délocaliser leurs capitaux et leurs entreprises, occasionnant ainsi des destructions d'emplois.
- Risque d'atteinte aux droits des consommateurs : les traités de libre-échange contiennent des clauses pour garantir la concurrence qui peuvent être utilisées par les firmes multinationales afin de contester des normes nationales.
Délocalisation
La délocalisation est une pratique consistant à fermer une unité de production sur le territoire national pour en ouvrir une autre à l'étranger, afin de produire à des coûts moindres.
En 2010, les ouvriers des usines Lipton en France ont lancé un mouvement de grève pour protester contre la fermeture de leurs usines. En effet, le groupe Lipton voulait délocaliser la production de la France vers la Pologne, où la main-d'œuvre coûte moins cher.
Le protectionnisme
Les moyens du protectionnisme.
Il existe diverses modalités de pratiques de protectionnisme, les moins fréquentes étant les barrières tarifaires (taxes appliquées sur des produits étrangers entrants). On remarque principalement des barrières non tarifaires (c'est-à-dire autres que les droits de douane), par exemple :
- Les restrictions quantitatives (quotas, contingentements) : c'est le volume annuel maximum d'importations pour un produit donné.
- Le commerce administré : il s'agit d'accords conclus entre deux pays pour limiter "volontairement" les exportations de l'un vers l'autre.
- L'utilisation de mécanismes anti-subventions ou anti-dumping : par exemple en interdisant l'importation de produits dont la fabrication ne respecte pas un certain nombre de normes (par exemple des productions impliquant un travail des enfants).
- L'imposition de normes diverses, techniques, sanitaires ou autres : par exemple, l'obligation que les produits importés comportent une notice dans la langue nationale.
Protectionnisme
Le protectionnisme désigne une doctrine et des politiques économiques reposant sur l'application de mesures tarifaires et non tarifaires visant à protéger ou favoriser les producteurs nationaux face à la concurrence étrangère.
Le protectionnisme vise à interdire ou limiter les importations de biens et services afin de protéger les entreprises et activités nationales de la concurrence extérieure. La mise en place de telles politiques peut se faire entre autres pour des raisons stratégiques ou culturelles.
Les limites du protectionnisme
Le protectionnisme est une mesure défensive qui présente plusieurs limites pour les économies nationales. Dans une économie protégée de la concurrence internationale :
- Les producteurs ne sont pas incités à l'innovation puisqu'ils disposent d'un marché protégé, et ne sont pas menacés par la concurrence. Les économies peuvent ainsi protéger des industries inefficaces, ce qui est défavorable à l'obtention de gains de productivité.
- Les consommateurs ne bénéficient pas de l'effet de la concurrence sur les prix. Les offreurs sont en situation de monopole sur le marché national, et peuvent imposer des prix plus élevés que ceux du marché international.
- Les consommateurs ont un choix plus restreint , car les variétés étrangères ne peuvent être vendues sur le marché national, ou à un prix prohibitif.
- Un effet secondaire des mesures protectionnistes qu'il existe de plus un risque de rétorsion de la part des autres États, c'est-à-dire que si un État Y met en place des mesures protectionnistes, les autres États peuvent mettre en place les mêmes mesures à l'encontre des exportations de l'État Y . Cela peut désavantager certains producteurs nationaux qui ne peuvent plus exporter, alors même que ce n'est peut-être pas leur secteur qui bénéficie des mesures protectionnistes initiales.
En 2009, pour protester contre l'interdiction par l'UE de l'importation de bœuf traité par des hormones de croissance, les États-Unis ont menacé de mettre en place des mesures de rétorsion en augmentant les droits de douane sur des produits européens, comme le roquefort.
Pourquoi mettre en place un protectionnisme ?
Krugman a notamment étudié la façon dont le Japon a mis en place un protectionnisme éducateur dans les années 1970, afin de permettre à ses entreprises de développer leur savoir-faire dans la construction de composants de mémoire vive. En taxant les importations de ces composants, le Japon a laissé le temps à ses entreprises d'apprendre en produisant et de devenir des spécialistes mondiales de la mémoire vive, alors que sans les mécanismes protectionnistes, les producteurs américains initialement plus avancés auraient inondé le marché japonais et probablement fait disparaître l'industrie japonaise.
La mondialisation de la production
L'essor des fmn.
On mesure principalement l'essor des FMN par leur nombre et par les flux d' IDE ( Investissements directs à l'étranger ) :
- En 2012, on comptait plus de 83 000 firmes multinationales et 810 000 filiales étrangères, contre 7000 à la fin des années 1960.
- Les FMN emploient plus de 68 millions de personnes dans leurs filiales, contre 21 millions en 1990.
- Les FMN produisent environ un quart du PIB mondial.
- Les flux des IDE dans le monde ont explosé, passant de 50 milliards de dollars en 1980 à 2000 milliards en 2007.
Les stratégies des FMN
La division internationale du processus productif (dipp).
La DIPP (Division internationale du processus productif) consiste à répartir les différents stades de production d'une même FMN entre différents pays. La production d'une même firme est ainsi pensée à l'échelle mondiale. Elle est fragmentée entre différents pays qui sont les plus compétitifs sur un segment particulier de la chaîne de production.
La DIPP est réalisée de la façon suivante : les FMN jouent sur les coûts de production en établissant des filiales qui réalisent des étapes du processus de production là où les coûts pour chaque étape de production sont moindres, en profitant des avantages des différents pays (salaires, savoir-faire, matières premières, fiscalité, etc.).
Une grande firme productrice d'ordinateurs peut avoir différentes filiales dans différents pays. Elle peut avoir des bureaux de concepteurs et de direction dans un pays développé (États-Unis), des filiales construisant les coques en plastique de ses appareils dans des pays où la main-d'œuvre est peu chère, des filiales construisant les objets techniques particuliers dans les pays où la main-d'œuvre est spécialisée (circuits imprimés en Chine, semi-conducteurs à Taïwan, en Corée du Sud et aux États-Unis, etc.), des usines d'assemblage dans un autre pays (Chine), un réseau de distributeurs propres à l'entreprise dans de nombreux pays du monde, et enfin des filiales dans les paradis fiscaux qui lui permettent d'échapper à la fiscalité des grands pays développés.
Le commerce intra-firme et entre firmes
Les FMN peuvent avoir recours à l' externalisation , c'est-à-dire avoir recours à des sous-traitants. Cela permet notamment de déplacer les risques et faire reposer la production sur un plus grand nombre d'acteurs.
Externalisation
L'externalisation est un processus par lequel une entreprise confie à des sous-traitants (nationaux ou étrangers) une partie de sa production qui était jusque-là réalisée par elle-même.
C'est l'existence de coûts de transactions et la recherche de l'allègement des coûts de production qui conduit deux firmes à s'unir et constituer une firme transnationale, plutôt que de rester indépendantes et faire du commerce entre elles.
01 86 76 13 95
(Appel gratuit)
Cours : Les fondements du commerce international
Les fondements du commerce international
Les premières épreuves du bac 2024 sont pour bientôt ! Consulte notre dossier sur le contrôle continu et le calcul des notes de ton bac pour maximiser ta préparation pour les révisions à ton examen 💪
Introduction :
Depuis la fin des années 1980, la croissance demeure l’un des objectifs prioritaires de tous les acteurs économiques et, dans un monde globalisé, elle est désormais fortement liée à l’insertion dans le commerce international. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les échanges internationaux ne sont pas récents. En effet, déjà sous l’Antiquité, les Romains échangeaient des épices, des étoffes et des pierres précieuses avec l’Asie ; les Chinois exportaient de la soie à destination des pays occidentaux. On parle des prémisses de l’internationalisation, c’est-à-dire de l’élargissement du champ d’activité d’une économie au-delà du territoire national. Les échanges se sont accélérés depuis les années 1980. Désormais, les économistes utilisent le terme de mondialisation , qui désigne ce processus vers une circulation accrue des biens, des capitaux, des hommes, mais aussi des informations et des cultures.
Ainsi, ce cours aura tout d’abord pour objectif de mettre en évidence les grandes évolutions et les caractéristiques du commerce international, puis d’expliquer quels en ont été les déterminants, autrement dit les éléments qui ont permis son essor.
Les évolutions du commerce international
La croissance des échanges de la révolution industrielle à la veille de la première guerre mondiale.
L’évolution du commerce international entre la révolution industrielle du XIX e siècle et la Première Guerre mondiale est caractérisée par une multiplication par 25 des échanges, alors que la production mondiale n’a été multipliée que par 2,2 [source : Paul Bairoch, « Révolution industrielle et sous-développement », revue Tiers-Monde , 1964] .
Ce sont principalement les pays européens qui participent à cette « première mondialisation » :
- le commerce intra-européen représente 40 % des flux en 1913 ;
- le commerce entre les pays européens et le reste du monde représente 37 % des flux à la même date.
- En 1913, 77 % des échanges mondiaux impliquent des pays européens. Le Royaume-Uni domine d’ailleurs ces échanges sur toute la période allant du XIX e siècle au début de la Première Guerre mondiale.
COMPOSITION DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX EN 1913 EN POURCENTAGES
- Ainsi, en 1913, les exportations françaises représentent 12,1 % des exportations mondiales, tandis qu’elles s’élèvent à 22,8 % pour le Royaume-Uni. Ces exportations se composent alors en majorité de produits manufacturés (57,9 % pour la France, 76,6 % pour le Royaume-Uni).
De nombreux facteurs permettent d’expliquer le développement de cette première mondialisation :
- la révolution industrielle entraîne de nombreuses innovations dans les transports et dans les industries (développement du chemin de fer, construction de bateaux plus puissants et plus rapides…) ;
- la croissance économique est forte ;
- les entreprises commencent à chercher des moyens pour rentabiliser leur production en écoulant le trop-plein de production par l’ouverture vers d’autres acheteurs (export) ;
- les entreprises souhaitent se fournir en matières premières inexistantes sur place ou moins chères à l’étranger (import) ;
- la pensée économique se modifie, avec des auteurs comme Adam Smith et David Ricardo qui développent leur théorie du commerce international . Ces auteurs classiques vont montrer les avantages du libre-échange et de la spécialisation internationale .
Concernant les caractéristiques des échanges jusqu’en 1913, on peut différencier deux grands types de pays :
- les pays qui ne sont pas encore rentrés dans l’ère industrielle, qui échangent les produits de leurs colonies (les épices, le chocolat ou le thé par exemple) et des matières premières, comme le Portugal ou l’Espagne par exemple ;
- les pays qui sont en pleine révolution industrielle, comme l’Angleterre, l’Allemagne ou la France qui commencent à produire à grande échelle et s’échangent les produits issus de leurs spécialisations réciproques.
Au XIX e siècle, dans le monde, les produits échangés sont essentiellement composés de produits primaires (2/3 du commerce international). En Europe, les importations sont pour beaucoup constituées de produits primaires (85 %), tandis que les exportations concernent principalement des produits manufacturés (60 %).
La première mondialisation débute au XIX e siècle avec une croissance des échanges supérieure à la croissance de la production . Favorisée notamment par la révolution industrielle, cette mondialisation concerne principalement les pays européens, et en particulier le Royaume-Uni qui occupe la première place. À l’échelle mondiale, les produits échangés sont essentiellement des produits primaires.
Un ralentissement des échanges de 1914 à 1945
Cette période est marquée par :
- deux guerres mondiales ;
- un ralentissement de la croissance du commerce international (ce dernier n’augmente que de 3 % entre 1913 et 1937) ;
- la crise économique de 1929 ;
- la montée du protectionnisme .
Protectionnisme :
Il s’agit d’une politique d’intervention d’un État dans l’économie pour protéger ses intérêts nationaux face à la concurrence étrangère. Par exemple, l’Union européenne a décidé en février 2019 de mettre des quotas sur les importations d’acier. Cette mesure vise à protéger les entreprises européennes qui verraient le prix de l’acier chuter du fait de l’entrée massive d’acier étranger.
Ces évènements ont des répercussions directes sur les échanges internationaux.
- Les « pays neufs » (États-Unis, Canada, Japon) progressent plus rapidement que l’Europe. Durant cette période, l’Amérique du Nord participe pour 22 % au commerce international et le Royaume-Uni cède sa place de numéro un au profit des États-Unis .
La période d’entre-deux-guerres est caractérisée par un ralentissement des échanges internationaux. Ce phénomène s’explique d’une part par la volonté des pays de se reconstruire et d’autre part par un repli des pays (protectionnisme). Cette période voit également apparaître de nouveaux pays dans les échanges : les États-Unis prennent la première place du commerce international.
L’évolution du commerce international depuis 1945
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement depuis les années 1980, on observe une accélération des échanges internationaux et de l’ouverture des pays (en particulier pour les pays développés à économie de marché).
Cette période est caractérisée par :
- une croissance exceptionnelle dans l’ensemble des pays ( Trente Glorieuses ) ;
- des innovations technologiques ;
- l’émergence de nouveaux pays industrialisés , dont par exemple les « quatre dragons » (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour).
- Elle offre ainsi un climat propice au développement des échanges.
Ce sont principalement les organisations internationales qui ont permis cet essor.
- Le Fonds monétaire international (FMI) , organisme international créé en 1945, regroupe aujourd’hui 184 pays. Il a pour objectif d’assurer la stabilité financière et de faciliter les échanges internationaux.
- La Banque mondiale , organisation internationale créée en 1944, est chargée de lutter contre la pauvreté et de promouvoir des projets dans les pays émergents.
- Le GATT , signé en 1947, n’est pas une organisation internationale, mais un accord qui impose les règles du commerce international (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).
- L’ OMC (Organisation mondiale du commerce) remplace le GATT en 1995 et devient la principale organisation internationale chargée de développer le commerce mondial. Elle est composée aujourd’hui de 149 pays membres. Son objectif principal est de mettre en place des accords commerciaux internationaux, de veiller aux respects de ces accords et de régler les différends commerciaux.
Le commerce international aujourd’hui
Répartition géographique des échanges.
Les échanges s’effectuent principalement entre pays développés : Europe et Amérique du Nord en tête totalisent les trois quarts des échanges mondiaux.
Depuis les années 1970 cependant, des pays émergents se sont spécialisés dans la production internationale de produits manufacturés. La plupart sont localisés en Asie orientale : Hong Kong, Taïwan, Singapour, la Corée du Sud ou encore la Chine. Ailleurs dans le monde, certains pays parviennent également à s’insérer avec succès dans l’économie mondiale, comme le Brésil, en Amérique latine.
Si tous les pays sont concernés par les échanges internationaux, un groupe de trois espaces se distingue : il s’agit de la Triade , qui rassemble l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie orientale. Les pays membres de cet espace échangent principalement entre eux.
Dans le même temps, on constate que, de plus en plus, les échanges s’organisent prioritairement en grandes zones régionales (l’Union européenne en est une, mais aussi l’ ALENA par exemple).

Une nouvelle catégorisation des échanges
Si la répartition géographique des échanges a évolué, leur catégorisation aussi, avec la distinction entre les échanges intrabranche et les échanges interbranche.
- Les échanges intrabranche sont principalement réalisés entre pays développés, et plus particulièrement ceux de la Triade.
Échanges intrabranche :
Les échanges intrabranche désignent des échanges de produits similaires entre des pays à développement économique similaire. Par exemple, la France échange des voitures avec l’Allemagne.

- En 2017, les échanges intrabranche de l’Europe à 28 représentent 57 % du commerce de l’ensemble régional. Autrement dit, en termes d’échanges intrabranche, l’Europe échange essentiellement avec l’Europe.
- Néanmoins les échanges interbranches traditionnels demeurent.
Échanges interbranches :
Les échanges interbranches désignent des échanges de produits différents entre pays à développement économique différent.
Une structure nouvelle des échanges
Les produits échangés se répartissent en deux catégories :
- les matières premières , regroupant les matières premières agricoles qui s’échangent de moins en moins depuis les années 1950, mais aussi les hydrocarbures et les produits miniers (denrées énergétiques), qui eux, restent stables ;
- les produits manufacturés , c’est-à-dire des produits confectionnés à partir de matières premières. Ils connaissent une forte expansion et représentent aujourd’hui 65 % des exportations mondiales.

- Ce graphique met en évidence l’évolution des types de marchandises exportés depuis 1900. En 1900, les produits agricoles représentaient 57 % des exportations contre 40 % pour les produits manufacturés. En 2011, les produits agricoles représentent 9 % des exportations contre 65 % pour les produits manufacturés.
Notons qu’avec la tertiarisation des économies , une quatrième catégorie est apparue récemment et a tendance à se développer de plus en plus rapidement : le commerce des services (part des échanges de services dans les échanges internationaux : 20 %) principalement sur Internet.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les échanges s’intensifient entre les pays et des organisations internationales ont été créées pour réglementer et favoriser ce commerce international. Les pays de la Triade dominent toujours les flux mondiaux et multiplient les échanges intrabranche, mais les flux s’intensifient également dans les associations économiques régionales. De plus, plusieurs pays en développement se spécialisent dans des productions et se démarquer de plus en plus dans l’économie mondiale. Les échanges concernent essentiellement des produits manufacturés, mais le commerce des services se développe toujours plus.
Les déterminants des échanges
Deux types de justifications aux échanges internationaux ont été mis en évidence de façon théorique. Il s’agit de la notion d’« avantage » (absolu ou comparatif) et de celle de « dotations factorielles » ou « dotations technologiques ».
Avantages absolus, avantages comparatifs
Les théories du commerce international insistent sur l’existence d’un gain à l’échange et sur les bienfaits de l’ouverture sur l’extérieur.
Adam Smith fut le premier à démontrer qu’en se spécialisant dans une production spécifique, chaque nation contribue à obtenir une allocation des ressources optimale au niveau mondial, c’est-à-dire à une meilleure répartition des ressources au niveau mondial. Pour Adam Smith, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il dispose d’un avantage absolu par rapport à une autre, par exemple en raison du climat ou de ses connaissances technologiques. Par exemple, le climat tropical de certaines régions africaines rend la production de mangues plus avantageuse qu’en France. Dès lors, les pays africains concernés pourront éventuellement se spécialiser dans ce type de production.
Avantage absolu :
Un avantage absolu est une production pour laquelle un pays donné a des coûts de production et/ou d’exploitation inférieurs à ceux des autres pays. Pour Adam Smith, chaque pays a donc intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il est le meilleur en termes de coûts de production.
Deux pays ont intérêt à échanger chacun le produit pour lequel ils détiennent un avantage absolu par rapport à l’autre. Il y a donc, pour chacun d’entre eux, un véritable intérêt à se spécialiser et à s’ouvrir.
- Ils peuvent ainsi vendre davantage à l’étranger en raison de prix concurrentiels et importer des produits qui coûteraient plus chers s’ils étaient produits chez eux.
Pour Adam Smith, si un pays ne détient aucun avantage absolu, il n’a pas intérêt à échanger. David Ricardo nuance cela : si un pays n’a pas d’avantage absolu, il doit échanger des produits pour lesquels il détient un avantage comparatif .
Avantage comparatif :
On parle d’avantage comparatif lorsqu’un pays se spécialise dans une production pour laquelle il possède des avantages de coûts relatifs par rapport à d’autres de ses productions.
David Ricardo prend l’exemple suivant :
- En Angleterre, la production d’une quantité $x$ de vin nécessite 120 heures de travail, contre 80 heures au Portugal.
- Toujours en Angleterre, la production d’une quantité $y$ de draps nécessite 100 heures de travail, contre 90 heures au Portugal.
- Dans les deux cas, le Portugal est le plus productif, c’est lui qui détient l’avantage absolu. Mais dans ce cas, selon l’analyse de Smith, l’échange n’est pas possible, car l’Angleterre ne dispose d’aucun avantage. En revanche, pour Ricardo, l’échange doit avoir lieu, tout le monde doit être gagnant : le Portugal doit abandonner la production de draps pour se concentrer sur le vin pour lequel son avantage par rapport à l’Angleterre est bien plus fort. De cette façon, il va pouvoir encore améliorer son avantage comparatif, en laissant à l’Angleterre la possibilité de se spécialiser dans les draps, production pour laquelle elle a le moins grand désavantage.
Adam Smith et David Ricardo ont montré à travers leur théorie que les pays ont intérêt à se spécialiser et à échanger au niveau international. L’analyse de David Ricardo montre que ces échanges internationaux sont possibles pour tous les pays et sont un jeu à somme non nulle, ce qui signifie que tout le monde peut y gagner. Cette analyse permet encore aujourd’hui d’expliquer les fondements du commerce international.
La théorie des avantages comparatifs de Ricardo a fait l’objet de travaux de la part de Hecksher et Ohlin (modèle HO), puis le travail a été complété dans les années 1940 par Samuelson (modèle HOS). Ces économistes ont ainsi tenté d’expliquer les avantages comparatifs des pays.
Dotations factorielles, technologiques et division internationale du travail
- Analyse des dotations factorielles
Le théorème HOS ou « théorie des dotations factorielles » stipule que les pays doivent se spécialiser dans la production pour laquelle ils bénéficient naturellement d’un avantage en termes de facteurs de production . Chaque pays se spécialise donc dans la production et l’exportation de biens qui utilisent le plus intensément le facteur de production le plus abondant.
Voici quelques exemples :
- L’Allemagne détient beaucoup de capitaux, elle aura donc intérêt à se spécialiser sur les productions nécessitant un capital important.
- La Chine dispose d’un grand nombre de travailleurs, elle peut donc se spécialiser dans les productions exigeant une quantité de facteur travail importante.
- La Suède possède des espaces maritimes exploitables, elle peut se spécialiser dans l’élevage de poissons.
L’économiste Wassily Leontief a voulu vérifier le modèle HOS sur les États-Unis. Les États-Unis détiennent relativement plus de facteur capital que de facteur travail. Si l’on utilise le théorème d’HOS, les spécialisations américaines devraient se faire dans des domaines utilisant plus de capital. Les États-Unis devraient donc exporter des produits à forte intensité capitalistique et importer des produits utilisant beaucoup de travail. Or, Léontief constate qu’il y a plus d’intensité capitalistique dans les importations américaines que dans leurs exportations : c’est ce que l’on appelle le paradoxe de Leontief .
- Pour résoudre ce paradoxe, Leontief distingue alors le facteur travail qualifié et le facteur travail non qualifié : les États-Unis disposent en abondance de facteur travail qualifié, comparativement aux autres pays. Il est donc logique que leurs spécialisations se tournent vers des produits utilisant en abondance du facteur travail qualifié.
- Analyse des dotations technologiques
Cette analyse a été proposée par Michael Posner en 1961. Cet économiste a montré que l’ innovation et les dépenses en recherche et développement procuraient aux firmes ou aux pays un avantage technologique valorisable sur le marché international.
Par exemple, une firme détient le monopole dans la production d’un bien nouveau. Si ce bien est consommé à la fois sur le territoire national et à l’étranger, cela génère des flux d’exportations. La firme se retrouve en situation de monopole temporaire tant que d’autres firmes n’ont pas mis au point un produit concurrent.
- L’innovation procure donc un avantage temporaire dans la production et l’exportation.
L’analyse ricardienne et le théorème d’HOS permettent d’expliquer les échanges interbranches, ou ce que l’on appelle la division internationale du travail (DIT) traditionnelle. Les pays se spécialisent dans les productions dont ils détiennent les facteurs de production en abondance. Les différentes économies du monde se répartissent les activités de production entre spécialités complémentaires. Les économies nationales sont donc connectées entre elles et interdépendantes.
D’autre part, l’analyse des dotations technologiques prouve que l’ avance technologique procure un avantage comparatif et que la compétition internationale ne passe pas uniquement par des avantages naturels ou des facteurs abondants, mais qu’elle peut provenir de l’innovation de produits ou de procédés.
Division internationale du travail :
La répartition des activités de production entre plusieurs États est appelée division internationale du travail, (DIT). Elle désigne la spécialisation de pays dans certaines productions complémentaires de biens et de services qu’ils s’échangent en maîtrisant l’intégralité du processus productif.
Cependant, si l’on regarde la nature des échanges aujourd’hui, il existe, comme nous avons pu le voir, des échanges intrabranche, c’est-à-dire de produits similaires. De nouvelles théories permettent d’expliquer ces nouveaux échanges.
Les déterminants des échanges intrabranche
En 1961, l’économiste Staffan Linder centre son analyse sur la demande domestique (ou intérieure) : il montre que le marché international n’est que le prolongement du marché national. La demande locale détermine le type de production envisageable. Le surplus non consommé par le marché local sera alors exporté.
- On comprend donc que les échanges vont se tourner vers des pays à développement économique similaires (les demandes étant similaires).
Bernard Lassudrie-Duchêne approfondit cette idée de demande dans les années 1970. Il montre que le consommateur cherche à se distinguer : il choisit de consommer des produits étrangers ayant des caractéristiques différentes de la production locale (différences qualitatives, de marques, de finition…).
La demande est un facteur explicatif des échanges de produits similaires . Le besoin de différenciation permet d’expliquer l’échange intrabranche. Les pays à développements économiques similaires vont donc échanger des produits similaires, mais aux caractéristiques différentes. Ces échanges sont caractéristiques de la nouvelle division internationale du travail .
Conclusion :
Les échanges internationaux, initiés dès la révolution industrielle, se sont fortement développés tout au long de la seconde moitié du XX e siècle. Ils représentent aujourd’hui un poids considérable dans les PIB des pays du monde. Les produits manufacturés sont ceux qui s’échangent le plus et leur nombre ne cesse d’augmenter, même si la part des services croît sensiblement.
Les échanges sont inégaux : ils se concentrent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, laissant de côté une grande partie du reste du monde.
Les échanges se justifient par plusieurs théories qui s’appuient sur une analyse des facteurs de production de chaque pays : les avantages absolus, les avantages comparatifs et les dotations factorielles. Les spécialisations qui en découlent ont conduit à une répartition des activités productives à l’échelle mondiale, appelée division internationale du travail. On observe aujourd’hui une nouvelle division du travail caractérisée par la distinction entre des échanges intrabranche et interbranches.
🎁 Dernière ligne droite ! -25% avec le code JEVEUXMONBAC2024 ! 😊
Les fondements du commerce international
sesT_2000_00_28C
Le commerce international
Dissertation
4 heures
20 points
Intérêt du sujet • Ce sujet permet de mobiliser l'ensemble des connaissances sur les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production.
Quels sont les fondements du commerce international ?
Document 1 Exportations et importations de biens et services de la France (en milliards d'euros)

Source : Tableaux de l'économie française , Insee, février 2020.
1. Regroupement « Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale ».
Document 2 Volume du commerce mondial des marchandises et PIB réel mondial (en indices base 100 en 2008)

Source : Rapport mondial sur le commerce , OMC, 2019.
Document 3 Les échanges entre la France et le Qatar (2018)

Source : « Les échanges commerciaux entre la France et le Qatar en 2018 », direction générale du Trésor, février 2019.
Document 4 Parts de la valeur ajoutée domestique et étrangère en pourcentage de la valeur des exportations de biens et de services en 2016

Source : Données OCDE, 2020.
Note : La valeur ajoutée domestique des exportations brutes est une estimation de la valeur de la production de biens et services destinés à l'exportation et réalisée par l'économie locale. Plus cette part est faible et plus le pays a eu besoin d'importer des biens et des services, incorporant ainsi de la valeur ajoutée étrangère à la production exportée.
Les clés du sujet
Analyser la consigne et dégager une problématique.

Problématique. Le sujet invite à rechercher les différentes causes du commerce international. On peut ainsi distinguer les facteurs qui expliquent les échanges entre pays différents et ceux qui concernent des pays comparables, tout en s'interrogeant sur le rôle des agents économiques : pays, firmes et consommateurs.
Exploiter les documents
Document 1. Quels types de biens et services sont principalement exportés et importés par la France en 2015 et en 2018 ? Quels sont les produits pour lesquels la France exporte plus qu'elle n'importe ? Quels sont ceux qui font l'objet d'échanges interbranches ? Qu'en déduire ?
Document 2. À quel rythme ont évolué le commerce mondial de marchandises et le produit intérieur brut (PIB) réel mondial depuis 2008 ? Quels liens peut-on établir entre les deux évolutions ?
Document 3. En quoi la nature des échanges croisés entre la France et le Qatar nous renseigne-t-elle sur les avantages comparatifs et la spécialisation des deux pays ?
Document 4. Comparez les parts de la valeur ajoutée étrangère dans la valeur des exportations brutes de différents pays présentés. Quels liens peut-on établir avec l'internationalisation de la production et les stratégies des firmes ?
Définir le plan

Les titres des parties ne doivent pas figurer sur votre copie.
Introduction
[accroche] Bien qu'il marque le pas à la suite de la crise de 2008, le commerce international a tendance à croître fortement depuis une cinquantaine d'années. [présentation du sujet] Entendu au sens large comme l'ensemble des échanges internationaux de matières premières, de produits semi-finis, de produits finis mais aussi de services, il a été encouragé par les organisations internationales et les États, majoritairement favorables au libre-échange après la fin de la Seconde Guerre mondiale. [problématique] Il convient de s'interroger sur les multiples facteurs qui expliquent à la fois l'importance de ce commerce mondial mais aussi, sur le long terme, son développement. [annonce du plan] En premier lieu, nous analyserons les facteurs des échanges entre économies différentes, puis, en second lieu, nous expliquerons l'essor du commerce entre économies semblables.
Le secret de fabrication
Il convient de bien départager les facteurs du commerce mondial entre ceux qui concernent les économies semblables et ceux qui ont lieu entre des économies différentes. L'internationalisation des chaînes de valeur est un argument qui peut figurer dans les deux parties, mais les mécanismes et illustrations ne sont alors pas les mêmes.
I. Commerce international et différences entre économies
1. la thèse des avantages comparatifs.
Au xix e siècle, David Ricardo , un économiste classique anglais, a théorisé les bienfaits du libre-échange . Il prend l'exemple de l'Angleterre et du Portugal qui ont chacun un plus grand avantage comparatif à produire respectivement du drap et du vin. Chaque pays se spécialise alors dans la production dans laquelle il est relativement le plus productif et importe les biens qu'il ne produit pas.
Au xx e siècle, d'autres économistes ont enrichi les travaux de Ricardo en expliquant les échanges internationaux par d'inégales dotations factorielles . Certains pays ont un facteur de production plus abondant qu'ils pourront se procurer à moindre coût. Ils ont alors intérêt à se spécialiser dans les productions utilisant intensément le facteur de production abondant et à importer les autres productions.
2. La spécialisation des économies à la base du commerce international
Les pays qui se spécialisent vont donc exporter les biens ou services pour lesquels ils bénéficient d'avantages comparatifs en termes de productivité ou de dotations factorielles. Ils vont donc réaliser des échanges interbranches . Par exemple, les importations de la France en provenance du Qatar, dont le sous-sol regorge d'hydrocarbures, sont constituées à 86,1 % de gaz naturel et de produits pétroliers ( document 3 ). Mais les avantages comparatifs peuvent également se construire : on parle alors de dotations technologiques . La France a ainsi fait de certaines de ses industries de véritables « fers de lance » de son économie. C'est le cas de l'aéronautique : en 2018, 77 % de ses exportations à destination du Qatar concernent des aéronefs et engins spatiaux ( document 3 ). Et environ 25 % de ses exportations industrielles totales sont constituées de matériels de transport ( document 1 ).
Les services sont les secteurs du transport, du tourisme, du commerce, de l'assurance ou de l'information-communication. Leur part dans les échanges internationaux connaît un essor important.
Les firmes s'appuient sur la spécialisation des territoires pour localiser leur production : elles vont ainsi profiter des avantages comparatifs à chaque stade de la production, d'autant que les coûts de transport baissent. La fragmentation croissante de la chaîne de valeur qui en résulte donne naissance à une hausse du commerce de produits semi-finis. L'examen de la valeur ajoutée de la production destinée à l'exportation montre ainsi qu'une partie est imputable aux importations : c'est le cas, en 2016, de 40 % des biens et services exportés par l'Irlande ( document 4 ).
3. Le commerce mondial, source de multiples avantages
Ricardo a démontré que les pays qui se spécialisaient réalisaient un gain en commerçant entre eux. Les échanges internationaux sont depuis considérés comme un moteur essentiel de la croissance. Depuis 2008, le commerce mondial de marchandises et le PIB mondial évoluent de manière parallèle : ils ont tous deux augmenté de 25 % environ en dix ans, tandis que le tassement du PIB mondial qui a suivi la crise de 2008 s'est accompagné d'une baisse de 12 % du commerce mondial de biens ( document 2 ).
En se tournant vers le commerce international, les firmes peuvent profiter d'une diminution des coûts de production liée aux avantages comparatifs. Elles peuvent ainsi améliorer leur compétitivité-prix . Les ménages vont pouvoir profiter d'une baisse des prix, qui alimente la demande . À l'échelle macro-économique, les avantages qui en résultent favorisent la croissance.
II. Un commerce mondial favorisé par les échanges entre économies semblables
1. de nombreux échanges entre économies comparables.
Depuis la création du GATT en 1947, remplacé par l' OMC en 1995, les accords de libre-échange se multiplient. On voit alors croître les échanges dits intra-zone , concernant des pays proches géographiquement et parfois économiquement. L'élargissement des marchés permet aux firmes de réaliser des économies d'échelle et de gagner en compétitivité-prix.
Le conseil de méthode
Les documents sont tous factuels dans une dissertation. Il convient donc de se poser des questions sur l'usage des données. Demandez-vous à chaque fois quel est l'intérêt du document, en rapport avec la question. Ce sont vos connaissances et la bonne compréhension du sujet qui vont vous permettre d'exploiter au mieux les statistiques. Ici les exportations et importations françaises sont rapprochées de la notion d'échanges intrabranches.
Les échanges peuvent concerner un même type de produits : on parle alors d'échanges intrabranches . En 2018, la France exporte des produits agricoles et de la pêche et en importe également pour des montants relativement proches. Il en est de même pour les matériels de transport ( document 1 ).
2. La recherche de différenciation des produits
Dans un contexte de mondialisation accrue, les firmes vont essayer de se soustraire à la concurrence en menant des stratégies de différenciation de produits, source de compétitivité hors-prix . La mise sur le marché de produits aux caractéristiques différentes va ainsi alimenter le commerce mondial.
Dans la seconde moitié du xx e siècle, différents économistes ont mis en évidence la demande de différence des consommateurs. Des produits, en apparence similaires, peuvent présenter des caractéristiques différentes. Si, par exemple, la France importe des voitures d'Allemagne, elle en exporte également : il s'agit de biens au design et à la qualité distincts. Les échanges internationaux permettent ainsi aux ménages de satisfaire ce besoin de variété.
3. La fragmentation des chaînes de valeur dans des économies comparables
Pour optimiser la production et gagner en compétitivité, les firmes peuvent choisir de se concentrer sur leur métier de base. Par exemple, les fabricants automobiles font appel à des équipementiers qui vont leur fournir des pièces détachées : des pare-brise, des pots d'échappement, etc. Une partie de la production est ainsi externalisée , c'est-à-dire confiée à des sous-traitants . Les firmes mettent alors en concurrence différents fournisseurs, dont certains peuvent se situer à l'étranger, contribuant à fragmenter la chaîne de valeur mondiale .
L'internationalisation de la production qui en résulte peut ainsi concerner des économies semblables. La réalisation du produit fini va nécessiter d'importer des biens intermédiaires ou semi-finis, certains pouvant franchir la frontière plusieurs fois. La valeur ajoutée créée dans la plupart des pays de l'OCDE provient de productions réalisées en partie à l'étranger ( document 4 ). Les stratégies des firmes conduisent ainsi à un essor du commerce mondial .
Il ne faut pas confondre commerce international et internationalisation de la production. La seconde notion n'est à présenter que dans la mesure où elle favorise le développement du commerce international.
[bilan] Une multiplicité de facteurs explique le commerce international. Une partie des échanges vient de la complémentarité des spécialisations des économies, en raison d'avantages comparatifs. En outre, les firmes, en fragmentant leur chaîne de valeur pour profiter de ces avantages, vont elles-mêmes être à l'origine d'échanges. Mais le commerce mondial concerne également des économies comparables, permettant aux entreprises de gagner en compétitivité et aux consommateurs de répondre à leurs besoins. [ouverture] La crise sanitaire que traverse l'économie mondiale en 2020 nourrit les critiques à l'encontre de la mondialisation, déjà pointée du doigt pour les dommages créés à l'environnement. Une relocalisation d'activités et une baisse des échanges sont-elles possibles ? La forte imbrication des économies semble pourtant difficilement contournable…
Pour lire la suite
Et j'accède à l'ensemble des contenus du site
Et je profite de 2 contenus gratuits
Chapitre 2 : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?
Introduction.
Commerce international : ensemble des échanges de biens et services entre pays. Il se mesure en additionnant les exportations de tous les pays = valeur des exportations mondiales de marchandises
Internationalisation de la production : processus de développement de la production de biens et services des firmes dans des pays autres que leur pays d’implantation initiale.
La valeur des exportations mondiales a été multipliée par 10 depuis 1970, alors que le PIB mondial a été multiplié par 4). Les exportations augmentent donc plus vite que le PIB, ce qui veut dire que l’on échange plusieurs fois un bien produit une fois.
Cela est permis par la baisse des coûts de transport (donc le progrès technique dans le secteur des transports) et la baisse des tarifs douaniers.
Cette internationalisation du commerce et de la production nous rend particulièrement dépendant de productions réalisées à l’étranger. Les problèmes d’approvisionnement en masques, en principes actifs de médicaments et autres appareils respiratoires lors de crise du covid-19 en témoignent !
1.Quels sont les fondements du commerce international ?
Le but de cette partie est d’expliquer pourquoi les pays commercent entre eux, plutôt que de produire tous les B&S dont ils ont besoin. On va commencer par expliquer le commerce de produits différents (le commerce interbranche) avant d’aborder le commerce de produits comparables (commerce intra-branche).
1.1Le rôle des dotations factorielles et technologiques dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale : l’échange international de produits différents
Il s’agit d’expliquer la spécialisation économique d’un pays : elle désigne le choix d’un pays de choisir de produire tels produits et de ne pas produire d’autres biens et services.
Spécialisation internationale : fait pour les pays de se consacrer à la production d'un éventail plus restreint de biens et de services que la gamme de biens et de services qu’il utilise.
-Pour expliquer la spécialisation et la division internationale du travail, D. Ricardo, économiste anglais du 19ème siècle, élabore la théorie de l’avantage comparatif.
Selon D.Ricardo, les pays se spécialisent dans les productions où ils sont relativement le plus efficaces ou les moins inefficaces, c’est-à-dire là où ils ont un avantage comparatif.
Avantages comparatifs : L’avantage comparatif est un critère de spécialisation qui conduit un pays à se spécialiser dans la production où il est le meilleur ou relativement le moins mauvais c’est-à-dire à se spécialiser dans les secteurs où l’écart de productivité est le plus petit par rapport aux autres pays.
-Les pays se spécialisent aussi là où ils sont le mieux dotés en facteurs de production (travail et capital) : selon leur dotation factorielle
Dotations factorielles : Ensemble des facteurs de production dont dispose un pays
Si, dans certains pays le facteur travail est relativement abondant, par rapport au facteur capital (pays en développement avec une forte croissance démographique par exemple), alors le prix du facteur travail sera relativement bon marché (relativement au facteur capital). Les pays les mieux dotés en facteur travail ont alors intérêt à se spécialiser dans la fabrication de produits intensifs en main d'œuvre (et donc à exporter ses produits), tandis que ceux qui sont mieux dotés en capital ont intérêt à se spécialiser dans les produits à forte intensité capitalistique.
-La spécialisation internationale peut aussi s’expliquer par la dotation technologique, (c’est à dire qu’il ne s’agit plus seulement de regarder la quantité de facteur de production possédée mais aussi leur productivité )
Les échanges internationaux s’expliquent aussi par l’écart technologique entre nations. Une nation bénéficie d’un écart technologique parce qu’elle dispose d’une avance technologique liée à l’importance de l’investissement en recherche-développement. Les économie s avancées exportent les produits innovants puis, progressivement, à mesure que les technologies deviennent plus communes, les économie s en développement les imitent et deviennent exportateurs lorsque ces produits peuvent être fabriqués par une main-d’œuvre à faible coût. Pour maintenir leur part de marché à l’exportation, les économie s avancées doivent donc innover continuellement.
Grâce aux importations et à la diffusion du progrès technique, certains pays en développement vont en profiter pour mener des stratégies de remontée des filières qui consistent à construire progressivement de nouveaux avantages comparatifs (ex de la Corée du Sud ). Spécialisés initialement dans des productions intensives en travail peu qualifié en vertu du théorème HOS, par exemple la production de biens de consommation à faible valeur ajoutée, ils diversifient progressivement leur offre vers des productions plus intensives en capital et à plus forte valeur
Conclusion :
Avec la théorie de l’avantage comparatif de Ricardo, la spécialisation des pays repose sur les écarts de productivité, avec la théorie des dotations factorielles, les pays exportent les produits selon leurs dotations en facteur de production ou dotations factorielles.
1.2L’échange international entre pays comparables
Les pays comparables sont les pays qui ont le même niveau de développement et qui exportent des biens comparables, c’est-à-dire dont les exportations consistent essentiellement en du commerce intra branche.
Le commerce interbranche correspond à un commerce de produits de branches d’activités différentes ; le commerce intra-branche renvoie au commerce entre produits d’une même branche d’activité.
Ce qui explique le commerce intra-branche, c’est la stratégie de différenciation des FMN : les entreprises des différents pays se font concurrence. Cette concurrence peut consister à différencier le produit de façon à obtenir une position de monopole. Cela est possible par deux moyens :
En recourant à l’innovation de produit et donc en proposant des gammes de produits de qualité et donc de prix différents : stratégie de différenciation verticale (par exemple, les différents standards de chambre d’hôtel ou les différentes gammes d’un même modèle de voiture)
En recourant à des dépenses de publicité et de marketing pour différencier les produits aux yeux des consommateurs : stratégie de différenciation horizontale. (variété différente : couleur, design, goût…)
- Ce qui explique alors le commerce intra branche est le fait que les entreprises font chercher à différencier leurs produits (par la qualité ou par d’autres caractéristiques) dans le but d’augmenter leur offre, donc la consommation donc la production pour augmenter leur bénéfice. Cette stratégie entraîne souvent une position de monopole de l’entreprise qui va ainsi pouvoir vendre son produit plus cher (exemple : les glaces Ben and Jerry’s)
-le développement du commerce intra-branche s’explique aussi par l’internationalisation de la chaîne de valeur
Fragmentation de la chaîne de valeur : c’est le fait que les entreprises fabriquent chaque segment de leur produit (de la conception à la commercialisation) séparément
« chaînes de valeur ». Il s'agit de la manière dont les différentes étapes de la production ajoutent de la valeur à un produit final ou, inversement, dont la valeur totale d'un produit est attribuée à chaque étape. Les chaînes de valeur mondiales impliquent que les étapes de production, de la conception d'un produit à sa livraison au consommateur final, sont effectuées dans des pays différents.
Internationalisation
Fragmentation dans différents pays pour tirer des avantages comparatifs et ainsi baisser leurs coûts de production (voir 2.2)
Du coup, les biens s’échangent plus vite qu’ils ne sont produits et cela explique que les pays échangent des biens similaires.

2.Quels sont les facteurs qui sont à l’origine de l’internationalisation de la production ?
Dans cette partie on se demande pourquoi les entreprises produisent dans plusieurs pays : cela s’explique par la recherche d’une plus grande compétitivité et par l’internationalisation de la chaîne de valeur.
2.1Les liens entre productivité des entreprises et compétitivité des pays
La productivité mesure l’efficacité de la production
Compétitivité : Pour un pays, la compétitivité est sa capacité à exporter. Pour une entreprise, la compétitivité est la capacité à faire face à la concurrence en gagnant des parts de marché.
L’entreprise peut améliorer sa compétitivité :
-soit par des prix plus bas que ses concurrents (compétitivité-prix). Pour cela, elle va chercher à baisser ses coûts de production. Si la PGF augmente, cela peut signifier que la production se fait avec des facteurs de production moins chers. La hausse de la productivité permet ainsi aux entreprises d’avoir des coûts de production plus bas et donc de vendre moins chers ses produits, ce qui augmente sa compétitivité-prix. Cela explique que dans les pays qui ont de faibles coûts de production (et en particulier un faible coût du travail) , qui sont plutôt des pays en développement, viennent s’installer des FMN en recherchent d’une meilleure compétitivité-prix (par exemple, les entreprises de textile au Bengladesh)
-soit par d’autres facteurs que les prix (compétitivité hors-prix) : qualité supérieure du produit, meilleure image de marque, fourniture d’un service après-vente, etc.. Ici, c’est la productivité en valeur des entreprises qui peut augmenter parce qu’elles vont vendre des biens à plus forte valeur ajoutée grâce à des travailleurs plus qualifiés et des machines plus performantes. Les FMN qui recherchent une compétitivité hors-prix (par exemple, celles qui veulent produire des biens de qualité ou des biens à fort contenu technologique) vont alors plutôt s’installer dans les pays développés où il y a de bonnes infrastructures.
=> Lorsqu’une entreprise est plus productive, elle gagne des parts de marché, cela va augmenter le volume de ses exportations et donc la compétitivité du pays.
2.2L’internationalisation de la chaîne de valeur accroît l’internationalisation de la production
Les FMN sont des entreprises qui ont au moins une unité de production ou de vente (filiale) à l’étranger.
Ces FMN sont créées lorsqu’une entreprise réalise un investissement productif à l’étranger = IDE. L’IDE peut consister à créer une usine de toute pièce, à en acheter une existante totalement ou partiellement (prise de participation).
Aujourd’hui, les diverses tâches de la production sont décomposées (conception, production des composants, assemblage, commercialisation), puis réparties dans un grand nombre de pays.
Cela a une conséquence sur la nature du commerce international, c’est l’internationalisation de la chaîne de valeur, lefait que les différentes étapes de la production d’un produit (conception, approvisionnement, fabrication, commercialisation) soient réalisées dans plusieurs pays :
-La firme peut chercher à réduire ses coûts de production (logique de compétitivité-prix) Dans ce cas, elle va souvent localisée une partie de la production dans un pays émergent
-La firme peut chercher à augmenter sa compétitivité hors-prix. Dans ce cas, elle va plutôt localiser son segment de production dans un pays où la main-d’œuvre est qualifiée, où il y a un potentiel de R&D et d’éducation, des infrastructures de qualité, … (pays développés)
Une FMN va d’ailleurs combiner les 2 logiques. La conséquence est que le commerce international constitue un commerce de biens intermédiaires (composants) à l’intérieur d’une même firme, assemblés dans un pays, pour donner le produit final, lequel sera commercialisé dans le monde entier = commerce intra firme.
Ce mouvement d’internationalisation de la chaîne de valeur est permis par des politiques de libéralisation commerciale et financière qui ont facilitées les flux de marchandises et les flux de capitaux. La baisse des coûts du transport a également joué un grand rôle tout comme l’essor des technologies de l’information et de la communication (TIC) qui facilitent la coordination entre firmes.
Remarques :
Cette stratégie de localisation de la production des FMN ne doit pas être confondue avec la stratégie de délocalisation. Cette dernière implique certes la création d’une usine à l’étranger, mais la combine avec la fermeture d’une usine et l’exportation des produits fabriqués dans le pays où l’usine a été fermée. Les délocalisations surviennent lorsque les firmes (sous la pression des actionnaires) ferment des usines rentables dans le but d’accroître les profits de l’entreprise.
Elle ne doit pas non plus être confondue avec la stratégie d’externalisation qui consiste pour une entreprise à sous-traiter une partie ou la totalité d’un produit (bien intermédiaire ou alors le bien final) à une autre entreprise.
3. Quels sont les effets du commerce international ?
- Les effets du commerce international sur les consommateurs et les producteurs
a)Les effets sur les consommateurs
Les effets positifs :
Avec la spécialisation internationale selon les avantages comparatifs, les coûts de production des entreprises diminuent ce qui peut se traduire par une baisse des prix de vente des produits et/ou par une hausse des salaires, c’est-à-dire un gain de pouvoir d’achat des consommateurs.
Les stratégies de différenciation des FMN vont permettre aux consommateurs d’avoir accès à une plus grande diversité de biens et services.
Les effets négatifs :
La recherche d’une meilleure-compétitivité -prix des entreprises entraîne une recherche permanente des coûts les plus bas :
-ce qui provoque une pression à la baisse (ou à la non augmentation) des salaires : ce qu’on appelle le dumping salarial et plus largement social
-un dumping environnemental : c’est-à-dire une pression à la non-existence de lois environnementales
-peut aussi se traduire par une baisse de la qualité des produits proposés.
La spécialisation internationale entraîne dans certains pays la disparition de pans entiers de secteurs d’activité ce qui va se traduire par
-des destructions d’emplois et une hausse du chômage et la disparition de l’ économie locale
-et par une dépendance accrue aux autres pays avec des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en composants intermédiaires qui reste d’entraîner des pénuries pour les consommateurs
b)Les effets sur les producteurs
Les effets positifs
En se spécialisant, les producteurs acquièrent une expertise qui leur permet d’accroître encore leurs gains de productivité. La pression concurrentielle accroît aussi leur recherche de productivité. La concurrence internationale incite les entreprises à innover pour pouvoir aussi augmenter leur compétitivité hors-prix.
De plus, la concentration de firmes dans un espace géographique donné est génératrice d’externalités positives qui renforcent la productivité de chacune d’elles
L’augmentation de la taille des marchés permet aux entreprises de faire des économie s d’échelle (quand les quantités produites augmentent le cout de production unitaire diminue) ce qui leur permet de baisser encore leur prix de vente et d’augmenter leur compétitivité.
Le commerce international entraîne une concurrence accrue :
-soit sur les prix : La recherche permanente du prix de vente le plus bas risque de conduire certaines entreprises à limiter au maximum leurs bénéfices ce qui à terme peut générer des risques de faillite et menacer leurs capacités d’investissement.
-soit sur la diversité des produits qui peut se faire par la différenciation horizontale ou par la différenciation verticale et qui peut faire perdre des parts de marché aux entreprises locales
-l’internationalisation de la chaîne de valeur peut conduire à des problèmes d’approvisionnement en pièces détachées ou en matières premières et donc limiter les possibilités de production
3.2 Les effets du CI sur les inégalités
-Les inégalités à l’intérieur des pays se mesurent par les écarts de revenus entre les ménages résidents
Dans les PDEM (pays développés), les inégalités se sont creusés sous l’effet de deux mécanismes : d’un côté la mondialisation renforce les FMN qui sont des sociétés cotées en bourse distribuant des dividendes à leurs actionnaires. La hausse des dividendes a permis l’enrichissement des plus riches. De l’autre côté, en détruisant des emplois peu qualifiés et en exerçant une pression à la baisse des salaires, l’internationalisation appauvrit la partie la plus défavorisée de la population des pays développés.
Dans les PED (pays en développement), la mondialisation permet l’enrichissement de la classe moyenne (surtout dans les pays émergents) car en engendrant de la croissance économique, elle a permis des créations d’emplois et une augmentation des salaires. Cependant, les inégalités se creusent entre ceux qui bénéficient de la mondialisation parce qu’ils travaillent dans une FMN ou dans le secteur formel et ceux qui travaillent dans le secteur informel.
=> les inégalités à l’intérieur des pays ont augmenté.
-Les inégalités entre pays se mesurent par les écarts de niveau de vie moyen entre pays.
Avec la mondialisation, les inégalités entre pays se sont réduites car elle a permis la croissance et le développement des PED qui ont bénéficié d’une forte augmentation de leur niveau de vie moyen. Ceci est surtout vrai pour les pays émergents. En effet, certains pays, notamment en Afrique, se sont retrouvés exclus de l’internationalisation de la production.
- La réduction des inégalités mondiales ou internationales ou globales depuis les années 1990 s’explique essentiellement par l’émergence de grandes nations, comme l’Inde ou la Chine tout particulièrement. En s’insérant dans les chaînes de valeur mondiales, ces pays fortement peuplés ont connu un rattrapage économique et de vastes classes moyennes sont apparues faisant de facto reculer l’inégalité internationale
4. Le débat entre libre-échange et protectionnisme
Le commerce international engendre certes des gains à l’échange mais il génère aussi, dans le même temps, d’importants effets distributifs au sein des nations. Les « perdants » de la mondialisation expriment donc une demande politique de protectionnisme
Gains à l’échange= Les gains à l’échange sont les avantages procurés aux offreurs et aux demandeurs par la spécialisation et l’échange. Ils peuvent être mesurés par le surplus du producteur et le surplus du consommateur et par l’augmentation de la production et de la consommation globale qui en découle.
4.1 Avantages et inconvénients du libre-échange
Libre-échange : système de commerce international reposant sur l'absence de barrières douanières à la circulation des biens et des services entre les pays. Les barrières douanières peuvent être tarifaires (taxes) ou non tarifaires (normes, quotas)
Les effets positifs de la mondialisation pour les consommateurs et les producteurs correspondent aux avantages du libre-échange (gains de productivité, croissance, gain de pouvoir d’achat, plus grandes variétés de produit).
Les effets négatifs du commerce international correspondent aux inconvénients du libre-échange pour les consommateurs et les producteurs.
A cela, il faut rajouter les avantages et les inconvénients pour les états :
-Avantages : les états en s’inscrivant dans une zone de libre-échange ont ainsi un pouvoir de négociation plus grand avec le reste du monde (exUE), ils peuvent bénéficier des avantages des autres pays de l’union douanière (transferts de technologie, croissance économique,…)
-Inconvénients : la concurrence internationale incite les états à limiter la fiscalité (dumping fiscal) ce qui restreint leurs recettes fiscales et leur autonomie politique
-Beaucoup de pays, en particulier les PED sont aussi tentés de limiter leur réglementation sociale et environnementale pour attirer les FMN : dumping social et environnemental
l’emploi dans une industrie traditionnelle
4.2 Avantages et inconvénients du protectionnisme
Protectionnisme : Ensemble des mesures visant à protéger un pays de la concurrence étrangère, soit par des barrières tarifaires (droits de douane) soit par des barrières non-tarifaires (quotas, normes sanitaires ou techniques)
L’idée ici est de ne pas nécessairement remettre en question le commerce international, mais de protéger l’ économie nationale contre les effets négatifs du libre-échange, donc de la mondialisation.
On peut justifier le protectionnisme ;
- pour protéger les industries naissantes, (F. List).
-pour protéger l’emploi dans une industrie traditionnelle ou dans une industrie vieillissante (M.Allais), le temps qu’elle s’adapte à la concurrence.
-pour protéger un secteur d’activité stratégique ; l’armement, la culture, les médicaments
Le protectionnisme peut consister à taxer les produits importés ce qui augmente leur coût et favorise les produits nationaux, le problème est que les entreprises voient aussi leurs coûts augmenter et augmentent les prix de sortent que les prix des biens importés augmentent, mais aussi les prix des productions nationales.
Les pays peuvent mettre en place des barrières non tarifaires, comme les quotas d’importations, les normes sanitaires (interdisant l’entrée de produit pour des raisons de santé, ex. OGM) ou normes technique (normes EU).
Les politiques protectionnistes s’exposent à des représailles. En effet, la mise en place de barrières douanières peut entraîner une réponse équivalente de l’autre pays : par exemple, si la France met des barrières à l’entrée de produits chinois, la Chine peut faire de même pour l’entrée de produits français sur son territoire. Or, le marché chinois représente un nombre beaucoup plus grand de consommateurs potentiels pour les entreprises françaises que le marché français.
Spécial Bac
Les fondements du commerce international
Voici les repères nécessaires pour rédiger une copie d'excellence sur le thème du " Commerce internationale" : une accroche ; le courant de pensée économique ou sociologique, un auteur et sa citation, le mécanisme, un chiffre significatif.

- LA THÉMATIQUE : LES FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL
- LE SUJET : DANS QUELLE MESURE LE PROTECTIONNISME PEUT-IL ÊTRE BÉNÉFIQUE POUR LA CROISSANCE ?
Donald Trump s’est lancé, en novembre 2018, dans une guerre commerciale avec la Chine. Les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur certains produits importés de l’Empire du Milieu. En rétorsion, les Chinois ont, eux aussi, décidé de taxer les produits américains. Les conséquences de telles mesures en matière de croissance sont incertaines. Pour certains économistes, les États-Unis se sont tiré une balle dans le pied. D’autres pensent à l’inverse que ce protectionnisme peut permettre d’apporter une réponse pertinente à certains problèmes économiques auxquels font face les États-Unis. À travers cette discussion sur les bienfaits et méfaits du protectionnisme émerge, en miroir, la question des avantages et des inconvénients du commerce international, entendu comme les flux de biens et de services entre espaces nationaux.
C’est le taux de croissance des échanges en volume prévu par l’OMC (Organisation mondiale du commerce) pour 2019, soit un net ralentissement par rapport à 2018 (-1,1 point), en raison notamment des tensions internationales.
Le mécanisme
La loi des avantages comparatifs de David Ricardo (1772-1823)
Tous les pays peuvent être gagnants dans un système de libre-échange s’ils se spécialisent, peu importe qu’ils aient des avantages absolus de coûts de production ou pas. Leur spécialisation doit porter sur la production des biens pour lesquels leur avantage comparatif est le plus élevé, ou leur désavantage le moins élevé en termes de coûts « relatifs ». Ils peuvent échanger les biens qu’ils ne produisent pas, les échanges s’expliquent alors par des écarts de productivité du travail.
L’avantage « comparatif » est envisagé par rapport aux autres pays et surtout par rapport aux autres biens que le pays est susceptible de produire. Les nouvelles théories montrent que les avantages comparatifs se construisent. Ainsi, les dépenses en innovation, en recherche et développement, en formation, ou bien les législations peuvent permettre à un pays de se créer des avantages qui ne sont pas donnés une fois pour toutes.
Cette loi de Ricardo montre les gains à l’échange, les avantages de la DIT (Division internationale du travail) et de la spécialisation, assurant gains de productivité et compétitivité. La question reste de savoir si tous les avantages comparatifs se valent et si les gains sont également distribués entre tous les pays.
Friedrich List

(1789-1846), économiste allemand. Selon lui, un pays qui n’a pas atteint le dernier stade de son développement lui permettant à la fois de satisfaire sa demande intérieure et d’exporter sera trop faible pour résister à la concurrence internationale. Il doit se protéger des importations, mais raisonnablement. C’est un protectionnisme « enfant ou éducateur ». Il est temporaire, sélectif et dégressif, le temps que les industries nationales se renforcent et puissent être compétitives sur le plan international. Le libre-échange ne peut être véritablement bénéfique qu’entre pays à la maturité économique comparable.
La protection douanière est notre voie, le libre-échange est notre but.
Le Système national d’économie politique, 1844
- International

- Classements des écoles
- Histoire, géographie et politique
- Littérature
- Philosophie
- Sciences économiques et sociales (SES)
- Quiz métiers
- Qui sommes-nous ?

Classement des écoles » Dissertations et devoirs » Sciences économiques et sociales (SES) » Dissertation : Les fondements du commerce international
Dissertation : Les fondements du commerce international
Analyser la consigne et dégager une problématique

Problématique. Le sujet invite à rechercher les différentes causes du commerce international. On peut ainsi distinguer les facteurs qui expliquent les échanges entre pays différents et ceux qui concernent des pays comparables, tout en s’interrogeant sur le rôle des agents économiques : pays, firmes et consommateurs.
Exploiter les documents
Document 1. Quels types de biens et services sont principalement exportés et importés par la France en 2015 et en 2018 ? Quels sont les produits pour lesquels la France exporte plus qu’elle n’importe ? Quels sont ceux qui font l’objet d’échanges interbranches ? Qu’en déduire ?
Document 2. À quel rythme ont évolué le commerce mondial de marchandises et le produit intérieur brut (PIB) réel mondial depuis 2008 ? Quels liens peut-on établir entre les deux évolutions ?
Document 3. En quoi la nature des échanges croisés entre la France et le Qatar nous renseigne-t-elle sur les avantages comparatifs et la spécialisation des deux pays ?
Document 4. Comparez les parts de la valeur ajoutée étrangère dans la valeur des exportations brutes de différents pays présentés. Quels liens peut-on établir avec l’internationalisation de la production et les stratégies des firmes ?
Définir le plan

Les titres des parties ne doivent pas figurer sur votre copie.
Introduction
[accroche] Bien qu’il marque le pas à la suite de la crise de 2008, le commerce international a tendance à croître fortement depuis une cinquantaine d’années. [présentation du sujet] Entendu au sens large comme l’ensemble des échanges internationaux de matières premières, de produits semi-finis, de produits finis mais aussi de services, il a été encouragé par les organisations internationales et les États, majoritairement favorables au libre-échange après la fin de la Seconde Guerre mondiale. [problématique] Il convient de s’interroger sur les multiples facteurs qui expliquent à la fois l’importance de ce commerce mondial mais aussi, sur le long terme, son développement. [annonce du plan] En premier lieu, nous analyserons les facteurs des échanges entre économies différentes, puis, en second lieu, nous expliquerons l’essor du commerce entre économies semblables.
I. Commerce international et différences entre économies
1. la thèse des avantages comparatifs.
Au xix e siècle, David Ricardo , un économiste classique anglais, a théorisé les bienfaits du libre-échange . Il prend l’exemple de l’Angleterre et du Portugal qui ont chacun un plus grand avantage comparatif à produire respectivement du drap et du vin. Chaque pays se spécialise alors dans la production dans laquelle il est relativement le plus productif et importe les biens qu’il ne produit pas.
Au xx e siècle, d’autres économistes ont enrichi les travaux de Ricardo en expliquant les échanges internationaux par d’inégales dotations factorielles . Certains pays ont un facteur de production plus abondant qu’ils pourront se procurer à moindre coût. Ils ont alors intérêt à se spécialiser dans les productions utilisant intensément le facteur de production abondant et à importer les autres productions.
2. La spécialisation des économies à la base du commerce international
Les pays qui se spécialisent vont donc exporter les biens ou services pour lesquels ils bénéficient d’avantages comparatifs en termes de productivité ou de dotations factorielles. Ils vont donc réaliser des échanges interbranches . Par exemple, les importations de la France en provenance du Qatar, dont le sous-sol regorge d’hydrocarbures, sont constituées à 86,1 % de gaz naturel et de produits pétroliers ( document 3 ). Mais les avantages comparatifs peuvent également se construire : on parle alors de dotations technologiques . La France a ainsi fait de certaines de ses industries de véritables « fers de lance » de son économie. C’est le cas de l’aéronautique : en 2018, 77 % de ses exportations à destination du Qatar concernent des aéronefs et engins spatiaux ( document 3 ). Et environ 25 % de ses exportations industrielles totales sont constituées de matériels de transport ( document 1 ).
Les firmes s’appuient sur la spécialisation des territoires pour localiser leur production : elles vont ainsi profiter des avantages comparatifs à chaque stade de la production, d’autant que les coûts de transport baissent. La fragmentation croissante de la chaîne de valeur qui en résulte donne naissance à une hausse du commerce de produits semi-finis. L’examen de la valeur ajoutée de la production destinée à l’exportation montre ainsi qu’une partie est imputable aux importations : c’est le cas, en 2016, de 40 % des biens et services exportés par l’Irlande ( document 4 ).
3. Le commerce mondial, source de multiples avantages
Ricardo a démontré que les pays qui se spécialisaient réalisaient un gain en commerçant entre eux. Les échanges internationaux sont depuis considérés comme un moteur essentiel de la croissance. Depuis 2008, le commerce mondial de marchandises et le PIB mondial évoluent de manière parallèle : ils ont tous deux augmenté de 25 % environ en dix ans, tandis que le tassement du PIB mondial qui a suivi la crise de 2008 s’est accompagné d’une baisse de 12 % du commerce mondial de biens ( document 2 ).
En se tournant vers le commerce international, les firmes peuvent profiter d’une diminution des coûts de production liée aux avantages comparatifs. Elles peuvent ainsi améliorer leur compétitivité-prix . Les ménages vont pouvoir profiter d’une baisse des prix, qui alimente la demande . À l’échelle macro-économique, les avantages qui en résultent favorisent la croissance.
II. Un commerce mondial favorisé par les échanges entre économies semblables
1. de nombreux échanges entre économies comparables.
Depuis la création du GATT en 1947, remplacé par l’ OMC en 1995, les accords de libre-échange se multiplient. On voit alors croître les échanges dits intra-zone , concernant des pays proches géographiquement et parfois économiquement. L’élargissement des marchés permet aux firmes de réaliser des économies d’échelle et de gagner en compétitivité-prix.
Les échanges peuvent concerner un même type de produits : on parle alors d’échanges intrabranches . En 2018, la France exporte des produits agricoles et de la pêche et en importe également pour des montants relativement proches. Il en est de même pour les matériels de transport ( document 1 ).
2. La recherche de différenciation des produits
Dans un contexte de mondialisation accrue, les firmes vont essayer de se soustraire à la concurrence en menant des stratégies de différenciation de produits, source de compétitivité hors-prix . La mise sur le marché de produits aux caractéristiques différentes va ainsi alimenter le commerce mondial.
Dans la seconde moitié du xx e siècle, différents économistes ont mis en évidence la demande de différence des consommateurs. Des produits, en apparence similaires, peuvent présenter des caractéristiques différentes. Si, par exemple, la France importe des voitures d’Allemagne, elle en exporte également : il s’agit de biens au design et à la qualité distincts. Les échanges internationaux permettent ainsi aux ménages de satisfaire ce besoin de variété.
3. La fragmentation des chaînes de valeur dans des économies comparables
Pour optimiser la production et gagner en compétitivité, les firmes peuvent choisir de se concentrer sur leur métier de base. Par exemple, les fabricants automobiles font appel à des équipementiers qui vont leur fournir des pièces détachées : des pare-brise, des pots d’échappement, etc. Une partie de la production est ainsi externalisée , c’est-à-dire confiée à des sous-traitants . Les firmes mettent alors en concurrence différents fournisseurs, dont certains peuvent se situer à l’étranger, contribuant à fragmenter la chaîne de valeur mondiale .
L’internationalisation de la production qui en résulte peut ainsi concerner des économies semblables. La réalisation du produit fini va nécessiter d’importer des biens intermédiaires ou semi-finis, certains pouvant franchir la frontière plusieurs fois. La valeur ajoutée créée dans la plupart des pays de l’OCDE provient de productions réalisées en partie à l’étranger ( document 4 ). Les stratégies des firmes conduisent ainsi à un essor du commerce mondial .
[bilan] Une multiplicité de facteurs explique le commerce international. Une partie des échanges vient de la complémentarité des spécialisations des économies, en raison d’avantages comparatifs. En outre, les firmes, en fragmentant leur chaîne de valeur pour profiter de ces avantages, vont elles-mêmes être à l’origine d’échanges. Mais le commerce mondial concerne également des économies comparables, permettant aux entreprises de gagner en compétitivité et aux consommateurs de répondre à leurs besoins. [ouverture] La crise sanitaire que traverse l’économie mondiale en 2020 nourrit les critiques à l’encontre de la mondialisation, déjà pointée du doigt pour les dommages créés à l’environnement. Une relocalisation d’activités et une baisse des échanges sont-elles possibles ? La forte imbrication des économies semble pourtant difficilement contournable…
Dissertation : Les facteurs d’inégalités scolaires
Dissertation : l’action collective.

L'équipe étudiant.es
étudiant.es : une équipe de jeunes étudiants vous proposant chaque jour du contenu de qualité sur la vie étudiante en France.
En rapport avec cet article

« Trump n'a rien fait pour assurer notre sécurité » : Biden publie une publicité cinglante à l'occasion de l'anniversaire de la fusillade d'Uvalde

« Devenu complètement voyou » : le Sénat Dem appelle le juge en chef Roberts à maîtriser Alito et Thomas

La défense par Pence du drapeau insurrectionnel d'Alito met en évidence ses liens avec le renversement violent du gouvernement

Trump travaille discrètement avec les Républicains sur un projet de loi qui rendrait impossible toute poursuite contre lui

Les alliés d'Alito dénoncent un «double standard» concernant les appels à la récusation suite aux commentaires anti-Trump de Ginsburg

Les maires travaillistes du Nord-Ouest présentent un nouveau plan ambitieux de train à grande vitesse, reliant Manchester et Liverpool
Articles populaires.

Découvrez les opportunités professionnelles du textile
En quoi est-ce nécessaire pour étudiant de s’équiper d’un dictaphone ?

Mastère en école de commerce : qu’est-ce qui devrait primer dans votre choix aujourd’hui ?
Articles recommandés.
Classement des meilleures prépas en architecture

Le métier de secrétaire assistant

Le chemin vers la réussite : comment effectuer un master informatique à Lille ?
Comment réussir son parcours universitaire ?

Faire ses études dans les affaires internationales : comment se préparer au monde de demain ?

Maformation.fr : votre guide vers la formation professionnelle idéale

Créer son site Internet en tant que jeune entrepreneur

Études à l’étranger : les 5 meilleures destinations pour les étudiants français

Trouvez votre emploi de chirurgien à Paris dès maintenant

Que peut-on attendre d’un cours d’art en ligne ?

Comment épargner quand on est étudiant ?

Quels sont les débouchés après une école de finance ?

Comment faire monter en compétence ses collaborateurs ?

Comment savoir sa classe en avance ?

Comment calculer sa moyenne générale ?

Le métier de secrétaire médical : un acteur clé du secteur médico-social
Qui sommes nous ?
Étudiant.es vous propose chaque jour le meilleur de l’actualité étudiante, ainsi que des classements et avis sur toutes les écoles en France.

Recevoir notre newsletter
Recevez les dernières actualités étudiantes en France directement par email.
- Mentions légales
© 2024 Étudiant.es | Classements et avis des écoles en France en 2024 par Tremplin Numérique
- Concours Écoles Agro Véto
- Concours Écoles d'ingénieurs
- Concours Écoles de commerce
- Concours Écoles de journalisme
- Concours Enseignement
- Concours Fonction publique : Administration
- Concours Fonction publique : Culture, Patrimoine
- Concours Fonction publique : Défense, Police, Justice
- Concours Fonction publique : Economie, Finances, Douanes, Travail
- Concours Fonction publique : Education, Animation, Sport, Social
- Concours Fonction publique : Technique, Sciences
- Concours IEP /Sciences Po
- Concours Santé Paramédical Social
- Diplômes comptables
- Ecoles d'Art / Architecture
- Réussir à l'université / IAE
- Réussir le Brevet des collèges (DNB)
- Réussir les tests de langues
- Réussir son BTS
- Réussir son BUT
- Les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production - le cours
Plan de la fiche :
- Aperçu des théories classiques du commerce international
- Aperçu des nouvelles théories du commerce international
- Les politiques commerciales
OBJECTIFS :
- La fiche s'articule autour de cinq dimensions.
- Une présentation sommaire des théories classiques et modernes du commerce international.
- Les gains à l'échange : productivité, économie d'échelle, différenciation des produits.
- L'impact des firmes multinationales et la fragmentation des chaines de valeur.
- Les termes du débat entre libre échange et protectionnisme.
- La réduction des inégalités entre pays et l'accroissement des inégalités au sein des pays.
NOTIONS : dotations factorielles et technologiques, avantage comparatif, théorème hos, différenciation des produits fragmentation de la chaine de valeur, économie d'échelle, libre-échange, protectionnisme, théorème Stolper-Samuelson. Lire la suite de la fiche ci-dessous et la télécharger :
Les autres fiches de révisions
Les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production, comment lutter contre le chômage.
- Comment lutter contre le chômage - le cours
Comment expliquer les crises financières – régulation
- Comment expliquer les crises financières – régulation - le cours
Les mutations du travail et de l'emploi
- Quelles mutations du travail et de l'emploi ?
Les sources et défis de la croissance économique
- Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ?
Décrochez votre Bac 2024 avec Studyrama !
- Poursuivre ses études après le bac
- Fiches de révision du Bac 2024
- Bac 2024 : les dates et épreuves
- Les sujets et corrigés du Bac 2024
- Que faire avec ou sans le bac...
- Résultats du Bac 2024 : dates, heures et résultats par académies

SES : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?
- Marina Aleksandrova
À lire dans cet article :

Le commerce international et l’internationalisation de la production sont des sujets à maîtriser pour le baccalauréat, car ces deux notions impliquent un large panel de sujets possibles autour de théories fondamentales du commerce. De plus, ces deux thèmes sont en lien direct avec le phénomène de la mondialisation, ce qui accentue davantage l’importance de leur maîtrise.
Les fondements du commerce international
Tout d’abord, abordons la définition du commerce international. Il s’agit de l’ensemble des biens, services et capitaux faisant l’objet d’un échange entre au moins deux pays. Pour comprendre véritablement le commerce international, il faut avoir en tête son évolution.
L’évolution du commerce international se fait en trois temps :
- Le XIXe siècle : période d’ouverture des économies, une véritable hausse des échanges internationaux est observée. Pour aller plus loin, nous pouvons noter que Suzanne Berger souligne en 2013, que la première mondialisation a lieu durant cette période.
- 1947 : création du GATT, devenue l’OMC en 1995, principale institution du commerce international.
- 1980 : le commerce international prend un nouveau tournant, les flux de services s’intensifient et on passe de mondialisation à globalisation (comprend davantage l’aspect financier).
Vient ici un point à connaître obligatoirement lorsqu’un sujet sur le commerce international tombe : la définition de la mondialisation. La mondialisation représente l’accélération des flux internationaux de biens, de services et de capitaux. De plus, la mondialisation comprend aussi les mouvements migratoires.
Lire aussi : La lutte contre le chômage
Les fondements de l’internationalisation de la production
L’internationalisation de la production est une stratégie de développement d’une entreprise au-delà de son marché national d’origine. Elle peut se manifester par l’implantation d’unités de production dans d’autres pays ou la conquête de nouveaux marchés étrangers.
Lorsqu’on parle d’internationalisation de la production, il est primordial d’évoquer le nom des entreprises spécifiques : les firmes multinationales (FMN). Une firme multinationale ou transnationale est une société commerciale privée ou publique dont les activités se déploient à travers des filiales sur au moins deux pays et/ou continents.
La caractéristique principale d’une FMN est l’IDE (investissement direct à l’étranger). Un chiffre parlant est la multiplication d’IDE par 25 entre 1980 et les années 2000.
Les théories à connaître pour parler du commerce international et de l’internationalisation de la production
L’accélération des échanges internationaux, et donc de l’internationalisation de la production, se base sur les théories d’avantages et gains à l’échange.
Smith et l’avantage absolu
Adam Smith dans la Richesse des nations (1776) analyse le commerce international comme le prolongement de sa théorie de la division du travail, il indique que si un pays B peut fournir une marchandise à meilleur prix parce que son coût de production est plus faible que le pays A, alors il vaut mieux que le pays A lui achète cette marchandise et lui vende une autre marchandise où il a des coûts de production faibles, là où le pays A possède un avantage absolu. La spécialisation qui en résulte entraîne une division internationale du travail, cela permet à chaque pays d’allouer ses ressources là où elles sont les plus efficaces. Grâce à cela, le pays maintient sa croissance .
Cependant, Smith n’avait pas vu un problème posé par sa théorie : un pays, dont les coûts de production sont inférieurs ou supérieurs dans toutes les productions, n’aurait alors aucun avantage et n’aurait donc pas un gain à l’échange international. C’est précisément pour lever cette limite que Ricardo développe une approche en termes d’avantage comparatif.
Ricardo et l’avantage comparatif
La théorie de Ricardo est extraite de son ouvrage Principes de l’économie politique et de l’impôt (1817). Cette théorie se base sur trois hypothèses : la valeur d’un bien repose sur la valeur travail, les facteurs de production sont immobiles à l’international et les différences de technique de production expliquent les différences de productivité qui fondent les avantages comparatifs dont disposent les pays, elles déterminent donc la spécialisation du pays. L’avantage comparatif est fondé sur l’idée qu’il est plus efficace de se spécialiser dans les produits dans lesquels le pays est relativement le plus productif en laissant aux autres pays les autres activités, même si le pays est capable d’être plus productif que les autres pays dans toutes les autres activités. En effet, toutes les économies disposent de ressources limitées, ce qu’elles peuvent produire est donc limité. Si le pays veut produire plus d’un bien, alors il faut réduire la production d’un autre bien. La spécialisation internationale, selon l’avantage comparatif, va permettre de repousser le « mur de la rareté ». La spécialisation des pays repose sur des différences relatives de productivité et donc sur des différences de coûts relatifs.
Dans l’exemple proposé par Ricardo : le Portugal est capable de fabriquer du vin et des draps pour un coût inférieur à l’Angleterre. Mais il est plus efficace pour les deux pays de se spécialiser et à échanger. En renonçant à produire du drap, le Portugal peut affecter ses ressources du vin dans lesquelles il est relativement plus efficace par rapport à celles du drap, réciproquement pour l’Angleterre qui produit des draps. L’ouverture permet donc au Portugal d’acquérir plus de draps que ce qu’il aurait produit en autarcie, inversement le vin pour l’Angleterre.
Lire aussi : Comment j’ai eu 20 au bac en SES, mes conseils
Le théorème HOS
Les travaux d’Heckscher et Ohlin fondent la théorie des avantages comparatifs sur l’importation de la dotation en facteurs de production. Le raisonnement initial repose sur un modèle à deux pays, deux facteurs (capital et travail) et deux produits. Dans ce modèle, il y a cinq hypothèses : respect de la CPP (concurrence pure et parfaite), les facteurs de production sont immobiles à l’international et ils sont substituables, les rendements d’échelles sont constants et les rendements factoriels sont décroissants. Les pays sont supposés ne pas avoir les mêmes dotations factoriels et n’ont donc pas les mêmes coûts relatifs de production. Les facteurs de production étant substituables, les pays les utilisent en fonction de leurs coûts relatifs.
Quelques années plus tard, Samuelson se penche sur la théorie HO et de-là vient le théorème de Heckscher – Ohlin – Sammuelson. Dans cette théorie, le libre-échange conduit à une égalisation des profits et des salaires dans le monde. Les pays riches en travail (salaires initialement faibles) se spécialisent dans des activités à forte intensité en travail et délaissent les activités capitalistiques. La demande de travail va donc augmenter, ce qui va accroître les salaires. Inversement, le capital dont le prix initial était élevé est moins demandé, donc son prix va diminuer. Un processus symétrique s’opère dans les pays relativement plus riches en capital. Dans ce pays, le prix du travail va diminuer et le prix du capital va augmenter, et donc à terme au niveau mondial, le commerce international va se traduire par une égalisation de la rémunération des facteurs de production. Ainsi, le théorème HOS met en évidence une convergence des économies grâce au libre-échange. Une vérification empirique du théorème HOS est l’émergence des dragons asiatiques des années 1960.
Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !
Bac français : comparaison de deux poèmes de Villon et Rimbaud
Jeunesse et expatriation : 41% des français de moins de 25 ans envisagent de s’expatrier , toefl : combien coûte le test en ligne d’anglais du toefl , bac pro : retrouve la liste des bacs professionnels par secteur d’activité, bac français 2024 : optimiser les 30 minutes de préparation, bac français 2024 : les dates des épreuves, l’orientation mise à l’honneur avec le concours d’éloquence oraccle, toeic : combien coûte le célèbre test en ligne d’anglais du toeic , révise avec notre guide du bac de français 2024, les notes des épreuves de spécialité comptent-elles dans le dossier parcoursup .

Inscris-toi à la newsletter du futur 👇🏼
Dans la même rubrique....

La sociologie de l’expérience

Le processus de « civilisation des mœurs »

Comment les actions individuelles constituent-elles des phénomènes collectifs ?

Mobilité sociale et paradoxe d’Anderson

Comment distinguer les classes moyennes « modernes » et les « classes moyennes traditionnelles ?

Le fonctionnalisme

Le culturalisme

Comment Marx justifie-t-il que la paysannerie forme une « classe en soi » mais pas une « classe pour soi » ?

- Quels sont les sources et défis de la croissance éco ?
- Comment est structurée la société française actuelle
- Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?
- Quelles politiques éco dans le cadre européen ?
- Comment expliquer l’engagement politique
- Comment expliquer les crises financière et la régulation du système financier ?
- Quelles mutations du travail et de l'emploi ?
- Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ?
- Quelles Inégalités compatibles avec les conceptions de la justice sociale
- Quels sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale
- Comment lutter contre le chômage ?
- Quelle action publique pour l’environnement
- EMC - Terminale
- Comment un marché concurrentielle fonctionne-t-il
- Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils
- Quelles sont les principales défaillances de marché
- Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportements des individus
- Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
- Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
- Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
- Comment les agents économiques se financent-ils ?
- Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques ?
- Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées
- EMC - Première
- Introduction : qu'est-ce que les SES ?
- Ch1. Création de richesses et mesures
- Ch2. Comment devenons-nous des acteurs sociaux
- Ch3. Comment se forment les prix sur un marché
- Ch4. Comment s'organise la vie politique
- Ch5. Quelles relations entre le diplôme, l'emploi et le salaire
- EMC - Seconde
- Lexique/info
- Prix Lycéen
- Compétition europ. de stat.
- Révisions Bac
- Choix des Spécialités, Bac et Orientation

Le Site SES de P. Savoye
Notions essentielles
Dotations factorielles et technologiques, Avantage comparatif, Spécialisation internationale, Différentiation des produits, Fragmentation/Internalisation de la chaîne de valeur, Compétitivité, Inégalités entre pays/au sein, Libre échange, Protectionnisme.
Acquis de 1ère
Gains à l'échange, Marché concurrentiel
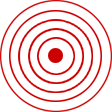
Cours et exercices en ligne avec :
Les vidéo de cours a consulter avec :
Documents de cours
Vocabulaire
Synthèse de cours
Exemples de Sujets
La France attire toujours les investisseurs étrangers (Le Monde 2023)
Conférence : Les nouvelles stratégies des entreprises à l'heure de la post-mondialisation, El Mouhoub
Animation sur les mesures du protectionnisme
Texte à trous sur les effets de fluctuation de change
Mots croisés 1
Mots croisés 2
Ex. sur les effets d'une variation de change
Méthodologie : une dissertation corrigé
Méthodologie dissertation : Sujet et
Exercice de problématisation et d'argumentation
Correction (copie d'élève) sur le sujet : Le commerce international ne présente-t-il que des avantages ?
Correction sur le sujet : Comment les FMN peuvent-elles améliorer leur compétitivité ?
Méthodo - Les épreuves de bac :
- Présentation des épreuves Bac
- Méthodlogie Epreuve composée :
EC1 , EC2 , EC3
Les étapes - EC3 et Dissertation
Méthodo - La mise en oeuvre d'une Argumentation
- Sujets 0 et leur corrigé
- Présentation du grand oral

Science Economique
Quels sont les fondements du commerce intern. et de l'internationalisation de la production ?
Elektrostal (Q198419)

Wiktionary (0 entries)
Multilingual sites (0 entries).
- Pages with maps
Navigation menu

- Visit Our Blog about Russia to know more about Russian sights, history
- Check out our Russian cities and regions guides
- Follow us on Twitter and Facebook to better understand Russia
- Info about getting Russian visa , the main airports , how to rent an apartment
- Our Expert answers your questions about Russia, some tips about sending flowers

Russian regions
- Belgorod oblast
- Bryansk oblast
- Ivanovo oblast
- Kaluga oblast
- Kostroma oblast
- Kursk oblast
- Lipetsk oblast
- Moskovskaya oblast
- Sergiev Posad
- Orlovskaya oblast
- Ryazan oblast
- Smolensk oblast
- Tambov oblast
- Tula oblast
- Tver oblast
- Vladimir oblast
- Voronezh oblast
- Yaroslavl oblast
- Map of Russia
- All cities and regions
- Blog about Russia
- News from Russia
- How to get a visa
- Flights to Russia
- Russian hotels
- Renting apartments
- Russian currency
- FIFA World Cup 2018
- Submit an article
- Flowers to Russia
- Ask our Expert
Moscow Oblast, Russia
The capital city of Moskovskaya oblast: Moscow .
Moscow Oblast - Overview
Moscow Oblast is a federal subject of Russia located in the Central Federal District. Moscow, the capital city of the country, is the administrative center of Moscow Oblast. At the same time, Moscow is not part of this region, it is a separate federal subject of Russia, a city of federal importance.
The population of Moscow Oblast is about 7,769,000 (2022), the area - 44,379 sq. km.
Moskovskaya oblast flag
Moskovskaya oblast coat of arms.

Moskovskaya oblast map, Russia
Moskovskaya oblast latest news and posts from our blog:.
23 June, 2022 / Natural Spring Gremyachiy Klyuch in Moscow Oblast .
23 March, 2022 / Main Cathedral of the Russian Armed Forces .
31 January, 2022 / Vasilyevsky (Shcherbatovsky) Castle in Moscow Oblast .
1 August, 2021 / Savvino-Storozhevsky Monastery near Moscow .
4 August, 2020 / Sights of Moscow Oblast - the heart of Russia .
More posts..
History of Moscow Oblast
The territory of the Moscow region was inhabited more than 20 thousand years ago. In the first millennium AD, this land was inhabited mostly by the Finno-Ugric peoples (Meryane and Meshchera). In the 9th-10th centuries, the Slavs began active development of the region. The population was engaged in hunting, fisheries, agriculture, and cattle breeding.
In the middle of the 12th century, the territory of the present Moscow region became part of the Vladimir-Suzdal principality, the first towns were founded (Volokolamsk in 1135, Moscow in 1147, Zvenigorod in 1152, Dmitrov in 1154). In the first half of the 13th century, the Vladimir-Suzdal principality was conquered by the Mongols.
In the 14th-16th centuries, Moscow principality became the center of unification of Russian lands. The history of the Moscow region is inextricably linked to military events of the Time of Troubles - the siege of the Trinity-Sergius Monastery by the troops of False Dmitry II, the first and second militias.
More historical facts…
In 1708, by decree of Peter the Great, Moskovskaya gubernia (province) was established. It included most of the territory of present Moscow oblast. In 1712, St. Petersburg became the capital of the Russian Empire and the significance of the Moscow region as the country’s economic center began to decrease.
In 1812, the Battle of Borodino took place near Moscow. It was the biggest battle of the Russian-French War of 1812. In the second half of the 19th century, especially after the peasant reform of 1861, the Moscow province experienced economic growth. In 1851, the first railway connected Moscow and St. Petersburg; in 1862 - Nizhny Novgorod.
The population of the Moscow region increased significantly (in 1847 - 1.13 million people, in 1905 - 2.65 million). On the eve of the First World War, Moscow was a city with a population of more than one million people.
In November, 1917, the Soviet power was established in the region. In 1918, the country’s capital was moved from St. Petersburg to Moscow that contributed to economic recovery of the province. In the 1920s-1930s, a lot of churches located near Moscow were closed, a large number of cultural monuments were destroyed. On January 14, 1929, Moscow Oblast was formed.
In 1941-1942, one of the most important battles of the Second World War took place on the territory of the region - the Battle for Moscow. In the postwar years, the growth of economic potential of the region continued; several science cities were founded (Dubna, Troitsk, Pushchino, Chernogolovka).
In the 1990s, the economy of Moscow Oblast experienced a deep crisis. Since the 1990s, due to the motorization of the population and commuting, road traffic situation in the Moscow region significantly deteriorated. Traffic jams have become commonplace.
Pictures of Moscow Oblast

Moscow Oblast scenery
Author: Mikhail Grizly

At the airport in the Moscow region
Author: Evgeny Davydov

Nature of Moscow Oblast
Author: Alexander Khmelkov
Moscow Oblast - Features
Moscow Oblast is located in the central part of the East European Plain, in the basin of the rivers of Volga, Oka, Klyazma, Moskva. The region stretches from north to south for 310 km, from west to east - 340 km. It was named after the city of Moscow, which however is not part of the region. Part of the administrative authorities of the region is located in Krasnogorsk.
On the territory of the Moscow region, there are 77 cities and towns, 19 of them have a population of more than 100 thousand people. The largest cities are Balashikha (518,300), Podolsk (309,600), Mytishchi (262,700), Khimky (256,300), Korolyov (225,300), Lubertsy (209,600), Krasnogorsk (174,900), Elektrostal (149,000), Odintsovo (138,900), Kolomna (136,800), Domodedovo (136,100).
The climate is temperate continental. Summers are warm, winters are moderately cold. The average temperature in January is minus 10 degrees Celsius, in July - plus 19 degrees Celsius.
One of the most important features of the local economy is its proximity to Moscow. Some of the cities (Odintsovo, Krasnogorsk, Mytishchi) have become in fact the “sleeping districts” of Moscow. The region is in second place in terms of industrial production among the regions of Russia (after Moscow).
The leading industries are food processing, engineering, chemical, metallurgy, construction. Moscow oblast has one of the largest in Russia scientific and technological complexes. Handicrafts are well developed (Gzhel ceramics, Zhostov trays, Fedoskino lacquered miniatures, toy-making).
Moscow railway hub is the largest in Russia (11 radial directions, 2,700 km of railways, the density of railways is the highest in Russia). There are two large international airports - Sheremetyevo and Domodedovo. Vnukovo airport is used for the flights within the country.
Attractions of Moscow Oblast
Moscow Oblast has more than 6,400 objects of cultural heritage:
- famous estate complexes,
- ancient towns with architectural monuments (Vereya, Volokolamsk, Dmitrov, Zaraysk, Zvenigorod, Istra, Kolomna, Sergiev Posad, Serpukhov),
- churches and monasteries-museums (the Trinity Lavra of St. Sergius, Joseph-Volokolamsk monastery, Pokrovsky Khotkov monastery, Savvino Storozhevsky monastery, Nikolo Ugresha monastery).
The most famous estate complexes:
- Arkhangelskoye - a large museum with a rich collection of Western European and Russian art of the 17th-19th centuries,
- Abramtsevo - a literary and artistic center,
- Melikhovo - an estate owned by A.P. Chekhov at the end of the 19th century,
- Zakharovo and Bolshiye Vyazyomy included in the History and Literature Museum-Reserve of Alexander Pushkin,
- House-Museum of the composer P.I. Tchaikovsky in Klin,
- Muranovo that belonged to the poet F.I. Tyutchev,
- Shakhmatovo - the estate of the poet Alexander Blok.
The architectural ensemble of the Trinity Sergius Lavra is a UNESCO World Heritage Site. The largest museum of the Moscow region is located in Serpukhov - Serpukhov Historical and Art Museum.
The places of traditional arts and crafts are the basis of the souvenir industry of Russia:
- Fedoskino - lacquer miniature painting,
- Bogorodskoe - traditional manufacture of wooden toys,
- Gzhel - unique tradition of creating ceramics,
- Zhostovo - painted metal crafts,
- Pavlovsky Posad - fabrics with traditional printed pattern.
Some of these settlements have museums dedicated to traditional crafts (for example, a toy museum in Bogorodskoe), as well as centers of learning arts and crafts.
Moskovskaya oblast of Russia photos
Landscapes of moscow oblast.

Nature of the Moscow region

Country road in the Moscow region

Moscow Oblast landscape
Author: Mikhail Kurtsev
Moscow Oblast views

Author: Asedach Alexander

Country life in Moscow Oblast
Author: Andrey Zakharov

Church in Moscow Oblast
Author: Groshev Dmitrii
Churches of Moscow Oblast

Church in the Moscow region

Cathedral in Moscow Oblast
The questions of our visitors
- Currently 2.85/5
Rating: 2.9 /5 (197 votes cast)
Top Things to Do in Elektrostal, Russia - Elektrostal Must-See Attractions
Things to do in elektrostal.
- 5.0 of 5 bubbles
- 4.0 of 5 bubbles & up
- Good for a Rainy Day
- Good for Kids
- Good for Big Groups
- Adventurous
- Budget-friendly
- Hidden Gems
- Good for Couples
- Honeymoon spot
- Good for Adrenaline Seekers
- Things to do ranked using Tripadvisor data including reviews, ratings, photos, and popularity.

1. Electrostal History and Art Museum

2. Statue of Lenin

3. Park of Culture and Leisure
4. museum and exhibition center.

5. Museum of Labor Glory

7. Galereya Kino
8. viki cinema, 9. smokygrove.

10. Gandikap
11. papa lounge bar, 12. karaoke bar.

- LANGUE FRANÇAISE
- DICTIONNAIRES BILINGUES
- TRADUCTEUR
- CONJUGATEUR
- ENCYCLOPÉDIE
- CUISINE
- FORUM
- JEUX
- LIVRES
- Suivez nous:
- EN ES DE IT
en russe Moskva

Capitale de la Russie , sur la Moskova .
- Population : 12 330 126 hab. (recensement de 2016)
- Nom des habitants : Moscovites

Moscou s'est développée à 156 m d'altitude sur la Moskova en position de carrefour par rapport aux grandes voies fluviales de la Russie d'Europe : Volga , Dvina , Dniepr , Don . La situation géographique reste privilégiée, valorisée par le rail et l'air (plusieurs aéroports). Le noyau historique (autour du Kremlin et de la place Rouge ) est entouré d'une première couronne mêlant quartiers industriels et résidentiels, parcs de loisirs et stades. Une deuxième couronne est composée surtout de grands ensembles résidentiels. L'ensemble, ceinturé par une zone forestière de loisirs (maintenant « mitée » d'ensembles urbains et industriels), couvre 886 km 2 . Métropole, Moscou détient toutes les fonctions. La centralisation politique a entraîné le développement économique. La ville est un grand centre culturel (universités, musées, théâtres) et commercial. L'industrie est caractérisée par l'essor des industries à forte valeur ajoutée (constructions mécaniques et électriques, chimie s'ajoutant au textile, et à l'agroalimentaire). La ville a accueilli les jeux Olympiques d'été de 1980 .
La position géographique : une ville de carrefour
La position géographique explique en partie la fortune de la ville. À plusieurs titres, elle est marquée par les avantages du contact et du carrefour. La ville est au centre de la vieille Russie. Elle commande de nos jours à deux rayons (grandes régions économiques) : le Centre-Industriel au nord, dans lequel elle est située, et le Centre-Terres Noires, plus agricole, au sud. Ces deux régions assurent une partie notable (environ les deux tiers dans le textile, plus du tiers dans la mécanique) de la valeur de la production industrielle de la Russie.
Les deux régions chevauchent deux grandes zones biogéographiques : la taïga , qui commence au nord des limites de l'agglomération contemporaine, et la forêt mixte, dans laquelle est située la ville. Il s'agit donc d'abord d'une position de contact entre les pays du Nord et les pays du Midi. On passe avec de nombreuses transitions des pays noirs de la grande forêt de conifères aux pays plus ouverts, plus clairs de la forêt mêlée d'essences caducifoliées où apparaissent le chêne et le tilleul. Au nord, on cultive sur des sols médiocres (les podzols ) du lin-fibre, du seigle, de la pomme de terre avec de faibles rendements ; vers le sud apparaissent le blé, puis le maïs-fourrage et le maïs-grain, enfin le tournesol sur des sols plus riches, déjà caractérisés par les « terres noires » (le fameux tchernoziom ), qui, dans les îlots de steppe, annoncent les plaines ukrainiennes. Ainsi s'opposent encore l' izba , maison de bois de la forêt au nord, et la khata , maison de pisé qui apparaissait autrefois dans les campagnes au sud.
Le contact et les transitions s'observent également d'ouest en est. À l'ouest de la ligne de Moscou au Don se disposent des arcs morainiques disséqués, atteignant par endroits 300 m d'altitude, formant le plateau du Valdaï , les « hauteurs » de Smolensk et de la Russie centrale. À l'est et au sud-est, les marques de la glaciation sont insignifiantes, les formes empâtées du relief disparaissent avec les marécages et l'hydrographie indécise. Les eaux s'écoulent en direction de la gouttière du Don , où la sécheresse s'accuse d'amont en aval, où les violents orages d'été creusent les premiers ravins qui annoncent les steppes du Don inférieur.
Ces contrastes sont accusés encore par les circonstances historiques et les traces qu'elles ont laissées. Les paysans russes réfugiés dans la forêt durant les invasions nomades qui déferlaient sur les steppes (et ont même atteint Moscou au cours de razzias) se sont protégés par des postes militaires, des forteresses entourées de palissades de bois. Les nomades s'efforçaient de dévaster, en l'incendiant, la forêt où les chevaux pénétraient difficilement. Ainsi la limite entre les deux zones est artificielle. Au sud du Moscou contemporain s'étendait une sorte de no man's land dans lequel la ligne des fortifications ne cessa de s'étendre jusqu'à la fin du danger, au début du xviii e s. Ainsi la frontière entre les deux « gouvernements » de Moscou (dans la forêt) et de Toula (découvert) avait été fixée sur la rivière Oka . La rivière Voronej est formée de deux tronçons, Voronej des forêts, Voronej des steppes.
Cette dualité explique le peuplement plus récent, sous une forme militaire et féodale, des plateaux et vallées au sud de l'agglomération actuelle, un type d'agriculture reposant sur l'existence de vastes domaines chargés de ravitailler la capitale. Or, la ville de Moscou a grandi à la limite même de ces zones, mais elle a exploité cette position de confins et de carrefour. De plus, elle est placée dans une situation de diffluence hydrographique. Non loin de là, le plateau du Valdaï est un château d'eau d'où les rivières se dispersent dans toutes les directions. Moscou se trouve sur la Moskova , rivière assez large, elle-même affluent de l' Oka qui va confluer dans la Volga . Le cours supérieur de la Volga passe à une cinquantaine de kilomètres plus au nord, et le port fluvial actuel lui est relié par la « mer de Moscou ». Enfin, le réseau de la Desna , affluent du Dniepr , et celui du Don confluent vers les mers du Sud. Tous ces fleuves étaient navigables ; les routes de terre unissaient, par l'organisation de « portages », les cours supérieurs des rivières du Nord et du Sud. Ainsi, des routes fluviales et de terre se croisaient aux environs de Moscou, les deux principales étant celle de la Volga à Novgorod et de Smolensk à Vladimir. Il faut ajouter que la pêche dans les rivières et les lacs était une activité essentielle au Moyen Âge, au même titre que la navigation et l'exploitation de la forêt ; les troncs d'arbres étaient flottés. Ainsi, quelque chemin qu'on empruntât, on passait presque toujours par la région de Moscou. Il faut remarquer que cette position de diffluence est devenue, grâce aux techniques modernes, une position de convergence : Moscou et son port sont, aujourd'hui, l'un des nœuds essentiels du système des cinq mers qui les relie à la mer Baltique, à la mer Blanche, à la Caspienne et à la mer Noire (et à la mer d'Azov).
Enfin, Moscou est au centre d'une des clairières les plus vastes, ouvertes dans la forêt lorsque succomba la Russie kiévienne et que des Russes vinrent s'y réfugier. L'agglomération est de nos jours, comme Paris, entourée de tous côtés par des bois. La forêt mixte cerne les aéroports ou les grandes localités séparées de l'agglomération. Cette clairière fournissait non seulement des produits agricoles, mais les matières premières d'un artisanat du cuir, de la laine, du bois, dont les produits, élaborés par les artisans locaux, les koustar , étaient vendus durant la mauvaise saison par des colporteurs. C'est l'origine des premières manufactures, de l'afflux de marchands, d'une tradition industrielle qui s'épanouit au cours du xix e s., en particulier le textile. Ces conditions favorables de la circulation et de l'économie régionale expliquent la faveur d'un gros village, puis d'un gorod , que les princes choisirent comme résidence.
Le site et l'extension
À l'origine, Moscou est un simple kreml , fortin de terre et de bois, dominant de quelque 40 mètres la rive escarpée de la Moskova, sur laquelle est jeté un pont, tandis que la rive droite, basse et marécageuse, reste inoccupée. La dissymétrie fondamentale du site demeure dans toute l'histoire de l'extension de la ville, sans doute parce que, mal défendue, l'autre rive offrait un danger tant que menaçaient les invasions, parce que ses prairies étaient inondées au moment de la débâcle, mais encore parce que le terrain de la rive gauche offrait davantage de possibilités pour le développement d'une grande ville. La cité s'étend en partie sur un plateau de craie, masqué par d'épais dépôts glaciaires et disséqué par des affluents en pente forte de la Moskova, dessinant autant de ravins, de méandres encaissés, si bien que les pentes dont s'accidente la ville sont restées dans le folklore international sous le nom de montagnes russes . D'autres buttes ou éperons seront utilisés pour la défense, mais le kreml constitue le centre, le noyau à partir duquel se développent plusieurs villes concentriques. On reconnaît en effet distinctement dans le plan actuel de la ville les ceintures de remparts qui marquent à chaque époque les limites de l'extension.
Le Kremlin était une forteresse entourée de palissades au pied de laquelle s'étendait une petite bourgade de marchands et de soldats. La plupart des édifices du Kremlin actuel ont été construits aux xiv e et xv e s. ; la ville de bois débordait la Moskova et formait un faubourg.
Kitaï-gorod (appelée à tort « Ville chinoise », le terme, d'origine tatare, signifiant plutôt « le fort ») s'étendit au nord-est dans la première moitié du xvi e s. ; elle était à peine plus spacieuse que le Kremlin lui-même.
Bielyï-gorod (la « Ville blanche ») enveloppait le Kremlin et Kitaï-gorod sur une superficie beaucoup plus grande, à l'ouest, au nord et à l'est : elle fut entourée de fortifications à la fin du xvi e s.
Zemlianoï-gorod (la « Ville de terre ») enfin, ceinte en 1742, engloba l'ensemble des villes précédentes et passa la Moskova sur l'autre rive, dessinant grossièrement un cercle de 4 à 5 km de diamètre.
Les deux rocades circulaires sont parfaitement visibles dans le dessin actuel : la ceinture des « boulevards » autour de Bielyï-gorod , et la ceinture des jardins, ou Sadovaïa , très large, autour de la Ville de terre ; tel est encore le noyau urbain à forte densité de construction et de population de l'agglomération actuelle.
Cette ville a été décrite par tous les voyageurs jusqu'au xx e s. comme un immense village, aux rues étroites, aux maisons de bois, les izbas, basses et entourées de jardinets ; il suffit d'un « cierge d'un kopeck » pour que se déchaînent les incendies. Au début du xix e s., Moscou n'a encore que 200 000 habitants. Cette ville correspond en gros aux quatre rayons (arrondissements) formant le centre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont tendance à se dépeupler au profit de la périphérie et deviennent une city où sont concentrées l'administration et les affaires en même temps qu'une ville-musée visitée par les provinciaux et les étrangers. Son extension a bénéficié des conditions favorables offertes par le sol : vallée d'un affluent de la Moskova, la Iaouza, à l'est, terrasse étendue à l'ouest, sources nombreuses et possibilités de creusement de puits artésiens, abondance des matériaux de construction, argiles, bois et même pierre. C'est à partir de cette ville initiale que s'étend, dans toutes les directions, l'agglomération contemporaine : d'abord, sous la forme de faubourgs très allongés le long des routes radiales menant dans toutes les directions et qui, en raison du sol argileux et humide, sont pavées et portent le nom de « chaussées » ; ensuite, par l'insertion des gros villages de la clairière primitive, qui, peu à peu, reçoivent l'excédent de la population du centre et multiplient le nombre de leurs izbas ; enfin, par la construction, spontanée ou systématique, de quartiers nouveaux. Ainsi s'est modelé le « Grand Moscou », entouré de nos jours par une large rocade routière, future autoroute, ayant grossièrement la forme d'un ovale d'une trentaine de kilomètres du nord au sud et de plus de 20 km d'ouest en est.
Mais l'extension du Moscou des xix e et xx e s. doit tout à l'essor de la fonction industrielle et du carrefour de communications récentes.
Les fonctions industrielles : les générations
La première génération d'ateliers et de manufactures de la ville est l'expression des activités de la Russie centrale. Moscou n'a pas d'industrie lourde, peu d'industrie chimique. L'industrie se développe à partir des matières premières locales (bois, cuir, lin et laine) ou des produits du négoce avec les pays du Nord (Novgorod) et de la Volga. Le choix de Moscou comme capitale a été en outre déterminant, le rôle dynastique ayant entraîné le développement de la fonction économique. Dès le xvi e s., la ville vit de la Cour et accapare, même après la fondation de Saint-Pétersbourg, une partie des fonctions des autres villes de la Volga supérieure comme Iaroslavl ou la ville du textile, Ivanovo. Il s'agit donc de produits de qualité, voire de luxe, fabriqués par une main-d'œuvre experte, bénéficiant d'une longue tradition, disséminée dans des entreprises de petite ou moyenne taille. Même si certaines branches ont décliné après la Révolution, la plupart se sont maintenues, étoffées ou modernisées : ainsi la confiserie, les parfums, les jouets, les objets d'artisanat, qui connaissent avec les touristes étrangers un regain de faveur, ou les industries du cuir. Le textile, qui occupait encore à la fin du xix e s. plus des trois quarts de la main-d'œuvre industrielle, surtout féminine, en emploie encore environ le cinquième et vient au second rang des industries moscovites. Les manufactures utilisent des filés provenant d'autres régions, et leur production se situe en aval : tissages de la laine et du coton (dans la célèbre manufacture des Trois Montagnes ), de la soie naturelle, de la rayonne et des textiles synthétiques, auxquels s'ajoutent la confection, le tricotage, la fourrure, la haute couture ; la branche textile a entraîné le développement du secteur des colorants et des machines.
La seconde génération d'industries date des chemins de fer et de l'abolition du servage. La première voie ferrée, venant de Saint-Pétersbourg, est achevée en 1851. Moscou est reliée au gros centre industriel de Kharkov en 1869, à la Biélorussie et à Varsovie en 1871, à la plupart des grandes villes de province en 1880. Les grandes gares se localisent à la périphérie de la Sadovaïa, portant le nom des villes qu'elles atteignent. Moscou devient un nœud de communications moderne, un carrefour commercial d'importance accrue, reçoit les produits lourds du Donbass. En même temps, les campagnes de la Russie centrale se dépeuplent à la suite de l'abolition du servage (1861). Des centaines de milliers de paysans viennent s'entasser autour des gares, le long des voies ferrées radiales qui pénètrent dans la ville, à proximité des usines nouvellement créées. Celles-ci sont fondées par d'autres capitaux, d'origine étrangère. C'est dans le dernier quart du xix e s. que naissent les premières entreprises métallurgiques : on en comptait 127, avant 1917, presque toutes de petite taille. Ce fut la base à partir de laquelle les premiers plans quinquennaux firent de Moscou le grand centre d'industrie mécanique, travaillant des métaux importés, se situant en aval de la production du Donbass et de l'Oural, livrant des produits finis de qualité, employant une main-d'œuvre qualifiée de cadres moyens et supérieurs formés dans de nombreuses écoles professionnelles. Ainsi, cette branche a ravi rapidement la première place à l'industrie textile et occupe actuellement plus de la moitié de la main-d'œuvre, concentrée dans des établissements de grande taille, fournissant plus du dixième de la valeur de la production mécanique de la Russie : machines-outils pour l'équipement des industries minière, chimique, automobile, textile, des roulements à billes ; électrotechnique, de plus en plus spécialisée dans les appareils électroménagers pour la large consommation urbaine et dans l'électronique (la plus connue est l'entreprise Dinamo, qui fabrique des moteurs et des transformateurs et exporte plus du dixième de sa production dans une trentaine de pays). L'automobile est concentrée depuis le premier plan quinquennal dans l'entreprise Likhatchev, qui a été rénovée et produit des voitures (mais aussi, dans les filiales situées dans l'agglomération, des camions, des autobus et du matériel de manutention). Enfin, la mécanique de précision (compteurs, horlogerie) est une vieille spécialité de Moscou.
À ces deux branches principales s'ajoutent les grandes industries urbaines, le combinat polygraphique (impression, édition) de la Pravda , des studios de cinéma, quelques usines de caoutchouc et de colorants. Au total, une main-d'œuvre de plus d'un million de salariés et de cadres, plus de 300 usines, le dixième du produit brut provenant de l'industrie en Russie.
Ces industries se localisent en fonction de l'origine de la matière première. Ainsi, en direction du bassin houiller de Toula et de Koursk, dans la banlieue sud, se trouvent une fonderie, l'usine de machines à coudre ex-Singer à Podolsk. Vers le sud-est, le long des voies ferrées, sont les usines Dinamo et Likhatchev ; vers le nord, près de Khimki, un chantier de constructions navales, des industries alimentaires ; vers l'est, en direction des villes de la Volga et du Second-Bakou, l'usine Elektrostal (aciers électriques), la chimie et les matières plastiques. Ainsi, l'agglomération s'est sans cesse avancée aux dépens de son oblast , où des villes de plus de 100 000 habitants concentrent une population industrielle et où les villes satellites ont été créées pour décentraliser la vieille ville. Moscou a ainsi construit sa zone d'attraction de main-d'œuvre.
Moscou, capitale
Les fonctions de services liées au rôle grandissant de la capitale utilisent une main-d'œuvre plus nombreuse que l'industrie : ainsi, plus du quart de la main-d'œuvre est employé dans la santé publique, l'enseignement et la recherche. Le transfert du siège du gouvernement décidé par Lénine a accéléré l'évolution démographique par rapport à celle de Saint-Pétersbourg et multiplié les fonctions. Elle attire les cadres, les visiteurs, les touristes. Staline avait voulu exprimer cette prépondérance en construisant des gratte-ciel, laids et démodés de nos jours, mais d'autres constructions nouvelles symbolisent la volonté de prestige. Ainsi se sont édifiés la plus haute tour de télévision du monde, à Ostankino (plus de 500 m), le plus grand hôtel (6 000 lits), à côté du Kremlin. À des titres divers, le théâtre Bolchoï , l'Exposition permanente des réalisations de l'économie nationale, l' université Lomonossov , les parcs d'attraction et les stades rassemblent les visiteurs provinciaux et étrangers.
Cette fonction se traduit par la concentration, en régime de planification centralisée, des ministères, des représentations étrangères. L'université et les hautes écoles rassemblent le cinquième des effectifs de toute la Russie, et l'université est la plus réputée du pays. Près du cinquième des ingénieurs de Russie travaillent à Moscou. Les grandes académies et des instituts de recherche renommés dans le monde entier y ont leur siège. La proximité des centres travaillant pour la défense nationale, enfouis dans la ceinture de verdure, la fondation de centres de recherches nucléaires, comme l'accélérateur de particules de Serpoukhov au sud, le centre de recherches fondamentales de Doubna au nord, sur la mer de Moscou, ont encore accru la concentration de scientifiques sortant des hautes écoles.
Sur le plan international, l'université Lumumba, située au sud de la Moskova, a attiré, avec des succès d'ailleurs divers, les étudiants du tiers monde, notamment de l'Afrique.
La ville s'ouvre également aux autres pays et prend une importance mondiale. Elle est de plus en plus choisie comme centre de grands congrès internationaux. Elle accueille plusieurs centaines de milliers d'étrangers par an, hommes d'affaires, touristes, le plus souvent regroupés selon la formule des voyages organisés et guidés. L'aéroport international de Cheremetievo est construit à une trentaine de kilomètres au nord de Moscou.
Expansion et rayonnement de Moscou
La ville a ainsi forgé autour d'elle une région urbaine de grande taille et de densité à l'hectare encore relativement faible, par rapport aux grandes capitales mondiales (300 à l'intérieur de la Sadovaïa, moins de 100 à l'intérieur de la rocade). Le processus a été géométrique, sous la forme radio-concentrique, si bien qu'on peut facilement enfermer dans des cercles de rayon croissant les agglomérations successives, du Kremlin à l'oblast. Depuis le régime soviétique, cette extension a été planifiée, définie par des limites administratives. Pour la première fois au cours du premier plan quinquennal, un plan d'urbanisme se préoccupe d'organiser et de prévoir l'extension de la ville et la répartition de la population. Mais l'avant-guerre compta encore peu de réalisations. En 1948, Staline veut donner à la capitale de la Russie victorieuse une allure prestigieuse et fait construire les huit gratte-ciel, dont le plus élevé est l'université sur le mont des Oiseaux, puis les stations du métro, d'un luxe de goût discuté. Un plan datant de 1953 porte la superficie de la ville, marquée par la limite du pouvoir de son Conseil ( Mossoviet ), à 330 km 2 , contre 300 environ avant la guerre. En 1959, la superficie atteint, par annexion de quelques quartiers ou villages, 356 km 2 . Enfin, la dernière phase est marquée par le décret du 18 août 1960, qui porte le territoire à 875 km 2 (886 aujourd'hui), enfermé par la rocade routière circulaire d'où partent dans toutes les directions les routes nationales (appelées « autoroutes ») à deux ou quatre voies. Autour, une autre enveloppe limite une « zone protégée » à faible densité où ne sont situées qu'une dizaine de localités de quelques milliers d'habitants chacune, où la construction est en principe interdite et qui doit être réservée au repos (forêt, parcs, prairies, plans d'eau, lacs et réservoirs sur les rivières, comme la Kliazma), s'étendant sur 1 800 km 2 , ce qui porte la superficie du « Grand Moscou » ( Mossoviet , plus ceinture protégée) à plus de 2 650 km 2 . Les villes incluses sont Mytichtchi , Balachikha à l'est, Lioubertsy au sud-est, Vidnoïe au sud...
Enfin, la région suburbaine appelée Podmoskovie (« région autour de Moscou ») s'étend sur la majeure partie de la province ( oblast ) administrative. Elle comprend encore plusieurs millions d'habitants répartis dans plusieurs types d'agglomérations. Les localités rurales appartiennent à la zone de ravitaillement en produits agricoles de la ville, spécialisées dans la culture maraîchère (pommes de terre et choux), la production porcine et laitière (avec une densité d'une trentaine de têtes de gros bétail sur 100 ha), l'exploitation de serres, généralement chauffées par la vapeur des usines voisines, des vergers de pommiers. La vallée de la Kliazma au nord constitue en particulier une zone de cultures légumières très dense. Dans des localités mi-rurales, mi-urbanisées subsistent un artisanat ou des ateliers travaillant en vue du marché urbain (objets de bois, de cuir, poteries, textiles), où se sont décentralisées de petites entreprises de la vieille ville. Des localités de maisons de campagne ( datcha ) sont entourées de verdure, de terrains de chasse, de baignades, de parcs de récréation. Des vieilles villes industrielles ou des centres de recherche sont installés au milieu de la forêt (ainsi Serpoukhov au sud, Doubna au nord, Elektrostal à l'est, la file des usines allongées jalonnant le canal Volga-Moscou au nord-ouest). Des villes satellites, ou spoutnik , villes nouvelles à croissance rapide, sont chargées de décentraliser la population ou de retenir la population nouvelle à la périphérie de l'agglomération. Une partie de la main-d'œuvre travaille sur place, une autre à Moscou. Ainsi se sont développées une vingtaine de villes, dont la majorité se situe dans la partie occidentale de l'agglomération : Istra, Dedovsk, Troïtski, Naro-Fominsk...
Une vingtaine de grands ensembles, chacun d'eux pourvu d'un équipement scolaire et commercial, ont été construits : ainsi Tcheremouchki et Kountsevo au sud-ouest et à l'ouest ; Babouchkine et Medvedkovo au nord, Khimki-Khovrino au nord-ouest, etc. L'un des meilleurs exemples d'aménagement est celui du Iougo-Zapad , du sud-ouest, où de nouvelles avenues ( prospekt ) ont été tracées, où l'immense parc des sports Loujniki s'étend dans la boucle de la Moskova, avec un stade de 100 000 places.
Un urbanisme « volontariste »
L'urbanisme soviétique reposait sur deux idées fondamentales qui déterminaient son originalité et son efficacité : le régime des droits de propriété élaboré depuis 1917 et l'intégration de l'aménagement du territoire dans le système de planification.
1924 : le plan de reconstruction et de développement de Moscou, par Chestakov, renforce le tracé radio-concentrique et la séparation sur le terrain des fonctions de la vie urbaine ( zoning ).
1929 : le plan d'« urbanisme socialiste » marque l'affrontement de deux grands courants de pensées : pour les « urbanistes », la création de maisons communes consacre la vie collective qui doit se dérouler dans un cadre urbain. Pour les « désurbanistes », la ville est historiquement et économiquement condamnée ; des cellules de vie collective doivent se créer sur tout le territoire et faire disparaître l'opposition ville-campagne. Les deux courants seront critiqués par le pouvoir, mais donneront cependant lieu à d'intéressantes réalisations.
1935 : le plan de reconstruction systématique amène la création de grandes artères radiales, la création du métro (son décor et son luxe témoignent de l'intérêt porté à l'aménagement de tous les lieux de vie collective), la délimitation stricte d'un périmètre d'extension. Si l'architecture proprement dite verse dans le monumentalisme (style « stalinien »), l'application de ce plan devait contribuer efficacement au développement de la capitale.
Le climat de Moscou est continental, avec des précipitations moyennes (624 mm par an), qui tombent surtout en été, et des températures moyennes qui oscillent entre 19 °C en juillet (23 °C maximum et 13 °C minimum) et – 9 °C en janvier (– 9 °C maximum et – 16 °C minimum), soit 28 °C d'amplitude thermique, pour une moyenne annuelle de 4 °C. Les hivers sont longs (4 mois) et rigoureux (150 jours de gel), avec parfois des excès (les températures descendent jusqu'à − 30 °C).
L'HISTOIRE DE MOSCOU
Vers 1140, un boyard du nom de Koucha construit un petit village dans une clairière au milieu de la forêt près d'une rivière au cœur de la Russie, et il perçoit un péage pour le passage de cette rivière, la Moskova (Moskva). Le prince d'une ville voisine, Iouri Dolgorouki de Rostov-Souzdal, s'empare du village en 1147 et lui donne le nom de Moscou, d'après celui de la rivière ( Moskva viendrait du finnois et signifierait « eaux troubles » en opposition à Oka, « eaux calmes »).
En 1156, ce prince décide de fortifier le village et il établit une citadelle sur la colline : le Kreml (ou Kremlin). Une ville (gorod) naît alors mais qui reste sans grande importance jusqu'à la seconde moitié du xiii e s. Le moment décisif, c'est en 1263 la fondation d'une principauté indépendante de Moscou par Alexandre Nevski, qui la confie à son fils cadet Daniel.
À partir d'un site géographique favorable, mais plutôt banal, le développement de Moscou s'explique par des raisons historiques. Daniel et ses successeurs mènent un jeu habile et utilisent la protection mongole pour agrandir leur territoire et abaisser les villes voisines. Capitale politique, Moscou devient en 1326 une capitale religieuse en raison de l'installation à l'intérieur du Kremlin du métropolite orthodoxe.
Derrière les palissades en bois du Kremlin, on trouve alors le palais du prince et la cathédrale de l'Assomption, mais la ville s'étend au-delà du Kremlin sur la rive gauche de la Moskova au xiv e et au xv e s. Les succès des princes de Moscou qui en 1480 s'affranchissent définitivement du tribut mongol font de la ville le successeur de Byzance, conquise par les Turcs en 1453. Moscou prétend même être la troisième Rome.
La ville s'agrandit et devient une belle cité aux monuments en pierre à partir de la fin du xv e s.
Au xvi e s., Moscou est un grand centre commercial, en particulier grâce à ses relations asiatiques. Le centre commercial se trouve à l'est du Kremlin, c'est Kitaï-gorod, entourée elle-même d'une muraille. Plus loin s'étend Bielyï-gorod (la « Ville blanche »), également entourée d'une muraille, qui se développe au xvii e s. Ce sera le quartier aristocratique et on y créera en 1755 la première université russe.
La ville s'étend également sur la rive droite, où se trouvent les quartiers populaires de la Zemlianoï-gorod (la Ville de terre). Avec 100 000 habitants au xvi e s., près de 200 000 à la fin du xvii e s., Moscou est une cité importante malgré les troubles et l'occupation polonaise.
En 1712, Pierre le Grand lui enlève cependant son titre de capitale au profit de Saint-Pétersbourg, qu'il vient de fonder. Néanmoins, l'importance de Moscou reste grande, car elle demeure la ville sainte où les tsars se font couronner, la capitale religieuse, la deuxième capitale de l'empire des tsars.
La ville est occupée par Napoléon en 1812 du 14 septembre au 19 octobre, et l'incendie de Moscou fait rage plusieurs jours après l'arrivée des troupes françaises.
Au xix e s., Moscou, malgré les progrès de Saint-Pétersbourg, connaît un développement certain dû à son rôle économique et à sa position centrale incontestablement plus favorable que celle de la métropole baltique. L'industrie textile, métallurgique et chimique apparaît dans les faubourgs, et Moscou compte plus d'un million d'habitants à la fin du xix e s. et plus d'un million et demi en 1917. Lors de la révolution de 1905, elle est une grande ville ouvrière, et c'est là que les socialistes russes déclenchent, en décembre, une insurrection, vaincue après quelques jours de violents combats.
En 1917, après la révolution d'Octobre victorieuse à Petrograd, le soviet de Moscou à majorité bolcheviste se heurte à la résistance acharnée des détachements d'élèves officiers, les junkers, qui réussissent à occuper le Kremlin et y massacrent plusieurs centaines de jeunes soldats rouges. Le soviet de Moscou doit donner l'ordre de bombarder les murailles du Kremlin pour reprendre la forteresse la nuit du 16 au 17 novembre.
Le 11 mars 1918, le Conseil des commissaires du peuple présidé par Lénine quitte Petrograd pour s'installer à Moscou, à l'intérieur du Kremlin.
Redevenue dès lors la capitale de la Russie, puis celle de l'Union des républiques socialistes soviétiques, fondée à la fin de 1922, Moscou va croître rapidement en raison même de la politique de centralisation suivie par Staline et par les dirigeants soviétiques. La ville se transforme rapidement et s'agrandit dans toutes les directions.
D'octobre à décembre 1941, les armées hitlériennes s'approchent jusque dans les faubourgs de Moscou, mais, malgré les 75 divisions (dont 14 blindées) et 1 000 avions mis en action par Hitler, elles ne peuvent s'emparer de Moscou, défendue par l'armée rouge et par un peuple dressé pour la défendre.
L'ART À MOSCOU
Moscou fut tout d'abord construite en bois ; elle reçut ses premiers bâtiments en pierre sous Ivan III (1462-1505), qui acheva le rassemblement des terres russes et voulut que la cité fût le symbole de sa puissance.
Ivan III confie tout d'abord à des architectes de Pskov la construction de la cathédrale de la Dormition (Ouspenski Sobor), à l'intérieur de l'enceinte fortifiée remontant au xii e s. (Kremlin) ; mais les Russes échouent, ayant oublié les techniques de construction en pierre sous le joug mongol. Le tsar fait alors appel à des Italiens, et c'est un architecte de Bologne, Aristotele Fieravanti (ou Fioravanti, vers 1415-vers 1486), qui en mène à bien la construction (1475-1479) en prenant pour modèle la cathédrale de la Dormition de Vladimir. Dans les années qui suivent, d'autres églises sont encore édifiées dans le Kremlin : la collégiale de l'Annonciation (Blagovechtchenski Sobor, 1484-1489), bâtie par des architectes de Pskov, se présente comme un cube entouré d'une haute galerie et coiffé de coupoles ; l'iconostase fut exécuté, semble-t-il, par Théophane le Grec (vers 1350-début du xv e s.) et Andreï Roublev (vers 1360-1430). En face fut élevée la collégiale de l'Archange-Saint-Michel (Arkhangelski Sobor, 1505-1509), œuvre du Milanais Alevisio Novi ; cet édifice conserve la structure des églises russes, mais il est, en particulier, orné de coquilles de style Renaissance, motif décoratif qui sera un élément caractéristique de l'architecture moscovite. Ces grands édifices s'équilibrent avec des constructions plus modestes comme la petite église de la Déposition-du-Manteau-de-la-Vierge (1484-1486), derrière laquelle pointent les bulbes des églises intégrées au palais du Terem, construit en 1635-1636. Le palais à Facettes (Granovitaïa Palata, 1487-1491) fut bâti par Marco Ruffo (actif à Moscou à partir de 1480) et Pietro Antonio Solari (vers 1450-1493) ; l'intérieur fut, en 1668, décoré de fresques par Simon Fedorovitch Ouchakov (1626-1686). Au-dessus de tous ces édifices se dresse le clocher d'Ivan le Grand (Ivanovskaïa kolokolnia). Cette énorme tour, commencée au début du xvi e s. et achevée en 1600 sous le règne de Boris Godounov, renferme trente et une cloches. L'une d'elles, la cloche Reine (Tsar kolokol), mesure 5,87 m de haut et pèse 218 t ; un fragment s'en détacha en 1737 et fut installé sur un socle de granit, au pied du clocher, en 1836. Résidence du tsar, mais aussi siège du métropolite, puis du patriarche, le Kremlin abrite encore le palais Patriarcal et la collégiale des Douze Apôtres (1655-1656), église privée du patriarche. Le Kremlin a été agrandi au cours des siècles, sa superficie est actuellement de près de 28 ha. Sous Dimitri Donskoï (1359-1389), l'enceinte de bois est remplacée par une enceinte en pierre. Elle est reconstruite en brique en 1485-1495 par Marco Ruffo et Pietro Antonio Solari, qui prennent pour modèle le château des Sforza de Milan. Les remparts, crénelés à l'italienne, sont flanqués de vingt tours : en 1485 est élevée la porte centrale, dite « porte secrète » (Taïnitskaïa vorota), d'où partait un souterrain conduisant à la rivière ; en 1487, on construit la tour de Beklemichev ; en 1490, la tour Borovitskaïa, par où Napoléon devait pénétrer dans le Kremlin ; en 1491, les portes Saint-Nicolas (Nikolskaïa vorota) et de Saint-Flor. Les couronnements actuels des tours sont du xvii e s. ; ceux de la tour à horloge de la porte du Sauveur ont été conçus en 1625 par l'Anglais Christopher Galloway.
À l'extérieur du Kremlin, de l'autre côté de la place Rouge (Krasnaïa Plochtchad, « Belle Place » en vieux russe), la place principale de Moscou.
On élève l'église Saint-Basile-le-Bienheureux (1554-1560) sur ordre d'Ivan le Terrible, pour commémorer la prise de Kazan. Ce monument, constitué d'une église centrale entourée de huit chapelles coiffées de coupoles bariolées, est une curiosité pittoresque et non un édifice typique de l'architecture russe. Toutefois, la partie centrale est construite dans un style largement répandu au xvi e s., le style pyramidal (en chater [ chatior ]). Les églises de ce modèle sont caractérisées par une flèche pyramidale coiffant un édifice très élancé et de section réduite. Les premières églises en chater avaient été construites dans les environs de Moscou : celle de Saint-Jean-Baptiste à Diakovo (1529), celle de l'Ascension à Kolomenskoïe (1532). Au xvii e s., on élève surtout des églises paroissiales, presque toutes du même type : de plan carré, elles sont plus hautes que larges, souvent à deux étages et couronnées de cinq coupoles ; le sommet des façades se termine par des arcs en encorbellement. On accède à l'église par une longue galerie fermée dont l'entrée est surmontée d'un clocher en chater, comme dans l'église de la Nativité à Poutinki (1649-1652), celle de la Dormition-des-Potiers (1654) ou celle de Saint-Nicolas-des-Tisserands (1676-1682).
À la fin du xvii e s. se répand un style nouveau, le baroque moscovite, ou style Narychkine, du nom du boyard Lev Kirillovitch Narychkine (1668-1705), beau-frère du tsar Alexis Mikhaïlovitch, qui fit bâtir en 1693 l'église de la Protection-de-la-Vierge à Fili. Celle-ci repose sur une haute galerie à arcades, et l'on y accède par des escaliers imposants. La partie inférieure de l'église est un cube flanqué sur chaque côté d'une construction semi-circulaire coiffée d'une coupole ; sur ce cube vient s'emboîter une première tour octogonale, surmontée d'une seconde, plus petite, elle-même couronnée d'une coupole. L'édifice, de couleur brique, est orné d'éléments décoratifs en chaux. Le style Narychkine se distingue en effet par la richesse du décor : les façades sont ornées de colonnettes, de chapiteaux, de corniches, de carreaux de faïence de couleurs vives ; les lignes architecturales sont soulignées par des moulures, les fenêtres sont encadrées de torsades et de volutes. On trouve de beaux exemples du baroque moscovite au monastère Novodevitchi ou au monastère Donskoï.
À partir des années1770-1780 et jusqu'au milieu du xix e s., le style classique remplace le baroque, en particulier dans l'architecture civile. Deux architectes, Vassili Ivanovitch Bajenov (1737 ou 1738-1799) et son élève Matveï Fedorovitch Kazakov (1738-1812), construisent pour de riches marchands ou pour des nobles une série d'hôtels particuliers, tous bâtis sur le même modèle : le corps central, décoré d'une imposante colonnade et d'un fronton, est flanqué de deux ailes ; l'ensemble de l'édifice est recouvert de stuc peint en couleurs pastel. Il en est ainsi de la maison Pachkov (1784-1786), œuvre de Bajenov, ou de la maison Demidov (1779-1791), due à Kazakov. C'est également sur ce modèle que Kazakov édifie dans les années 1780 l'ancien Sénat (avec sa vaste Salle à colonnes) et, en 1786-1793, le bâtiment de l'université, qui sera restauré après l'incendie de 1812. Une architecture semblable se retrouve dans les résidences que se font construire les nobles aux environs de Moscou : châteaux de Kouskovo des années 1770 et d'Ostankino des années 1790, appartenant aux comtes Cheremetev, château d'Arkhangelskoïe (vers 1780-1831), résidence des princes Galitzine (Golitsyn), puis Ioussoupov.
Après l'incendie de 1812, Alexandre I er crée une commission pour la restauration de Moscou. L'architecte Ossip Ivanovitch Bovet (1784-1834) aménage le centre de la ville dans le style classique, notamment la place du Théâtre où il construit le théâtre Bolchoï (1821-1824). Près du Kremlin est édifié en 1817 le Manège (détruit par un incendie en 2004).
Au milieu du xix e s. se développe un style nouveau, inspiré par l'architecture russe médiévale, à laquelle il emprunte de nombreux éléments décoratifs. C'est dans ce style « vieux russe » qu'ont été édifiés par C. Thon (Konstantine Andreïevitch Ton [1794-1881] le, Grand Palais (1838-1849) et le palais des Armures (1849-1851), à l'intérieur du Kremlin ; de même, le Musée historique (1875-1881), dont la décoration extérieure est due à V. Sherwood (Vladimir Ossipovitch Chervoud [1833-1897]), les galeries marchandes (1888-1894), qui abritent aujourd'hui le magasin Goum, et la galerie de peinture Tretiakov, dont la façade a été dessinée par le peintre Viktor Mikhaïlovitch Vasnetsov (1848-1926).
Après la révolution d'Octobre, Moscou redevient la capitale. Comme dans les autres domaines de l'art, des tentatives se font jour pour créer une architecture rompant résolument avec celle du passé. Au début des années 1920, les architectes recherchent surtout des formes nouvelles, méprisant les aspects fonctionnels et les problèmes de construction. De nombreux projets, sans doute irréalisables, sont d'ailleurs dus à des peintres ou à des sculpteurs, tel celui de Tatline pour un monument à la III e Internationale. Par la suite, les architectes s'efforcent de concilier les recherches formelles et les nécessités d'une architecture fonctionnellement adaptée au nouveau genre de vie. C'est dans cet esprit, par exemple, que Konstantine Melnikov construit plusieurs clubs à Moscou, notamment le club Roussakov, auquel il applique le principe des volumes transformables (salle adaptable aux différents besoins).
Cette synthèse entre expression formelle et fonctionnalisme est parfaitement atteinte dans les projets d'Ivan Leonidov à la fin des années 1920. Cependant, ils ne furent pas pris en considération, car alors commençaient à s'imposer les partisans d'un style monumental empruntant ses éléments composites à l'architecture du passé. Ce style triomphera au milieu des années 1930. Qualifié parfois de « stalinien », il est caractérisé par la massivité et la surabondance des éléments décoratifs, colonnes, corniches, etc. Les gratte-ciel de Moscou, tel celui de l'université Lomonossov (1949-1953), en offrent un exemple typique. Après 1956, l'architecture devient beaucoup plus sobre. On édifie des bâtiments de verre et de béton aux formes parallélépipédiques, tels le palais des Congrès (1961) [dans l'ensemble du Kremlin], dont le projet a été établi sous la direction de Mikhaïl Vassilievitch Possokhine, le cinéma Russie sur la place Pouchkine, plus récemment l'hôtel Russie ou encore les immeubles du « nouvel Arbat ».
Un plan de rénovation du centre historique a été entrepris dans les années 1990 : reconstruction de la porte de la Résurrection, de la cathédrale Notre-Dame de Kazan, de l'ancienne cathédrale du Christ-Rédempteur, édifiée entre 1839 et 1883 pour célébrer la victoire de 1812 sur Napoléon (rasée par Staline en 1933 et aménagée en piscine en 1960) …
LES MUSÉES DE MOSCOU
La galerie Tretiakov, donnée à la ville de Moscou en 1892, présente un vaste panorama de l'art russe depuis le xi e s. jusqu'à nos jours ( Vierge de Vladimir, Andreï Roublev, Kandinski, etc.).
Le musée des Beaux-Arts Pouchkine est consacré à la peinture occidentale, des primitifs italiens à Picasso (collections Chtchoukine et Morozov), en passant par les écoles hollandaise (Rembrandt), flamande, espagnole, les impressionnistes, Van Gogh, Cézanne, Matisse, etc.
Le musée du palais des Armures est installé dans le palais construit pour lui de 1849 à 1851. L'institution a pour origine un dépôt d'armes créé dans les premières années du xvi e s. Depuis 1917, le palais des Armures est devenu un grand et riche musée d'art : armes et armures, émaux des xvi e et xvii e s., orfèvrerie européenne, parures et broderies, pierres précieuses.
La ville et sa proche banlieue compte maints autres musées : le musée d'Histoire, le musée Pouchkine, le musée Andreï Roublev (dans l'ancien monastère Saint-Antoine), le musée d'architecture (à Kolomenskoïe), le musée d'Art et d'Histoire (à Serguiev Possad), le musée de la Céramique (dans le château de Kouskovo), etc.
Médias associés

Articles associés
aéronautique.
Science de la navigation aérienne et de la technique des...
automobile.
[TECHNIQUES] Véhicule routier mû par un moteur à explosion, à combustion interne, électrique...
Cheremetievo .
Aéroport de Moscou, au N.-N.-O. de la capitale.
Quartier central de Moscou, ancienne résidence des tsars, siège du...
Lioubertsy .
Ville de Russie, banlieue de Moscou, à 20 km au S.-E. du Kremlin...
Lomonossov (université).
Université située à Moscou et inaugurée en 1953.
Rivière de Russie, principal affluent de la Volga (rive droite), qui...
Rouge (place).
Place principale de Moscou, en bordure du Kremlin.
État d'Europe orientale et d'Asie, la Russie est baignée au nord par l'océan Arctique...
transsibérien (Chemin de fer).
Chemin de fer transcontinental long de 9 297 km, reliant Moscou à Omsk...
Art, science et technique de l'aménagement des agglomérations humaines.
Ancien État d'Europe et d'Asie (1922-1991) ; 22 400 000 km 2 ; capitale : Moscou...
Environ la moitié de la population de notre planète vit dans des villes ou des zones urbaines, soit environ 3,5 milliards d'hommes...
Volga (la).
Fleuve de Russie, le plus long d'Europe. 3 690 km. Bassin de...
Chronologie
- 1480 Le grand-prince de Moscou Ivan III libère définitivement la Russie de la domination mongole.
- fin du XV- début du XVI e s. Construction de nombreux monuments du Kremlin, à Moscou.
- 1589 Création du patriarcat orthodoxe de Moscou.
- 1936 Début des grands procès de Moscou.
- 1980 Les jeux Olympiques de Moscou sont boycottés par les États-Unis pour protester contre l'intervention des troupes soviétiques en Afghanistan.

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
Chapitre 2 Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ? 2.1 Sensibilisation En décembre 1899, le bateau à vapeur Manila, en provenance d'Inde, s'arrima au port de Gênes en Italie et y déchargea sa cargaison de céréales.. Le canal de Suez avait ouvert trente ans plus tôt, réduisant considérablement les coûts d'importation ...
Le commerce international lié à la spécialisation peut s'expliquer par la dotation factorielle des pays. Il s'agit de la dotation en facteurs de production (travail et capital). Elle permet de définir la compétitivité d'un pays. La théorie classique du commerce est au fondement du libre-échange et des échanges internationaux.
Les fondements du commerce international font l'objet de différentes analyses, dont la théorie des avantages comparatifs et la dotation factorielle. Le libre-échange a quelques limites qui peuvent justifier l'apparition du protectionnisme, cherchant à protéger la production nationale. Les sociétés s'internationalisent et favorisent la ...
Cette analyse permet encore aujourd'hui d'expliquer les fondements du commerce international. La théorie des avantages comparatifs de Ricardo a fait l'objet de travaux de la part de Hecksher et Ohlin (modèle HO), puis le travail a été complété dans les années 1940 par Samuelson (modèle HOS). Ces économistes ont ainsi tenté d ...
Les titres des parties ne doivent pas figurer sur votre copie. Introduction [accroche] Bien qu'il marque le pas à la suite de la crise de 2008, le commerce international a tendance à croître fortement depuis une cinquantaine d'années. [présentation du sujet] Entendu au sens large comme l'ensemble des échanges internationaux de matières premières, de produits semi-finis, de produits ...
1 SESSION 2023 A ALAURÉAT GÉNÉRAL ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉIALITÉ SES SUJET 1 - DISSERTATION - CORRIGE « Quels sont les fondements du commerce international ? » INTRODUCTION Ouverture : Depuis l'apès-guerre, on assiste à une ouverture du Commerce International (CI), dans un contexte favorable au libre-échange.
Les stratégies d'internationalisation ont pour principaux objectifs d'augmenter la compétitivité. 1. Compétitivité-prix. La compétitivité-prix consiste à proposer des produits moins ...
1.Quels sont les fondements du commerce international ? Le but de cette partie est d'expliquer pourquoi les pays commercent entre eux, plutôt que de produire tous les B&S dont ils ont besoin. On va commencer par expliquer le commerce de produits différents (le commerce interbranche) avant d'aborder le commerce de produits comparables ...
La protection douanière est notre voie, le libre-échange est notre but. Le Système national d'économie politique, 1844. Voici les repères nécessaires pour rédiger une copie d'excellence sur le thème du "Commerce internationale" : une accroche ; le courant de pensée économique….
Dissertation : Les fondements du commerce international Analyser la consigne et dégager une problématique Problématique. Le sujet invite à rechercher les différentes causes du commerce international. On peut ainsi distinguer les facteurs qui expliquent les échanges entre pays différents et ceux qui concernent des pays comparables, tout en s'interrogeant sur le rôle des agents ...
A. Un commerce international encouragé qui s'est développé grâce au libre-échange et à des évolutions technologiques L'internationalisation des économies est un processus ancien qui s'est traduit par le développement du commerce international entre pays. Définition. Le commerce international désigne les échanges de biens et ...
1 Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ? Les dossiers SES de RCE - Sciences économiques L'enjeu de ce chapitre est de comprendre les principaux éléments qui déterminent la croissance économique.
Hecksher, Ohlin et Samuelson. Eli Hecksher (1879-1952) et Bertil Ohlin (1899-1979), deux économistes suédois, ont développé un modèle sur le commerce international en 1933. Paul Samuelson (1915-2009), économiste américain, « prix Nobel d'économie » en 1970, a contribué à l'amélioration de ce modèle en 1941.
QUELS SONT LES FONDEMENTS DU COMMERCE . INTERNATIONAL ET DE L'INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION ? Les objectifs d'apprentissage des élèves sont strictement définis par les programmes. Cette fiche pédagogique, à destination des professeurs, vise à les accompagner dans la mise en œuvre des nouveaux programmes.
THEME 1- Chapitre 2 - Quels sont les fondements du commerce international ? B. Les nouvelles théories du commerce international pour comprendre l'essor des échanges intra-branches entre pays comparables. Document 3. La différenciation des produits explique le commerce intra-branche Document 4.
I. Quels sont les fondements du commerce international ? Au XXe siècle, après s'être effondré pendant les deux guerres mondiales et la crise des années 1930, le commerce international connaît un essor remarquable à partir de 1945, avec un taux de croissance nettement plus rapide que celui de la production mondiale.
Plan de la fiche : OAS_AD("Native"); Aperçu des théories classiques du commerce international Aperçu des nouvelles théories du commerce international Les politiques commerciales OBJECTIFS :
Les fondements du commerce international Tout d'abord, abordons la définition du commerce international. Il s'agit de l'ensemble des biens, services et capitaux faisant l'objet d'un échange entre au moins deux pays. Pour comprendre véritablement le commerce international, il faut avoir en tête son évolution.
Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ? Quelles politiques éco dans le cadre européen ? Comment expliquer l'engagement politique. ... Les étapes - EC3 et Dissertation. Méthodo -La mise en oeuvre d'une Argumentation.
Virtual International Authority File. VIAF ID. 146808073. retrieved. 17 December 2023. Library of Congress authority ID. n2008021619. 1 reference. stated in. Virtual International Authority File. VIAF ID. 146808073. retrieved. 17 December 2023. NL CR AUT ID. ge945071. subject named as. Elektrostal (Rusko) 1 reference.
Moscow Oblast is located in the central part of the East European Plain, in the basin of the rivers of Volga, Oka, Klyazma, Moskva. The region stretches from north to south for 310 km, from west to east - 340 km. It was named after the city of Moscow, which however is not part of the region. Part of the administrative authorities of the region ...
1. Bars & Clubs. 11. Papa Lounge Bar. Bars & Clubs. 12. Karaoke Bar. Karaoke Bars. Things to Do in Elektrostal, Russia: See Tripadvisor's 801 traveller reviews and photos of Elektrostal tourist attractions.
Moscou. en russe Moskva. Moscou Moscou. Capitale de la Russie, sur la Moskova.. Population : 12 330 126 hab. (recensement de 2016) Nom des habitants : Moscovites GÉOGRAPHIE Moscou. Moscou s'est développée à 156 m d'altitude sur la Moskova en position de carrefour par rapport aux grandes voies fluviales de la Russie d'Europe : Volga, Dvina, Dniepr, Don.