01 86 76 13 95
(Appel gratuit)

La dissertation en philosophie
Introduction :
Le mot « dissertation » dérive de l’étymologie latine du mot « discussion » qui signifie « examen attentif, contradictoire » ; « échange d’arguments ». La dissertation est donc un effort de réflexion dans lequel on examine de manière attentive les problèmes philosophiques liés à un sujet.
Une dissertation réussie se prépare avec trois ingrédients : une méthode (ensemble de règles qui guide la réflexion), de la culture (culture personnelle et culture philosophique acquise en cours) et de la curiosité (la philosophie est un regard curieux sur soi-même et sur le monde).
L’épreuve de la dissertation dure 4 heures. Deux sujets au choix sont proposés, sous forme de questions. Nous prendrons ici pour sujet support « La liberté doit-elle être sauvée ? »
Décortiquer le sujet
Pour répondre à une question, il faut d’abord la comprendre. Pour cela, il faut analyser les mots du sujet, c’est-à-dire le décomposer en tous ses éléments pour comprendre ce qui est réellement demandé. Ce travail préparatoire s’effectue au brouillon.
Première étape : relever les notions du sujet
Dans un premier temps, il s’agit de repérer dans le sujet les notions du programme étudiées en cours.
Dans le sujet, les notions peuvent être explicites ou implicites. Lorsqu’elles sont implicites, il faut donc les mettre en évidence.
- « La liberté doit-elle être sauvée ? »
La notion du programme est explicite : la liberté .
- « L’ État doit-il faire notre bonheur ? »
L’ État et le bonheur sont explicites. Une autre notion est désignée implicitement par l’expression « doit-il faire » : le devoir .
Il faut ensuite faire subir le même traitement aux autres termes, afin d’éviter de plaquer sur votre sujet du bac un autre sujet traitée pendant l’année, impliquant la même notion, mais pourtant différent.
« La liberté doit-elle être sauvée ? » est différent de « La liberté doit-elle parfois être sauvée ? » :
- « Sauver » : le verbe est à définir.
- « Doit-elle » : il s’agit d’une formulation typique de sujet.
Deuxième étape : la libre association
Il s’agit de noter spontanément les idées qui vous viennent à l’esprit en rapport avec la question du sujet. La question vous suggère une réponse, qui elle-même amène à une idée ; cette idée s’enchaine sur une autre et ainsi de suite… Surtout ne vous censurez pas ! Le « tri sélectif » des idées se fait dans un second temps. Au départ, l’objectif est d’amasser un maximum d’idées, de références et d’exemples.
Troisième étape : la conceptualisation
Cette étape est la plus complexe. Conceptualiser, c’est définir un terme de manière philosophique par rapport au sens courant que nous en avons, le sens du dictionnaire. Pour conceptualiser, il faut :
- s’aider de l’étymologie quand on le peut. Ici, « liberté » vient de libertas , qui signifie « indépendance » et « libre pouvoir » ;
- distinguer les différents domaines de réflexion dans lesquels la notion se retrouve : liberté politique, morale, métaphysique, religieuse ;
- distinguer la notion des notions voisines et des notions contraires : liberté/individualisme, liberté/émancipation, liberté/servitude liberté/aliénation ;
- énoncer les différents attributs de la notion, ceux qui sont évidents puis plus réfléchis :
- « La liberté est un ressenti indéfinissable mais agréable » ;
- « La liberté est la capacité à user de son libre arbitre » ;
- mobiliser ses cours. La notion de liberté est conceptualisée de manière différente chez Hobbes, chez Spinoza ou chez Sartre ;
- les repères au programme sont également utiles, ils comportent des distinctions relatives aux notions du programme.
Il est essentiel de conceptualiser. C’est en conceptualisant un terme que vous ferez apparaître les pistes de réflexions philosophiques qu’il vous faudra détailler dans votre développement.
Le type de sujet
Les questions du type : « peut-on/peut-il » interrogent sur :
- la possibilité pratique . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si on dispose des moyens techniques de faire telle ou telle chose ;
- la possibilité morale ou le droit . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si on a le devoir moral ou le droit juridique de faire telle ou telle chose.
Les questions du type : « faut-il/doit-on » interrogent sur :
- la nécessité matérielle, le besoin . Il s’agit de retraduire le sujet en se demandant si nous sommes contraints de X, à quel besoin répond X ;
- l’ obligation morale, le devoir . Il s’agit de traduire le sujet en se demandant si notre dignité exige que X, si nous avons le devoir moral de X…
Pour les questions du type : « pourquoi X/à quoi sert X » :
- il s’agit de mettre en évidence les raisons, les causes de X, ses buts et/ou son utilité . Il faut aussi poser la question de l’inutilité de ce X.
Ces réflexes de traduction, combinés à la compréhension des termes du sujet, aident à problématiser le sujet.
Pour notre sujet « La liberté doit-elle être sauvée ? », on peut donc se demander :
- sommes nous contraints de protéger politiquement les libertés ?
- À quel(s) besoin(s) répond notre volonté de protéger la liberté ?
- Avons-nous l’obligation morale de combattre ce qui entrave nos libertés ?
La problématique
Pour structurer les idées récoltées, il faut ensuite cadrer une problématique. Pour cela, il faut déterminer deux réponses au sujet, et les mettre, d’une certaine manière, en compétition.
Répondre à la question du sujet ne consiste pas à opposer radicalement une première réponse et une deuxième réponse au sujet : vous vous contredirez vous-même et votre réponse globale sera incohérente. Ainsi, si vous dites tout d’abord que nous devons sauver la liberté parce qu’elle est menacée puis qu’il n’est pas nécessaire de protéger la liberté car elle n’est pas menacée, vous vous contredisez !
Il faut donc construire des réponses crédibles et consistantes , et cela demande un savoir faire particulier.
Proposer une première réponse et la questionner
Après avoir formulé une première réponse, il faut énoncer les implications de cette thèse, en se demandant ce qu’implique le fait de soutenir cette réponse . Trouvez des conséquences et formulez-les sous formes d’idées brèves, aidez-vous de la formule « si… alors… ». Il s’agit ensuite de questionner ces implications, puis d’associer les idées et références philosophiques pour amorcer l’argumentaire.
L’Homme doit sauver la liberté.
Si la liberté doit être sauvée alors c’est que la liberté est en danger. De quels dangers souffre la liberté ? Quels sont les dangers qui font obstacle à la liberté ? Existe-t-il des personnes (esclavage) / des politiques (tyrannie, totalitarisme) / des facteurs socio-culturels (déterminisme) / des désirs (Inconscient) qui nuisent à la liberté ? Quels dangers ruinent la liberté morale ? La liberté politique ?
C’est que nous ne sommes pas vraiment libres ou bien que nous sommes libres « en sursis ».
Pourquoi pouvons-nous affirmer que nous ne sommes pas libres ? D’un point de vue politique , certains peuples sont encore sous le joug de dictateurs. L’ONU est une organisation qui veille à la préservation des libertés de l’Homme, premier droit à sauver et préserver selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. D’un point de vue moral et politique , la notion de déterminisme vient confirmer que la liberté est menacée et que nous devons nous émanciper de bons nombres d’influences qui pèsent sur notre existence et la déterminent à notre insu. D’un point de vue métaphysique , Spinoza effectue une critique du libre arbitre montrant finalement que nous sommes dans une liberté illusoire.
Proposer une deuxième réponse à la question et la questionner
La liberté n’a pas besoin d’être sauvée.
Si la liberté n’a pas a être sauvée, alors c’est que nous avons le sentiment imprescriptible d’être libre. Comment se manifeste notre sentiment de liberté ? Que ressentons-nous ? La liberté ne se prouve pas, elle s’éprouve. C’est un sentiment agréable mais indéfinissable. C’est donc que la liberté fait partie de la nature de l’homme, elle est inhérente à la nature humaine. L’homme est-il libre par nature ? Rousseau l’affirme : l’homme naît libre même si partout il est sous les fers, sous le joug de ceux qui le gouvernent. Selon la Déclaration des droits de l’homme, les hommes naissent libres et égaux en droit. D’un point de vue moral, Sartre affirme le caractère imprescriptible de la liberté qui fait partie de l’essence de l’Homme.
C’est par le questionnement des réponses apportées au sujet que des idées philosophiques majeures sont mobilisées.
Formuler cette opposition sous la forme d’une alternative
- Doit on penser que X et admettre que Y ou bien penser que … ce qui revient à …
- Doit on penser que X alors que … ou bien penser Y mais alors … ?
Doit-on penser que la liberté est une valeur résolument en danger et considérer qu’elle est attaquée dans tous les domaines ou bien admettre qu’il persiste en l’Homme une part de liberté naturelle, inaliénable et indestructible, même s’il est bien difficile de l’exercer ?
Sans problématique, la dissertation n’a aucune orientation, aucune piste de réflexion n’est lancée. Une problématique consiste a rendre explicite le ou les problèmes qui sont contenus dans la question initiale, mais qui sont cachés.
Construire un plan
On ne peut pas appliquer un même type de plan pour tous les sujets. Nous présenterons donc ici trois plans possibles.
Plan thèse, antithèse, synthèse
Ce plan est appelé plan dialectique et s’effectue nécessairement en trois parties. La troisième partie, la synthèse, explique l’insuffisance des deux thèses précédemment opposées et résout la difficulté rencontrée. Mais il n’est pas toujours possible de procéder ainsi et selon le type de sujet, le plan dialectique n’est pas toujours pertinent.
Plan en trois parties avec deux thèses : l’opinion et la réfléchie
Il s’agit ici de présenter une première thèse, une opinion spontanée, puis de critiquer cette opinion en réfutant les arguments de la première thèse. La troisième partie consiste en la proposition d’une deuxième thèse, plus réfléchie.
I) La liberté est menacée en tous bords
II) Nous avons les moyens politiques et moraux de protéger nos libertés
III) Mais la liberté n’est-elle pas, au fond, une illusion ?
Plan qui conteste le sens de la question
Ce plan contient également trois parties. La première apporte une réponse. La deuxième partie la nuance ou la conteste. La troisième partie critique le présupposé du sujet.
La liberté est-elle une illusion rassurante ?
I) L’homme se croit libre mais ne l’est pas
II) La liberté est une croyance nécessaire au bon fonctionnement de la morale et de la justice
III) La liberté n’est pas une illusion mais elle est une conquête qui exige de l’engagement et du courage
- Quel que soit le plan envisagé, ils progressent tous vers le même but : la résolution des problèmes liés au sujet.
La structure du devoir
La dissertation possède une structure, un squelette qui est toujours le même.
Introduction
L’introduction doit contenir un certain nombre d’étapes et avoir une longueur d’une demi page à une page. Tout d’abord, une accroche qui introduit la ou les notions du sujet mais surtout qui permet d’arriver à la problématique : un acte de la vie quotidienne, un événement historique, une scène de roman ou de film, un mythe, une citation… Tout ce qui amène à se poser la question du sujet est le bienvenu. On expose ensuite la problématique, puis l’annonce du plan.
Développement
Le développement, en deux ou trois parties, court sur trois à huit pages. Chaque partie se découpe selon le même schéma.
L’ idée directrice est la formulation d’une première réponse consistante à la question.
L’ argumentation doit ensuite contenir une progression logique (avec des connecteurs logiques),un travail de conceptualisation, des exemples, des références philosophiques ( on peut utiliser les idées, les arguments, les exemples d’un auteur philosophique, ou partir d’une citation) et des connaissances (en art, en science, en histoire).
Le bilan permet de revenir au sujet et d’y répondre partiellement.
Enfin, la transition permet de relancer la discussion afin de passer à la deuxième partie.
La conclusion, d’une demi page environ, doit répondre à la question initiale. Elle se fait en deux temps. Tout d’abord, il faut faire un bilan récapitulatif, expliquer le cheminement entre les différentes parties du devoir. Ensuite, on apporte une réponse claire et précise à la question posée.
Les fausses réponses du style « cela dépend des points de vue de chacun » ou bien « c’est une question difficile à laquelle on ne peut pas répondre » sont à bannir. De même, les ouvertures avec une question sans aucun rapport avec le sujet initial ne sont pas pertinentes.
Conclusion :
Rédiger une dissertation demande donc un travail en deux temps. Le temps du brouillon est nécessaire, mais aussi déterminant. Plus on interroge le sujet et pose clairement deux ou trois pistes de réflexion pour y répondre, plus le devoir sera réussi. C’est pourquoi il faut passer entre 1 h 30 à 2h sur le brouillon. Cependant, il ne faut pas rédiger tout le devoir au brouillon, seulement l’introduction. Le deuxième temps est celui de la rédaction, qui doit être soignée tant du point de vue de la forme que de l’expression écrite. La rédaction prend environ 2h.
Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser .
Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.
- We're Hiring!
- Help Center

Méthodologie de la dissertation de philosophie (mise à jour, 2024)

Related Papers
Alexis Delamare
Exercice académique franco-français par excellence, la dissertation a de quoi surprendre. N’est-ce pas une folie que de prétendre régler en quelques heures une question philosophique discutée depuis des siècles ? L’énoncé même de certains sujets (« La connaissance ») apparaît presque ridicule comparé au temps dont on dispose pour le traiter. La dissertation traduirait ainsi une forme de mégalomanie philosophique. Une seconde critique régulièrement évoquée se concentre sur la totale liberté laissée aux étudiants : comment comparer entre elles des productions qui auront fait usage de thèses, d’auteurs, de références, totalement différents ? On comprend bien comment l’on note un commentaire : on met en regard le sens du texte et ce qu’en a compris l’étudiant. Mais pour la dissertation ? Sur quelle norme devrait-on se fonder pour juger la copie ? Enfin, on pourra encore ajouter ceci, que la dissertation, parce qu’elle nous pousse à défendre des thèses pour mieux les rejeter par la suite, est une forme d’absurdité. Pourquoi ne pas simplement défendre notre point de vue ? Pourquoi s’embarrasser de ces longs détours avant de parvenir enfin, épuisés, à la vérité de la dernière partie ?
wajdi hajlaoui
Méthodologie pour rédiger bonnement les bons sujet de mémoire ,littérature ,philosophie pour pouvoir réussir les grands concours tels l'agrégation et l'admission à l'école normale supérieure .
Lamiaa Khaldoune
Michael D Rosenfeld
Le séminaire proposé n’est pas un séminaire de recherche sur la théorie de la littérature. Son ambition est de montrer au public visé (doctorants surtout, étudiants de deuxième année de master aussi) quel intérêt pratique (méthodologique) la théorie de la littérature a pour leur propre recherche : la théorie permet de définir des problématiques plus pertinentes, plus cohérentes, plus rigoureuses que l’approche empirique. La théorie est abordée ici comme un outil, non comme un objet en soi, ni, surtout, comme un obstacle à surmonter. Les textes servant de base aux séances ont été choisis pour leur intérêt méthodologique, mais aussi pour leur clarté et leur accessibilité intellectuelle. Ils sont en général assez courts, et on les trouve facilement. Il est demandé aux étudiants de choisir et d’orienter leurs exposés de façon à faire ressortir ce que le corpus théorique étudié peut apporter à leur propre recherche. À côté d’un travail d’élucidation, les interventions des enseignants ont pour objectif de partager une expérience. Elles indiquent en particulier en quoi telle ou telle ressource théorique (tel ouvrage, tel concept, telle idée) a pu susciter leur questionnement, étayer leurs travaux (à commencer par leurs propres thèses de doctorat et habilitation à diriger des recherches), résoudre telle ou telle difficulté rencontrée dans la conduite d’une recherche. Les trois responsables du séminaire assistent ensemble à la totalité des séances. Équipe : Serge Rolet (Lille 3), Vincent Vivès (Valenciennes), Damien Zanone (UCL)
Raphaël Verchère
Cet ouvrage permet aux élèves de Terminale de s’approprier de façon autonome, concrète et directement utilisable les connaissances et les compétences attendues pour l’épreuve de philosophie au Bac : - des fiches méthodologiques sur les deux épreuves : dissertation et explication de texte ; - des fiches de cours sur les notions au programme ; - des exercices variés et ciblés avec les commentaires du prof ; - des sujets d’annales commentés et corrigés ; - des conseils et astuces. En bonus - Les repères du programme expliqués - Les clés de l’oral de rattrapage
Comme pour la dissertation, l’introduction est un moment absolument fondamental du commentaire. L’on pourrait penser, à première vue, que la tâche de l’introduction du commentaire est moins significative que celle de la dissertation, en disant à peu près : dans la dissertation, il s’agit d’inventer un problème, tandis que, dans le commentaire, le texte, donc le problème, est déjà devant nous : il n’y a rien à inventer, seulement à découvrir. Une telle conception est erronée. On a vu, dans la dissertation, que même les sujets-question devaient être problématisés : il fallait montrer en quoi la question constituait un problème, il fallait transformer la question en problème. La tâche est assez similaire pour le commentaire : il faut montrer en quoi le texte pose un problème, en quoi la question abordée par le texte ne va pas de soi et exige donc une résolution. Le développement du commentaire, de même que pour la dissertation, va consister à montrer comment le texte répond au problème que l’on aura identifié en introduction.
Boris Barraud
La dissertation est, au sein des facultés de droit françaises, l'un des exercices les plus anciens et les plus classiques. À travers lui, l'enseignant cherche à évaluer non les connaissances de l'étudiant mais sa capacité à comprendre, à penser et à synthétiser le droit. Surtout, parce que, en droit, la forme compte autant que le fond, l'enseignant cherche à mesurer l'acceptation et la compréhension par l'étudiant de certains canons en vigueur parmi les facultés de droit françaises, canons qui ont pour seule justification le fait qu'ils sont des canons, i.e. des usages, loin de toute légitimité scientifique. L'objectif de la dissertation est, à partir d'un sujet donné, d'isoler une problématique (non la problématique qui n'existe pas) dans une introduction et d'y répondre dans un plan et dans des développements objectifs mais aussi personnels. Cet exercice fait appel à de nombreuses qualités qu'il faut cultiver : capacité d'analyser le sujet, esprit de synthèse, capacité de communication des connaissances, habileté de présentation et d'exposition de celles-ci. Les sujets des dissertations peuvent être de toutes sortes, des plus théoriques aux plus attachés au droit positif. Mais, quel que soit le sujet, l'étudiant ne doit en aucun cas se borner à présenter l'état du droit positif, à l'instar d'un manuel. La bonne dissertation est celle qui consiste en une réflexion ou, mieux, en une démonstration. Et son rédacteur doit, notamment à travers le plan et les intitulés, exprimer une position personnelle, sans toutefois verser par trop dans les jugements de valeur ou, pis, dans les considérations politiques. Tout d'abord, il convient de prendre connaissance du sujet et, sur papier libre, de noter la définition de ses termes ainsi que toutes les idées (ou pistes d'idées) venant à l'esprit en séparant celles qui pourraient constituer des parties ou des sous-parties et celles qui pourraient seulement servir le propos au sein des sous-parties. Même si le sujet est court concernant les dissertations, il convient de le lire à plusieurs reprises et de s'assurer de la bonne compréhension de ses termes afin d'éviter le hors-sujet, lequel emporte toujours des conséquences très dommageables. Parfois, la ponctuation ou certains mots de liaison sont décisifs en ce qu'ils influencent le sens du sujet et donc la problématique et les réponses qu'il est possible d'en tirer. Une fois un premier point autour du sujet effectué, il s'agit de rechercher, en consultant manuels, ouvrages et revues juridiques, mais aussi toute source offerte par le Web (à condition que sa fiabilité soit avérée et de pouvoir ensuite la citer en note de bas de page), d'autres idées et informations, toujours en notant au brouillon les parties et sous-parties potentielles et les autres données non-exploitables en termes de plan. Une fois qu'il apparaît que les recherches autour du sujet ne peuvent plus être productives (ou du moins seulement marginalement), reste à reprendre toutes les notes du brouillon et à les ordonner sur un nouveau papier libre en séparant cette fois ce qui sera l'introduction, ce que seront le plan et les intitulés et ce que sera le propos tenu en chaque sous-partie. Éventuellement, mais non-nécessairement, quelques éléments peuvent être conservés en vue de la rédaction d'une conclusion. Il s'agit à cet instant de regrouper par affinités les idées et informations qui se complètent, qui s'opposent, également celles qui doivent finalement être exclues de la démonstration, afin de concevoir progressivement ce qui sera le plan (sans alors chercher à affiner les intitulés, ce qui est un exercice d'abord formel et intervenant en dernier lieu). Il importe de ne surtout pas s'engager trop vite dans la rédaction et dans la conception du plan. Tout cela ne vient qu'à la fin, validant le travail en quelque sorte. Le plan, notamment, est le fruit naturel des recherches et des réflexions ; il serait désastreux de vouloir ab initio concevoir un plan pour ensuite rechercher quelques éléments susceptibles de la garnir substantiellement. Deux éléments sont centraux dans la dissertation : son introduction (1) et son plan (2). Il n'est pas davantage à dire du contenu de chaque sous-partie. Simplement faut-il préciser que, systématiquement, des annonces de sous-plans (des chapeaux introductifs) doivent précéder et annoncer les A et B et des phrases de transition doivent permettre le passage de I à II et de A à B. Tant les chapeaux que les transitions permettent de renforcer et de traduire la logique du raisonnement. Quant au contenu, simplement faut-il inviter l'étudiant à ne pas se borner à exposer de manière excessivement descriptive les données et, sans néanmoins bannir toute description, à adopter également une approche critique, si ce n'est polémique à propos des éléments en cause.
El haouary ouadie
Michel Weber
« […] D’épreuve en épreuve, la philosophie affronterait des rivaux de plus en plus insolents, de plus en plus calamiteux, que Platon lui-même n’aurait pas imaginés dans ses moments les plus comiques. Enfin le fond de la honte fut atteint quand l’informatique, le marketing, le design, la publicité, toutes les disciplines de la communication s’emparèrent du mot concept lui-même, et dirent : c’est notre affaire, c’est nous les créatifs, nous sommes les concepteurs ! » L’épreuve dernière qu’évoquent Deleuze et Guattari a trouvé au XXe siècle un développement assez inattendu, en l’espèce de la transformation de ce qui n’était somme toute qu’une bataille d’arrière-garde — la dénonciation active du « fond de la honte » — en la guerre intestine qu’institue potentiellement le « conseil philosophique privé ». Il s’agit en effet ni plus ni moins de la réactualisation de la lutte que se livrèrent — selon Platon, il y a 2500 ans — Socrate et les sophistes . À nouveau, on marchande l’idéal philosophique.
RELATED PAPERS
International Journal of Psychophysiology
Nicholas Benikos
Gregory T . Doolan
Diabetes Care
Leopold Fezeu
Geografia: Malaysian journal of society and space
mohmadisa hashim
arXiv (Cornell University)
Iwona Jasiuk
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism
Roland Savard
International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology
LALITA LUTHRA
Archives of pathology & laboratory medicine
Alvaro Giraldo
RePEc: Research Papers in Economics
Thomas de Hoop
Journal of Japan Institute of Light Metals
Hiroyuki Toda
Joris Dirckx
Computational Optimization and Applications
Andrew Eberhard
Pattern Recognition
Ngọc Thành Lê
Necip Asım - İlm-i Lisân (İnceleme-Metin-Aktarma-Sözlük) Haz. Muhammet Raşit ÖZTÜRK
Muhammet Raşit Öztürk
Armando del Romero
The Journal of Organic Chemistry
John Gupton
Sociedade & Natureza
ISABELLE PINHEIRO
JMIR Research Protocols
Martin L Nielsen
Diseases of the Colon & Rectum
Eric rullier
Daniel de Oliveira
RELATED TOPICS
- We're Hiring!
- Help Center
- Find new research papers in:
- Health Sciences
- Earth Sciences
- Cognitive Science
- Mathematics
- Computer Science
- Academia ©2024

- Inscription Connexion Devenir Premium
- Méthodologie et outils
MÉTHODO : comment bien rédiger sa dissertation de philosophie ?
- Publié le 31 mars 2020
- Mis à jour le 16 juin 2021

T’entraîner à la rédaction de sujets est la clé ! Une bonne préparation te permettra de réussir et de peut-être t’assurer une bonne note à la dissertation et décrocher une mention au bac de philosophie.
Il y a 3 étapes à prendre en compte dans la construction de ta dissertation de philosophie, si tu les appliques tu auras toutes les cartes en main pour faire une bonne disserte.
1. Quelle méthode choisir ? Quelle architecture de dissertation est la meilleure ?
Les méthodes de dissertation sont variées. Entre ce que t’a dit ton prof, ce que tu as vu sur le net, ce que tu as lu dans ton manuel, etc., il y a souvent de quoi se perdre ! Voici quelques conseils pour choisir entre toutes ces sources.
4 éléments universels et essentiels à la dissertation, quelle que soit la méthode choisie.
D’abord, il faut se rappeler que, si les méthodes sont différentes, il y a 4 éléments qui sont universels et essentiels à la dissertation, quelle que soit la méthode choisie :
- Une problématique ;
- Une réponse personnelle et argumentée à cette problématique ;
- La définition détaillée et approfondie des termes du sujet ;
- Un plan en trois temps.
Dans tous les cas, choisis la méthode avec laquelle tu te sens à l’aise et n’en change pas. Attention, la méthode que tu choisiras doit obligatoirement proposer un plan en trois parties, les correcteurs sont assez sévères sur ce point.
Je te donne un exemple de méthode, d’architecture, de nomenclature ci-dessous, attention quelques éléments dont tu dois te souvenir :
- Les noms des parties ne doivent pas apparaître.
- Le plan guide la hiérarchisation de ton analyse.
- Tu dois introduire chaque partie par une phrase de transition.
Dans cet exemple de plan en 3 parties (voir ci-dessous), l’enjeu de la question sera de savoir dans quelle mesure le bonheur est le but de la politique .
La méthode que tu choisiras doit obligatoirement proposer un plan en trois parties, les correcteurs sont assez sévères sur ce point.
Partie 1 : qu’est-ce que le bonheur ?
- Aspect universel
- Aspect singulier
Partie 2 : la politique, qui est la gestion des affaires publiques, ne semble donc pas devoir s’occuper du bonheur, qui finalement est quelque chose de propre à chacun.
- Définition détaillée de la politique
- Si l’état prétend imposer sa conception du bonheur aux individus, il y a de fortes dérives totalitaires à craindre.
- Mais s’il ne s’en occupe pas du tout alors la politique n’est qu’un instrument au service de quelques-uns .
Partie 3 : en réalité, la politique, si elle ne s’occupe pas directement du bonheur, doit cependant faire en sorte que chacun puisse le trouver. Elle doit assurer les conditions de possibilités du bonheur.
- La politique doit permettre à l’homme d’être éduqué, soigné, etc.
- La politique d’un état doit assurer la paix intérieure et la paix extérieure, faire en sorte que la vie sociale et le bien commun soient possibles.
2. S’entraîner à définir avec précision les notions du programme de philosophie
Pour cet exercice, n’hésite pas à te faire des cartes mentales (mindmaps) colorées et personnalisées qui te permettront de mémoriser à long terme.
Je te donne un exemple ci-dessous :

Si tu as du mal à apprendre ton cours, et que tu as besoin d’aide, retrouve des cours synthétiques sur superBac ! Ces fiches sont rédigées par des professeurs certifiés.
Tu trouveras aussi de nombreux cours et vidéos de notions sur la chaîne Youtube superBac by digiSchool .
3. Entraîne-toi !
Pour s’entraîner avec succès, il y a deux types d’exercices simples et ultra efficaces.
Entraînement à la dissertation n°1 : choisir – remplir – comparer
Choisir un sujet dont tu peux trouver le corrigé en ligne sur superBac. Par exemple, tu peux trouver : « La culture nous rend-elle plus humain ? »
Puis, remplir les étapes en écrivant seulement l’essentiel : définitions, références à un auteur, idée d’argument à mentionner, etc.
Problématique : …
Partie 1 : …
Partie 2 : …, partie 3 : ….
Enfin, comparer avec le corrigé proposé.
Le but n’est pas que tout soit absolument similaire mais que les éléments essentiels soient là : des définitions justes et complètes, des références judicieuses aux auteurs, une bonne méthodologie qui suit une logique de raisonnement, ainsi qu’une réponse personnelle.
Entraînement à la dissertation n°2 : l’exercice de conviction
Pour cet exercice, il vous faudra donc :
- Choisir un sujet de dissertation de philosophie
- Trouver la problématique de ce sujet
- Trouver ta réponse personnelle
- Argumenter ta réponse personnelle devant un auditoire : par exemple, un ou plusieurs membres de ta famille, et essaye de les convaincre que tu as raison.
Cet exercice te permet de mettre tes idées au clair , de sortir du côté un peu abstrait de la dissertation et de travailler en t’amusant .
De plus, il est fort probable que tes parents ou tes amis te répondent et argumentent à leur tour. Ce qui te permettra de voir des aspects du problème qui t’avaient échappés.
Une fois cet exercice fait, tu peux toujours t’amuser à remplir le plan à trou avec toutes les idées qui auront germé !
Si cet article vous a aidé, dites-le-nous 🙂
Note moyenne 4 / 5. Vote count: 19

Comment bien se relire pour ne pas faire d’erreurs d’orthographe ?
Apprendre à bien se relire est primordial pour de nombreuses raisons. Tous les jours, entre nos messages, nos e-mails, nos devoirs à faire, nos examens, nous écrivons énormément et il est parfois difficile de se relire sans méthode fiable. Aurore Ponsonnet, formatrice en orthographe et Maureen Pinneur, responsable pédagogique chez digiSchool, te donnent leurs meilleurs conseils de relecture pour ne plus faire de faute ! Rappels de grammaire, conjugaison, orthographe des mots et techniques de relecture, tout est là, suivez le guide !

Bac de philosophie : les citations à retenir
Chaque jour l'épreuve de philosophie se rapproche, et tu commences à paniquer ou à te demander ce que tu vas bien pouvoir dire dans ta copie ? digiSchool t'a compilé 30 citations qui pourront, on l'espère, te débloquer pour la dissertation !

Bac technologique 2021 : programme et épreuve de philosophie
La philosophie est la matière commune de tous les bacheliers. Cependant, son programme et l'épreuve qui lui est rattachée connaissent quelques variations selon les filières. Zoom sur la philosophie pour la filière technologique : programme, modalités d'évaluation, conseils de révisions... suis le guide !
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
C’est très utile
Merci pour la comprehension mais je peus avoir les citation merci
Je les veux
bon plan pour moi
Un très grand merci mon professeur pour votre soutien sans même nous connaître.
M’aidera de bien comprendre
Merci, ceci m’aidera beaucoup
quelle la question posé pour la dissertation
Très heureuse de vous lire
Merci beaucoup et j’apprécie énormément votre aide

Méthode de la dissertation de philosophie
- Comment suivre ces conseils ?
Introduction
- Principes fondamentaux
- Réfléchir au brouillon
- Nuances importantes
Cet article essaie de donner les bases de la méthode de dissertation de philosophie dans le supérieur. C’est un projet ambitieux, et je n’ai aucune prétention à l’exhaustivité : les principes que je présente sont simplement le fruit de mon expérience en prépa A/L et en licence 3 de philosophie.
Comment suivre ces conseils ?
Voir une méthode aussi longue peut être très décourageant, surtout si on essaie de la lire d’une traite. En fait, je pense que tout consulter d’un coup serait même contre-productif, car la progression méthodique doit se faire petit à petit : modifier sa manière de faire demande une attention constante aux éléments qu’on veut corriger. On ne peut être partout à la fois.
Alors comment faire avec cet article ? La première chose est de comprendre que l’ambition ici n’est pas de révolutionner ta manière de voir la dissertation de philosophie, ni de donner une recette magique : il faut construire sur ce que tu connais déjà. Si tu consultes cette page, c’est sûrement que tu as au moins une petite idée de ce qu’est une dissertation de philosophie. Cette conception préalable, il ne faut surtout pas l’abandonner totalement, sinon cela signifierait repartir à zéro. Tu connais forcément des choses pertinentes et justes sur la méthode de philosophie, même si tes notes sont basses.
Le but de cet article est donc de tendre à l’exhaustivité pour te laisser y piocher des choses en fonction de tes difficultés personnelles. Il est structuré avec des petits titres, ce qui permet d’aller directement au point que l’on recherche (soit parce qu’il a été mentionné par un de nos professeurs dans une correction, soit parce qu’on estime qu’on doit s’y améliorer). La consultation de cette page doit donc à mon avis être fractionnée pour permettre l’application spécifique des conseils qui sont donnés afin de les intégrer à sa pratique actuelle de la dissertation.
Je le répète encore une fois, car c’est à mon avis le plus important : il ne faut pas consulter cet article pour refonder sa pratique de la philosophie et repartir de zéro en suivant ces conseils. Au contraire, mieux vaut s’approprier les éléments de cette page pour compléter et corriger ses acquis : ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus personnel.
La spé Histoire des arts (AL/LSH)
L’ismapp, l’ehess, les écoles de commerce, méthode du commentaire littéraire.
La dissertation de philosophie est peut-être celle qui pose le plus de problèmes de méthode en général. En effet, c’est souvent ce que les professeurs déplorent à chaque correction : les élèves n’ont pas su faire de bonnes problématiques, n’ont pas su analyser les exemples, ont mal construit le plan, mal géré les transitions, etc. Comparée à la dissertation de lettres, d’histoire, de musique ou de théâtre, la dissertation de philosophie demande peut-être un volume moins important de connaissances : la difficulté est pour ainsi dire déportée de la restitution à l’articulation des idées. Si votre plan en histoire comporte un petit vice d’organisation, ce sera beaucoup moins grave qu’en philosophie, où la structure est absolument essentielle : si les idées ne s’enchaînent pas correctement, l’argumentation perd toute sa force. C’est pourquoi travailler la méthodologie en philosophie est extrêmement utile pour faire progresser tes notes, surtout si tu remarques qu’elles ne reflètent pas ta maîtrise du cours. Cela étant posé, rentrons dans le vif du sujet : je commencerai par présenter les principes fondamentaux qui doivent guider la réflexion dissertatoire, avant de te donner des pistes à la fois pour la réflexion au brouillon et la rédaction.
Un élève de l’ENS t’explique tout ce que tu dois savoir sur cette spé.
Après avoir passé deux en prépa littéraire, elle présente l’école qu’elle a intégré sur concours : l’ISMAPP, ou Institut Supérieur du Management Politique et Public.
Emma, en master 1 d’études politiques à l’EHESS après trois ans de prépa littéraire au lycée Fénelon, te présente l’EHESS et les spécificités de cette école entièrement tournée vers la recherche.
Principes fondamentaux de la dissertation de philosophie
Ces principes donnent les grandes lignes de ce qu’on cherche à faire quand on écrit une dissertation de philosophie. En réalité, ils ne sont pas si évidents : vérifier qu’on les applique bien peut aider à dépasser certains blocages.
Orientation vers un problème
C’est le principe le plus important : toute la pensée pendant l’exercice doit être orientée vers la recherche ou la résolution d’un problème. Tant qu’on n’a pas de problème, on en cherche un, et une fois qu’on l’a trouvé, on doit tout faire pour le résoudre. Mais qu’est-ce qu’un problème ? Une question à laquelle on ne sait pas répondre de manière évidente et qui semble nécessiter une réflexion philosophique pour être traitée. J’expliciterai quelques principes pour tenter de trouver un problème intéressant à partir d’un sujet, mais ce qu’il faut bien retenir c’est que ce dernier constitue et conditionne tout l’intérêt de la réflexion : si tu prends une question dont la réponse est trop évidente, le correcteur va s’ennuyer autant que toi ; pire, si tu prends une question non pertinente, tu feras un hors-sujet. Et si tu ne fais pas bien attention à répondre à la question précise posée en introduction et aucune autre, tu risques également un grand manque de cohérence. Trouver et résoudre un bon problème pourrait être résumé par un principe de pertinence : pertinence du questionnement par rapport au sujet et pertinence des thèses avancées par rapport au problème trouvé.
Principe de non évidence
Même si je l’ai déjà mentionné rapidement ci-dessus, il n’est pas inutile de répéter que le caractère non trivial et non évident du problème fait tout le sel de la copie. Si tu poses une question à laquelle n’importe qui répondrait sans hésiter, c’est que cette dernière n’a pas sa place dans la dissertation de philosophie – sauf si tu montres que la réponse qui paraissait très évidente ne l’est pas, et que tu présentes des alternatives ensuite – . Personne ne prendrait le temps d’écouter quelqu’un qui écrit 15 pages pour justifier le fait qu’il faut emporter un parapluie quand le temps se couvre ; Pour évaluer l’évidence de sa question, il suffit de prendre un tout petit peu de recul et se demander si la réponse vient rapidement sans grande réflexion. Je reviendrai bien entendu sur les façons de mettre en pratique ce principe.
Principe de justification
Ce principe a davantage trait à la structure des idées présentées dans la dissertation : ces dernières doivent non seulement être vraies, mais aussi montrer pourquoi elles le sont. En effet, comme les thèses en philosophie sont souvent peu évidentes, il est impossible de se contenter de les affirmer sans argumenter afin de convaincre le lecteur de leur donner du crédit. La justification ne doit surtout pas prendre la forme d’un argument d’autorité, ou se présenter comme une métaphore ou une analogie. Ces deux procédés peuvent être utilisés, mais ils ne sont pas logiquement valides : ils serviront dans ce cas uniquement la bonne intelligibilité du propos (ce qui n’est pas à négliger) sans se substituer à une bonne argumentation. Je reviendrais également sur le principe de justification dans la partie rédaction.
Principe de spécificité
Un des grands écueils qui était le mien dans mes premières dissertations était de traiter le sujet de manière trop générale : je trouvais un problème très large, puis je présentais des idées très abstraites, et enfin je me passais de donner des exemples. Évidemment, le résultat faisait peur à voir : certes, mon développement avait un rapport avec le sujet, mais ce que j’écrivais n’était pas assez précis pour rester intéressant. Quand on ne manipule que des généralités, on finit par penser à côté de ce qui est vraiment problématique et qui demanderait le plus d’attention. C’est pourquoi il faut garder en tête un objectif de spécificité dans la formulation du problème, des thèses, et des exemples. Comment cela se caractérise-t-il concrètement ? Dans le cas du problème, cela revient à se demander si la question qu’on pose n’aurait pu être posée à partir d’un autre sujet de dissertation : si c’est le cas, cela signifie souvent que le problème trouvé est trop large, qui ne capture pas l’essence problématique des concepts spécifiques présentés par le jury. Dans le cas des thèses, cela revient à se demander si leur présentation dans la copie est bien orientée vers la résolution de notre problème et uniquement à celui-ci : si ce n’est pas le cas, c’est sûrement qu’on pourrait les préciser davantage afin d’améliorer l’intelligibilité de notre propos. Il en va de même pour les exemples : ils doivent être orientés vers l’illustration d’une thèse bien spécifique.
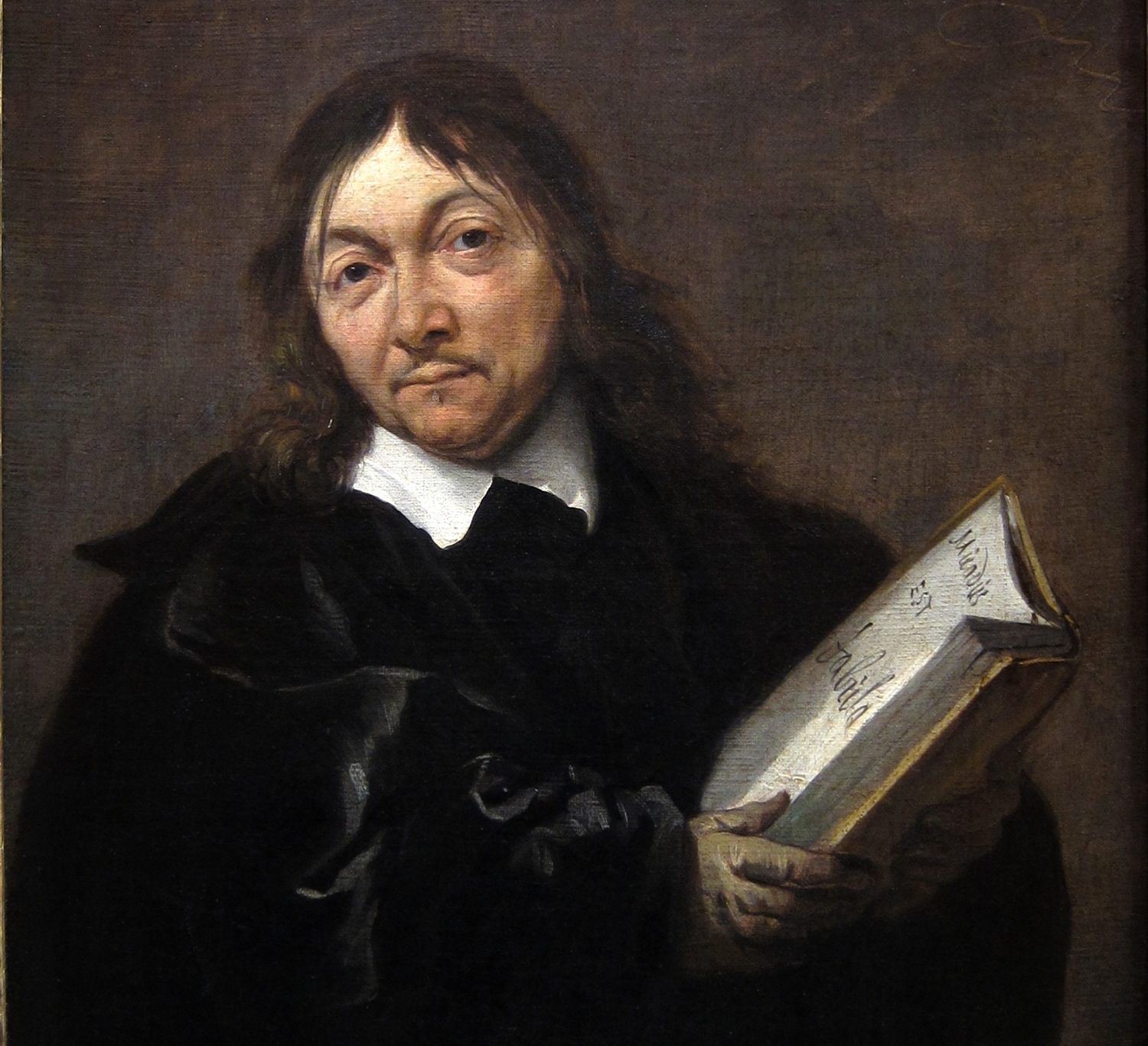
Ce cher René Descartes, si célèbre pour sa méthode (Jan Baptiste Weenix, Portrait de René Descartes , vers 1648). Quel beau front !
Sara, qui a intégré l’EDHEC après une khâgne A/L classique, t’explique comment entrer en école de commerce.
Liste des fiches en Littérature
Cet article liste toutes les fiches de littérature que tu peux nous demander gratuitement, et détaille la manière de les obtenir.
Réfléchir au brouillon :
Quand on est face à sa feuille blanche et aux quelques mots du sujet, il est souvent difficile de savoir par où commencer. Les concepts donnés dans cette section sont ordonnés de manière à constituer des étapes potentielles de réflexion : ces dernières fonctionnent très bien dans mon expérience, mais quelques modifications sont certainement possibles. Le but ici est en effet davantage de rendre compte de la subtilité analytique nécessaire pour préparer le plan de la dissertation. Considérer ces étapes dans leur ensemble permettra notamment de trouver les failles potentielles dans son approche de l’exercice.
Analyse des notions :
Il est important de commencer par analyser les notions, c’est-à-dire les différentes composantes du sujet. Tout d’abord, les notions ne correspondent pas toujours à des mots : en effet, le sujet comporte souvent différentes échelles d’analyse auxquelles il faut prêter attention. Si on prend le sujet « Les merveilles de la technique », il est facile de comprendre que « merveilles » et « technique » sont des notions à analyser. Il est déjà moins facile d’analyser les déterminants « les » et « la ». Et il est encore moins facile de compléter ces analyses par une étude de l’unité lexicale « merveilles de la technique ». Pourtant, cela est nécessaire, car il ne suffit pas de trouver les définitions des merveilles, les définitions de la technique pour ensuite les combiner arbitrairement : l’analyse philosophique prend tout son sens quand on comprend la signification et les implications nouvelles des deux notions quand elles sont associées de la sorte. Bien sûr, tous les sujets ne présentent pas de telles unités lexicales, comme le sujet « l’homme est un loup pour l’homme », ou « l’artificiel ».
Comment donc analyser les notions du sujet après les avoir reconnues ? Un bon point de départ peut être de poser des définitions en se servant non seulement de notre intuition, mais aussi des définitions spécifiques données par des philosophes. On peut même se poser la question : comme X aurait défini cette notion ? Et on doit essayer de faire ça à toutes les échelles décrites précédemment. Explorer la diversité des définitions est une première étape indispensable, qui peut être complétée par une recherche des synonymes des notions, des contraires, et des autres notions présupposées ou découlant logiquement de la première notion. Par exemple, si j’ai un sujet sur « Le méchant », je vais trouver les notions connexes de « gentil », mais aussi de « mauvais », de « mal », ou encore de « violence ». Chaque nouvelle notion tirée des précédente ne doit pas rester isolée dans notre esprit : on se doit d’expliciter le lien qu’elle entretient avec les autres (la « violence » est le mode d’action du « méchant », mais est-ce toujours le cas ?). Cette étude des notions n’est pas gratuite, elle permet de se constituer un fondement logique qui garantit que notre approche se fonde sur les bons éléments logiques. Elle permettra par la suite de savoir ce qui sera pertinent ou non, et ce qui sera spécifique ou non.
Recherche des exemples :
Cette étape est peut-être la plus importante après la problématisation. En effet, elle participe beaucoup au remplissement du critère de pertinence, de spécificité et de non évidence. Les exemples, s’ils illustrent bien les notions présentées dans le sujet, garantiront une analyse concrète et permettront de ne pas se perdre dans une abstraction déconnectée de la réalité. Car la philosophie se doit, pour être intéressante, de se confronter à des problèmes humains, qui ont souvent de nombreux enjeux. Le fait d’être assis pendant six heures devant une table d’examen nous fait perdre parfois le sens du réel qui se trouve derrière les mots du sujet : on voit ces derniers hors de tout contexte, et c’est pour ça qu’on a l’impression qu’ils ne nous parlent pas. Trouver des exemples, c’est donc faire l’effort d’une remise en contexte, c’est-à-dire rechercher la situation que les notions du sujet peuvent décrire. C’est ainsi qu’on ne cherche plus à décrypter le mystère derrière la mention du mot « merveilles » à propos de la technique : il suffit de chercher des exemples de celles-ci ! On pense alors facilement aux fusées, avions, tours gigantesques, ouvrages d’architecture impressionnants, etc. Il suffit de simplement se demander : « à quoi peut renvoyer cette expression ? », « que peut-on appeler par ce nom ? ». Trouver des exemples est aussi un très bon moyen d’obtenir de nouvelles définitions par abstraction. Ces idées seront le terreau fertile de la problématisation ultérieure, alors il est souvent bon de chercher le plus d’exemples possible.
Problématisation
Cette étape est sûrement la plus longue et la plus complexe, c’est pourquoi il ne faut pas passer trop de temps sur les précédentes, d’autant plus que de nouvelles notions, définitions, concepts et exemples nous viendront grâce à la réflexion menée ici. Le but de la problématisation est d’utiliser tous les outils collectés jusque-là pour trouver une contradiction, une zone de flou ou une indétermination qui mènera à la découverte d’un problème. Pour réussir à faire ça, il faut analyser les exemples qu’on a trouvés pour en tirer des idées en rapport avec notre sujet. Si l’intitulé est une question, on peut analyser les exemples pour voir s’ils nous donnent une réponse au sujet. Par exemple, si le sujet est « Qu’est-ce qui est artificiel ? », je peux analyser l’exemple du lac artificiel pour essayer de comprendre pourquoi on qualifie un tel lieu de la sorte. Si le sujet n’est pas une question, il faut essayer de faire la même analyse d’exemple en cherchant les zones d’indétermination, comme je vais le montrer.
Comment donc interroger l’exemple ? D’abord en posant des questions classiques : qu’est-ce que c’est ? (définition), pourquoi ? (justification), dans quel but ? (finalité), quelle est la valeur ?. Ex : Qu’est-ce qu’un lac artificiel ? Pourquoi appelle-t-on les lac artificiels de la sorte ? Dans quel but construit-on des lacs artificiels ? Est-il bien ou mal de faire des lacs artificiels ? Bien sûr, il faut essayer de répondre à chacune d’entre elle. En fonction des cas, certaines de ces interrogations seront plus ou moins facile à satisfaire. L’objectif de la problématisation est justement de garder seulement les questions dont les réponses ne sont pas évidentes à trouver, et poser ensuite de nouvelles questions pour préciser le problème. Ex : Pourquoi est-ce qu’on a l’intuition qu’un lac artificiel est moins bien qu’un vrai lac ? C’est en partant questions simples de départ et en les précisant au fur et à mesure qu’on se heurte à des difficultés : on parvient finalement à un point où plusieurs réponses possibles semblent s’opposer dans notre esprit. Cela veut dire qu’on est très proche du problème. Pour faciliter cette recherche, il faut la mener sur de nombreux exemples, et voir si on tombe sur les mêmes zones d’indétermination et sur les mêmes réponses aux questions posées. Ex : pourquoi dit-on parfois que l’attitude d’une personne est artificielle ?
Une fois qu’on a trouvé une difficulté, on peut utiliser les définitions et notions précédentes pour voir si on peut les articuler à notre réflexion. Il s’agit alors non seulement de voir si on trouve de nouvelles réponses à notre problème, mais aussi si cela ne cela ne crée pas de nouvelles contradictions. L’objectif est ici de chercher à articuler tout ce qu’on a trouvé jusque-là, de poser des définitions sur les exemples et les contradictions : ce n’est pas toujours possible en fonction du temps qui nous reste en épreuve, mais le faire évite les angles morts dans notre réflexion. Par exemple, dans le sujet sur l’artificiel, en analysant plusieurs exemples comme le lac artificiel, le maquillage, je me rends compte que ma réponse à la question de définition n’est pas la même en fonction des exemples, ce qui m’incite à chercher plus loin de ce côté-là.
Une fois qu’on a fait cela, il ne reste plus qu’à formaliser le problème pour le rendre intelligible à notre futur lecteur : pour ce faire, il faut non seulement montrer qu’il y a contradiction, mais aussi justifier que chacune des pistes contradictoires est pertinente. En effet, il ne sert à rien de présenter une fausse contradiction, au sein de laquelle une des thèses serait en réalité indéfendable ou non pertinente. Pour simplifier, on pourrait dire qu’il faut trouver, grâce à notre travail précédent, six choses pour formuler un bon problème. La première est la question à laquelle on ne trouvait pas de réponse évidente. La seconde est une thèse permettant de répondre à cette question (la piste A). La troisième est une thèse différente permettant de répondre également à cette question (la piste B). La quatrième est une justification sommaire de pourquoi la première thèse (A) est défendable (par des exemples ou arguments logiques). La cinquième est une justification sommaire de la seconde thèse (B), du même format que pour la première. Enfin, la dernière chose à trouver est une raison explicite qui fait que les deux thèses sont incompatibles. Si tu parviens à trouver tous ces éléments à la fin de ta problématisation, tu es normalement très bien parti dans l’exercice.
La recherche des idées pour le plan
Ensuite, il faut utiliser les philosophes, les exemples et les définitions pour trouver des arguments soutenant l’une ou l’autre des thèses. La dissertation est en effet un exercice argumentatif : il ne faut pas tant trouver des idées que des justifications, souvent tirées de pensée d’auteurs, ou bien mises au point sur le moment. Les références philosophiques ne sont pas nécessaires dans chaque sous-partie, car le plus important reste la progression et la cohérence de l’argumentation. Un trop grand nombre de référence mène parfois à une forme de patchwork dans lequel il est difficile de trouver une continuité.
Il est intéressant de se dire, comme le répétait mon professeur d’hypokhâgne, qu’on doit être capable d’asservir les philosophes à son discours, c’est-à-dire utiliser leur œuvre et leurs arguments comme bon nous semble au sein de notre argumentation. Cela permet non seulement de ne pas avoir recours à leur autorité, mais aussi d’éviter de faire un hors sujet en voulant respecter arbitrairement le discours de l’auteur, qui n’est pas forcément pertinent dans sa forme originale pour notre sujet. On peut également utiliser des références littéraires et historiques, mais il faut impérativement qu’elles soient mobilisées de manière philosophique : elles doivent toujours être couplées à une argumentation et une analyse philosophique fine des ses implications. Si cette référence sert d’exemple, on se doit d’abstraire ses caractéristiques pour en tirer des conclusions philosophiques.
La recherche des idées est beaucoup plus efficace quand on a conscience des impératifs propres à la construction du plan : on trouve en effet des arguments beaucoup plus pertinents si on sait comment ces derniers s’articuleront ensuite dans la structure de la copie. Cela permet de chercher des idées dans la bonne direction, et de ne pas travailler sur des idées redondantes.
La construction du plan
Une fois qu’on a un problème éloquent, établir un plan n’est pas ce qui est le plus difficile. Dans l’idéal, cette étape se fait conjointement avec la précédente, pour adapter réciproquement la recherche des idées et la construction structurelle de la copie en fonction des impératifs de chacune.
Le plan de dissertation est habituellement en trois parties, qui correspondent en fait à trois thèses. Ce nombre possède une dimension arbitraire : il est très souvent possible de continuer à poser de nouvelles idées après la conclusion, qui pourraient très bien être pertinentes. Cependant, ce rythme ternaire est un impératif de l’exercice, car il constitue la forme minimale d’un développement argumentatif réussi. La dissertation concentre en effet les différentes manières de raisonner face à une première thèse : la confirmation, la réfutation, et enfin la réconciliation ou le dépassement. Ces trois étapes correspondent à différentes capacités intellectuelles. Pour la confirmation, c’est d’abord la création d’une première thèse cohérente, systématique et argumentée. Pour la réfutation, il faut trouver les failles, les contre-exemples ou les limites de la partie précédente, ce qui permet de défendre une position opposée qui doit également être cohérente et argumentée. Le dépassement est souvent autrement plus complexe car il doit faire apparaître l’articulation des deux premières thèses, c’est-à-dire qu’il doit montrer pourquoi il est normal qu’il y ait contradiction apparente, mais indiquer ensuite quelle reformulation conceptuelle permet de coordonner les points de vue contradictoires afin de donner une réponse au problème. Le mot d’ordre de la dernière partie serait ainsi de ne rien laisser de côté : il faut intégrer toutes les idées précédentes, au risque de ne pas être convaincant dans sa conclusion.
Par exemple, sur le sujet « les merveilles de la technique », si je dis en première partie que les merveilles de la technique sont les artefacts qui impressionnent et que l’entendement ne pouvait concevoir avant de les avoir vues, ma deuxième partie pourra attaquer cette position sur plusieurs points. Dans un premier lieu, cette définition n’est pas assez spécifique, car elle ne distingue pas assez précisément les merveilles de la technique des autres merveilles : les arcs-en-ciel sont tout aussi incroyables et pourtant ils ne sont pas fabriqués. De même, dans la référence aux simples capacités de l’entendement, on ne fait pas référence à la valeur méliorative d’une telle qualification : on dira difficilement qu’une bombe nucléaire est une « merveille de la technique », même si sa puissance colossale est difficile à concevoir. Un autre contre-argument pourrait être que la perceptive subjectiviste (référence à l’entendement humain ici) est grandement dépendante du contexte historique et culturel : aujourd’hui, un grand pont ne nous apparaît plus forcément comme une « merveille de la technique », alors que pour certaines civilisations antiques, cela était profondément novateur. Cette première position sur les « merveilles de la technique » semble donc mener à une forme de relativisme du type : tout dépend de chacun, de sa situation et de ses conceptions personnelles, ce qui est philosophiquement insatisfaisant. C’est le rôle de la seconde partie de formuler ces objections (pas nécessairement toutes celles-ci) pour opposer une autre manière de voir les merveilles de la technique qui ne souffre pas les critiques formulées. La troisième partie constituera de la même manière un repérage des failles de la seconde partie, et une résolution grâce à une nouvelle idée, qui ne devra pas reprendre les défauts de la première thèse (sinon ce serait tout bonnement un retour en arrière).
Bien entendu, le plan en philosophie n’est pas unique : il peut fonctionner de plusieurs manières, du moment que la continuité logique et argumentative est conservée. L’opposition entre la thèse et l’antithèse peut être très forte, opposition que le dépassement devra résoudre et articuler. Mais il peut aussi y avoir une première partie donnant une thèse incomplète et insatisfaisante, devant être complétée par la seconde partie, qui peut à nouveau comporter des failles qui seront comblées par la troisième partie. Pour s’assurer que son plan est cohérent, on peut simplement vérifier que chacune des parties forme une unité argumentative, c’est-à-dire qu’elle défend une réponse à la question qui nous semble tenable : cela évite de se perdre dans des justifications bancales.
Un brouillon qui va droit au but
Au brouillon, un plan détaillé finalement construit devrait ressembler à ça : 3 grandes parties dont le titre indique explicitement la réponse au problème défendue ; 3 sous-parties correspondant chacune à un argument en faveur de l’idée de la partie.
Pour chaque sous-partie, je conseillerais de mettre le plus d’informations possible formulées d’une manière très synthétique : cela permet de trouver les bonnes formulations au bon moment plutôt que de reprendre celles de son brouillon, qui ne sont pas forcément pertinentes dans le nouveau contexte de la rédaction de la copie. Les éléments à indiquer sont à mon avis, par ordre de priorité : réponse apportée au problème, définition de chacun des termes du sujet (spécifique à la sous-partie), exemple, référence philosophique, structure sommaire de l’argument.
Voici un exemple pour une sous-partie sur le sujet « A quelles conditions l’art peut-il être subversif ? » (développé pour faire comprendre ce qui se passe dans ma tête) :
- Réponse à la problématique : A condition de révéler des choses qui ne font pas partie de l’espace du sensible, et ainsi déranger la politique qui cherche à maintenir un certain partage du sensible.
- « l’art » : conçu comme un dispositif de communication spécifique, qui s’inscrit dans l’espace du sensible en suivant ses propres lois, et qui a la particularité de pouvoir en modifier la structure/le partage
- « peut-il » : pouvoir structurel de l’art qui vient de sa dimension sensible (visible/audible,etc.) à part dans l’espace du sensible du fait de son autonomie (par rapport aux autres moyens de communications régis par la politique). Aussi possibilité au sens de non nécessité de l’artiste de chercher à modifier le partage du sensible (conformisme).
- « être subversif » : s’attaquer aux normes spécifiques qui régissent l’espace du sensible, déranger la politique qui souhaite maintenir l’ordre qu’elle y a établi
- « Conditions » : les conditions de la subversivité sont le choix des thématiques à représenter, le choix de l’art de traiter de problématiques déjà vues, ou alors de nouvelles actuellement dissimulées.
- Référence : Jacques Rancière, Le partage du sensible
- Exemple : L’œuvre d’art Colored Vases de Ai Weiwei : alerter sur la destruction de l’ancien savoir-faire de l’artisanat chinois
- On admet l’existence d’un espace du sensible (médias, communications, tout ce qu’on voit et ce dont en entend parler en général), régulé par la politique
- On admet l’existence de zones d’ombres de cet espace, et d’un partage qui met certains thèmes/sujets de côté car cela arrange l’ordre établi.
- On admet le statut spécifique et autonome de l’art dans cet espace.
- L’art peut être subversif si l’artiste fait le choix de thématiques qui ne respectent pas le partage actuel du sensible.
Le même exemple (en mots clés pour montrer ce que j’écris vraiment au brouillon en conditions réelles) :
- RP : à condition révéler choses hors de l’espace du sensible, déranger politique et partage existant
- « l’art » : dispositif de com spécifique : dans espace du sensible, autonome, peut modifier le partage
- « peut-il » : pouvoir structurel de l’art : dimension sensible, autonomie (possibilité d’indépendance politique). Aussi « peut-il » = choix ou non du conformisme au partage
- « être subversif » : attaquer construction actuelle du partage du sensible => déranger ordre établi
- « conditions » : choix de thématiques cachées, problématiques, scandaleuses pour la politique
- Réf : Jacques Rancière, Le partage du sensible
- Ex : Colored Vases de Ai Weiwei, alerter sur destruction ancien artisanat chinois
- Espace du sensible, régulation par la politique
- Zones d’ombres, partage maintenu entre différentes thématiques
- Statut spécifique de l’art
- Subversif si certain choix de thématiques
La recherche des enjeux du problème
Cette étape n’est pas la plus cruciale en pratique, mais elle peut, si elle est bien menée, apporter beaucoup de profondeur au devoir que tu rédiges. Trouver les enjeux d’un problème, c’est simplement répondre à la question : « Pourquoi résoudre ce problème est-il important ? ». Ce qui veut parfois dire se poser aussi les questions suivantes afin de trouver plus d’idées : « Qu’est-ce que cela change dans le monde si je réponds X ou Y à ce problème ? », « Quelles seraient les conséquences si on ne parvenait pas à trouver de réponse à ce problème ? », « Est-ce que la réponse à ce problème pourra apporter des solutions ou des pistes de solutions à d’autres problèmes plus ou moins importants ? ».
Ces enjeux te permettront de donner plus d’importance au travail que tu fais sans le considérer comme une pure spéculation intellectuelle, mais bien une réflexion sur des choses plus ou moins concrètes.
Une fois le brouillon terminé, la rédaction paraît plus simple : cependant, comme c’est le moment où notre discours se met en forme, c’est là qu’apparaissent souvent les failles de notre raisonnement au brouillon, que l’on pourra corriger en étant attentif à la cohérence et au suivi des idées alors qu’on est en train d’écrire.
L’introduction
L’introduction est le moment de la présentation du problème et des enjeux de la copie : c’est à la fois la première impression et le reflet le plus concis de ton travail au brouillon. C’est pourquoi il est mieux de privilégier l’efficacité dans la rédaction, de manière à montrer que la direction du devoir est connue et maîtrisée. Délayer, lister ou faire un panorama des exemples en rapport avec le sujet est donc inutile : toute la structure de l’introduction doit mener et ramener au problème.
Premier paragraphe : Accroche, présentation des notions et introduction du sujet.
Beaucoup de choses sont possibles pour faire une bonne accroche : citations, exemples, petites histoires, etc. Cependant, l’accroche se doit toujours d’être courte et pertinente, sinon elle perdra l’attention du lecteur qu’elle avait en premier lieu capturée. Pour être sûr d’être parfaitement dans le sujet, je conseillerais de trouver un exemple qui découle des enjeux trouvés préalablement. De cette manière, l’accroche sera directement tournée vers le point nodal de l’introduction : le problème philosophique.
Dans le même paragraphe, il est intéressant de présenter et de définir les notions principales du sujet. Le but de cette étape n’est pas du tout de lister les entrées du dictionnaire, mais au contraire de montrer au lecteur qu’on a déjà fait un travail préalable de sélection des définitions qui sont pertinentes pour notre sujet, sans l’embarrasser de celles qui ne fonctionneraient pas dans ce contexte. Par exemple, pour le sujet « Le sens du beau », on peut dire en introduction qu’on peut définir le sens comme une faculté de percevoir, mais aussi comme une signification, en décidant par exemple d’exclure la définition comme direction qui pourrait paraître moins intéressante à analyser ici. La présentation des notions est donc avant une mise en relation de celles-ci dans le contexte du sujet pour montrer la direction que prendra le développement.
Deuxième paragraphe : Présentation du problème sous sa forme rigoureuse, présentation des enjeux au problème
Le deuxième paragraphe permet d’introduire le problème. Il me semble qu’il est intéressant de faire figurer dans cette présentation en premier lieu la première thèse (A), avec sa justification, sommaire pour le moment mais convaincante (a). Ensuite, on peut présenter la seconde thèse qui semble contradictoire avec la première (B), avec sa justification de manière analogue (b). Eventuellement, pour ajouter de la force au propos et souligner la contradiction, on peut expliciter ce qui fait que les deux thèses semblent contradictoires (C). Enfin, il suffit de poser la ou les questions qui découlent de ce paradoxe que l’on vient de formuler (D), qui constitue véritablement la problématique du devoir.
Un problème peut être parfaitement pensé par le rédacteur, mais s’il n’est pas formulé correctement dans l’introduction, le correcteur peut facilement croire que ce n’est pas le cas. C’est pourquoi les étapes que j’ai décrites précédemment me semblent être les plus importantes : on peut ajouter des petits exemples, d’autres petites justifications, mais il ne peut à mon avis manquer aucun élément présenté ci-dessus. Si on oublie les petites justification (a et b), le lecteur pourra avoir l’impression que les deux thèses sont posées arbitrairement, sans fondement. Pour éviter cela, il suffit de mentionner des exemples ou des raisons intuitives qui font qu’on peut adhérer à chacune des thèses : dans tous les cas, cette argumentation sera développée dans la copie. Si on ne mentionne pas les thèses contradictoires, le lecteur peut avoir l’impression que la question posée à la fin n’est motivée par rien, que sa réponse est évidente, ou encore ne pas comprendre l’origine de sa formulation. Pour éviter cela, la mention d’un minimum de deux positions en apparence opposées est primordiale.
Ensuite, il est intéressant de présenter, au sein du même paragraphe, les enjeux de la réponse au problème, ce qui motivera d’autant plus le correcteur à poursuivre sa lecture, sachant que tu t’efforceras d’être concret et intéressant.
Troisième paragraphe : annonce de plan, plus ou moins elliptique
L’annonce de plan divise souvent les professeurs : certains affirment qu’il faut laisser du suspense dans le déroulement de l’argumentation, alors que d’autres affirment qu’il faut annoncer ce qu’on va faire comme dans n’importe quelle autre discipline. Les deux sont donc à mon avis possible, à voir avec le professeur. Dans le cas d’une annonce de plan complète, il peut être intéressant, au lieu de simplement mentionner les idées défendues par chaque partie, de présenter les questions qui résument l’attitude argumentative pour chaque étape du développement. Par exemple, au lieu d’écrire : « Dans une première partie, nous verrons en quoi les merveilles de la techniques peuvent être conçues comme les artefacts qui dépassent l’entendement humain », il peut être plus intéressant de dire « Dans une première partie, nous commencerons par nous demander ce qui justifie l’émerveillement humain face à certains objets techniques ». Cela permet à la fois de montrer l’orientation de la recherche, mais aussi de laisser un peu de mystère sans pour autant laisser l’avenir inconnu.
Le développement : enchaîner les parties, rédiger un paragraphe argumentatif
L’enchaînement des parties a été, dans son aspect logique, déjà couvert par la sous-partie « La construction du plan » ; dans son aspect rédactionnel, il reste à faire un point sur les transitions. L’usage de ces dernières par les élèves est en effet souvent critiqué par les professeurs. La transition ne doit pas être artificielle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas constituer un petit morceau de texte « tampon » qui servirait à aérer la disposition des paragraphes sur la copie. Idéalement, la transition amorce la partie suivante en commençant à soulever les faiblesses de la précédente. C’est elle qui justifie la poursuite de l’argumentation car, en philosophie, si on ne trouve pas de contre argument ou de limite à la thèse précédente, il n’y a pas de raison de continuer à discourir. Il y a donc une nécessité constante d’articulation du discours et de ses différentes étapes dans la dissertation ; mais on peut très bien la garantir sans avoir recours à la transition. En effet, il suffit simplement de commencer la partie suivante par la remise en question de la précédente, ce que la transition, à cause de son très petit volume textuel, n’était pas capable de faire complètement. En pratique donc, il vaut mieux éviter de faire des transitions si on n’est pas capable de les rendre pertinentes et véritablement utiles à la progression argumentative du discours.
La rédaction d’un paragraphe argumentatif, deuxième enjeu clé du développement, peut être facilitée en gardant quelques principes en tête. En premier lieu, un paragraphe correspond à un argument, c’est-à-dire des prémisses et une conclusion. Le but de la rédaction est de rendre le plus clair possible la structure logique qui lie ces différents éléments, pour que le lecteur ne peine pas à comprendre le cheminement. Les exemples et les métaphores peuvent aider à l’intelligibilité du propos, mais ils ne doivent pas remplacer l’argumentation rigoureuse. Ensuite, comme je l’ai dit plus haut, il est toujours très positif d’utiliser les auteurs, mais cela doit être pour reconstruire leur argumentation de manière à ce que celui qui ne connaît pas sa pensée soit en mesure de comprendre. Bien entendu, ce ne sera pas le cas du correcteur, mais ce dernier jugera quand même ta capacité à clarifier et exposer pertinemment des idées déjà formulées auparavant. Finalement, pour garantir une argumentation efficace, il faut bien justifier chaque prémisse, et chaque déduction : c’est ce qui donnera toute sa force persuasive à ta copie.
Mais le plus important reste avant tout de préciser et clarifier les définitions qui sont posées et varient entre chaque sous-partie : c’est ce cheminement dans les définitions qui fait tout l’intérêt de la dissertation philosophique. On peut faire cela de manière très explicite, en citant les mots du sujet et en montrant quel est leur sens dans le contexte précis de notre argument. Sans cette démarche, on reste dans le flou définitionnel, et la pensée n’avance pas.
La conclusion
Idéalement, la conclusion ne se contente pas de répéter toutes les étapes parcourues pendant la copie, mais parvient à faire une synthèse organisée de tout ce qu’il faut retenir de la démarche accomplie, tout en répondant à la question posée en introduction. Pour ce faire, il faut de trouver dans chaque partie ce qui a subsisté à la réfutation ultérieure, à savoir les points structurants de la réponse à la problématique. En d’autres mots, il faut considérer chaque étape de son argumentation, et se demander ce qu’on peut garder d’elle à la lumière de la conclusion apportée dans la dernière partie : on reprend ainsi tous les points de la première et de la seconde partie qui vont dans le sens de la troisième et on rappelle ce qui nous a permis de dépasser les contradictions. On n’ajoute aucune information à celles déjà présentes dans la copie, mais on crée une synthèse sélective qui insiste sur les aspects les plus importants du développement.
Nuances importantes sur la méthode
Parler de méthode est une entreprise extrêmement ambitieuse, surtout dans le cadre d’une discipline intellectuelle comme la philosophie. Cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, parce que personne n’est capable de comprendre totalement comment lui viennent ses propres idées, et de savoir quels les mécanismes précis guident son raisonnement. Une méthode donnée ne fonctionnera jamais pour tout le monde, car tout dépend des acquis précédents et des habitudes d’introspection. L’idée ici est seulement pour moi d’essayer de vulgariser le mieux possible la manière dont j’ai réussi à progresser en philosophie en mentionnant tout ce qui m’a aidé.
Ensuite et surtout, parce que notre manière d’agir ne peut se résumer à une suite d’instructions. Il y a toujours une grande part d’intuition même dans nos projets les plus réglés. La méthode est seulement une tentative de figer la durée de nos actions mentales : il est impossible de le faire totalement et précisément. Tous les conseils de cet article sont donc des guides, des principes qu’il faut remplir par sa propre intuition pour se les approprier.
Enfin, il est finalement certain que beaucoup d’idées n’arrivent pas par méthode, mais apparemment par pur hasard, sans qu’on les ait cherchées. A mon avis, ce n’est pas parce qu’une méthode peut être utile qu’il faut en faire la panacée : il faut se prémunir de tout réductionnisme et embrasser la part d’inexpliqué dans la pensée. C’est donc selon moi un équilibre fragile entre règles déterminées et intuition qu’on peut entretenir pour développer tout le potentiel de la réflexion philosophique.
L’article en PDF
La fiche mémo pdf.
- Accessible aux A/L
- Accessible aux B/L
- Accessibles aux LSH
- Méthodes d'apprentissage
La spé Lettres modernes pour Lyon (LSH)
La méthode de la composition d’histoire, la l3 d’histoire, reprendre sa copie, reprendre ses erreurs, les formes de l’emploi du temps, la spé anglais pour ulm (a/l), la spé lettres modernes pour ulm (a/l), les sites généraux utiles, l’ens d’ulm, la spé théâtre pour ulm et lyon (a/l et lsh), pourquoi la méthode , voir plus loin que les écrits : conseils de révisions pour les oraux, court terme, moyen terme, long terme, avoir un groupe de travail, du bon usage des flashcards, la l3 lap à assas (droit), constituer un exemplier.
- Introduction
- Table des matières
- Cours de Philosophie
- Lecture suivie
- Bibliographie
Cours de philosophie

Méthodologie de la dissertation philosophique.
28 Sep 2007 par Simone MANON
Dissertation signifie discussion, dispute . Elle est le moment où un élève est convoqué à un authentique effort de la pensée. Elle est la philosophie en acte.
Or qu’est-ce que penser ? Ce n’est jamais opiner c’est-à-dire affirmer sans examen. « Penser, disait Alain, consiste essentiellement à savoir ce que l’on dit et si ce que l’on dit est vrai ».
C’est toujours réfléchir , faire retour sur des énoncés afin d’en interroger le sens, la valeur de vérité s’il s’agit d’un énoncé théorique (doxique ou scientifique), la valeur morale s’il s’agit d’une affirmation morale et le fondement . Cette démarche consiste donc à s’arrêter sur des idées (« Penser c’est s’arrêter ») pour expliciter leur substance, saisir leurs présupposés et leurs enjeux, leurs limites et par suite procéder à leur dépassement par des idées plus pertinentes. Penser consiste à découvrir que rien ne va de soi et que tant que l’on n’a pas fait subir à une idée l’épreuve du feu, elle demeure un impensé . L’épreuve du feu c’est le débat contradictoire. La dissertation suppose donc le sens dialectique .
La philosophie est, en effet, le champ du problématique. S’il était possible qu’il y ait, dans les réponses possibles à une question, d’un côté la pure intelligence et de l’autre la pure sottise, l’examen serait vite fait. Mais voilà, les choses ne se passent pas ainsi. Le réel est ambigu, parfois proprement énigmatique . Penser c’est avoir le sens des problèmes , la conscience des complexités et des ambiguïtés.
La dissertation requiert :
Une méthode..
Une méthode est un ensemble de règles auxquelles il convient de conformer la conduite de sa réflexion. Quel que soit le sujet à traiter, ces règles doivent être respectées. Ce respect ne préjuge pas de la qualité de votre réflexion car celle-ci est aussi tributaire de la richesse des contenus, mais il lui confère sa validité formelle. Ce n’est pas suffisant mais c’est nécessaire.
Une culture.
On ne réfléchit pas dans le vide. La culture est ce qui a été acquis soit par l’expérience soit par l’école, les lectures etc. Plus elle est riche, plus l’horizon s’élargit. Il est vain de croire que l’on peut faire la lumière sur une question sans connaissances. D’où la nécessité des cours. La plupart du temps, on ne peut pas traiter philosophiquement un sujet sans culture philosophique. On entend par là, la compréhension des concepts dans leur précision et leur rigueur ; une sensibilisation aux problématiques que les grands maîtres ont élucidées chacun à leur manière. Mais si elle nourrit la réflexion, la culture ne saurait se substituer à elle. Une dissertation ne consiste jamais à énumérer des thèses d’auteurs, à réciter un cours, à juxtaposer des propos généraux, même fort savants. Elle consiste à affronter un problème dans une démarche progressive afin d’arriver par un cheminement cohérent à une conclusion. Ce qui importe ce n’est pas seulement le contenu de la conclusion, c’est la manière dont vous y arrivez. (Souvenez-vous que ce n’est pas le contenu d’un énoncé qui fait son caractère doxique , c’est que celui qui l’énonce ne peut pas le fonder sur un ordre de raisons. Inutile donc de masquer l’indigence d’un acte de pensée derrière l’autorité d’une référence).
Une puissance de réflexion.
Il faut bien avouer que cette puissance n’est pas également répartie. Par exemple, les professeurs qui ne sont que des élèves plus expérimentés que ceux qui leur sont confiés n’ont pas la puissance de réflexion des maîtres qui ne sont pas à leur tour des élèves (les grands esprits. Cf. texte de Léo Strauss ).
Chacun doit faire du mieux qu’il peut. A ce niveau il n’y a pas de recettes, sinon nous serions tous de grands penseurs.
Les règles de la méthode.
1) comprendre l’énoncé : la règle de l’introduction. .
En classe terminale, un énoncé de dissertation est formulé sous forme interrogative. C’est donc une question .
Ex : A-t-on le choix d’être libre ?
Il ne suffit pas de lire la question pour saisir le ou les problèmes qu’elle pose. C’est la différence avec les mathématiques. En mathématiques on formule les données du problème dont vous avez à trouver la solution. Pas en philosophie. C’est à vous de dégager ce que l’on appelle la problématique, en analysant avec précision l’énoncé.
Une problématique n’est pas un problème, c’est un ensemble de problèmes s’articulant d’une certaine manière et précisant la question.
Il n’y pas trente six manières d’expliciter la problématique d’un sujet. Seule l’analyse rigoureuse des termes de l’énoncé le permet.
Ex : Avoir le choix : capacité de se déterminer à une possibilité ou à une autre. L’homme se sent libre lorsqu’il peut choisir. A l’inverse s’il ne disposait d’aucune capacité de choix et si sa conduite était l’effet nécessaire de certaines conditions, on dirait qu’il est déterminé.
Cette analyse conceptuelle permet de formuler les problèmes que le développement devra affronter et d’énoncer les termes de véritables alternatives.
PB : Est-on libre (= avoir le choix) d’être libre ou bien est-on déterminé à être libre ?
PB : Mais, les notions de déterminisme et de liberté étant antinomiques, si l’on est déterminé à être libre, il est absurde de parler de liberté. Pourquoi est-il contradictoire de dire que l’on est déterminé à être libre ? (Questions annonçant la thèse : Soit on est libre, et donc libre d’être libre, soit on est déterminé et il est absurde de parler de liberté).
PB : Pour autant (renversement dialectique) qu’il faille renoncer à une telle absurdité revient-il à affirmer qu’on est libre d’être libre ? Car si on est libre d’être libre cela signifie qu’on a la possibilité de choisir de ne pas l’être. Or choisir de ne pas être libre n’est-ce pas encore être libre ? Il s’ensuit que l’on n’est pas libre d’être libre, on est condamné à l’être soit que l’on consente à la servitude soit que l’on décide de se libérer. (Question annonçant l’ antithèse : « l’homme est condamné à être libre » : thèse sartrienne).
Nul ne pouvant échapper sans mauvaise foi à sa condition, on est responsable d’actualiser sa liberté foncière ou de la fuir. Mais ( Dépassement ) pour absolue qu’elle soit, la liberté est une liberté en situation, en butte à de multiples obstacles qui, certes, ne sont que par elle mais qui la limitent et lui donnent parfois des doutes sur elle-même. N’est-ce pas parce que la liberté est le propre de l’existant qu’elle est angoissante et que l’homme peut être enclin à fuir ses responsabilités? N’est-ce pas parce qu’elle prend sens essentiellement comme projet de libération que certains préfèrent croire qu’ils n’ont pas le choix et qu’ils sont déterminés ?
Vous voyez sur cet exemple que les problèmes ne sont pas posés arbitrairement. Ils procèdent des analyses conceptuelles , ils s’enchaînent avec ordre.
Vous voyez aussi que le caractère dialectique de la démarche exige la capacité de vous faire à vous-même les objections qu’un autre sujet pensant pourrait vous faire. C’est pourquoi Hannah Arendt disait que dans l’activité pensante on est deux ou plusieurs en un. La pensée a une essence dialogique. Platon disait que « la pensée est le dialogue de l’âme avec elle-même ».
Ainsi, les difficultés de la thèse (réponse à la première question) suscitent la formulation de nouveaux problèmes et débouchent sur l’énoncé de l’antithèse. Celle-ci n’est donc pas la négation de la thèse, elle est son dépassement par une idée plus pertinente. La troisième partie n’est pas une synthèse du type : dans I et II il y a du bon et du mauvais. La réflexion philosophique est incompatible avec le relativisme du type : toutes les opinions se valent, on peut soutenir une chose et son contraire. La troisième partie articule dans une cohérence ultime les deux premières parties. Elle réalise un dernier dépassement.
Danger : Ce qu’il faut absolument éviter à ce niveau c’est de mal engager la réflexion. Mal problématiser le sujet revient à poser des faux problèmes, ou des questions hors sujet.
Ex : Une question hors sujet serait ici : L’homme est-il libre ou non ? Car le sujet présuppose la liberté et la question est de savoir si l’on est libre d’être libre ou non.
Toute la problématique s’articule autour de l’expression : « choisit-on ». Ceux qui n’ont pas la prudence de s’arrêter sur le concept de choix passent à côté de ce qui est en jeu dans cet énoncé.
Le respect de cette première règle permet de rédiger l’introduction. Comme le mot l’indique, elle introduit le développement. Sa fonction est d’expliciter la problématique de l’énoncé afin d’engager la réflexion dans la bonne voie. Il n’est pas difficile de comprendre que des problèmes non identifiés ne peuvent pas être traités. Introduire est donc l’opération déterminante de la dissertation. Elle demande de la prudence. Il faut éviter la précipitation (= aller trop vite) et la prévention (= préjugé. Nécessité d’une ascèse des idées toutes faites).
2) Construire une argumentation cohérente, approfondie et éclairante : les règles du développement.
.
Il implique une idée directrice. Une dissertation est un drame où quelque chose se joue. Dans l’exemple proposé, l’idée directrice est l’idée que l’homme peut tout choisir sauf le fait qu’il dispose de cette capacité. Il peut choisir d’accepter son sexe ou de le refuser, de consentir à sa situation sociale ou de vouloir la changer, de donner un sens à son existence ou de ne pas lui en donner etc. Bref, il y aurait mauvaise foi à se prétendre déterminé. L’énoncé invite à méditer le sens de la liberté et vous devez faire la lumière sur la question. Celle-ci doit être obsessionnellement présente du début à la fin de votre réflexion. Il fait donc éviter les digressions inutiles, les propos non centrés sur la question. L’idée directrice est la colonne vertébrale d’un devoir.
Il implique l’exploitation de références. Des références philosophiques mais pas seulement. La littérature, l’histoire, des données informatives précises tirées de l’observation de l’expérience peuvent avec intérêt être mobilisées. Le cours de philosophie est essentiel. Dans l’exemple proposé, le sujet est intraitable par un candidat ne disposant pas d’un solide cours sur la notion de liberté. Qui n’a aucune idée de l’antinomie :déterminisme-liberté ; de la thèse sartrienne est voué à l’échec. Le premier travail consiste donc avec l’inventaire conceptuel à trouver les références pertinentes pour le traitement du sujet. (Attention : Souvenez-vous de ce qui a été dit précédemment. Mobiliser une culture ne signifie pas se dispenser de penser, en récitant ce que l’on sait. Une dissertation est comparable à un banquet. Des convives sont invités mais c’est le maître de la cérémonie qui leur confère leur place. Une référence n’arrive donc pas comme un cheveu sur la soupe. Elle a sa raison d’être dans le cheminement d’une réflexion personnelle qui s’approprie un auteur pour faire la lumière sur une question).
Il implique un souci d’exemplification. Il ne faut pas confondre illustration et argumentation . Un fait ne peut jamais établir la validité d’une affirmation, le raisonnement seul est habilité à cette tâche. Néanmoins si l’exemple ne doit jamais se substituer à l’argument, il est nécessaire, d’une part pour ôter à la réflexion son caractère abstrait, d’autre part pour lui éviter de se perdre dans des spéculations oiseuses. Philosopher consiste à penser le réel et non, à la manière du rêveur ou de l’idéologue à se complaire dans des chimères.
Il implique un plan en trois parties . Thèse-antithèse-dépassement. L’introduction a formulé les problèmes que va affronter chacune des parties. Dans l’exemple proposé, la première partie examine l’antinomie liberté-déterminisme afin d’établir que si la liberté a un sens, on ne peut pas dire que l’on est déterminé à être libre. La deuxième partie reprend la question en examinant si dire que l’on est libre signifie que l’on peut choisir de ne pas l’être. L’analyse conduit à comprendre la thèse sartrienne : l’homme est condamné à être libre. La troisième opère le dépassement : dire que l’homme est libre ce n’est pas nier les multiples déterminations dans lesquelles la liberté peut être tentée de s’engluer. Thème sartrien ou existentialiste de l’être-en-situation.
Il implique une rédaction soignée des transitions. Le passage d’une partie à l’autre exige de ramasser en quelques lignes les résultats d’analyse du premier développement et d’introduire de manière cohérente le nouveau développement de la réflexion. D’où la nécessité d’avoir toujours présente à l’esprit l’idée directrice. Au fond, à la fin de chaque partie on fait le bilan. Le propos est du type : nous avons compris que… Il s’ensuit que… En dégageant les conséquences on voit apparaître de nouvelles difficultés. La réflexion est conduite à rebondir avec un propos du type : mais, ne peut-on pas dire que… ?
Au terme de chacune des parties il faut recommencer l’opération.
Comme la réflexion progresse dans l’élucidation de la question, il est bon de pointer les progrès. Un candidat qui maîtrise le mouvement de sa pensée devient capable de dire : « nous ne savions pas alors que… nous voyons à présent que… »
La plus grande difficulté est, à mes yeux, de trouver l’angle permettant d’opérer le dépassement final. L’exercice requiert une hauteur de vue auquel il n’est pas toujours possible à un élève de s’élever. (Cf. : toujours cette idée d’ascension que Platon décrit dans l’allégorie de la caverne. Régression vers le principe rendant intelligibles et cohérentes les deux premières analyses).
NB : On peut pardonner à un élève de ne pas réussir cette opération, on ne lui pardonnera jamais de ne pas traiter dialectiquement la question, c’est-à-dire de ne pas bâtir une solide première partie et une solide deuxième partie.
3) Expliciter les résultats de la réflexion : la règle de la conclusion.
La conclusion doit être concise, claire et précise. L’élève doit se dire : « on nous avait posé telle question ; au terme de la réflexion je suis en mesure de répondre de cette manière ». Il faut donc formuler la réponse avec fermeté. Sont exclus les propos vagues du type : « ça dépend de… ».
Marqueurs: activité réflexive et critique , analyse , argumentation , cohérence , dialectique , doxa , opinion , préjugé
Posté dans Méthodologie
197 Réponses à “Méthodologie de la dissertation philosophique.”
Merci d’avoir répondu. C’est bien la signification que j’avais cru comprendre mais alors il faudrait la formuler ainsi: je vous suis reconnaissant (ou reconnaissante) de l’aide que vous apportez aux élèves. Pour ce qui est de votre question: -D’abord il est absolument nécessaire d’améliorer votre expression. Ex: J’apprécie sa bonne volonté, je me suis mal exprimé, toutes mes excuses, préoccupation, l’ordre des grandes parties, etc. – L’introduction n’a pas pour fonction de recopier le sujet mais d’élaborer la problématique. Ce qui nécessairement conduit, par la formulation des problèmes impliqués dans la question, à annoncer la thèse, l’antithèse et le dépassement. Il y a de nombreuses dissertations rédigées sur ce blog. Voyez sur un exemple ce que signifie: élaborer la problématique.Dans cet article ( https://www.philolog.fr/peut-on-forcer-quelquun-a-etre-libre/ ), je donne un exemple d’introduction qui est très détaillée car je n’écris pas le développement, (la vôtre doit être beaucoup plus courte), mais elle a le mérite de rendre explicite le travail d’élaboration de la problématique. Bien à vous.
Bonjour madame merci pour votre éclaircissement en fait je veux connaître comment structuré moné devoir je comprend que le sujet ne fait pas parti du sujet mais avant lintroduction on doit les recopier? J’aimerai connaître les partis obligatoire de l’introduction et lordre de rédaction.merci encore pour votre aide. j’ai un problème de clavier donc veuillez m’exuser pour certaines phrases mal rédiger. Dans la deuxième ligne je veux dire ne fait pas parti de l’introduction.
Bonjour Il me semble qu’en étudiant divers exemples de dissertations sur ce blog, vous avez la réponse à vos questions. Rien de plus éclairant que l’application des règles sur des questions précises. Voyez: https://www.philolog.fr/lenfance-est-elle-ce-qui-doit-etre-surmonte/ ainsi que l’exemple d’introduction proposé dans ma réponse précédente. Bien à vous.
Bonjour, Tout d’abord je tiens à vous remercier car ce site répond vraiment aux attentes qu’on pourrai se poser sur la philosophie (méthodologie, cours…), c’est super bien expliqué. J’aimerai savoir si, comme pour le français, on doit annoncer clairement les parties que l’on va traiter dans l’argumentation après l’introduction (par ex : Une première partie traitera de …. tandis qu’une seconde aura pour objet …) ou, à l’inverse, si elles doivent être « sous-entendues » dans l’intro. Merci d’avance !
Bonjour Dans la mesure où vous élaborez correctement la problématique du sujet, les différentes parties sont annoncées par les connecteurs logiques appropriés. Premier point: introduction de la thèse. Deuxième point: renversement dialectique: Mais, pourtant etc. Troisième point: dépassement de l’apparente contradiction de la thèse et de l’antithèse par l’annonce du point de vue permettant de les justifier l’une et l’autre. Il s’ensuit qu’il n’est pas utile de vous répéter en disant : dans la première partie…. On doit l’avoir compris par la manière dont vous avez posé les problèmes. Voyez sur un exemple de dissertation l’application de la règle. Ouvrez la rubrique dissertation, vous aurez l’embarras du choix. Par exemple: https://www.philolog.fr/penser-par-soi-seul-est-ce-penser-librement/ Bien à vous.
Merci pour votre réponse, en effet l’exemple sur la citation d’Alain met clairement en évidence les différentes parties qui vont être traitées sans qu’elles soient pour autant annoncées comme dans une dissertation de français. Cordialement.
bonjour Mme MANON je voudrais vous remerciez pour cet éclaircissement.je mettrai en application la methode sur un sujet et je vais vous envoyez l’introduction que j’aurai fait.
Bonjour N’envoyez pas votre introduction. Ce site n’est pas un site d’aide aux devoirs et j’ai pour principe de ne pas intervenir dans le travail des élèves. Vous n’avez pas tenu compte de mes indications quant à l’incorrection de votre expression. De toute évidence vous confondez l’infinitif du verbe avec sa conjugaison à la 2ème personne du pluriel. Ex: vous remercier. Ici le verbe est à l’infinif, donc il s’écrit avec er, non ez. Dans votre précédent message, j’avais corrigé vos fautes. Bien à vous.
c’est compris madame mais j’ai une préoccupation : un sujet peut-il avoir plusieurs dépassements?
Bonjour madame,
Je suis actuellement en train de préparer le concours d’entrée à science po, votre site est d’une grande d’aide en ce qui concerne le thème de la culture.
Ma question est donc la suivante : la méthode de la dissertation de culture générale du concours d’entrée en première année à science po est-elle la même que celle de la dissertation de philosophie ?
Cordialement,
Bonjour N’étant pas correctrice ou professeur à sciences po je ne peux pas répondre à votre question. Il faut consulter le texte officiel définissant les règles précises de l’épreuve. Bien à vous.
J’ai lu votre chapitre sur la méthodologie de la dissertation, dans lequel vous examinez le sujet « A-t-on le choix d’être libre ? ».
Ne faudrait-il pas d’abord définir ce qu’on appelle « être libre » ? Il me semble qu’on est libre, non pas d’une manière générale, mais par rapport à une décision particulière. Surtout, on est plus ou moins libre et, pour le faire comprendre clairement, je prends un exemple.
Supposons que je juge absurdes les exigences de l’épreuve de philosophie du baccalauréat, et cette nécessité de rédiger une introduction, une thèse, une antithèse et une synthèse. Car, après tout, cela n’est qu’un rite de l’épreuve et je pourrais douter que Hobbes, Descartes, Spinoza, etc. eussent jamais présenté ainsi leurs idées et, me dire que, s’ils y avaient été contraints, ils eussent été recalés à l’examen. J’ai donc le choix de refuser, ou non, de me soumettre aux exigences de l’épreuve. Maintenant, dans quelle mesure suis-je libre de le faire ? Comme le correcteur n’aura que peu de temps à consacrer à ma copie, il se bornera, sans doute, à constater mon insoumission et, en conséquence, sans pousser plus loin, m’attribuera la note zéro. La liberté de ma décision est donc limitée (mais pas nulle, contrairement à ma note prévisible), car je peux envisager de me « rattraper » ailleurs.
En résumé, il me semble que, en général, on n’est pas totalement libre de prendre telle ou telle décision, ou entièrement contraint à décider dans tel ou tel sens, mais qu’on est amené à considérer le degré de contrainte auquel on est soumis.
Comment, dans ces conditions, doit-on interpréter le sujet « A-t-on le choix d’être libre » ?
Respectueusement
Bonjour Vous remarquerez que seuls les problèmes sont énoncés, ils ne sont pas traités et il va de soi qu’à chaque étage de l’analyse, l’enjeu de l’exercice consiste à préciser le sens de l’idée de liberté. La question engage une réflexion d’ordre métaphysique, puisqu’elle enveloppe le débat: liberté ou déterminisme. Vos remarques sont rencontrées dans la troisième partie qui appelle un développement sur l’idée de liberté en situation. https://www.philolog.fr/etre-en-situation-dans-le-monde-sartre/ Soyez attentif aux réponses à Flavien dans les commentaires qui suivent ce cours. Mais il est bien clair que tout choix implique d’en assumer les conséquences. Il n’y a pas de sens à dire que vous êtes contraint à accepter les règles d’une épreuve, vous êtes libre (liberté absolue au sens métaphysique dit Sartre), de choisir de ne pas le faire avec les conséquences que cela suppose. Il n’y a pas de liberté sans responsabilité et sans courage. https://www.philolog.fr/liberte-et-obstacles/ Bien à vous.
Madame je suis ravi que vous vous souciez tant des élèves en leur proposant des clés pour leur succès. Bien j’aimerais avoir une précision; il est vrai toute science est dynamique car c’est d’ailleurs la dynamicité qui caractérise une vraie science. pour ce qui est de la méthodologie, l’on a toujours insisté sur ce qu’on appelle définition des concepts qui, disent certains professeurs, si elle est omise ou délaissée, conduit à une mauvaise dissertation. il me semble que c’est ce que vous entendez par analyse. Analyser signifie-t-il définir?
Bonjour Dans le cours il est question d’une analyse des concepts, d’une analyse rigoureuse des termes de l’énoncé. Analyser consiste dans ce cas à expliciter les diverses significations des concepts et dans le traitement des problèmes, il convient de bien préciser la définition sur laquelle on travaille. Les concepts linguistiques, à la différence des concepts scientifiques, sont en effet ambigus, équivoques. La rigueur conceptuelle exige de déjouer ce piège par un souci scrupuleux des définitions. Bien à vous.
merci madame
Bonjour Madame,
Etant élève de Khâgne, j’ai quelques soucis quant aux sujets composés d’une seule notion , par exemple : » l’intuition ». Devons nous reformuler la notion sous la forme d’une question comme les sujets classiques, question qu’ensuite nous problématisons ?
Bien à vous.
Bonjour Paul Ces énoncés sont effectivement les plus difficiles car c’est à vous de formuler la question dont vous aurez à expliciter la problématique. Les problèmes à affronter sont très différents selon qu’il s’agit de l’intuition sensible, intellectuelle ou métaphysique. Ex de question: faut-il opposer l’intuitif et le discursif? ou bien faut-il opposer l’intuition à l’intelligence comme mode d’appréhension du réel (Bergson)? ou bien est-il légitime d’assigner l’intuitif et le discursif à deux facultés distinctes en l’homme?(débat opposant Descartes et Pascal) etc. Bien à vous.
Je vous remercie.
bonjour! j’ai lu certains articles mais je n’arrive pas à bien cerner ce dont il est véritablement question dans une dissertation philosophique.
Bonjour Ce site n’est pas un site d’aide aux devoirs. Quant à la méthodologie, il me semble qu’elle définit avec précision des termes que manifestement vous n’avez pas assimilés, si j’en juge par le plan que vous présentez dans un autre commentaire. Commencez par comprendre la différence entre: -une question -un problème -une problématique. Cet effort vous permettra de comprendre que l’enjeu d’une dissertation est l’élucidation d’une problématique que l’on s’est d’abord donné la peine d’élaborer. Bien à vous.
[…] documentaire sur le thème… ». 2.2 Fortement conseillé : commencer par la …question 2 ! » Méthodologie de la dissertation philosophique. Dissertation signifie discussion, dispute. Elle est le moment où un élève est convoqué à un […]
merci pour ce que vous faites mais soyez un peu plus explicite
Madame, J’aimerais beaucoup avoir le point de vue d’une femme d’expérience comme vous. Pensez-vous que l’échec au concours soit une preuve d’incompétence et le signe qu’il faut abandonner la philosophie? Tout au long de mes études, j’ai toujours obtenu de bons voire de très bons résultats, y compris quand j’ai décidé de m’inscrire de nouveau à l’Université après des années de salariat. L’an passé j’ai échoué. C’était la première fois que je m’y présentais. Ma famille qui me croyait excellente au vu de mes résultats passés l’a très mal vécu et m’a regardé différemment après cela. Et cette année, le découragement me gagne. Peut être suis-je trop isolée, avec mes textes et mes soucis quotidiens. Toujours est-il qu’un deuxième échec pourrait vraiment sonner le glas de mon amour pour cette discipline et m’isoler davantage. J’ai rompu avec l’université car je ne m’y sentais plus à ma place. Je ne sais plus vers qui me tourner… Ce message est personnel, mais il pourrait peut être aider de nombreux lecteurs après moi. Merci beaucoup, Joséphine
Bonjour Joséphine Je sais qu’on n’échappe pas aux périodes de découragement lorsqu’on prépare les concours mais il ne faut pas les laisser opérer leur travail de sape. Seuls ceux qui ne se sont jamais mesurés à l’épreuve peuvent en ignorer la difficulté et en faire la pierre de touche de la compétence dans une discipline quelconque. Ce serait méconnaître la part de chance, et les nombreuses contingences qui interviennent dans la réussite. J’ai donc de la peine à comprendre la réaction de votre famille et je me demande si vous ne projetez par sur les autres des sentiments traduisant surtout les doutes qu’un premier échec a suscités en vous. L’amour de la philosophie n’est pas tributaire de la réussite ou de l’échec à un concours. Ce que ce dernier met en jeu, c’est une carrière professionnelle, non l’intérêt intrinsèque de la philosophie. Recentrez-vous sur toutes les vertus qui sont les siennes: le bonheur d’une réflexion nous faisant avancer sur le chemin de la compréhension, l’apaisement des affects par la distance que le regard philosophique induit sur soi et sur le monde, le plaisir de se sentir chez soi en compagnie des grands phares de l’humanité. Là est le sésame de la paix intérieure et peut-être celui de la réussite. Le soutien de ceux qui passent par les mêmes chemins peut être utile. Il n’est pas bon de trop s’isoler quand on a l’impression de se taper la tête contre un mur. Ne suivez-vous donc plus une préparation universitaire? Les corrections très sévères de professeurs exigeants sont toujours fécondes. Quoi qu’il en soit, chacun est confronté à la nécessité de tenir en respect ses démons. La philosophie, en tant qu’elle est amour de la sagesse, devrait vous y aider et je ne peux que vous exhorter à mettre en œuvre les stratégies que nos grands maîtres ont définies. Là seulement est le salut, pour toutes les épreuves que nous avons à surmonter dans la vie. Soyez bien convaincue, que nous faisons tous l’expérience du découragement. Puissiez-vous trouver en vous les ressources morales pour le surmonter. Avec toute ma sympathie.
Madame, merci beaucoup, vraiment vos paroles me font du bien. Je suis trop isolée en effet, il y a peu de gens qui comme vous sont disponibles et solidaires … J’ai eu des correcteurs, sévères, instructifs, encourageants mais avares de leur temps (trop peu de corrections) et onéreux pour si peu (je parle du Cned) ! Truffaut faisait la liste de ses échecs. Parfois ils étaient nombreux. Je crois que je dois me faire à cette idée, que la réussite est jalonnée d’échecs, et laisser ma famille penser ce qu’elle veut… Merci encore, Joséphine
Bonsoir Professeur Manon, je me permets de répondre à Joséphine (que je ne connais pas), car je suis passée aussi par beaucoup d’échecs en étudiant la philosophie que « imputavo » je mettais sur le compte d’autrui ou aux conditions, lieu d’études, difficultés économiques (travail et chômage plus cours du soir), coûts des livres exorbitants et celui de l’université, manque de temps et de sommeil pour tout relire en dehors de la bibliographie conseillée, bref une grand découragement: tous les professeurs étaient des génies, des gens cultivés et je me sentais très loin de pouvoir donner ma voie, écrire quelque chose de sensé. J’ai eu la chance de toujours me former et comme Joséphine d’être une bonne étudiante au dessus de la moyenne. Mais l’université et surtout le philosophie demandent un effort qui va au-delà de l’étudier. Il s’agit d’aimer l’excellence, de ne jamais se contenter et ainsi on se met une pression extrême nous-mêmes. La femme est normalement plus centrée sur le désir de réussite mais aussi plus enclin à chercher au fond d’elle cette puissance que les garçons jettent au dessus de leurs épaules. Serait-ce peut-être la maternité qui nous oblige à donner et toujours plus à notre créature? La philosophie est pour moi mon 4ème enfant.Les trois premiers ont été un jeu d’enfant. Ce dernier à naître me donne bien des soucis. Mais une chose est sûre, la méthodologie est très mal ou pas enseignée du tout dans nos universités, mais on nous demande d’écrire selon leurs canons classiques. Est ce que l’on peut y échapper? Malheureusement on me dit avec intelligence et sensibilité féminine de ma professeur en cours privés extra -universitaires que c’est un passage forcé auquel on doit se plier pour ensuite apprendre notre voix non comme vox populi, ou doxa mais comme sa capacité de finalement parler avec du sens, une logique. Mon problème est et reste que je n’arrive pas à écrire selon cette méthodologie que je n’ai jamais apprise ni au bac littéraire, ni au Cned. Je la trouve pédante, et comme Nietzsche explicite si bien pleine de lourdeurs bien allemandes et décadentes. Je me sens frustrée par cette méthode de devoir discourir alors que ma vraie voix est instinctive, fluide, logique. J’admire qui arrive à se plier aux dictat de cette méthode que je trouve contraignante, non naturelle: thèse, sa contradiction et l’approfondissement; avec des phrases de ‘ligatura’ comme en musique entre les trois parties et une conclusion que bien souvent on dénature par peur du risque de devenir trop personnelle. Je me sens la voix d’un castrat et non plus la mienne, avant si spontanée. Alors une question se pose sur mon épaule qui tend vers la table de travail, comme un papillon qui sait que la fin du jour arrive et pas de lendemain: à quoi la philosophie sert -elle si elle devient un fardeau? Avons-nous oublié Nietzsche qui poussait à un gai savoir? Je souhaite tellement continuer la philosophie, car cela fait environ 47 ans que j’en lis, mais je voudrais pouvoir trouver des professeurs qui me libèrent de cette épée de Damoclès sur ma tête et m’apprennent en légèreté à utiliser cette fameuse méthode sans me casser la voix.
J’admire le courage de Joséphine de dire qu’elle est découragée, car c’est le même sentiment que je ressens depuis cette année (II année en philosophie dans mon université) et qui m’empêche de retrouver l’entrain , la joie de vivre la philosophie. Auriez-vous des conseils pour sortir de cette impasse? Car je commence à me sentir trop serrée dans ces obligations et me demande aussi si je ne suis pas à la hauteur de ce genre d’études. avoir une bonne culture générale ne suffit pas, ni penser savoir écrire, mais les règles de la méthode m’étouffent. J’apprécie votre blog et vous lis régulièrement. Merci.
Bonjour Madame Je suis très démunie pour vous répondre car votre problème n’est pas, comme pour Joséphine, l’échec à un concours. Ce qui vous pèse est une dimension essentielle de la réflexion philosophique, à savoir la méthode dialectique. Or réfléchir philosophiquement n’a jamais consisté à s’abandonner à la spontanéité de sa pensée. Dès lors je me demande si votre rapport à la philosophie ne repose pas sur un malentendu. Comme je suis spinoziste en matière de sagesse, je considère qu’il faut fuir ce qui nous attriste (nous diminue) et rechercher ce qui nous rend joyeux (nous augmente). Pourquoi persévérer dans une voie qui semble si contraire à votre nature? Il faut vous mettre au clair avec vous-même, vous faire une idée adéquate de votre désir, dirait Spinoza, afin de rechercher votre utile propre. Une pratique qui « étouffe » n’est pas, de toute évidence, une pratique épanouissante. Ne serait-il pas judicieux d’en tirer les conséquences? Bien à vous.
[…] » Méthodologie de la dissertation philosophique. Dissertation signifie discussion, dispute. Elle est le moment où un élève est convoqué à un authentique effort de la pensée. Elle est la philosophie en acte. Or qu’est-ce que penser ? Ce n’est jamais opiner c’est-à-dire affirmer sans examen. « Penser, disait Alain, consiste essentiellement à savoir ce que l’on dit et si ce que l’on dit est vrai ». C’est toujours réfléchir, faire retour sur des énoncés afin d’en interroger le sens, la valeur de vérité s’il s’agit d’un énoncé théorique (doxique ou scientifique), la valeur morale s’il s’agit d’une affirmation morale et le fondement. […]
bonsoir en fait ce qui m’amene est le fait que j’ai un devoir de philosophie jeudi et franchement j’ai l’impression que je ne comprends rien a la dissertation philosophique et j-ai besoin de savoir comment rédiger une dissertation en philosophie j’arrive nouvellement en classe de terminale scientifique et toute les terminales de notre lycée doivent participer a ce concours
Bonjour Ce site n’est pas un site d’aide aux devoirs. Cet article fournit les règles de la méthode. Vous disposez sur ce blog de quantité de dissertations où sont appliquées ces règles. Il vous suffit de vous donner la peine d’exploiter ces ressources pour commencer à comprendre. Bon travail.
Je tiens à vous remercier tour d’abord de la qualité de vos articles ainsi que les sujets divers que vous proposez. En effet, votre blog m’a donné une passion à la philosophie. Ceci dit, je me suis inscrit cette année en L1-Philosophie à distance par passion à cette discipline et par choix d’améliorer mes capacités d’analyses et d’argumentations étant un professionnel dans le management des télécoms. De ce fait, je me suis permis de vous adresser ces mots afin de vous demander conseil concernant la méthodologie à suivre pour traiter et analyser les cours. En ce moment, j’ai comme module l’histoire de la philosophie ancienne et de la philosophie générale. Pour le moment, je suis la méthodologie suivante : – 1ère lecture simple du texte philosophique – 2ème lecture en prenant des notes et analysant les paragraphes afin de comprendre le contexte et l’analyser – 3ème lecture final suivi par la rédaction d’un essai sur la problématique discutée Souvent je complète mes cours par la lecture des articles concernant le même sujet du cours dont le dernier est l’intellectualisme morale. Trouvant cette méthodologie longue bien qu’efficace, je me suis permis de vous solliciter à ce propos.
En vous remerciant pour votre retour. Bien cordialement, Charles
Bonjour La méthode que vous décrivez est excellente. Je ne peux que vous confirmer dans ce choix. La réflexion philosophique exige en effet du temps afin de s’assimiler les idées et de développer sa propre capacité de penser. Rien n’est plus contraire à cet enjeu que le souci de brûler les étapes. La précipitation ouvre un boulevard aux facilités des esprits superficiels, proies complaisantes des faiseurs d’opinions ou des idéologues. Tous mes vœux d’épanouissement dans vos études. Bien à vous.
Chère madame je dois d’abord vous remercier pour vos précieux conseils. Voici ma question, ou plutôt mon problème. Quand au début d’une dissertation je me demande ce que l’on pense communément d’une question pour amorcer ma réflexion, je me rends compte que je ne peux pas toujours trancher entre deux propositions qui se valent. Par exemple, si la question est : Peut-on tirer des leçons de l’histoire? Je cherche ce que l’on a tendance à penser, et je trouve deux idées toute faites et opposées. On dit souvent que l’histoire se répète, et donc qu’il il est possible de tirer des leçons etc… Ou au contraire, on dit que l’expérience ne nous apprend rien, et donc qu’il n’est pas possible de tirer des leçons etc… je ne sais pas si je suis clair, mais quelle opinion choisir entre les deux? En vous remerciant
Bonjour D’ordinaire, il y a une opinion qui est plus proche de ce que vous pensez spontanément sur une question donnée. Celle-ci peut donc vous fournir l’occasion d’engager la problématisation. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas important. Quelle qu’elle soit, l’opinion choisie vous permet d’amorcer votre réflexion. Bien à vous.
j ai été tres ravi d avoir appris beaucoup de choses
[…] C’est dans cet objectif que les connaissances doivent être abordées pour nourrir une réflexion personnelle. On peut aller voir ces différents conseils de méthodologie, une approche ironique intitulée « Comment rater sa dissertation de philosophie ? » ainsi que cette fiche sur l’explication de texte et cette autre, centrée sur la dissertation. […]
Bonjour Madame, Merci pour ce site remarquable. En examinant le plan que vous proposez pour traiter le sujet choisi, je me demande en quoi la troisième partie constitue un dépassement de la précédente, selon la définition que vous donnez de cette opération (élévation de la réflexion à un nouveau point de vue, supérieur, englobant les deux premiers et permettant de montrer qu’ils s’articulent avec cohérence). En effet, si la deuxième partie consiste à soutenir qu’il n’y a pas de sens à dire qu’on peut choisir d’être libre et qu’il vaut mieux dire qu’on est condamné (et non déterminé) à l’être (thèse sartrienne), alors la troisième partie, où vous proposez d’expliquer que cette condamnation à une liberté absolue peut engendrer la tentation de la mauvaise foi, ne représente qu’un prolongement de la seconde, un ensemble de précisions relatives à la thèse existentialiste (liberté absolue donc angoissante donc engendrant la tentation de se faire croire qu’on est « englué » dans des déterminations). La troisième partie adopte le même point de vue que la seconde, complète son propos mais ne la dépasse en rien, du moins me semble t-il. Ai-je mal saisi votre démarche? Cordialement. Eric
Bonjour Oui, vous comprenez mal l’idée essentielle du dépassement. Ce n’est le thème de la mauvaise foi, c’est l’idée que la liberté humaine, tout absolue qu’elle soit est celle d’un être en situation dans le monde (et non une liberté acosmique). https://www.philolog.fr/etre-en-situation-dans-le-monde-sartre/ Bien à vous.
Bonjour Madame Je tombe par hasard sur la réponse que m’avait adressée Gioconda. C’est émouvant pour moi de la découvrir ce matin. Je l’en remercie chaleureusement. Au fond, la difficulté de Gioconda n’est pas si éloignée de la mienne, non que la méthodologie me paraisse difficile à assimiler et à appliquer, car cela j’ai su le faire très jeune mais justement j’étais jeune et à 20 ans, rien n’est plus important que d’imiter ses modèles (en l’occurrence ses professeurs) et de leur plaire. Plus tard, cette même méthode nous paraît artificielle et puisqu’il s’agit de philosophie, peu philosophique. Car si la grande philosophie est tout sauf un libre bavardage, elle ne devrait pas nous obliger non plus à céder à la mauvaise foi. C’est pourtant ce qui arrive quand on développe une troisième partie tirée par les cheveux à laquelle on ne croit pas soi-même ! Aussi suis-je très sensible à la formule de Gioconda : » Je me sens la voix d’un castrat et non plus la mienne. » Il est une manière universitaire et formatée de construire un discours sur le monde qui ne nous convainc plus passé un certain âge, car alors on sent bien qu’un « On » parle à notre place et que l’exercice n’a plus rien à voir avec à la liberté de penser. Merci à vous et à Gioconda, je lui souhaite de prendre la philosophie par un autre bout, non sans rigueur mais loin des universités. Comme Charles Péguy peut-être… Joséphine
Bonjour Madame Manon,
c’est au tour de mes enfants de se « confronter » à la philosophe. Certes, c’est plutôt moi-même qui m’y suis « confronté », semble-t-il principalement à cause de mon immaturité et de ma dispersion en classe il y a une trentaine d’années. Souhaitant à mes enfants une meilleure perception de la philosophie que celle que j’en avais à leur âge, j’ai donc pris les des devants à la recherche de toute « nourriture » que je puisse leur soumettre (leur laissant la responsabilité d’en faire bon usage), ce en complément de ce que leur professeur de terminal leur apprendra et je suis tombé sur votre site. Merci, oui merci de me permettre d’apporter ma pierre à l’éducation de mes enfants ne serait qu’en leur faisant connaître votre site. Merci aussi de m’avoir enfin permis de ne serait-ce qu’entrevoir ce qu’on attendait de moi au bac de philo de 1989 🙂 Enfin, toujours grâce à votre site, il n’est pas impossible que je finisse par comprendre quelques concepts philosophiques qui aujourd’hui encore m’échappent complètement et par avance je vous en remercie également.
Bien à vous, Denis C.
Bonjour Monsieur Merci pour cet aimable message. En espérant que mon site continue à vous faire aimer la philosophie et nourrisse des échanges féconds avec vos enfants. Bien à vous.
Bonjour madame, Je suis actuellement en Terminale S et, j’aimerai savoir si dans les exemples que nous devons présenter, pouvons nous donner des exemple de notre quotidien. Cette année nous avons eu deux professeurs différents cependant, l’un nous dit que nous devons utiliser notre vécu car c’est là le but de la dissertation, l’élèves doit développer ses pensées personnelles et, l’autre professeur nous dit que nous ne pouvons pas en citer car ces dernier sont beaucoup trop triviaux et peuvent même blesser notre correcteur dans certains cas. Merci d’avance. Rajeswari
Bonjour La réflexion philosophique n’est pas indexée sur le vécu de chacun. Mais votre expérience, sous réserve de pouvoir être élevée à l’universel, peut vous fournir matière à exemplifier une idée. Il faut simplement, dans la manière de la mobiliser, lui ôter son caractère strictement personnel. Ex: Si vous réfléchissez sur l’enfance, vous ne devez pas dire « quand j’étais petit » mais, bien que vous souvenant de votre expérience enfantine, vous lui ôtez sa particularité en disant: « l’enfant »…. Bien à vous.
Bonjour Madame, Tout d’abord je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous avez fourni pour permettre à des étudiants comme moi de mieux comprendre les notions de philosophie. Dans votre article, vous parlez de la méthodologie pour problématiser des sujets qui sont sous forme de questions. Mais je me demandais quels seraient les conseils que vous nous donneriez pour problématiser le sujet dans le cas où il se présenterait sous la forme d’un mot, d’une notion et non d’une question. Bien à vous, Marie.
Bonjour La différence entre les deux types d’énoncés tient au fait que celui qui se présente sous la forme d’une notion a une difficulté supplémentaire. C’est à vous à trouver les questions. L’élaboration de la problématique dans ce cas est donc plus ardue. Vous pouvez consulter comme exemple la présentation des chapitres. Le programme se décline sous forme de notions, les cours doivent construire les problématiques possibles même si ce n’est pas sous forme exhaustive. Bien à vous
Laisser un commentaire
Nom (requis)
Mail (will not be published) (requis)
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Entrées complémentaires
Il n’y a pas d’entrée similaire.

Tous droits réservés.
10 leçons sur : la liberté
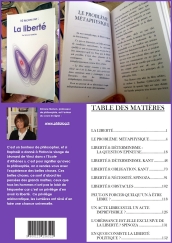
10 Chapitres du cours sur la liberté, sélectionnés et édités dans un format papier agréable et pratique.
Impression à la demande au format poche
Pour Commencer
Comment se repérer dans ce blog ?
Présentation du chapitre I
- Chapitre I – La philosophie.
- Chapitre II – Conscience. Inconscient. Sujet.
- Chapitre III – Autrui.
- Chapitre IV – Désir.
- Chapitre IX – L'art.
- Chapitre V – Bonheur et moralité.
- Chapitre VI – Nature-Culture.
- Chapitre VII – Le travail.
- Chapitre VIII – La technique.
- Chapitre X – La religion.
- Chapitre XI – Le langage.
- Chapitre XII – Le réel, l'expérience.
- Chapitre XIII – La raison.
- Chapitre XIV – L'interprétation.
- Chapitre XIX – Droit et justice.
- Chapitre XV – L'histoire
- Chapitre XVI – La vérité.
- Chapitre XVII – Matière, vie, esprit.
- Chapitre XVIII – La politique.
- Chapitre XX – Etat et Société.
- Chapitre XXI – La liberté.
- Chapitre XXII – Réflexions sur l'Europe
- Chapitre XXIII- L'existence, le temps, la mort
- Chapitre XXIV- L'ennui
- Chapitre XXV. Le plaisir.
- Chapitre XXVI: La guerre.
- Présentation des chapitres
- Dissertations
- Explication de texte
- Méthodologie
Commentaires Récents
- Simone MANON dans Explication de l’allégorie de la caverne
- Antoine dans Explication de l’allégorie de la caverne
- Simone MANON dans Qu’est-ce que l’autorité?
- Simone MANON dans Le populisme.
- Jerome dans Le populisme.
- Emile Durkheim et l’analyse du lien social : De la division du travail social (1893) – Je suis mon monde dans Ambiguïté de la division du travail.
- Grégory Massé dans Qu’est-ce que l’autorité?
- Simone MANON dans Laïcité: une institution désenchantée.
- Noon dans Laïcité: une institution désenchantée.
Articles Récents
- Kant. La condition nécessaire à la possibilité de la paix entre les Nations.
- La dialectique du bourgeois et du barbare
- Charles Stépanoff: L’animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage
- Joyeux Noël.
- Vincent Coussedière. Eloge de l’assimilation
Liens - Chambéry
- Lycée Vaugelas
- Proxy Informatique
Liens - Cuisine
- La cuisine de Mercotte
- Les bonheurs de Senga
Liens - Philosophie
- La république des livres
- La vie des idées
- Le blog de Marcel Gauchet
- Les beaux cours de philosophie de Jacques Darriulat
- PhiloSophie sur l'académie de Grenoble
- Sens Public
- Tumulti e ordini. Le blog de Thierry Ménissier.
- Flux des publications
- Flux des commentaires
- Site de WordPress-FR
PhiloLog © 2024 Tous droits réservés.
Propulsé par WordPress - Thème « Misty Look » par Sadish Proxy Informatique -->

Méthode de la Dissertation Philosophique
I. le sujet.
La dissertation est l’exercice proposé pour le sujet 1 et le sujet 2 du Baccalauréat de philosophie. Le sujet de dissertation se présente toujours sous la forme d’une question à laquelle vous devez répondre. Tout au long de votre réflexion, il faut vérifier régulièrement que vous êtes bien en train de répondre à la question. Il existe quelques énoncés récurrents :
1) Qu’est-ce que… ? : On vous demande de répondre par une définition précise (ex : Qu’est-ce que la vertu ? Qu’est-ce que la justice ?), la question de l’essence de la chose, de sa nature que vous allez chercher à définir et à rendre dans toute sa complexité.
2) Peut-on… ? : Vous chercherez à interroger la possibilité pratique : dispose-t-on des moyens techniques pour… ? ; et/ou la possibilité morale : a-t-on le droit de… ? Il faut alors faire jouer la distinction entre le légal (ce qui relève du fait, du droit positif) et le légitime (fondé en raison : le rationnel, le Juste, le Bien etc…).
3) Faut-il… ? Doit-on… ? : On interroge la nécessité physique, matérielle, le besoin : sommes-nous contraints de… ? Avons-nous besoin de… ? ; et/ou l’obligation morale (= le devoir) : avons-nous le devoir de… ?
4) Pourquoi… ? À quoi sert… ? : Il s’agit de montrer les causes, les raisons de la chose, ses buts, ses finalités et/ou son utilité.
Vous chercherez toujours à comprendre la question et à défendre sa pertinence : ne contestez jamais la formulation ou l’intitulé du sujet mais dites-vous toujours « c’est une excellente question à laquelle il faut absolument répondre ». Que la question du sujet soit totale (appelant la réponse oui ou non) ou partielle, cela ne change rien à la méthodologie de la dissertation. Les deux questions de dissertation proposées au Baccalauréat portent forcément sur des thèmes différent de la philosophie. Choisissez donc judicieusement !
II. Analyse du sujet / Tempête sous un crâne (= brainstorming )
Essayez dans un premier temps de répondre sincèrement à la question en vous demandant qu’est-ce que les mots du sujet signifient. Etudiez les arguments et les contre-arguments possibles en vous forçant à défendre des points de vue qui ne sont pas forcément les vôtres. Au brouillon, appliquez la formule, il y a x et x et tous les x ne se valent pas afin d’installer de la différence, de la nuance et même de l’ambivalence. Efforcez-vous de casser les généralités abstraites trop souvent creuses et fallacieuses. Travaillez sur les différences plutôt que sur les similitudes. Servez-vous d’expressions qui apprennent quelque chose, d’exemples bien trouvés, pris dans la culture (littérature, mythes, religion, histoire, science, politique, etc..), en les développant en fonction du sujet posé et du problème soulevé par le sujet (ou qu’on a soi-même formulé à partir du sujet). Enfin, demandez-vous quels philosophes seraient susceptibles de répondre à ce sujet de dissertation et comment le feraient-ils ? Que diraient-ils ?
III. Introduction
A. Amorce et rappel du sujet
Vous devez introduire le sujet, partir d’un exemple précis pris dans la culture ou l’opinion qui vous amène tout naturellement à vous poser la question du sujet. Il s’agit de justifier le sujet, d’en montrer la pertinence et le bien-fondé ( facultatif ). Une amorce n’est jamais vague. Pas de : « De tout temps les hommes ont cherché à être heureux… » ou « Durant des siècles, les philosophes se sont interrogés sur le bonheur… ». Ensuite seulement vous rappelez la question à laquelle vous répondrez tout au long de votre dissertation . Vous ne devrez jamais reformuler le sujet. Si vous ne trouvez pas de bonne amorce, vous commencerez par rappeler le sujet.
B. Définitions des termes du sujet
Après avoir rappelé le sujet, il convient de définir les termes importants. Nul besoin de dictionnaire, c’est votre définition par rapport au sujet qui importe. Ainsi, il faudra faire résonner les définitions entre elles (puisqu’elles sont liées par le sujet) et les intriquer de manière élégante (sans les juxtaposer). Ces définitions servent de base, mais elles ne doivent pas rester figées, il conviendra de les retravailler au fur et à mesure de la dissertation. Ainsi, il convient d’éviter les relativismes mous du type : « Certains pensent que…, d’autres pensent que… ».
C. Problématisation
Une fois avoir défini les termes, vous serez plus en mesure d’esquisser le problème que pose le sujet : Pourquoi, de prime abord, peut-on répondre oui à la question, mais également pourquoi peut-on répondre non ? Pourquoi y a-t-il plusieurs réponses possibles envisageables ? Il faut penser à s’étonner (même de manière opératoire, en faisant semblant). Si l’on (le jury, le correcteur) pose ce sujet (et pas un autre), c’est bien parce qu’il renvoie à un problème évident ou caché, qu’il s’agit de découvrir, de formuler, d’exposer, d’expliciter au lecteur dans toute sa complexité (complexe ne signifie pas compliqué). Toujours d’abord cherchez à montrer le bien-fondé du sujet, tel qu’il est posé (quelle est sa nécessité ? Sa légitimité ? Pourquoi a-t-il été posé ainsi, et pas autrement ? En quoi cela se justifie-t-il ?) Par la phase de problématisation, vous étudiez les différentes réponses possibles au sujet et vous montrez pourquoi elles sont toutes plus ou moins pertinentes et défendables.
D. Problématique
À la fin de la phase de problématisation, vous serez à même de formuler la sacro-sainte problématique qui va diriger votre devoir.
Pour produire facilement une problématique, procédez ainsi :
- Réponse naïve, immédiate, on suit l’opinion commune.
- (au brouillon ou en problématisation) Réponse nuancée, contradictoire, qui va contre l’opinion immédiate et commune.
- (Dans l’introduction, à la fin de la problématisation) Problématique : Alors, est-ce que vraiment 1 ou bien au contraire, plutôt 2 ? / Alors ou bien 1, ou bien au contraire 2.
Ceci est pour vous aider et vous guider, mais cela ne veut pas dire que toute problématique doit absolument ressembler à cela. Une problématique réussie doit parvenir à présenter un paradoxe.
Exemple :
- Sujet : Faut-il satisfaire tous ses désirs pour être heureux ?
– Réponse spontanée : oui, c’est la seule manière de nous procurer du plaisir, condition sine qua non du bonheur. Plus grand est le nombre de désirs satisfaits plus grand sera notre bonheur.
– Réponse nuancée : non,il y a des désirs qu’il vaut mieux maîtriser que satisfaire, car leur réalisation risque de nous rendre à jamais malheureux.
– Problématique : Ou bien satisfaire tous ses désirs est le seul moyen d’accéder au bonheur, ou bien au contraire , ne pas maîtriser ses désirs nous conduit irrémédiablement au malheur.
E. Annonce du plan
Vous devez esquisser pour votre lecteur les grandes étapes de votre réponse. Évitez cependant les « dans un premier temps…dans un second temps… ». Vous devez annoncer les thèses que vous allez défendre en I, II et III et pour le faire de manière élégante voici une proposition :
Sujet : Faut-il satisfaire tous ses désirs ? I. Satisfaire ses désirs est ce qui nous rend heureux. II. Pourtant, la frustration nous rend malheureux : le désir est donc obstacle au bonheur. III. Il faut alors apprendre à maîtriser ses désirs et non y renoncer.
Annonce du plan : En apparence , satisfaire tous ses désirs semble être la condition du bonheur, en nous procurant le plus de plaisir possible (I). Mais en réalité , il est possible que trop s’occuper de ses désirs est un obstacle au bonheur et nous conduit à la frustration ou à l’ennui (II). C’est pourquoi, nous sommes en droit de penser qu ’il vaut mieux rechercher à maîtriser ses désirs plutôt qu’à les satisfaire (III).
Remarque sur l’introduction : 1) Toutes ces étapes ne sont pas là pour vous ennuyer ou vous empêcher de penser mais pour vous cadrer et vous mettre sur la bonne piste. Vous éviterez ainsi plus facilement les hors-sujets. 2) Ne citez jamais de noms de philosophes dans l’introduction (ou alors éventuellement en amorce, c’est la seule exception). Ne posez jamais de questions en introduction pour mettre les enjeux en lumière, mais au contraire répondez-y directement même si la réponse est naïve et incomplète, cela servira de base de travail.
IV. Développement
A. Élaboration d’un plan
Le développement est composé en général de trois grandes parties. C’est un héritage de a tradition dialectique hégélienne (mais on peut l’envisager en deux ou quatre parties). Les grandes parties doivent s’enchaîner logiquement, ne pas être juxtaposées : vous devez répondre petit à petit aux difficultés du sujet. Aucune grande partie et aucun argument ne doit répéter ce qui a déjà été dit. Les grandes parties (au moins les deux premières) doivent s’opposer drastiquement.
I : Thèse . Adoptez le point de vue de l’opinion (la réponse évidente au sujet), dites ce que tout le monde pense ou croit, cherchez à défendre ce point de vue.
II : Antithèse . Critiquez cette opinion (en cela, vous serez disciple de Platon), montrez que la thèse du I n’est pas satisfaisante : montrez ses limites, sa naïveté, défendez un point de vue opposé.
III : Synthèse . Cherchez alors une autre réponse, plus précise, plus en accord avec le réel, qui soit plus conforme à la vérité, au devoir-être, à l’idéal. Vous tirez les leçons de l’aporie (= ce qui est sans issue, sans solution, ce qui ne permet pas de répondre) de I que vous avez révélé en II, et vous tentez d’en sortir, de trouver un moyen de répondre, d’accorder les contradictions en les dépassant : vous devez résoudre le problème ou le dépasser, trancher la question.
B. Composition des grandes parties
Chaque grande partie comporte :
1) Une phrase d’amorce qui présente la thèse alors défendue, et comment elle le sera. ( facultatif )
2) Trois (entre deux et quatre) sous-parties qui énoncent les arguments permettant de justifier, démontrer, discuter la thèse défendue.
3) Vous terminez la partie par une petite synthèse/transition qui fait le bilan de ce que vous avez montré et pourquoi quelque chose cloche : quelles sont les limites et les difficultés que vous avez rencontrées qui ne rendent pas la réponse suffisamment satisfaisante et pourquoi il est nécessaire d’étudier une autre réponse dans une autre grande partie. Il s’agit ici de trouver une objection à ce que vous venez de dire, ce qui implique de poursuivre le devoir.
C. Sous-parties
Nous l’avons dit, chaque partie du développement (I, II, III) est constituée de trois sous-parties(minimum deux et maximum quatre). Chaque paragraphe doit démontrer, présenter, avancer un argument en faveur de la thèse de la partie. Un paragraphe peut contenir :
1) La formulation de l’argument. C’est l’idée que vous essayez de défendre ( obligatoire )
2) Un exemple qui illustre votre propos et ajoute du concret à l’argument. L’exemple doit être précis et parfaitement en rapport avec l’argument. Utilisez votre culture personnelles, les connaissances acquises dans les autres matières ou à défaut, les évènements de votre vie personnelle, mais évitez les banalités. ( facultatif )
3) Un système, une doctrine, une citation (expliquée), une référence à une philosophie ou à un philosophe pour ajouter de l’abstrait (demandez-vous comment tel ou tel philosophe aurait pu répondre à ce sujet de dissertation). Ne plaquez jamais le cours sans le mettre au service du sujet de dissertation qui vous occupe. Pas plus d’un philosophe ou un système de pensée par sous-partie. ( facultatif )
Remarque sur le développement : Vos sous-parties doivent forcément débuter par la formulation de votre argument : interdiction de commencer le paragraphe en écrivant : « Kant a dit que … »,ou « Epicure a dit que… ». Les philosophes sont des béquilles qui vont vous aider dans le cheminement de votre pensée, mais en aucun cas vous ne devez vous réfugiez derrière eux. À la fin de chaque sous-partie, pensez toujours à montrer comment vous venez de répondre au sujet.
V. Conclusion
1) Rappelez le sujet et votre problématique ( facultatif )
2) Rappelez votre cheminement de pensée et le parcours que vous avez suivi au long de votre dissertation en répétant succinctement vos arguments les meilleurs ( obligatoire )
3) Répondez franchement et directement et définitivement à la question du sujet (cela ne veut pas dire que vous devez être absolument catégorique, ici encore vous pouvez/devez faire preuve de nuance). ( obligatoire )
Remarques sur la conclusion : 1) Ne parlez pas des philosophes dans la conclusion. 2) Jamais d’ouverture.
VI. Remarques finales
1) Soyez clair, cherchez toujours à faire comprendre, pas besoin d’esbrouffe ou de jargon à moins que vous ne vouliez utiliser et expliquer des concepts philosophiques.
2) Ne vous censurez pas. Si quelque chose est susceptible de choquer, ne vous privez pas, même allez-y franchement, mais toujours en défendant votre point de vue.
3) Jamais de « Je » dans votre devoir. Préférez le « on » ou mieux encore le « nous ».
4) La maîtrise de la langue peut se révéler très utile dans la construction de votre devoir et la formulation de vos arguments.
5) Évitez à tout prix les relativismes et les banalités notamment pour les définitions, les arguments et les exemples : « La définition du bonheur dépend de chacun », « Faire du shopping rend heureux », etc…
6) Soyez stratège. La dissertation n’est pas la quête de la réponse vraie, mais un exercice rhétorique. Le but n’est pas de trouver la vérité, mais d’avoir raison. Argumentez pour convaincre ou persuader votre correcteur que vous dites des choses pertinentes. Ainsi, ne faites pas un catalogue d’arguments mais essayez de proposer une progression cohérente.
7) Une bonne dissertation doit faire entre 8 et 12 pages : la qualité ne peut pas aller sans la quantité et une copie de 4 pages ne pourra jamais remplir tous les critères et satisfaire tous les attendus.
8) Aérez vos paragraphes en sautant des lignes et en faisant des alinéas quand cela est nécessaire.
9) Soignez votre écriture, votre orthographe et votre copie de manière générale. Relisez-vous pour corriger les fautes d’orthographe, soulignez les titres d’œuvres et les mots en langue étrangère.
10) Amusez-vous ! Ecrire une dissertation doit être un exercice joyeux d’expression de soi.
Sapere aude ! [1]
Par Thomas Primerano, professeur de philosophie, diplômé de la Sorbonne, membre de l’Association de la Cause Freudienne de Strasbourg, membre de Société d’Études Robespierristes, auteur de ‘’Rééduquer le peuple après la terreur’’ publié chez BOD.
[1] Emmanuel Kant : « Ose penser par toi-même ! », dans Qu’est-ce que les Lumières ? – 1784
Pour voir un cas concret, consultez notre exemple de dissertation rédigée .
You may also like

Le Bonheur en Philosophie

Méthodologie des Questions sur le Texte philosophique (séries technologiques)

Explication de texte de philosophie : La Méthode
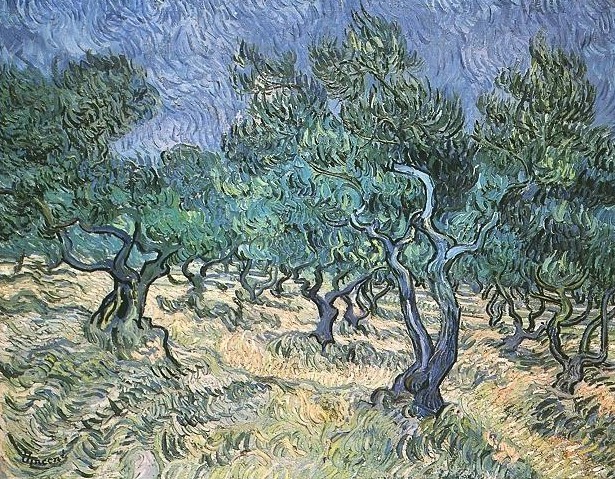
La Nature en philosophie
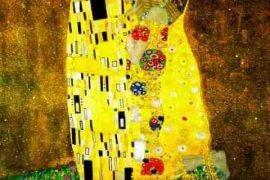
Le Désir – Définition
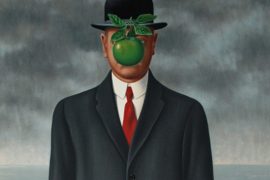
La Conscience en Philosophie: Cours & Citations
68 Comments
J’aimerai avoir des sujets de dissertation traités pour mieux comprendre la méthodologie de la dissertation philosophique.
Bonjour j’aimerais avoir un de type examen corrigé!
Merci pour votre aide…
jaimerai avoir plus d’exemple svp
c’est tres interessant
Dans le dévelopement du sujet , est-ce qu’il doit tjrs porter (3)parties ? Et pourquoi pas (2)parties ?
Bonjour j’aimerais avoir un de type examen corrigé!
Bonjour je suis castro j’ai vraiment des lacunes pour la comprehension de la dissertation philosophique.Je n’ai jamais su realiser ce que c’est qu’une problematique j’ai vraiment besoin d’aide!!
bonjour, est ce que le synthese peut vraiment repondre au problematique?
Introduire,développer et conclure?
Comment introduire, développer, conclure un sujet philosophique?
Bonsoir ! J ai vraiment besoins d aide de vous pour que je puisse réalisée une dissertation acceptable.parce que je lis et relis je pouvais pas la faire
Je vais particer a un concour mais jusqu’à présent j ai du lacune en dissertation.le concour sera lieu le 18 septembre prochain
Je vous remercie!!!!très bon travail
j’aimerai avoir des exemples
j’aimerai avoir plus de detail svp
Je besoin plus de sujet philosophique afin de mieux comprendre la méthode
D apres ce que je comprends On a pas vraiment répondu aux problèmes qui on a crée
Comment faire pour résoudre une dissertation philosophie
salut je veux des sujets types BAC
Slt nous voullions des sujets et corriges so possible merci
bonjour j’aurais bien voulu que vous m’aider de manière à comprendre la methodologie et en savoir plus sur la philodophie je suis en classe de terminale
salut pourais je avoir des sujet de bac des annees 1900
Chaque thèse proposes une solution au problème. Dans ces thèses tu proposes au minimum deux arguments différents qui appuient ta thèse.
I / thèse 1) argument + exemple OU référence 2 argument + exemple OU référence
et cela trois fois, sans oublier l’intro et la conclusion.
c’est bien
bien, merci!
Bonjour moi c’est Coulibaly Tanfotien Gatien je veux un sujet de BAC exercice et corrigé pour ma formation de première merci d’avance
du moi votre bonne example pr la dissertation philosophic, nous eclairn ptement
merci pour votre aide que dieu vous bénisse amen
Merci pour votre aide! J’aimerais aussi y trouver des résumés des notions au programme de Terminale!
Merci,j’aimerai avoir un example de sujet afin de traiter d’autres.
un exemple de sujet traité en philosophie de type1
Ça aide beaucoup
voir la méthodologie des sujets corrigé pour mieux comprendre
Pourrais_ je avoir des sujets de dissertation type Bac pour mieux renforcer mes acquis
je voudrais vraiment qu’on me montre la manière à suivre pour très bien faire mon introduction, car je vois que sans l’introduction les autres parties ne seront pas bonnes…
Bonjours !J’aimerai avoir un sujet traité pour mieux comprendre.
J’aimerais avoir des sujets de dissertantion traités pour mieux comprendre la méthodologie de la dissertation philosophique
la passion est elle une occasion de chute ou d’élévation?
j’aimerai aussi avoir un sujet et son corriger type
C’est vraiment intéressant!
merci pour votre aide, ça me sera util
la compréhension serait optimale avec un exemple bien précis!
Etre et devenir
J’aimerais avoir des exemples plus précis et traités pour bien comprendre par_ce_que la je suis vraiment perdu
merci beaucoup a vous. mais je ne suis pas satisfait parce que vous n’avez pas fait un essai de dissertation philosophique. cela pourrais m’aider a mieux comprendre. merci pour votre générosité quand meme.
bonsoir j’aimerais bien comprendre la dissertation en philo?
La partie n’est pas exhaustive,il nous faut un exemple pour une meilleure compréhension
merci pour votre aide
si le sujet est du plan dialectique comment fait-on en faire? si c’est que vous avez dit tu es vraiment acceptable dans ce cas votre manière de traiter le sujet avec la méthodologie philosophique indifférent que nôtre. pour cela je me demande la méthodologie de la philosophie n’est pas international car il s’agit de beaucoup de méthode pour traiter un sujet philosophique ou bien avez-vous d’autres idées qui va me faire tort ainsi j’ai donné ma proposition et j’aimerais avoir la réponse que je vous ai posé merci
Bonsoir, s’il vous plait, je n’ai jamais fait philo ,niveau première 2015. J’aimerais obtenir un exemple de sujet , puis un corrigé quelconque afin de me faire observer la méthode. merci.
J’aimerais comprendre beaucoup plus la méthodologie de la dissertation en philo . avoir des sujets
J’aimerais essayer de faire une dissertation philosophique dans un commentaire
J’aimerais savoir comment faire la dissertation de ce sujet : peut on se couper du passé
J’aimerais avoir des exemples plus précis et traités pour bien comprendre par_ce_que la je suis vraiment perdu
C’est trés intéressant mais j’aimerais avoir un exemple de dissertation pour mieux comprendre si c’est possible
C’est vraiment intéressant !!! Mais Je voudrais les explications détaillées du sujet de type 1 et 2
J’aimerais un sujet de dissertation traité pour mieux comprendre
La force peut elle fonder le droit
J’ai besoin d’un prof pour que quand je traite des sujets qu’il puisse me corriger
s’il vous plait,j’ai besoin d’un exemple sur un sujet de dissertation corrigé en philosophie pour mieux maitriser sa méthode . merci d’avance.
Les sujets de bac
Si l’appréhension du monde n’était qu’intiutive la connaissance se réduirait à l’aspect extérieur des choses or,celle -ci est parfois trompeur
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.

Méthodologie de la dissertation: règles générales, introduction et conclusion
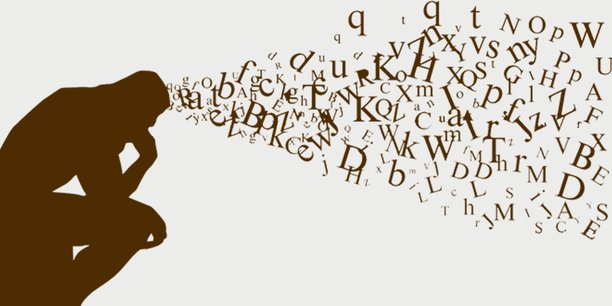
Il faut analyser minutieusement la forme et le contenu du sujet, et surtout ne pas immédiatement commencer à rédiger afin d’éviter tout contresens et afin de délimiter le sujet. Il faut donc :
1- prendre le temps d’analyser le sujet d’une manière générale mais aussi de manière détaillée. Chaque terme est important dans le libellé du sujet, de même que la manière dont est posé le sujet. Il faut questionner chaque mot (ou expression, voire segment de phrase) :
à quoi fait-il référence ? qu’est-ce qu’il implique ? qu’est-ce qu’il suggère ou sous-entend ? qu’est-ce qu’il dit ? qu’est-ce qu’il ne dit pas ? à quel champ linguistique appartient-il ? à quel champ sémantique appartient-il ? quelles sont ses spécificités ? etc…
2- jeter ses idées sur le papier et écrire au brouillon toutes les questions ou éléments d’information qui viennent à l’esprit (dates, événements, références précises, exemples). Il s’agit d’une recherche: on peut donc écrire au brouillon tout ce qui passe par la tête et choisir même des illustrations tirées de la littérature ou de l’art lorsqu’elles sont pertinentes.
3- penser comment organiser ses idées, après avoir soigneusement trié les informations qui entrent strictement dans le cadre du sujet. Pour ce faire, on élabore un plan détaillé sous forme d’un tableau.
L’introduction
Il vaut mieux adopter un style neutre.
- Ne pas utiliser la première personne du singulier (“Je”) lors de la rédaction mais “nous” (ex: “nous verrons dans une première partie…” ou « nous examinerons… » ; « nous nous interrogerons sur… ») ; le pronom « on » (« on peut constater ») ; la forme impersonnelle (« il est possible d’observer ») ; ou la forme passive (« il est admis que… »).
A éviter ! « Pour conclure je voudrais dire… » ; « J’ai choisi… » ; « je vais me concentrer… » ; « Dans cette rédaction, je vais expliquer… »
- Ne jamais répéter les règles de la dissertation lors de la rédaction. Les professeurs savent déjà les règles de la dissertation: ils n’ont donc pas besoin qu’on leur fasse un cours sur celles-ci.
A éviter ! “dans une dissertation, il faut faire…” ; “je dois commenter ce document…”; “Il faut que je conclue…” Ne jamais commenter le sujet en donnant un avis personnel. Dans une dissertation, on ne doit pas laisser transparaître ses sentiments ou ses impressions, ni avoir de jugement subjectif. On doit expliquer des faits et les analyser, mais on ne doit pas donner d’opinion.
A éviter ! “je pense que le sujet est intéressant…”; “j’aime ce sujet…”; “Enfin, pour moi, l’idée que… est choquante”; « Il me semble que… » ; « Je crois que De Gaulle a raison… »; “L’autre chose qui est étonnante pour moi…; « A mon avis, le plus grand changement qui a causé… »:
- Ne jamais faire référence à des faits personnels. Dans une dissertation, on ne raconte pas sa vie, ni une histoire. On analyse un sujet et des événements.
A éviter ! « On a étudié qu’après la Deuxième Guerre Mondiale… », « J’ai l’intention de raconter »
L’introduction a pour finalité:
- de présenter le sujet,
- de trouver un axe de réflexion (une lecture du sujet)
- d’annoncer succinctement les différentes perspectives qui seront développées au cours de la dissertation afin de faire comprendre au lecteur ce qui va être abordé.
Il ne s’agit pas de raconter une histoire comme le ferait un romancier, sur un mode narratif (un récit), mais au contraire d’expliquer des événements. Expliciter présuppose des questions telles que: Pourquoi ? Comment ? Dans quelle mesure…? En quoi…?
L’introduction doit donc mettre en valeur une problématique : il s’agit de trouver une ligne directrice et la développer.
Il faut ainsi se poser ces questions après avoir bien pensé au sujet : – qu’est-ce que je veux démontrer dans ma dissertation ? – quelle est l’idée principale qui va être discutée tout au long de la dissertation ? – quels points vais-je développer ?
L’introduction doit comporter 3 parties :
1- La première phase de l’introduction contextualise le sujet. Elle le replace dans son contexte historique voire donne un panorama de la situation. Elle donne des informations sur le sujet, mais de manière générale. On peut se poser ces questions afin d’être sûr de délivrer les renseignements essentiels ou principaux sur le sujet :
– de quoi parle-t-on ? qu’est-ce que… ? – quand ? quelle période ? que se passait-il à ce moment-là ou au même moment ? – qui ? quoi ? – où ? – quelle définition ? – quelle était la situation à cette époque ?
2- La seconde phase doit analyser et interroger le sujet, c’est-à-dire qu’il faut trouver les questions que posent le libellé du sujet et ses présupposés. A partir de ces questions, on choisit un axe d’étude particulier. Cette phase constitue la ‘problématique’. Un questionnement doit apparaître dans l’introduction soit sous forme interrogative ou affirmative:
- comment ?…
- dans quelle mesure ?…
- quelles ont été/a été… l’influence/les conséquences/les causes etc…. ?
- ceci pose le problème de…
- ceci nous invite à nous interroger sur…
- ceci soulève le problème suivant : …
- la question de … peut ainsi être posée en ces termes : quel … / en quoi… dans quelle mesure… comment…
3- La troisième phase de l’introduction sert à présenter les différentes grandes parties qui vont être examinées et étudiées. Il faut donc les annoncer clairement en les hiérarchisant, c’est-à-dire montrer quelle sera la partie n°1 et de quoi elle parlera ; quelle sera la partie n°2 et de quoi elle parlera ; quelle sera la partie n°3 et de quoi elle parlera. L’annonce doit être courte et synthétique. Ici apparaitront des mots comme :
– Dans un premier temps…. Dans un second temps… Dans un troisième temps… – Pour commencer… Par la suite… Pour finir… – Tout d’abord… Puis… Enfin…
C’est ici que l’on peut utiliser le ‘nous’ avec un verbe au futur simple de l’indicatif afin d’annoncer les différentes parties à venir dans la dissertation :
– Nous examinerons dans un premier temps… / On examinera… – Nous verrons que… / On verra que… – Nous étudierons (tel aspect)… / Sera étudié (tel aspect)… – Nous montrerons que… / Il sera montré que… – Nous analyserons… Apparence de l’introduction : 1) contexte 2) problématique 3) plan
La conclusion
La conclusion apparaît en toute fin de dissertation. Elle a pour finalité :
- de résumer les points principaux qui ont été développés
- de faire la synthèse de ce qui a été discuté (conséquences, résultats, situation…),
- d’ouvrir de nouvelles perspectives ou de mentionner des questions qui pourraient faire l’objet d’une autre dissertation (prolonger le raisonnement).
La conclusion doit être relativement brève (il ne s’agit pas de commencer une énième partie), concise, synthétique et dynamique. Elle ne doit pas donner de nouveaux exemples ou des idées supplémentaires sur le sujet. En effet, il ne s’agit en aucun cas de développer un point nouveau ou une idée qui aurait été négligée, omise, ou oubliée durant la dissertation. Il ne s’agit pas non plus de donner des réponses à des questions qui n’auraient pas été abordées auparavant (restez cohérent et logique !).
Mais il faut toujours donner l’impression que d’autres choses pourraient être dites, que le sujet, s’il a été traité, pourrait être en réalité approfondi par d’autres éléments, par d’autres questions, par d’autres perspectives d’approche.
On peut par exemple terminer par une comparaison avec une autre période, en reliant des faits étudiés à d’autres événements (les relier par exemple au contexte international ou à la période contemporaine). On peut établir des parallèles, des ponts avec d’autres sujets, d’autres domaines, d’autres pays. Il faut ainsi se poser ces questions après avoir bien étudié le sujet : – qu’est-ce que j’ai démontré et analysé dans ma dissertation ? – quel bilan puis-je faire de mes explications ? quel est le résultat auquel je suis parvenu(e) ? – quels points pourraient encore être développés ? Quel(s) nouveau(x) problème(s) sont soulevés par mon étude ?
La conclusion doit comporter 3 parties :
1- Il faut tout d’abord résumer le propos et faire la synthèse de ce qui vient d’être développé, donner une réponse la problématique qui a été posée au début de la dissertation. Il faut clairement montrer que l’on termine sa dissertation. On peut utiliser des formules comme:
- En conclusion, nous avons vu que…
- En définitive il apparaît que…
- Pour conclure on pourrait dire que…
- Finalement, nous avons montré que…
2- Il faut alors donner une réponse au problème qui a été posé au début de la dissertation dans l’introduction. C’est ici que l’on peut nuancer son propos, donner ses conclusions sur la question, dire à quelle conclusion l’on est parvenu après examen du sujet.
3- Pour terminer, l’on peut suggérer les limites ou les apories du sujet et envisager d’autres pistes de lecture éventuelles, d’autres perspectives d’étude, d’autres questions ou plus générales ou plus pointues. Cette dernière étape doit ‘ouvrir’ la dissertation et non pas clore totalement le sujet (un sujet n’est jamais totalement épuisé ou totalement analysé même après étude; l’on peut toujours trouver d’autres perspectives de recherche pour l’approfondir, renouveler les interprétations ou les analyses…).
Apparence de la conclusion : 1) Résumé de ce qui a été démontré 2) Réponse au problème soulevé 3) Nouvelles approches
Articles similaires

STAGE COLLECTIF REMISE A NIVEAU 6EME VERS 5EME: REPRENDRE L’ANNEE SEREINEMENT !

STAGE COLLECTIF REMISE A NIVEAU PRIMAIRE : REPRENDRE L’ANNEE SEREINEMENT !

STAGE COLLECTIF VISIO SEMAINE REVISION : DERNIERE LIGNE DROITE BAC FRANCAIS !

BREVET : DERNIERE LIGNE DROITE !

STAGE COLLECTIF VISIO FEVRIER : LA CLE POUR REUSSIR SON EXAMEN DE FRANCAIS
Révise le bac : sujets officiels corrigés d’Algérie 2024
Révisions de dernière minute ? Tu as besoin de t’entraîner avec les sujets corrigés du bac général 2024 d’Algérie ? Élève de première ou de terminale, cet article est pour toi ! Les sujets du centre étranger d’examen d’Algérie tombent du 3 au 7 juin, c’est-à-dire une semaine avant la métropole ! Retrouve les sujets officiels et leur corrigé de la session du bac 2024 en Algérie. Nos profs te donnent des conseils de dernière minute et un dernier point sur la méthode : de quoi décrocher la mention !

Tes épreuves écrites se déroulent entre les 14 et 21 juin si tu es en métropole. Révise en réalisant, dans les temps, l’un des sujets corrigés du bac général 2024 d’Algérie ! Tu peux retrouver le corrigé réalisé par notre communauté enseignante. Entraîne-toi autant de fois que nécessaire, et n’hésite pas à aller sur digiSchool.fr pour affiner tes connaissances en relisant les cours ou en faisant plus d’annales. Prépare-toi pour être au top le jour de l’examen !
Les sujets officiels nous sont directement transmis par le service presse de l’Éducation nationale.
- Sujet officiel de l’épreuve anticipée de français
- Sujet corrigé de l’épreuve de philosophie du bac d’Algérie 2024
- Sujet de la spécialité HGGSP
- Spécialité HLP, sujet officiel 2024
- Épreuve corrigé de la spécialité SVT du bac d’Algérie
- Sujet officiel corrigé de la spécialité SES
- Sujet officiel corrigé de la spécialité physique-chimie
- Spécialité maths, sujet corrigé de l’épreuve officielle
/!\ ATTENTION : Si vous avez déjà lu l’article sur le bac général du Liban 2024 , il s’agit des mêmes sujets. /!\
Les épreuves du bac général vont bientôt se dérouler. Retrouve, ci-dessous, les sujets corrigés du bac général 2024 d’Algérie et leur correction made by digiSchool ! Français, philo ou spé. ? Entraîne-toi afin d’être au top le jour J.
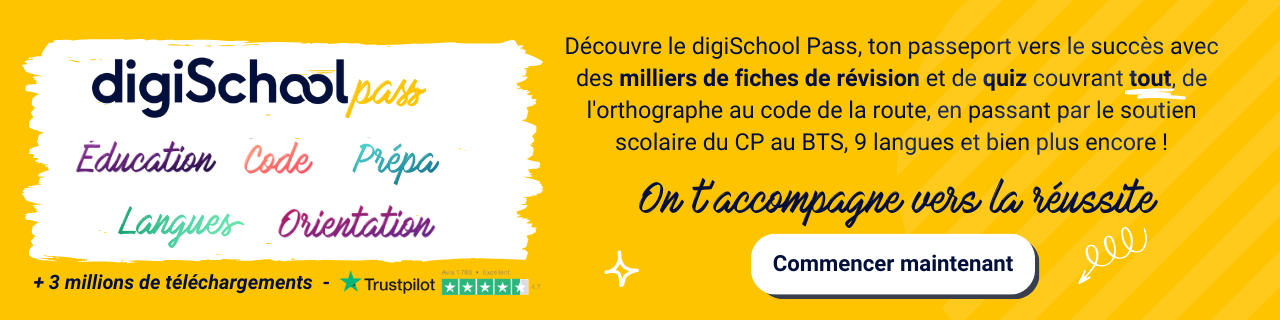
Sujet officiel corrigé de l’épreuve anticipée de français 2024
Les élèves du centre étranger d’examen d’Algérie devront rédiger une dissertation, une analyse de texte ou un commentaire pour l’épreuve anticipée de français. Le commentaire est un extrait d’une pièce de théâtre d’Alfred de Musset intitulée Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée . Pour la dissertation, les trois sujets au choix portent sur la poésie avec une œuvre d’Arthur Rimbaud, une de Francis Ponge ou une autre d’Hélène Dorion.
Consulte également notre article sur les sujets probables du bac de français 2024 pour continuer ton entraînement.
Sujet officiel
Sujet corrigé.
Affine tes connaissances grâce à nos cours sur le roman , la poésie , le théâtre et la littérature d’idées . Teste-toi avec nos quiz sur les œuvres au programme comme « Rabelais, Gargantua » ou sur les genres littéraires comme « Le genre poétique ». Le diplôme est à portée de main !
Philo 2024 : sujet officiel corrigé du bac d’Algérie
Consulte nos cours sur les notions d’ art , de vérité , de liberté , et bien d’autres, pour réviser ! Retrouve également nos annales pour plus d’entraînement et un exemple de mise en situation.
Les deux sujets de dissertation de philosophie au choix sont : « L’art nous aide-t-il à vivre ? » et « Pourquoi faut-il se fier à la science ? » Le commentaire de texte que les élèves d’Algérie ont à l’épreuve du bac est un extrait de L’Éthique à Nicomaque d’Aristote.
Des doutes sur la méthode de dissertation ou d’explication de texte pour les épreuves de philo ? Consulte sur digiSchool.fr comment réaliser une bonne introduction et une bonne conclusion de dissertation expliquée par nos profs et tous nos cours de philosophie de terminale . Tu peux également parcourir notre article sur les sujets probables du bac de philo 2024 ou les fiches de révisions des notions de philosophie !
Sujet officiel corrigé de la spécialité HGGSP 2024
Au point sur les chapitres « Affirmations de puissance, rivalités et coopérations » et « La Chine : à la conquête de l’espace, des mers et des océans » ? Consulte nos leçons HGGSP pour vérifier et préciser tes connaissances en HGGSP !
Les deux sujets au choix pour la dissertation sont disponibles :
- en juin 2024
L’étude critique de documents sera disponible à la même date.
PDF prévu dès le 5 juin 2024
Besoin de conseils de dernière minute sur la méthode ? Consulte sur digiSchool.fr la méthodologie de la dissertation expliquée par nos profs. Tu peux également parcourir notre article sur les sujets probables du bac de spé. HGGSP 2024 . La mention n’attend plus que toi !
Spé. HLP 2024 : le sujet officiel du bac d’Algérie
Les deux sujets proposés aux élèves d’Algérie pour la spé. HLP sont disponibles en juin 2024 . Le corrigé d’interprétation philosophique ou littéraire et celui d’essai philosophique ou littéraire te permettront de t’entraîner.
Retrouve notre article sur les sujets susceptibles de tomber au bac 2024 pour la spé. HLP pour t’aider !
Besoin de peaufiner tes connaissances sur le chapitre « La recherche de soi » pour répondre au quiz « Éduquer, est-ce éveiller ou transmettre ? » ? Retrouve, sur digiSchool.fr, nos cours et nos quiz de spé. HLP pour t’aider dans ce projet. Continue de te tester avec nos annales !
Bac Algérie 2024 : sujet et corrigé de la spé. SVT
Le corrigé de la question du texte argumenté et celui concernant le développement scientifique répondant à un problème sont disponibles en juin 2024 .
Retrouve sur notre chaîne YouTube des vidéos sur la partie pratique d’évaluation des compétences expérimentales pour réviser.
Des questions sur la méthode ? Consulte toutes nos leçons de spé. SVT de terminale sur digiSchool.fr. Parcours notre article sur les sujets probables du bac de la spé. SVT 2024 . Entraîne-toi avec les annales disponibles sur notre site !
Spé. SES : sujet officiel du bac 2024 en Algérie
Éprouve tes connaissances en SES avec des quiz sur « Les déterminants des échanges entre pays différents » ou « Les crises financières » ! Entraîne-toi avec nos annales en attendant les sujets corrigés du bac général 2024 d’Algérie.
Pour l’épreuve de SES, tu peux choisir entre la dissertation et l’épreuve composée .
Pour la dissertation, tu disposes d’un dossier documentaire comprenant quatre documents : trois tableaux à analyser et un extrait du Code de la propriété intellectuelle . En te basant sur ces documents, tu devras répondre à la question suivante : Quelles sont les sources de la croissance économique ?
Si tu optes pour l’épreuve composée, ta réflexion se structurera en trois parties. La première partie Mobilisation des connaissances , te demande de présenter le paradoxe de l’action collective . La deuxième partie Étude d’un document consiste à répondre à deux questions en utilisant un graphique à l’appui. La troisième partie Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire , quant à elle, inclut deux documents (un extrait de texte et un tableau) qui t’aideront à répondre à la problématique suivante : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que les facteurs de structuration de l’espace social sont multiples.
Tu ne sais plus faire des fiches de révisions en SES ? Tu veux revoir la méthode de travail dans cette spé. ? Suis les conseils de nos profs sur notre site digiSchool.fr avec l’ensemble de nos cours de SES . Tu peux aussi réviser avec nos cours pour réussir ton épreuve. Consulte notre article sur les sujets susceptibles de tomber au bac de spé. SES 2024 .
Centre examen Algérie 2024 : sujet officiel et corrigé spé. physique-chimie
Les trois exercices donnés pour le bac 2024 de la spé. physique-chimie sont disponibles en juin 2024 .
En attendant, teste-toi avec notre quiz sur la réaction acide-base , et révise la concentration d’une solution avec notre cours.
Tu as des interrogations sur la partie pratique de l’examen ? Consulte notre chaîne YouTube et découvre les explications données par nos profs. Retrouve nos cours de physique-chimie pour préciser tes acquis. Entraîne-toi avec nos quiz et nos annales qui sont disponibles sur digiSchool.fr. N’hésite pas !
Spé. maths : sujet et corrigé de la session Algérie 2024
Trouve ci-dessous les 3-5 exercices de l’épreuve de spé. maths Algérie 2024 en juin .
En attendant, consulte nos annales pour te perfectionner avant le jour J ! Notre article sur les sujets probables de la spé. maths au bac 2024 peut également t’intéresser.
Fébrile ? Retrouve nos quiz disponibles sur digiSchool.fr pour t’entraîner ! Que ce soit sur la réunion, produit cartésien et parties d’ensembles , ou sur orthogonalité et produit scalaire , teste tes acquis pour parfaire ta technique. N’hésite pas à consulter nos cours pour affiner tes connaissances. Pour un bac sans angoisse !
Quel sera ton niveau de réussite avec les sujets corrigés du bac général 2024 d’Algérie ? Français, philo, spécialités, continue tes révisions pour la session du bac 2024 en retrouvant nos annales sur digiSchool.fr. Précise et éprouve tes connaissances grâce à nos leçons et à nos quiz.
Bonne chance pour les épreuves qui approchent !
Tu veux réviser plus et d’autres contenus ? Rejoins-nous sur digiSchool Éducation ! Tu peux également t’abonner à notre chaîne digiSchool Lycée sur YouTube. Tu retrouveras des LIVES de révisions juste avant les épreuves ! On t’attend !
Évitez les fautes dans vos écrits académiques
Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.
- Dissertation
6 étapes incontournables pour réaliser une dissertation
Publié le 2 octobre 2019 par Justine Debret . Mis à jour le 31 janvier 2024.
En français, la dissertation est un exercice d’argumentation qui se construit en 6 étapes. Nous allons vous expliquer comment faire une dissertation de A à Z.
Pour faire une dissertation, c’est très simple :
- Lire et analyser le sujet
- Trouver la problématique
- Faire le plan de la dissertation
- Rédiger l’introduction
- Rédiger le développement
- Faire la conclusion
Pour tout comprendre sur comment faire une dissertation, nous allons utiliser un exemple concret issu des annales du Bac S de philosophie de 2019.
Table des matières
1. lire et analyser le sujet, 2. trouver la problématique, 3. faire le plan de la dissertation, 4. rédiger l’introduction, 5. rédiger le développement de la dissertation, 6. ecrire la conclusion, présentation gratuite.
Vous allez devoir produire une réflexion organisée sur un sujet spécifique qui vous est imposé.
Le sujet peut être :
- une question
- un thème ou concept
- une citation
Si vous avez le choix entre plusieurs sujets, sélectionnez celui qui vous inspire le plus et sur lequel vous avez le plus de connaissances. Il faudra le choisir rapidement si vous devez faire une dissertation lors d’un examen de quelques heures (dans les 10 premières minutes).
Une fois le sujet choisi, vous allez devoir définir chaque terme présent dans l’intitulé, afin de mieux le comprendre.
Exemple : Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté ?
Essayez ensuite de reformuler le sujet complètement à partir de vos définitions ou de synonymes.
Reformuler des textes efficacement
Reformulez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre outil de paraphrase gratuit.
Reformuler un texte gratuitement
Lisez plusieurs fois la reformulation du sujet rédigée à partir de vos définitions. Au brouillon, écrivez toutes les idées qui vous viennent à l’esprit sur le sujet (exemples, auteurs, événements, …).
C’est à partir de ces connaissances et votre reformulation que vous allez pouvoir trouver votre problématique.
Petit conseil ! Utilisez cette question clé : à quel(s) problème(s) ces connaissances tentent-elles de répondre ?
Une question centrale va émerger et c’est à partir de cette dernière que votre dissertation va se construire pour créer un débat où s’affrontent des thèses divergentes.
Le plan d’une dissertation peut prendre diverses formes. L’important est qu’il réponde bien à votre problématique pour que vous évitiez le hors-sujet.
- Utilisez votre brouillon initial sur lequel vous avez noté vos idées.
- Classez ensuite ces idées par thématique ou argument.
- Normalement, vous pourrez arriver à deux ou trois idées principales, divisées en deux ou trois sous-parties qui seront illustrées par des exemples concrets.
- N’oubliez pas de rédiger une transition entre chaque grande partie (conclusion de la partie actuelle et introduction de la partie suivante).
I) Les devoirs de l’Homme, une soumission naturelle et nécessaire ?
1) Les devoirs, un concept pluriel et contextuel -> Expliquez ici quels sont les différents devoirs que nous rencontrons et en quoi il divergent en fonction des cultures et systèmes étatiques. -> L’existence de devoirs pluriels (travail, citoyenneté, devoir par rapport à la famille, devoir scolaire, droits et devoirs de l’Homme).
2) L’Homme contraint par nature ? -> Concept de contrainte imposée par la nature sur l’Homme (la nature de l’Homme). -> Hobbes et “l’Homme est un loup pour l’Homme” : il abandonne sa liberté et vit en société pour survivre car la nature de l’Homme est agressive.
3) L’Homme : un animal social contraint pour sa liberté ? -> Aristote parlait du concept d’”animal social”. -> Le devoir de morale et d’empathie chez Rousseau fait qu’un être est humain (naturellement) et sociable. -> Sartre et son concept de liberté et libre arbitre : l’Homme est libre et responsable de ses actes naturellement (c’est inné). C’est pour cela qu’il peut vivre en société.
– TRANSITION –
II) La libération de l’Homme par le devoir
1) La culture libératrice -> Le devoir nous permet de nous cultiver et donc de nous libérer de la nature qui est en nous (Kant). -> L’école et l’éducation, le vote, … sont des droits et devoirs qui nous libèrent de notre ignorance naturelle (innée) et de la contrainte du déterminisme. -> Freud et les pulsions de l’Homme qui sont contrôlées intérieurement pas le surmoi. La pression sociale et les devoirs sociaux nous permettent de nous libérer de nos pulsions et désirs en les rejetant dans le ca.
2) Le travail comme contrainte de libération quotidienne -> Le concept de travail comme contrainte/liberté (apporte l’estime de soi, mais nous contraint lourdement) avec Platon, Marx (“l’opium du peuple”) et Kant.
3) La reconnaissance comme liberté -> Kant définit l’autonomie comme la capacité à se donner ses propres règles et de les suivre. La liberté ne consiste donc pas à échapper à toute règle, à tout devoir, mais à se les donner et à y soumettre ses actes. -> Exemple du devoir de mémoire des survivants de la Seconde Guerre mondiale : processus de libération psychologique personnelle et rôle de devoir citoyen.
L’introduction d’une dissertation doit suivre une structure stricte. Elle introduit le sujet, la problématique et le plan.
Les parties d’une introduction de dissertation sont :
- Une amorce ou phrase d’accroche.
- L’énoncé du sujet.
- La définition des termes et reformulation du sujet.
- La problématique.
- L’annonce du plan.
Le droit de vote est considéré par les institutions comme un devoir moral pour les citoyens, comme le rappelle l’inscription figurant sur les cartes électorales : « Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ».
Les devoirs explicitent un comportement à suivre ou à ne pas suivre. Ils préconisent la conformité avec une règle. Cette notion semble en contradiction avec celle de la liberté, car le devoir s’opposerait à une impulsion ou un désir qui définirait notre liberté.
Toutefois, cette conception de la liberté est naïve et limitée, car être libre ne consiste pas à faire ce que l’on veut. De même, le devoir ne se limite pas à une contrainte imposée de l’extérieur. Il peut s’agit d’une obligation qu l’on décide de s’imposer librement.
Nous questionnons donc ces concepts en essayant de répondre à la problématique suivante : peut-on vraiment dire qu’on renonce à sa liberté quand on fait le choix de se soumettre à ses devoirs, quand on exerce donc sa liberté avec son libre-arbitre ?
Notre raisonnement questionnera tout d’abord les devoirs de l’Homme comme une soumission naturelle et nécessaire (I), avant d’interroger la possible libération de l’Homme par le devoir (II).
Corriger des documents en 5 minutes
Trouvez rapidement et facilement les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation dans vos textes.
- Correction d'un document en 5 minutes
- Appliquer les modifications en 1 clic
- Corriger des documents pendant 30 jours
Essayez le correcteur IA

Le développement d’une dissertation comporte toujours deux ou trois parties. Si vous faites une dissertation en deux parties, vous devrez rédiger trois sous-parties pour chacune (deux si vous faites trois grandes parties).
Chaque partie soutient une idée centrale qui répond à la problématique, alors que chaque sous-partie s’articule autour d’un argument qui soutient et illustre l’idée directrice.
Vos arguments doivent absolument être illustrés par un exemple !
Entre chaque partie, vous devez rédiger une transition qui conclut la partie précédente et annonce la partie suivante.
La conclusion d’une dissertation est une brève synthèse du développement en indiquant nettement la réponse à la question posée dans l’introduction. Il est aussi possible d’ajouter une ouverture à la fin.
Notre étude a montré qu’au-delà du poids contraignant des devoirs que l’on peut sentir au premier abord, ils n’entravent pas notre réelle liberté. Bien au contraire, nos devoirs nous libèrent de la nature humaine qui est en nous et qui nous rend esclave de nos pulsions, désirs et violence interne. Reconnaître ses devoirs et les accepter, contribue à entretenir notre puissance d’agir et donc notre liberté.
Le concept de devoir reste très lié à celui de droit dans les démocraties occidentales. Le droit de vote est-il libérateur ?
Voici une présentation que vous pouvez utiliser pour vous améliorer ou partager nos conseils méthodologiques sur la dissertation. N’hésitez pas à la partager ou à l’utiliser lors de vos cours :).
Sur Google Slides En version PowerPoint
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.
Debret, J. (2024, 31 janvier). 6 étapes incontournables pour réaliser une dissertation. Scribbr. Consulté le 5 juin 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/comment-faire-une-dissertation/
Cet article est-il utile ?
Justine Debret
D'autres étudiants ont aussi consulté..., conclusion d’une dissertation : comment la rédiger , essay : comment faire une dissertation en anglais , introduction de dissertation.

COMMENTS
Étape 3 de la méthode d'une dissertation - Faire un plan. Maintenant que vous avez une problématique, il faut faire un plan qui y répond. Recherchez des idées et notez-les de manière ordonnée. En fonction du sujet de dissertation de philosophie proposé, un type de plan va s'imposer : dialectique, analytique ou thématique.
Méthodologie de la dissertation de philosophie : La Rédaction. L'introduction comporte deux parties : Le premier paragraphe est la présentation détaillée de la problématique. Le deuxième paragraphe est l'exposé rapide du plan que vous allez suivre : présentez rapidement l'idée principale de chaque partie.
Méthodologie pour faire la dissertation en philosophie étape par étape. La dissertation en philo, de l'introduction à la rédaction et jusqu'à la conclusion : comment faire ? Décortiquons ...
Une dissertation réussie se prépare avec trois ingrédients : une méthode (ensemble de règles qui guide la réflexion), de la culture (culture personnelle et culture philosophique acquise en cours) et de la curiosité (la philosophie est un regard curieux sur soi-même et sur le monde). L'épreuve de la dissertation dure 4 heures.
La dissertation philosophique est un exercice scolaire qui consiste à poser un problème en fonction d'un sujet donné et à y répondre par une rgumentation a rigoureuse. Elle n'est pas pure technique, aucune série de « conseils » ne saurait constituer le moyen automatique - la « recette infaillible » - pour obtenir une très ...
Reprenons les bases de la dissertation de philosophie pour vous préparer au baccalauréat. Vous profiterez en plus tout au long de l'article des conseils des professeurs de philosophie ...
Mais, même en première approche, une définition n'en est pas une si l'on ne peut aller du concept à la définition, et surtout de la définition au concept2.Supposonsquel'ondiseparexemple«laguerre,c'estleconflit». ... Méthode de la dissertation philosophique
Comme pour la dissertation, l'introduction est un moment absolument fondamental du commentaire. L'on pourrait penser, à première vue, que la tâche de l'introduction du commentaire est moins significative que celle de la dissertation, en disant à peu près : dans la dissertation, il s'agit d'inventer un problème, tandis que, dans le commentaire, le texte, donc le problème, est ...
Notre article sur la méthode de la dissertation en philosophie Notre article sur le plan d'une dissertation en philosophie Notre service de correction et relecture pour la dissertation . Salut, nous c'est Scribbr 👋 ...
Elle permet de définir les termes du sujet et d'annoncer le plan. Dans l'introduction d'une dissertation de philosophie, on retrouve ces éléments : la phrase d'accroche (amorce) ; l'énoncé du sujet ; la définition termes et reformulation du sujet ; la problématique ; l'annonce du plan.
Il y a 3 étapes à prendre en compte dans la construction de ta dissertation de philosophie, si tu les appliques tu auras toutes les cartes en main pour faire une bonne disserte. 1. Quelle méthode choisir ? Quelle architecture de dissertation est la meilleure ? Les méthodes de dissertation sont variées.
Une bonne préparation te permettra de réussir et de peut-être t'assurer une bonne note à la dissertation et décrocher une mention au bac de philosophie. Il y a 3 étapes à prendre en compte dans la construction de ta dissertation de philosophie, si tu les appliques tu auras toutes les cartes en main pour faire une bonne disserte. 1.
Dans ce troisième épisode consacré à la méthodologie, je vais vous donner quatre étapes à suivre pour bien commencer votre dissertation de philosophie. Il s'agit des différentes étapes à suivre au brouillon pour réaliser votre introduction de dissertation et votre plan. Tout d'abord première étape, il faut analyser le sujet et ...
Méthodologie de la dissertation philosophique classe de première C & D Situation Problème : Après avoir fait votre leçon sur la logique, votre enseignant vous propose un sujet de dissertation philosophique dans le but de contrôler votre degré d'appropriation des apprentissages.
Introduction. La dissertation de philosophie est peut-être celle qui pose le plus de problèmes de méthode en général. En effet, c'est souvent ce que les professeurs déplorent à chaque correction : les élèves n'ont pas su faire de bonnes problématiques, n'ont pas su analyser les exemples, ont mal construit le plan, mal géré les transitions, etc. Comparée à la dissertation de ...
La dissertation requiert : Une méthode. Une méthode est un ensemble de règles auxquelles il convient de conformer la conduite de sa réflexion. Quel que soit le sujet à traiter, ces règles doivent être respectées. Ce respect ne préjuge pas de la qualité de votre réflexion car celle-ci est aussi tributaire de la richesse des contenus ...
Quand vous découvrez un sujet de dissertation, demandez-vous toujours en premier lieu pourquoi la question vaut d'être posée. La première étape de la dissertation philosophique consiste à transformer la question posée en un problème philosophique. Cette étape s'appuie sur l'analyse des termes du sujet.
Exemples de préparation et de rédaction du commentaire de texte. Ce véritable guide pédagogique apporte méthode et règles de travail pour composer une dissertation et un commentaire de texte philosophiques. Copier RUSS Jacqueline, FARAGO France, Les méthodes en philosophie. Armand Colin, « Cursus », 2017, ISBN : 9782200617264.
Bonsoir, s'il vous plait, je n'ai jamais fait philo ,niveau première 2015. J'aimerais obtenir un exemple de sujet , puis un corrigé quelconque afin de me faire observer la méthode. merci. ... 06/08/2020 at 10:51 . J'aimerais comprendre beaucoup plus la méthodologie de la dissertation en philo . avoir des sujets. says: Carnes sylphat ...
Méthodologie de la dissertation : règles générales, introduction et conclusion. Passer au contenu. ... 1- La première phase de l'introduction contextualise le sujet. Elle le replace dans son contexte historique voire donne un panorama de la situation. ... ABC COURS peut vous proposer un professeur spécialiste de la Philosophie pour lui ...
Afin que vous compreniez mieux ce que l'on attend de vous dans une dissertation, voici un exemple de dissertation de philosophie. A chaque fois, je précise entre parenthèses juste après à quelle étape de la méthodologie de la dissertation cela correspond. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire d'abord cet article sur la ...
Les deux sujets de dissertation de philosophie et le commentaire de texte que les élèves d'Algérie ont à l'épreuve du bac seront disponibles en juin 2024. Sujet officiel. PDF prévu dès le 4 juin 2024. Sujet corrigé. PDF prévu dès le 4 juin 2024. Des doutes sur la méthode de dissertation ou d'explication de texte pour les ...
Lire et analyser le sujet. Trouver la problématique. Faire le plan de la dissertation. Rédiger l'introduction. Rédiger le développement. Faire la conclusion. Pour tout comprendre sur comment faire une dissertation, nous allons utiliser un exemple concret issu des annales du Bac S de philosophie de 2019.