
L'art - dissertations de philosophie
- La culture dénature-t-elle l'homme ?
- La culture fait-elle l’homme ?
- La culture nous permet-elle d'échapper à la barbarie ?
- La culture nous rend-elle plus humains ?
- L'art a t-il pour seule fonction de nous plonger dans l'imaginaire ?
- L'art est-il moins nécessaire que la science ?
- L'art fait-il réfléchir ou fait-il rêver ?
- L'artiste doit-il chercher à rendre compte de la réalité ?
- L'artiste est-il maître de son œuvre ?
- L'art modifie-t-il notre rapport à la réalité ?
- L'art peut il se passer de règles ?
- Le plaisir est-il l'origine et la fin de l'art ?
- Les artistes nous aident-ils à être libres ?
- Les artistes sont-ils utiles ?
- Les œuvres d'art éduquent-elles notre perception ?

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

La culture > L'art
voir un extrait gratuit | voir les sujets traités | plans de dissertations | plans de commentaires
Liste des sujets traités

Commentaires disponibles
Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo
Exemple de sujet : L’art nous détourne-t-il de la réalité ?
Le problème consiste ici à remarquer que le statut de l’art est ambigu. L’art procède initialement d’un travail technique qui a pour but de produire une représentation esthétique, c’est-à-dire une oeuvre qui se montre. Mais, pour autant une oeuvre d’art n’est jamais totalement autonome dans le sens où elle représente toujours quelque chose, que cette chose soit une réalité physique (un objet du monde par exemple) ou une idée abstraite qui décide l’auteur de l’oeuvre à la créer. L’art est donc une forme de langage qui n’est pas vraiment autonome, mais qui re-présente ce qui a déjà été présenté. En ce sens, si une oeuvre traduit ce qu’un auteur, un artiste a cherché à y montrer, l’oeuvre d’art n’est jamais vraiment elle-même sans pouvoir non plus être autre chose qu’elle-même, sans pouvoir se substituer à ce qu’elle montre ou décrit. Se poser la question du rapport de l’art à la réalité traduit ce paradoxe puisqu’il semble que l’art est à la fois une production autonome qui a une existence esthétique propre et une illusion qui ment sur elle-même et se fait passer pour une réalité qu’elle n’est pas et dont elle détourne.... [voir le corrigé complet]
“L’art nous apprend-il quelque chose ?” Découvrez le corrigé !
Les sujets du bac philo 2023 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui ont été donnés, mercredi matin.
La première dissertation proposée aux élèves de terminale en filière technologique était : « L’art nous apprend-il quelque chose ? »
Mathias Roux , professeur de philosophie, vous propose son corrigé.
Expresso : les parcours interactifs

Joie d’aimer, joie de vivre
Sur le même sujet, corrigés du bac philo – filière technologique : “l’art nous apprend-t-il quelque chose ”.
L’artiste cherche-t-il à délivrer un savoir lorsqu’il crée une œuvre ? N’a-t-il pas plutôt pour vocation de donner à voir quelque chose de…

Corrigés du bac philo – filière technologique : extrait de l’“Encyclopédie”, de Denis Diderot
Dans ce texte de Denis Diderot, extrait de l’Encyclopédie qu’il a co-écrite avec d’Alembert, l’auteur explique à quelles conditions un témoignage…

L’art désigne un ensemble de procédés visant un résultat pratique. Mais cette notion doit être vite distinguée de son acception technique au profit de son sens esthétique. L’art de l’ingénieur n’est pas celui de l’artiste qui s’adonne…
“Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?” Découvrez le corrigé !
Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi matin…

Sujets du bac philo 2023 : découvrez les intitulés et les corrigés
Les sujets du bac philo 2023 sont tombés ! Dans chaque filière, générale et technologique, les élèves avaient le choix entre trois sujets, deux dissertations…

“Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?” Découvrez le corrigé !
Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi…

Explication de texte : Cournot, “Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique”. Découvrez le corrigé !
Les sujets du bac philo 2022 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les sujets de dissertation et d’explication de texte qui sont tombés, mercredi matin…

"Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?" Découvrez le corrigé !

Consulter le journal
Bac philo 2022 : corrigé du sujet « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? »
Evelyne Oléon, professeure agrégée de philosophie, propose un corrigé d’un des sujets de l’épreuve de philosophie du baccalauréat général 2022.
Par Service Campus
Temps de Lecture 3 min.
- Ajouter à vos sélections Ajouter à vos sélections
- Partager sur Twitter
- Partager sur Messenger
- Partager sur Facebook
- Envoyer par e-mail
- Partager sur Linkedin
- Copier le lien
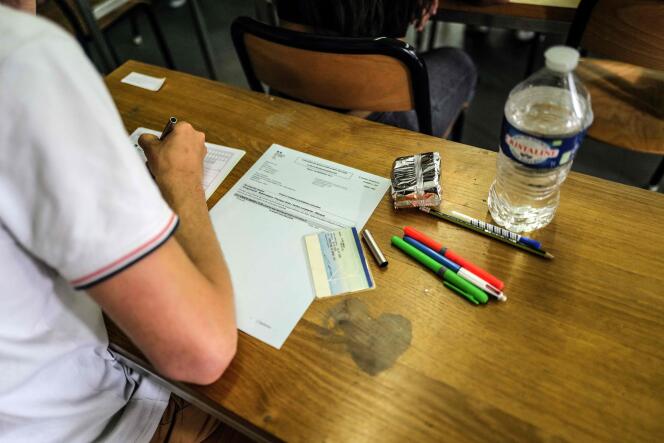
Ce mercredi 15 juin, les élèves de terminale générale passent l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Voici le corrigé d’un des deux sujets de dissertation proposés, réalisé par la professeure de philosophie Evelyne Oléon.
« Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? »
Analyse – problématisation :
L’expression, au pluriel, « pratiques artistiques » renvoie aux différentes formes d’art envisagées du point de vue du faire : production, création. C’est le travail du sculpteur qui transforme la matière pour lui donner une forme, du musicien qui travaille la matière sonore, du cinéaste qui prend et monte des prises de vues, du romancier. Le sujet insiste sur la diversité de ces pratiques mais invite à les penser aussi dans ce qu’elles ont en commun.
Peuvent-elles transformer le monde ? Ont-elles un pouvoir d’action, de modification sur le monde ? Sont-elles dotées d’une efficience, voire d’une efficacité ? Il faudra les penser par rapport à d’autres pratiques auxquelles on reconnaît un pouvoir de modification. La technique transforme la nature, l’action politique transforme la vie des hommes. Les pratiques artistiques ont-elles un effet sur le monde ? L’art nous semble souvent relever de l’imaginaire et non du réel, ouvrir un espace spirituel de contemplation mais non d’action. Les pratiques artistiques n’interprètent-elles pas le monde plutôt que de le transformer ?
Enfin la question interroge le rapport au monde. Le monde ce n’est pas seulement la nature, le réel mais le monde ambiant, ce que les hommes ont en commun, ce qu’ils habitent ensemble, en tant qu’hommes.
Les pratiques artistiques ont-elles le pouvoir de transformer le monde ? Est-il d’ailleurs souhaitable qu’elles cherchent à le faire ? Quel rapport peut-on établir entre cette transformation du monde, si elle est pensable, et celles engagées par d’autres pratiques comme la pratique politique par exemple. Y a-t-il une manière propre à l’art de transformer le monde des hommes ?
1/Les pratiques artistiques ne transforment pas le monde et il n’est peut-être pas souhaitable qu’elles le fassent
A – Les différentes pratiques artistiques transforment la matière en l’informant, en faisant émerger d’autres possibilités à partir du donné naturel (de nouveaux sons ; de nouvelles formes), mais ne transforment pas le monde en lui-même. Les objets esthétiques sont d’abord des objets imaginaires. Ils constituent une interprétation du monde et non une transformation réelle (un paysage interprète le monde mais ne le modifie pas). L’œuvre d’art est un monde, elle ne transforme pas le monde. C’est ce qui distingue les pratiques artistiques de la technique. L’art se sert des techniques mais les met au service de l’imaginaire alors que le technicien vise à transformer concrètement la nature.
B – Les limites de l’art engagé qui voulait changer le monde, transformer la vie des hommes mais qui perd, se faisant, la gratuité du processus créatif en se pliant à l’idéologie, confondant pratiques artistiques et pratiques politiques. Vouloir changer le monde par l’art, c’est souvent mettre les révolutions esthétiques au service des révolutions politiques – exemple : les constructivistes russes, les futuristes italiens.
2/Les pratiques artistiques ne transforment pas le monde mais notre regard sur le monde
A – Si les pratiques artistiques ne transforment pas le monde, elles peuvent changer notre façon de le voir. Les arts donnent à voir, à percevoir. Il s’agit de changer non pas la vie concrète de la société mais d’opérer une révolution spirituelle. Non pas de « transformer le monde » , comme le dit Marx de la praxis révolutionnaire, mais de « changer la vie » , selon les vœux de Rimbaud.
B – L’art donne à voir – comme le dit Alberti à propos de la perspective à la Renaissance : « Le tableau est une fenêtre sur le monde. » Pour Proust, le peintre opère le regard, donne de nouveaux yeux pour voir le monde. Il réalise, pour notre perception, une catastrophe géologique, un vrai tremblement de terre, renversant des anciens modèles, en créant de nouveaux.
3/Cette transformation esthétique n’est-elle pas aussi une transformation du monde, une transformation spécifique aux pratiques artistiques ?
A – Les changements introduits par les pratiques artistiques ne sauraient se limiter au seul « monde de l’art ». Les pratiques artistiques ont souvent des effets décisifs sur la vie sociale, que l’on pense à la photographie, au cinéma, au rôle qu’ils ont joué dans l’histoire du XX e siècle, révolutionnant le rapport à la trace, à la mémoire, à la manière de faire de l’histoire.
B – Les transformations introduites par l’art ne sont pas seulement celles du regard. Cela est patent avec les pratiques artistiques du XX e siècle, qui agissent directement sur le réel et non sur notre perception du réel : le land art , c’est l’art qui fait le paysage et ne se contente pas de le représenter. Le body art , c’est l’art qui modifie le corps et non notre représentation du corps comme le fait le nu.
Mais les transformations que les pratiques artistiques introduisent sont des transformations spécifiques que l’on ne saurait confondre avec celles introduites par la science, la technique, la politique. Il s’agit de transformations lentes, peu prévisibles, sans mainmise de la volonté, se gardant des idéologies et du désir de pouvoir, se gardant même sans doute de tout projet de transformation du monde.
Conclusion : même s’il convient de penser la spécificité des pratiques artistiques, de leur impact possible sur le monde, même s’il convient de les distinguer de toute autre pratique, les pratiques artistiques contribuent bien à « changer la vie » selon l’expression de Rimbaud, et à faire des mondes.
Service Campus
Le Monde Mémorable

Le génie Chaplin
Personnalités, événements historiques, société… Testez votre culture générale

La fabrique de la loi
Boostez votre mémoire en 10 minutes par jour

Offrir Mémorable
Un cadeau ludique, intelligent et utile chaque jour

Culture générale
Approfondissez vos savoirs grâce à la richesse éditoriale du Monde

Mémorisation
Ancrez durablement vos acquis grâce aux révisions

Découvrez nos offres d’abonnements
Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.
Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois
Ce message s’affichera sur l’autre appareil.
Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.
Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).
Comment ne plus voir ce message ?
En cliquant sur « Continuer à lire ici » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.
Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?
Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.
Y a-t-il d’autres limites ?
Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.
Vous ignorez qui est l’autre personne ?
Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe .
Lecture restreinte
Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article
Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.
Évitez les fautes dans vos écrits académiques
Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.
- Dissertation
Exemple de dissertation de philosophie
Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.
Voici des exemples complets pour une bonne dissertation de philosophie (niveau Bac).
Vous pouvez les utiliser pour étudier la structure du plan d’une dissertation de philosophie , ainsi que la méthode utilisée.
Conseil Avant de rendre votre dissertation de philosophie, relisez et corrigez les fautes. Elles comptent dans votre note finale.
Table des matières
Exemple de dissertation de philosophie sur le travail (1), exemple de dissertation de philosophie sur le concept de liberté (2), exemple de dissertation de philosophie sur l’art (3).
Sujet de la dissertation de philosophie : « Le travail n’est-il qu’une contrainte ? ».
Il s’agit d’une dissertation de philosophie qui porte sur le concept de « travail » et qui le questionne avec la problématique « est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ? ».
Télécharger l’exemple de dissertation de philosophie
Corriger des documents en 5 minutes
Trouvez rapidement et facilement les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation dans vos textes.
- Correction d'un document en 5 minutes
- Appliquer les modifications en 1 clic
- Corriger des documents pendant 30 jours
Essayez le correcteur IA

Sujet de la dissertation de philosophie : « Etre libre, est-ce faire ce que l’on veut ? ».
Cette dissertation de philosophie sur la liberté interroge la nature de l’Homme. La problématique de la dissertation est « l’’Homme est-il un être libre capable de faire des choix rationnels ou est-il esclave de lui-même et de ses désirs ? ».
Sujet de la dissertation de philosophie : « En quoi peut-on dire que l’objet ordinaire diffère de l’oeuvre d’art ? ».
Cette dissertation sur l’art et la technique se demande si l’on peut désigner la création artistique comme l’autre de la production technique ou si ces deux mécanismes se distinguent ?
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.
Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation de philosophie. Scribbr. Consulté le 23 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-philosophie/
Cet article est-il utile ?
Justine Debret
D'autres étudiants ont aussi consulté..., exemple de dissertation juridique, la méthode de la dissertation de philosophie , plan d'une dissertation de philosophie.
Aide en philo
- Corrigé de dissert
- Dossiers / Cours
- Liste de sujets
- Votre correction
- BAC de philo
- Fonctionnement
- Nos certificats
- Infos presse
- MaPhilo recrute
Sujets de philosophie sur L'art
Liste des sujets corrigés les plus demandés :.
Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

I. Définition et rôle de l’art dans la perception de la réalité
L’art, dans son sens le plus large, est une activité humaine qui vise à susciter une émotion, une réflexion ou une prise de conscience chez l’observateur. Il peut prendre de nombreuses formes, de la peinture à la sculpture, en passant par la musique, la littérature, le cinéma, le théâtre, etc. L’art est donc un moyen d’expression, un langage qui permet de communiquer des idées, des sentiments, des visions du monde.
L’art a un rôle fondamental dans notre perception de la réalité. Il nous permet de voir le monde sous un angle différent, de le comprendre et de l’interpréter. Comme le disait Picasso : « L’art est un mensonge qui nous permet de comprendre la vérité ». En d’autres termes, l’art peut déformer la réalité pour mieux la révéler, pour mettre en lumière des aspects que nous ne percevons pas dans notre quotidien.
Cependant, l’art n’est pas seulement un miroir de la réalité, il est aussi un créateur de réalités. Il peut nous faire voir des choses qui n’existent pas, nous faire imaginer des mondes différents, nous faire rêver. Il peut aussi nous faire réfléchir sur notre propre réalité, sur notre place dans le monde, sur nos valeurs et nos croyances.
II. L’art comme moyen d’évasion et de distorsion de la réalité
L’art peut être vu comme un moyen d’évasion, une porte ouverte sur d’autres mondes, d’autres réalités. Il peut nous permettre de nous évader de notre quotidien, de nos problèmes, de nos soucis. Comme le disait Baudelaire : « La vraie vie est ailleurs ». L’art peut nous transporter ailleurs, nous faire rêver, nous faire oublier la réalité.
Mais l’art peut aussi distordre la réalité, la déformer, la transformer. Il peut nous montrer une réalité idéalisée, embellie, ou au contraire une réalité sombre, tragique, dérangeante. Il peut nous faire voir le monde sous un angle différent, nous faire percevoir des choses que nous ne voyons pas dans notre quotidien.
Cependant, cette distorsion de la réalité n’est pas nécessairement négative. Elle peut nous permettre de voir la réalité sous un autre angle, de la comprendre et de l’interpréter différemment. Elle peut aussi nous permettre de prendre du recul, de réfléchir, de questionner notre propre réalité.
III. L’art comme outil de révélation et de critique de la réalité
L’art n’est pas seulement un moyen d’évasion ou de distorsion de la réalité, il est aussi un outil de révélation et de critique de la réalité. Il peut nous faire prendre conscience de certaines réalités, nous faire réfléchir, nous faire questionner notre propre réalité.
Comme le disait Brecht : « L’art n’est pas un miroir pour refléter la réalité, mais un marteau pour la façonner ». L’art peut donc être un outil de transformation de la réalité, un moyen de critiquer, de dénoncer, de remettre en question.
L’art peut aussi être un moyen de résistance, de contestation, de revendication. Il peut être un moyen de dénoncer des injustices, de lutter contre des oppressions, de revendiquer des droits. Il peut être un moyen de faire entendre des voix qui sont souvent ignorées ou marginalisées.
IV. Réconciliation de l’art et de la réalité : une perspective dialectique
L’art et la réalité ne sont pas nécessairement en opposition, ils peuvent être en dialogue, en interaction. L’art peut être un moyen de comprendre la réalité, de l’interpréter, de la transformer. Il peut être un moyen de révéler la réalité, de la critiquer, de la questionner.
Comme le disait Hegel : « L’art est la manifestation sensible de l’idée ». L’art peut donc être un moyen de donner forme à des idées, à des pensées, à des visions du monde. Il peut être un moyen de donner une forme concrète à des concepts abstraits, à des idées complexes.
En conclusion, l’art ne nous détourne pas nécessairement de la réalité, il peut au contraire nous permettre de la comprendre, de l’interpréter, de la transformer. Il peut être un moyen de révéler la réalité, de la critiquer, de la questionner. Il peut être un moyen de donner une forme concrète à des idées, à des pensées, à des visions du monde. Il peut être un moyen de donner une forme concrète à des concepts abstraits, à des idées complexes.
Autres dissertations à découvrir :
- Dissertations
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
philofrançais.fr
"passe ton bac d'abord ", l’art.

Remue-neurones …
Pourquoi des artistes? Pourquoi l’art ? L’art sert-il à quelque chose ? A quoi reconnait-on une oeuvre d’art ? Le Beau est-il toujours la finalité de l’art ? L’art nous détourne-t-il de la réalité ? Pour avoir du goût, faut-il être cultivé ? L’art est-il une illusion ? L’œuvre d’art est-elle une preuve de la liberté ? L’art est-il une forme de langage ? L’art est-il affranchi de toute règle morale ? L’art a-t-il une spécificité par rapport aux autres domaines de l’activité humaine ? L’art dépend-il de règles ou d’un génie créateur ? « Quand y a-t-il art ? »
QUELQUES DEFINITIONS
Art, artiste....
En latin « ars », désignait « l’habileté acquise par l’étude ou la pratique » . Le mot peut donc s’appliquer à toutes les activités humaines qui impliquent la maitrise d’un savoir faire codé : art de la guerre, art oratoire, art d’être ceci ou cela…
Jusqu’au XVIIIème, le nom de celui qui pratique les arts est artisan . (de l’italien artigiano .)
Ce n’est donc que depuis le XVIIIème siècle et parallèlement à l’apparition du mot « technique » que l’art est qualifié par le terme « beaux-arts . C’est donc au XVIIIème siècle que la distinction entre artiste et artisan commence à se faire.
Arts libéraux, Arts mécaniques...

Art et Technique
Dans le champ de l’art, le terme de technique recoupe au moins quatre définitions distinctes, il désigne :
- les matériaux employés dans la réalisation de l’objet exposé
- le savoir faire artisanal de l’artiste
- une simple manière de procéder, qui ne suppose pas nécessairement l’acquisition d’un savoir-faire particulier. (certaines techniques compromettent la spontanéité d’un geste ou entravent les possibilités de découvertes accidentelles).
- Enfin, renvoyant aux productions industrielles, la technique désigne l’ensemble des machines
Petit rappel sur l’histoire de l’art ….
QU'EST-CE QUE L 'ART ?
L’oeuvre d’art est un objet paradoxal puisqu’il est à la fois “inutile” dans la mesure où il n’a pas d’utilité vitale ( Du moins en apparence) et en même temps, il n’y a pas de société humaine sans art. Il y a donc un paradoxe : inutile et en même temps essentiel à l’homme.
Comment alors définir ce qu’est une oeuvre d’art ? D’autant qu’en fonction des époques, la définition peut varier. Au XXI° siècle la question n’est plus tout à fait la même qu’au XVII° ou XVIII°… Aujourd’hui, l’art ne cherche plus le “Beau” , n’est plus soumis à des règles strictes comme il l’était par exemple à l’âge classique. La question que l’on pourra se poser alors sera : Quand y-a-t-il art ?

Emmanuel Kant
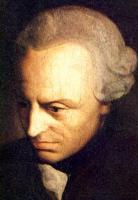
Emmanuel Kant (1724-1804) Philosophe allemand. La Critique de la faculté de juger s’intéresse, en particulier, au jugement de goût, dont l’objet est l’œuvre d’art.
En droit on ne devrait appeler art que la production par liberté, c’est-à-dire par un libre arbitre qui met la raison au fondement de ses actions. On se plaît à nommer une œuvre d’art le produit des abeilles (les gâteaux de cire régulièrement construits), mais ce n’est qu’en raison d’une analogie avec l’art ; en effet, dès que l’on songe que les abeilles ne fondent leur travail sur aucune réflexion proprement rationnelle, on déclare aussitôt qu’il s’agit d’un produit de leur nature (de l’instinct), et c’est seulement à leur créateur qu’on l’attribue en tant qu’art.
Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger (1750)

Pour qu’il y ait « art », il faut qu’il y ait intention. Les abeilles n’ont pas une intention. Elles fabriquent ce que pour quoi elles sont programmées. Elles ne savent rien faire d’autre. . C’est une activité innée et non une manifestation de l’esprit. Pour Kant, on ne peut donc « appeler art » que la production par liberté ».
Alain : L’art déborde les règles...

Alain (Émile Chartier, 1868-1951), dans Système des Beaux-Arts, montre qu’il n’y a pas de commune mesure entre la façon de procéder de l’artisan, maître des règles qui le rendent compétent dans son métier, et la manière de créer de l’artiste dont l’activité (en tant qu’elle est proprement artistique) ne se soumet à aucune règle préalable.
Il reste à dire en quoi l’artiste diffère de l’artisan. Toutes les fois que l’idée précède et règle l’exécution, c’est industrie. Et encore est-il vrai que l’oeuvre souvent, même dans l’industrie, redresse l’idée en ce sens que l’artisan trouve mieux qu’il n’avait pensé dès qu’il essaie ; en cela il est artiste, mais par éclairs. Toujours est-il que la représentation d’une idée dans une chose, je dis même d’une idée bien définie comme le dessin d’une maison, est une oeuvre mécanique seulement, en ce sens qu’une machine bien réglée d’abord ferait l’oeuvre à mille exemplaires. Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu’il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu’il emploiera à l’oeuvre qu’il commence ; l’idée lui vient à mesure qu’il fait ; il serait même rigoureux de dire que l’idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu’il est spectateur aussi de son oeuvre en train de naître. Et c’est là le propre de l’artiste. Il faut que le génie ait la grâce de la nature et s’étonne lui-même.
Un beau vers n’est pas d’abord en projet, et ensuite fait ; mais il se montre beau au poète ; et la belle statue se montre belle au sculpteur à mesure qu’il la fait ; et le portrait naît sous le pinceau. […] Ainsi la règle du Beau n’apparaît que dans l’oeuvre et y reste prise, en sorte qu’elle ne peut servir jamais, d’aucune manière, à faire une autre oeuvre.
Alain, Système des Beaux-Arts , (1920), Livre I, Chap. VII

La spécificité de la création artistique tient au débordement des règles par l’artiste. C’est par ce dépassement des règles que l’œuvre d’art prend forme au fur et à mesure, sous la main de l’artiste. Aucune règle ne préside, à l’avance, à l’apparition du beau. Alain montre ici que l’artiste ne possède pas une idée déterminée de l’œuvre qu’il réalise. C’est en réalisant son œuvre que la règle qui la détermine est rendue manifeste. C’est donc bien cette absence préalable d’idée et de règle qui présiderait à la réalisation d’une œuvre qui caractérise l’art. C’est pourquoi l’œuvre d’art est toujours singulière, là où, à l’inverse, l’œuvre technique, suivant un procédé de réalisation prédéfini, peut être reproduite à l’infini. L’œuvre d’art est caractérisée par la non-reproductibilité en raison du fait que la création artistique déborde les règles (pas de règles préexistantes à l’œuvre qui suffisent à déterminer sa création). L’artiste n’est donc pas seulement un artisan car il ne fabrique pas seulement, il crée. Ce texte suppose reconnu que les artistes sont aussi et d’abord des artisans : ils ont à apprendre les opérations nécessaires à la production d’oeuvres techniquement maîtrisées. Mais l’essentiel de la création artistique est ailleurs : il est, sinon dans l’oubli, du moins dans le débordement des règles, par quoi l’oeuvre prend forme au fur et à mesure qu’elle est produite tandis que l’artiste, spectateur de lui-même, donne corps à la beauté. Nulle règle ne préside, à l’avance, à l’apparition du beau qui devient ainsi, pour lui-même et de manière singulière, sa propre règle. Mais, l’absence de règles, préalables et suffisantes pour la création d’oeuvres d’art, peut être rapportée à l’absence de concept rigoureusement déterminé, dans l’esprit de l’artiste, de ce que devrait être le beau. Ne sachant pas quelle beauté il poursuit, l’artiste ne peut pas savoir non plus selon quelles règles il va l’atteindre. Il en va, semble-t-il, tout autrement pour la production technique : la fonction de l’objet qu’il y a à produire détermine de façon beaucoup plus serrée, dans l’esprit de l’artisan, le concept de cet objet ainsi que les règles à respecter pour sa production.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, (1770 - 1831)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel , ( 1770 – 1831 ) philosophe allemand . Son œuvre, postérieure à celle de Kant a eu une influence décisive sur l’ensemble de la philosophie contemporaine .
En nous plaçant au point de vue du sens commun, nous avons à soumettre à l’examen les propositions suivantes 1° L’art n’est point un produit de la nature, mais de l’activité humaine ; 2° Il est essentiellement fait pour l’homme, et, comme il s’adresse aux sens, il emprunte plus ou moins au sensible ; 3° Il a son but en lui-même. […] A cette manière d’envisager l’art se rattachent plusieurs préjugés qu’il est nécessaire de réfuter. 1° Nous rencontrons d’abord cette opinion vulgaire que l’art s’apprend d’après des règles. Or ce que les préceptes peuvent communiquer se réduit à la partie extérieure, mécanique et technique de l’art ; la partie intérieure et vivante est le résultat de l’activité spontanée du génie de l’artiste . L’esprit, comme une force intelligente, tire de son propre fonds le riche trésor d’idées et de formes qu’il répand dans ses œuvres. Cependant il ne faut pas, pour éviter un préjugé, tomber dans un autre excès, dire que l’artiste n’a pas besoin d’avoir conscience de lui-même et de ce qu’il fait, parce qu’au moment où il crée il doit se trouver dans un état particulier de l’âme qui exclut la réflexion, savoir, l’inspiration. Sans doute, il y a dans le talent et le génie un élément qui ne relève que de la nature ; mais il a besoin d’être développé par la réflexion et l’expérience. En outre tous les arts ont un côté technique qui ne s’apprend que par le travail et l’habitude. L’artiste a besoin, pour n’être pas arrêté dans ses créations, de cette habileté qui le rend maître et le fait disposer à son gré des matériaux de l’art. […]
2° Une autre manière de voir non moins erronée au sujet de l’art considéré comme produit de l’activité humaine est relative à la place qui appartient aux œuvres de l’art comparées à celles de la nature. L’opinion vulgaire regarde les premières comme inférieures aux secondes, d’après ce principe que ce qui sort des mains de l’homme est inanimé, tandis que les productions de la nature sont organisées, vivantes à l’intérieur et dans toutes leurs parties. Dans les œuvres de l’art, la vie n’est qu’en apparence et à la surface ; le fond est toujours du bois, de la toile, de la pierre, des mots. Mais ce n’est pas cette réalité extérieure et matérielle qui constitue l’œuvre d’art ; son caractère essentiel, c’est d’être une création de l’esprit, d’appartenir au domaine de l’esprit, d’avoir reçu le baptême de l’esprit, en un mot, de ne représenter que ce qui a été conçu et exécuté sous l’inspiration et à la voix de l’esprit. Ce qui nous intéresse véritablement, c’est ce qui est réellement significatif dans un fait ou une circonstance, dans un caractère, dans le développement ou le dénouement d’une action. L’art le saisit et le fait ressortir d’une manière bien plus vive, plus pure et plus claire que cela ne peut se rencontrer dans les objets de la nature ou les faits de la vie réelle. Voilà pourquoi les créations de l’art sont plus élevées que les productions de la nature. Nulle existence réelle n’exprime l’idéal comme le fait l’art. En outre, sous le rapport de l’existence extérieure, l’esprit sait donner à ce qu’il tire de lui-même, à ses propres créations, une perpétuité, une durée que n’ont pas les êtres périssables de la nature. »
Hegel, Introduction aux leçons d’esthétique (traduction de Charles Bénard et Claire Margat),Le Intégrales de Philo, Nathan, p. 46-48.
Le beau artistique est plus beau que le beau de la Nature car il est le produit de la pensée, d’une pensée libre . Si les productions de l’esprit sont supérieures, c’est parce qu’elles sont l’expression de l’homme qui prend conscience de lui-même en se contemplant lui-même et en imprimant sa marque sur le monde. (voir exple de l’enfant qui fait des ronds dans l’eau). Tout homme agit sur le monde. Mais l’artiste est celui qui le spiritualise.
QU' EST-CE QU'UNE OEUVRE D' ART
Nelson goodman.
Le philosophe américain Nelson Goodman se demande ici dans quelle mesure n’importe quoi peut être considéré comme une oeuvre d’art:
« La littérature esthétique est encombrée de tentatives désespérées pour répondre à la question «Qu’est-ce que l’art ?» Cette question, souvent confondue sans espoir avec la question de l’évaluation en art «Qu’est-ce que l’art de qualité ?», s’aiguise dans le cas de l’art trouvé – la pierre ramassée sur la route et exposée au musée ; elle s’aggrave encore avec la promotion de l’art dit environnemental et conceptuel. Le pare-chocs d’une automobile accidentée dans une galerie d’art est-il une œuvre d’art ? Que dire de quelque chose qui ne serait pas même un objet, et ne serait pas montré dans une galerie ou un musée – par exemple, le creusement et le remplissage d’un trou dans Central Park 1 , comme le prescrit Oldenburg 2 ? Si ce sont des œuvres d’art, alors toutes les pierres des routes, tous les objets et événements, sont-ils des œuvres d’art ? Sinon, qu’est-ce qui distingue ce qui est une œuvre d’art de ce qui n’en est pas une ? Qu’un artiste l’appelle œuvre d’art ? Que ce soit exposé dans un musée ou une galerie ? Aucune de ces réponses n’emportent la conviction.
Je le remarquais au commencement de ce chapitre, une partie de l’embarras provient de ce qu’on pose une fausse question – on n’arrive pas à reconnaître qu’une chose puisse fonctionner comme œuvre d’art en certains moments et non en d’autres. Pour les cas cruciaux, la véritable question n’est pas «Quels objets sont (de façon permanente) des œuvres d’art ?» mais «Quand un objet fonctionne-t-il comme œuvre d’art ?» – ou plus brièvement, comme dans mon titre 3 , «Quand y a-t-il de l’art?».

Ma réponse : exactement de la même façon qu’un objet peut être un symbole – par exemple, un échantillon – à certains moments et dans certaines circonstances, de même un objet peut être une œuvre d’art en certains moments et non en d’autres. À vrai dire, un objet devient précisément une œuvre d’art parce que et pendant qu’il fonctionne d’une certaine façon comme symbole. Tant qu’elle est sur une route, la pierre n’est d’habitude pas une œuvre d’art, mais elle peut en devenir une quand elle est donnée à voir dans un musée d’art. Sur la route, elle n’accomplit en général aucune fonction symbolique. Au musée, elle exemplifie 4 certaines de ses propriétés – par exemple, les propriétés de forme, couleur, texture. Le creusement et remplissage d’un trou fonctionne comme œuvre dans la mesure où notre attention est dirigée vers lui en tant que symbole exemplifiant. D’un autre côté, un tableau de Rembrandt cesserait de fonctionner comme œuvre d’art si l’on s’en servait pour boucher une vitre cassée ou pour s’abriter.
Nelson Goodman, «Quand y a-t-il art ?» (1977), in Manières de faire des mondes , trad. 1992

Hannah Arendt, 1906 - 1975

Hannah Arendt, 1906 – 1975), est une philosophe allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme et la modernité. Ses livres les plus célèbres sont Les Origines du totalitarisme (1951), Condition de l’homme moderne (1958) et La Crise de la culture (1961).
« Parmi les choses qu’on ne rencontre pas dans la nature, mais seulement dans le monde fabriqué par l’homme, on distingue entre objets d’usage et œuvres d’art ; tous deux possèdent une certaine permanence qui va de la durée ordinaire à une immortalité potentielle dans le cas de l’œuvre d’art. En tant que tels, ils se distinguent d’une part des produits de consommation, dont la durée au monde excède à peine le temps nécessaire à les préparer, et d’autre part, des produits de l’action, comme les événements, les actes et les mots, tous en eux-mêmes si transitoires qu’ils survivraient à peine à l’heure ou au jour où ils apparaissent au monde, s’ils n’étaient conservés d’abord par la mémoire de l’homme, qui les tisse en récits, et puis par ses facultés de fabrication. Du point de vue de la durée pure, les œuvres d’art sont clairement supérieures à toutes les autres choses; comme elles durent plus longtemps au monde que n’importe quoi d’autre, elles sont les plus mondaines des choses. Davantage, elles sont les seules choses à n’avoir aucune fonction dans le processus vital de la société; à proprement parler, elles ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des objets d’usage: mais elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine. »
Hannah Arendt, La Crise de la culture
H. Arendt montre la spécificité de l’œuvre d’art par rapport aux autres productions humaines. Les œuvres d’art se distinguent de toute autre production humaine par leur durée « Du point de vue de la durée pure, les œuvres d’art sont clairement supérieures à toutes les autres choses » et aussi par leur inutilité puisque « elles sont les seules choses à n’avoir aucune fonction dans le processus vital de la société » et «Elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation». Elles ont «une immortalité potentielle» parce qu’elles survivent à l’artiste, puis à la société à laquelle appartenait cet artiste. Mais elles peuvent être détruites ou perdues, et finiront aussi par disparaitre d’où « une immortalité potentielle ». Ces œuvres d’art ont aussi comme caractéristiques d’appartenir « au monde » C’est à dire à l’ensemble de l’humanité. Dans l’espace et dans le temps. La seule finalité de l’art est donc d’être là, d’exister dans le monde. Ce n’est pas un objet de consommation et ça ne doit pas le devenir. Car c’est précisément parce que les œuvres n’en sont pas, qu’elles ne servent « à rien », qu’elles durent !! Et si « elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine » , c’est précisément pour qu’elles ne deviennent pas de simples objets de consommation. Il leur faut des espaces spécifiques qui demandent un effort pour les atteindre..et les comprendre. Sinon « La culture se trouve détruite pour engendrer le loisir »

LA QUESTION DU BEAU

« Qu’est-ce que le beau ? » . Ce qui est beau pour moi peut être laid pour un autre. Rien n’est plus beau que sa crapaude…pour un crapaud ! Si Hume considère le beau comme subjectif : « la beauté n’est pas une qualité inhérente aux choses, elle n’est que dans l’âme qui les contemple et chaque âme voit une beauté différente », d’autres comme Kant le distingue de l’agréable et lui attribue une universalité.
L’art relève de la poièsis , c’est-à-dire de la production ou de la création.La conception actuelle de l’art suppose que celui-ci se soit dissocié du religieux. On peut aujourd’hui croiser dans un musée un Piss-christ (Andres Serrano 1987), un masque africain, un nu, un carré recouvert de peinture blanche… La liste n’est pas exhaustive.
C’est au XVIIIe siècle qu’apparaît le concept d’esthétique (dont l’étymologie signifie sensation) • le Beau est relatif à l’effet qu’il produit, à la sensation qu’il procure • la sensation a été discréditée par la philosophie platonicienne (suprématie du monde intelligible sur le monde sensible). Méfiance vis-à-vis des illusions opposées à la raison, à la connaissance mathématique de la vérité.
Chez Platon, le beau est toujours associé à la vérité , en est une manifestation. « Le beau, seul, a reçu en partage d’être ce qui se manifeste avec le plus d’éclat de force ravissante » Platon.
Chez les modernes par contre , la beauté sera réduite à une valeur strictement humaine. La beauté deviendra relative au plaisir qu’elle nous donne. Les choses alors deviennent belles parce que nous les désirons et non parce qu’elles sont désirables .
Kant considérera que l’homme de goût doit immédiatement éprouver du plaisir à la représentation de l’objet. C’est la beauté libre , celle qui fait abstraction de la fonction de l’objet, sa beauté se manifeste dans les formes qui ne visent à rien, qui ignorent le sens, l’utilité de l’objet. On retrouvera cette idée dans l’abstraction au début du XXe siècle. (Voir texte de Kant). On retrouve cette idée chez Nietzsche lorsqu’il écrit « ils n’aiment pas une forme pour ce qu’elle est en soi mais pour ce qu’elle exprime. Ce sont les fils d’une génération savante tourmentée et réfléchit à mille lieues des vieux maîtres qui ne se souciaient pas de lire et ne songer qu’à repaître leurs yeux ». On retrouve cette idée chez Fernando Pessoa : « les choses n’ont pas de signification, elles ont une existence / les choses sont l’unique sens occulte des choses » in Le Gardeur de troupeaux. À être trop attentif au sens des choses, nous les faisons disparaître dans la réalité sensible. Le propre d’une œuvre d’art est d’être une chose « faite » … A vous de voir !

Dossier du Centre Pompidou sur le Beau.
G.W.F Hegel, supériorité de l'art
Hegel, Introduction à l’esthétique
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, (1770 – 1831) un philosopheallemand. Son œuvre, postérieure à celle de Kant a eu une influence décisive sur l’ensemble de la philosophie contemporaine.
Il est permis de soutenir dès maintenant que le beau artistique est plus élevé que le beau dans la nature. Car la beauté artistique est la beauté née et comme deux fois née de l’esprit. Or autant l’esprit et ses créations sont plus élevés que la nature et ses manifestations, autant le beau artistique est lui aussi plus élevé que la beauté de la nature. Même, abstraction faite du contenu, une mauvaise idée, comme il nous en passe par la tête, est plus élevée que n’importe quel produit naturel ; car en une telle idée sont présents toujours l’esprit et la liberté. »
Hegel, L’Esthétique ,1832
Le beau artistique est plus beau que le beau de la Nature car il est le produit de la pensée . Si les productions de l’esprit sont supérieures, c’est parce qu’elles sont l’expression de l’homme qui prend conscience de lui-même en se contemplant lui-même et en imprimant sa marque sur le monde. (voir exple de l’enfant qui fait des ronds dans l’eau). Tout homme agit sur le monde. Mais l’artiste est celui qui le spiritualise.
E. Kant et le beau
« La beauté naturelle est une belle chose ; la beauté artistique est une belle représentation d’une chose» Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger .

Kant, beauté adhérente et beauté libre
Il existe deux espèces de beauté la beauté libre ou la beauté simplement adhérente. La première ne présuppose aucun concept de ce que l’objet doit être ; la seconde suppose un tel concept et la perfection de l’objet d’après lui. Les beautés de la première espèce s’appellent les beautés (existant par elles-mêmes) de telle ou telle chose ; l’autre beauté, en tant que dépendant d’un concept (beauté conditionnée), est attribuée à des objets compris sous le concept d’une fin particulière.
Des fleurs sont de libres beautés naturelles. Ce que doit être une fleur, peu le savent hormis le botaniste et même celui-ci, qui reconnaît dans la fleur l’organe de la fécondation de la plante, ne prend pas garde à cette fin naturelle quand il en juge suivant le goût. [..,]
Dans l’appréciation d’une libre beauté (simplement suivant la forme) le jugement de goût est pur, On ne suppose pas le concept de quelque fin pour laquelle serviraient les divers éléments de l’objet donné et que celui-ci devrait ainsi représenter, de telle sorte que [par cette fin] la liberté de l’imagination, qui joue en quelque sorte dans la contemplation de la figure, ne saurait qu’être limitée.
Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Éd. Vrin, 1974
Kant distingue deux types de beauté : L’une, la beauté libre , ne dépend d’aucun but. Sa beauté n’est pas liée à sa fonction . C’est une beauté purement esthétique. (La beauté naturelle sera donc plus souvent une beauté libre .(Oiseaux, crustacés..) Mais même dans ce cas, si on s’intéresse à la fonction, il ne s’agit plus alors de beauté libre (voir exemple du botaniste)). L’autre, la beauté adhérente , ne peut pas être pensée indépendamment de sa fin ou de sa fonction. Plus loin dans le texte, Kant donne l’exemple d’une église. Pour lui, la beauté du lieu ne peut pas être détachée de sa fonction (la prière) et de son but. Donc pour lui, la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique car elle est purement esthétique tandis qu’il y a une part de plaisir lié à la connaissance dans l’œuvre artistique.
Kant : l'agréable et le jugement de goût

Le Beau pour Kant provoque « une satisfaction indépendante de tout intérêt ». La beauté n’est pas une propriété objective de la chose. C’est les effets que provoque en moi la représentation d’une chose qui me font dire : « c’est beau ». Le jugement de goût est contemplatif. C’est-à-dire qu’une œuvre que je trouve belle, je ne la trouve pas belle parce que je veux la posséder, où parce que j’aimerais avoir une maison comme celle qui y est représentée… Je n’ai pas « d’intérêt à la trouver belle, et pourtant, je la trouve belle ». Et si je n’y ai pas d’intérêt personnel, cette beauté peut être reconnue par tous. La beauté est donc désintéressée.
D’où la différence que fait Kant entre le goût et l’agréable. L’agréable est lié à mon intérêt (matériel ou moral). Mon appréciation est liée à qqchse qui se passe « hors de moi ». Alors que le jugement de goût n’est lié qu’à l’émotion, à la satisfaction que j’éprouve. C’est à mon imagination, mon émotion que je suis sensible. Donc à des choses qui sont « en moi ». Si le beau peut plaire « universellement », c’est parce que mon gout n’est pas déterminé par des intérêts personnels, il est alors acceptable de penser que chacun pourra s’accorder avec moi.
Pour Kant le jugement de goût prétend à l’universel. Pour lui, « est beau ce qui plaît universellement sans concept ». Pour Kant, ce qui vaut pour un seul ne vaut rien.
Il ne faut pas confondre le jugement esthétique pur : « la musique de Mozart est belle » du jugement d’agrément : « j’aime le vin des Canaries ». La beauté ne peut se réduire à l’agréable qui procure une sensation de plaisir Kant le précise, cette universalité est sans concept. Or le concept est ce qui permet d’identifier une chose, ce qui donne une règle pratique pour la construire. Mais selon lui, en matière esthétique, il n’y a pas de règles ni pour produire de la beauté, ni pour en juger. Une cathédrale peut répondre au concept de cathédrale sans être belle.
En résumé pour Kant : – Il existe deux sortes de beauté : la beauté libre : spontanément présente dans la nature. Elle est pour Kant supérieure à l’art. Et la beauté adhérente , qui elle est lié à une fonction – La beauté ne se réduit pas à l’agréable, source de plaisir puisque la beauté doit être « désintéressée », elle n’a pas d’utilité. ( L’agréable satisfait les sens, le goût s’adresse à l’esprit) – La beauté ne se réduit pas non plus à un concept de perfection formelle : la beauté n’est pas une connaissance, elle ne peut être démontrée. – Par contre le beau plait«universellement » puisque le jugement esthétique se détache de toute considération d’utilité personnelle, il peut être considéré comme valant pour tous ; Mais le goût dont parle Kant n’a rien de naturel, il correspond aux goûts partagés par une société culturellement privilégiée. C’est le reproche lui fera Bourdieu, sociologue. L’art au lieu d’unifier la société humaine grâce à son pouvoir de communication, la divise : avec d’un côté les amateurs du « grand art » et de l’autre la masse qui s’abrutit de divertissements kitsch ((Disneyland ou le tee-shirt avec la tête de la Joconde)
Le tournant de l'art moderne
Avec l’’art moderne l’œuvre d’art n’a plus à être belle et comme le dit Claudel « Voilà déjà longtemps que l’idée de beauté s’est rassise » . (Voir vos cours d’histoire de l’art)
Au début du XXème, des mouvements comme le dadaïsme se veulent exister contre l’idée même de Beau.
L’art moderne implique que ce qui importe dans l’œuvre est son caractère créateur, original, inédit, provocateur, plus que sa beaut é (voire même à l’exclusion de sa beauté).
Selon Malraux, une œuvre d’art n’a plus à être belle mais impressionnante. Esthétique du laid, du repoussant, de l’odieux ou horribles (étalages sanglants de boucherie humaine, dans La mariée de Spoerri (ci-dessous) en 1973).
Le tout est de susciter une réaction, un intérêt, comme d’une autre manière les œuvres qu’il faut toucher, voire la créer soi-même en partie ( Ex : Le pénétrable sonore de Soto qu’il faut traverser pour qu’il produise une « musique » assourdissante de cloches de cathédrale.)
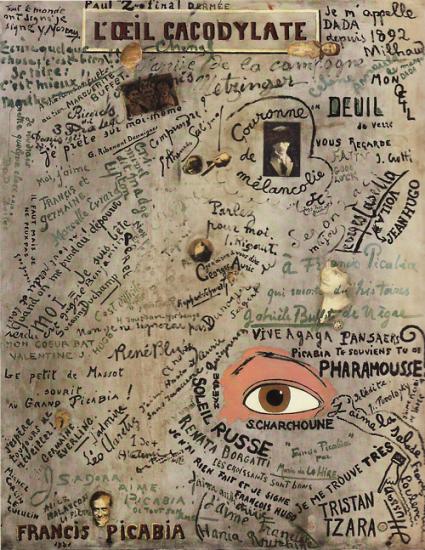
ART ET INSPIRATION
N’importe qui peut-il faire de l’art ? C’est à la Renaissance que se développe le concept de génie . Il est hérité de l’Antiquité, c’est l’idée de « fureur divine » d’inspiration que l’on retrouvera chez les auteurs de la Pléiade. Au Moyen Âge, cette idée était impensable. Seul Dieu était créateur. L’idée du génie revient avec le romantisme.
Là aussi, voici la position de Kant : Kant oppose la création artistique, produit d’un « il faut le faire » non analysable, non transmissible (il est impossible de reproduire un chef d’oeuvre) à la production technique qui est toujours liée à un savoir rationnel et transmissible.
Au final, Kant définit le génie de manière oxymorique par un art-naturel : le génie est un « favori de la nature » et c’est ce qui donne « les règles de l’art ». Pour lui, quatre traits caractérisent le génie : – l’originalité : le génie produit hors des règles, il n’y a pas de modèle à ses productions elle ne ressemble à rien et c’est par le « goût » à comprendre comme la culture qu’il va civiliser. Caractérise l’œuvre du génie, c’est son exemplarité – L’exemplarité : l’œuvre géniale est indéfinissable. Production spontanée selon des règles et des procédés que le génie se donne à lui-même. On pourra analyser à postériori, imiter le génie, mais lui, alors qu’il fait école, n’appartient lui-même à aucune école. Les créateurs se suivent et ne se ressemblent pas… – Le génie produit sans savoir comment il produit, comme le disait Picasso. Il ne cherche pas, il trouve. Contrairement à l’artisan, l’artiste de génie ne contrôle pas ses opérations de production – Enfin ce qui différencie l’œuvre du génie dans les beaux-arts, du génie scientifique c’est… qu’aucune découverte scientifique n’est vraiment originale car elle aurait pu être faite par un autre savant, mais la Pietà ne peut être que l’œuvre de Michel-Ange et La Recherche du temps perdu ne peut être que l’œuvre de Proust ! L’œuvre est une « exclusivité esthétique », unique, inimitable parce que ça règle et réinventer à chaque fois.
Mais Kant déprécie la beauté artistique au profit de la beauté naturelle . Kant se rapproche de Platon et de Rousseau pour lesquelles l’art est toujours du côté de l’artifice, de la vanité, de l’illusion, de la tromperie… Kant va donc s’efforcer de naturaliser l’art : puisque l’art est le produit d’un sujet qui est lui même nature. « Le paysage se pense en moi écrit Cézanne et je suis sa conscience » . L’artiste devient un voyant, un traducteur…L’artiste devient celui qui puise dans le fond de l’être, celui qui dit, qui montre, qui donne à voir. Il n’est plus celui qui fait, il est celui qui « voit ». Kant annonce le romantisme … C’est donc la nature elle-même qui a voulu l’homme « parlant » et c’est elle qui se dit à travers les figures de l’art : « Terre, n’est-ce pas ce que tu veux, en nous, renaître ? » Rilke (eh oui !) L’artiste a donc le sentiment d’être habité, posséder et possesseur d’une parole qui ne lui appartient pas… L’artiste n’est donc plus un démiurge, virile et tout-puissant…
L'ART SERT-IL A QUELQUE CHOSE ?
Art et imitation.
L’œuvre peut consister en une imitation médiocre de la réalité, sorte de photographie mais sans réel projet esthétique. C’est un peu la croute du peintre du dimanche… C’est une tentative de reproduction du monde mais toujours inférieur, comme dirait Hegel, à la réalité. Il n’y a pas d’intention, pas d’esprit. Mais il peut s’agir aussi d’une volonté de montrer « à travers un tempérament » un coin du monde. On pense alors aux œuvres de Zola , aux oeuvres des réalistes du 19e. Plus proche de nous, c’est l’hyperréalisme américain dénonçant la société de consommation.

Platon et l'imitation
Pour Platon, l’art reste l’illusion d’une illusion.
Platon critique l’art en tant que copie – il vaut moins que son original – et en tant que discours enchanteur – il nous ment. L’art nous éloigne donc du Vrai et du Bien . Dans Les Lois , il recommande même de « chasser les poètes de la cité ». Mais s’il approuve la censure, il ne rejette pas tous les arts : formé à l’école de Pythagore qui trouva les lois de l’harmonie, il estime que la musique a une grande valeur pédagogique et qu’elle élève l’âme.

Socrate – Il y a donc trois espèces de lit ; l’une qui est dans la nature, et dont nous pouvons dire, ce me semble, que Dieu est l’auteur ; à quel autre, en effet, pourrait-on l’attribuer ? Glaucon – A nul autre Socrate – Le lit du menuisier en est une aussi Glaucon – Oui Socrate – Et celui du peintre en est encore une autre, n’est-ce pas ? Glaucon – Oui Socrate – Ainsi le peintre, le menuisier, Dieu, sont les trois ouvriers qui président à la façon de ces trois espèces de lit. […] Donnerons-nous à Dieu le titre de producteur de lit, ou quelqu’autre semblable ? Qu’en penses-tu ? Glaucon – Le titre lui appartient, d’autant plus qu’il a fait de lui-même et l’essence du lit, et celle de toutes les autres choses. Socrate – Et le menuisier, comment l’appellerons-nous ? L’ouvrier du lit, sans doute ? Glaucon – Oui Socrate – A l’égard du peintre, dirons-nous aussi qu’il en est l’ouvrier ou le producteur ? Glaucon – Nullement Socrate – Qu’est-il donc par rapport au lit ? Glaucon – Le seul nom qu’on puisse lui donner avec le plus de raison, est celui d’imitateur de la chose dont ceux-là sont ouvriers. […] Socrate – Le peintre se propose-t-il pour objet de son imitation ce qui, dans la nature, est en chaque espèce, ou plutôt ne travaille-t-il pas d’après les œuvres de l’art ? Glaucon – Il imite les œuvres de l’art.(…) Socrate – Pense maintenant à ce que je vais dire ; quel est l’objet de la peinture ? Est-ce de représenter ce qui est tel, ou ce qui paraît, tel qu’il paraît ? Est-elle l’imitation de l’apparence, ou de la réalité ? Glaucon – De l’apparence. Socrate – L’art d’imiter est donc bien éloigné du vrai ; et la raison pour laquelle il fait tant de choses, c’est qu’il ne prend qu’une petite partie de chacune ; encore ce qu’il en prend n’est-il qu’un fantôme. Le peintre, par exemple, nous représentera un cordonnier, un charpentier, ou tout autre artisan, sans avoir aucune connaissance de leur métier ; mais cela ne l’empêchera pas, s’il est bon peintre, de faire illusion aux enfants et aux ignorants, en leur montrant du doigt un charpentier qu’il aura peint, de sorte qu’ils prendront l’imitation pour la vérité. Glaucon – Assurément. Platon, La République
Pour Platon*, il existe deux mondes. Le monde sensible ( monde trompeur- voir allégorie de la caverne) et le monde Intelligible (monde des idées- qui est celui de la vérité et de la réalité). C’est dans le monde Intelligible que se trouvent les idées parfaites des choses. Et c’est à lui qu’il faut se référer et accéder (Le philosophe est celui qui en connait le chemin et peut y conduire les hommes)
Dans ce texte extrait de La République , Platon inventorie 3 formes de lits :
a) L’Idée du lit, dans le monde Intelligible (dimension divine). C’est le lit absolu. Le « vrai » lit. (Il n’en existe qu’une seule forme)
b) Le lit de l’artisan , le lit de l’artisan traduit dans la matière le lit idéal. Il imite la forme Il n’est lit que par ressemblance avec l’Idée du lit . (Il en existe plusieurs formes).Mais il garde unlien avec « l’essence » du lit idéal
c) Le lit de l’artiste n’est plus un lit puisqu’il ne représente qu’ « une petite partie du lit ». C’est une imitation de l’apparence du lit de l’artisan qui est déjà lui-même une apparence. Le lit de l’artiste n’a donc plus rien à voir avec l’essence du lit. Le lit de l’artiste imite l’apparence sensible. Aussi on ne pourra atteindre l’idée du lit grâce au lit de l’artiste
En fait, l a représentation du lit par l’artiste nous égare, nous trompe, nous éloigne de la vérité du lit. C’est pourquoi l’artiste représente un danger.

Aristote et l'imitation

Disciple de Platon, fondateur du « Lycée » à Athènes, Aristote est un penseur encyclopédique car aucune des dimensions du savoir humain ne lui est étrangère. Il a rédigé une poétique qui définit l’art de l’épopée, de la tragédie et de la comédie. L’ouvrage contenant cette dernière a malheureusement disparu. C’est cette disparition qui sert de fil d’Ariane au ro man d’Umberto Eco, Le Nom de la rose.
La poésie* semble bien devoir en général son origine à deux causes, et deux causes naturelles. Imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès leur enfance (l’homme diffère des autres animaux en ce qu’il est très apte à l’imitation et c’est au moyen de celle-ci qu’il acquiert ses premières connaissances) et, en second lieu, tous les hommes prennent plaisir aux imitations.
Un indice est ce qui se passe dans la réalité : des êtres dont l’original fait peine à la vue, nous aimons à en contempler l’image exécutée avec la plus grande exactitude ; par exemple les formes des animaux les plus vils et des cadavres.
Une raison en est encore qu’apprendre est très agréable non seulement aux philosophes mais pareillement aussi aux autres hommes ; seulement ceux-ci n’y ont qu’une faible part. On se plaît à la vue des images parce qu’on apprend en les regardant et on déduit ce que représente chaque chose, par exemple que cette figure c’est un tel. Si on n’a pas vu auparavant l’objet représenté, ce n’est plus comme imitation que l’oeuvre pourra plaire, mais à raison de l’exécution, de la couleur ou d’une autre cause de ce genre.
Aristote, Poétique , 4, 1448 b, Éd. Les Belles Lettres,

Mais il y a une autre forme d’imitation, celle des « modèles idéaux » . C’est à cette imitation là que fait référence Aristote . Il s’agit d’ imiter ce qui est parfait dans la nature . À la Renaissance, pour Vinci c’est la nature qui donne a l’art ses modèles et l’artiste est celui qui est capable de voir la perfection de la forme et qui va tenter de l’imiter.
Mais l’esthétique de la mimesis n’a jamais été une invitation à reproduire le réel, le propos aristotélicien disant que « l’art imite la nature ou l’achève» signifiant que l’artiste doit être un aussi bon artiste que la nature pour porter à l’expression ce qu’il cherche à en montrer. Or pour rivaliser avec la nature, il faut savoir lui être infidèle. Le corps humain n’a jamais eu les proportions de la statuaire grecque mais ce sont ces proportions qui en montrent la force et l’harmonie. L’homme qui marche n’a jamais eu les deux pieds rivés au sol, comme dans l’œuvre de Rodin, mais sans cette ruse, le mouvement serait suspendu. L’art est un mensonge qui dit la vérité ; tous les artistes le proclament à leur façon. La servile reproduction ne dévoile rien. Quel intérêt aurait une activité se contentant de reproduire ce qui se donne à la perception immédiate ?
Si Platon rejette l’imitation parce qu’il y voit une apparence trompeuse qui nous éloigne du chemin de la vérité, en revanche pour Aristote « Imiter est naturel aux hommes ». Pour lui, l’imitation :
• est source de connaissances • procure du plaisir Et l’art, en imitant nous permet
• de regarder ce qui serait insoutenable dans le réel. • de s’instruire de manière plaisante Et si on ne « reconnait pas » l’objet représenté, on pourra toujours prendre plaisir à son exécution. On peut donc considérer que chez Aristote, l’art ne se contente pas d’ imiter la nature, mais plutôt de rivaliser avec elle. L’art nous permet d’avoir accès à ce que nous cache la nature et nous découvre des choses que nous ne savons pas voir dans la réalité
Il appartient à Aristote d’avoir souligné que l’idée d’imitation dans l’art n’est absolument pas le signe d’une activité inférieure. Si la mimèsis est condamnée par Platon dans La République, livre III, 393-398, et livre X, 595-608, elle apparaît ici comme une tendance naturelle aux hommes qui apporte plaisir et connaissance. Il importe de remarquer que, pour Aristote, la mimèsis n’est pas une pure copie ; elle participe d’une transposition, voire d’une idéalisation qui donne à l’art poétique son caractère exemplaire.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
Hegel, philosophe allemand, professeur à l’université de Berlin. Rejetant la philosophie de Kant qu’il juge formelle et éloignée de la vie, Hegel propose un système visant à présenter l’ensemble de l’histoire et de la culture.
C’est un vieux précepte que l’art doit imiter la nature ; on le trouve déjà chez Aristote. Quand la réflexion n’en était encore qu’à ses débuts, on pouvait bien se contenter d’une idée pareille ; elle contient toujours quelque chose qui se justifie par de bonnes raisons et qui se révélera à nous comme un des moments de l’idée ayant, dans son développement, sa place comme tant d’autres moments.
D’après cette conception, le but essentiel de l’art consisterait dans l’imitation, autrement dit dans la reproduction habile d’objets tels qu’ils existent dans la nature, et la nécessité d’une pareille reproduction faite en conformité avec la nature serait une source de plaisirs. Cette définition assigne à l’art un but purement formel, celui de refaire une seconde fois, avec les moyens dont l’homme dispose, ce qui existe dans le monde extérieur, et tel qu’il y existe. Mais cette répétition peut apparaître comme une occupation oiseuse et superflue, car quel besoin avons-nous de revoir dans des tableaux ou sur la scène, des animaux, des paysages ou des événements humains que nous connaissons déjà pour les avoir vus ou pour les voir dans nos jardins, dans nos intérieurs ou, dans certains cas, pour en avoir entendu parler par des personnes de nos connaissances ? On peut même dire que ces efforts inutiles se réduisent à un jeu présomptueux dont les résultats restent toujours inférieurs à ce que nous offre la nature. C’est que l’art, limité dans ses moyens d’expression, ne peut produire que des illusions unilatérales, offrir l’apparence de la réalité à un seul de nos sens ; et, en fait, lorsqu’il ne va pas au-delà de la simple imitation, il est incapable de nous donner l’impression d’une réalité vivante ou d’une vie réelle : tout ce qu’il peut nous offrir, c’est une caricature de la vie.
Hegel,Esthétique, Introduction : Chap. I, Section II, §. 1,tr. fr. S. Jankélévitch, éd. Champs Flammarion, pp. 34-35
Pour Hegel, il est clair que la fonction de l’art n’est pas l’imitation. Il s’agirait alors de refaire en moins bien, ce qui existe déjà. L’art produirait alors des « illusions unilatérales » (c’est-à-dire ne pouvant être saisie qu’avec la vue, ou l’ouie). Ce qui confinerait l’art dans un but purement formel et le limiterait à ne nous offrir qu’une « caricature de la vie ». Or pour Hegel, l’art doit être l’expression de l’esprit.
Dans son Introduction à l’esthétique, Hegel évoque « les idées courantes sur l’art ». La première de ces idées est « l’imitation de la nature », idée qu’il fait remonter notamment à Aristote. . On remarquera cependant que la condamnation d’un art de pure imitation ne peut viser avec exactitude la thèse d’Aristote, pour qui l’imitation n’est pas tout à fait une simple tentative de reproduction. Il n’en demeure pas moins que Hegel souligne l’insuffisance du concept d’imitation pour penser l’essence de l’art.
On peut relever les critiques suivantes à propos de l’art comme imitation : • Hegel souligne d’abord qu’il s’agit d’une conception dépassée, correspondant à un moment de l’idée • il s’agit d’une idée inutile car il n’y a aucune raison à vouloir représenter ce qui existe déjà et parce que le résultat ne peut être qu’inférieur à l’original (Hegel reprend en un sens la critique de Platon) ; • l’invention y est absente
L’art comme « caricature de la vie ».
En indiquant qu’un art qui vise l’imitation n’est qu’une caricature de la vie, Hegel souligne l’imperfection de toute imitation par rapport à la réalité. L’artiste ne peut pas, par ses propres moyens techniques, parvenir à reproduire ce que fait la nature, la vie, et qui est perceptible par tous les sens. Son oeuvre sera donc toujours grossière (à grands traits) par rapport à la réalité naturelle, cela à l’image d’une caricature. Ainsi, un tableau ne donne qu’une vision « aplatie » d’un paysage, sans profondeur réelle, sans les « bruits » de la nature réelle…
on peut s’interroger sur l’idée de Hegel selon laquelle toute oeuvre offre « l’apparence de la réalité à un seul de nos sens » ; il existe des arts qui semblent convoquer plusieurs sens, et l’on peut se demander si une oeuvre ne pourrait pas être semblable à la « vie » en faisant appel à tous les sens ; on peut faire allusion ici à l’idée d’un « art total » « Il y a des portraits dont on dit assez spirituellement qu’ils sont ressemblants jusqu’à la nausée. »

Les raisins de Zeuxis

Les limites de l’imitation
Art et dévoilement du monde
Il y a parmi les peintures des grottes de Lascaux (18 000 ans d’âge !) la représentation d’une sorte de licorne. Georges Bataille y voit, dans Lascaux ou la naissance de l’art (1955), « une part de rêve qui ne correspond plus au désir d’une chasse heureuse ». L’art ici l’emporte sur le rite, sur les incantations de chasseurs avides de tuer le gibier. Ainsi, l’homme de Lascaux, par sa vision stylisée de l’animal, nie le monde existant et manifeste le désir de faire naître ce qui n’existe pas : il laisse sur la pierre la première trace du génie créateur de l’homme.(Source Philomag)

H.Bergson : l'art, un révélateur...

LA TECHNIQUE RECHERCHE L’UTILE, L’ART INVITE AU DÉTACHEMENT
Henri Bergson 1859 -19411, est un philosophe français. Il a publié quatre principaux ouvrages dont l’Essai sur les données immédiates de la conscience, et Les Deux Sources de la morale et de la religion en 1932. prix Nobel de littérature en 1927.
Différence radicale entre production technique et création artistique : la première est indexée sur la recherche de l’utile tandis que la seconde est libre ou, mieux, libérée de ce genre de préoccupation.
« A quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience? Le poète et le romancier qui expriment un état d’âme ne le créent certes pas de toutes pièces ; ils ne seraient pas compris de nous si nous n’observions pas en nous, jusqu’à un certain point, ce qu’ils nous disent d’autrui. Au fur et à mesure qu’ils nous parlent, des nuances d’émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps mais qui demeuraient invisibles telle l’image photographique qui n’a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. […]
Remarquons que l’artiste a toujours passé pour un «idéaliste ». On entend par là qu’il est moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie. C’est, au sens propre du mot, un «distrait ». Pourquoi, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses? On ne le comprendrait pas, si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes n’était une vision que notre attachement à la réalité, notre besoin de vivre et d’agir, nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait, il serait aisé de montrer que, plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à contempler, et que les nécessités de l’action tendent à limiter le champ de la vision.
Henri Bergson. La pensée et le mouvant, 1938. PUF, Quadrige1990. p.149 à 151.
Ce texte questionne la finalité de l’art. L’œuvre (l’art) nous permet de voir ce que d’ordinaire on ne sait pas voir. Il permet un dévoilement. Par l’art « une extension des facultés de percevoir est possible » (Bergson ). Il est donc un révélateur. Et il révèle ce qui est. Mais s’il révèle ce qui est, c’est que ce que l’artiste donne à voir ce n’est donc pas une invention, ce n’est pas une réalité qu’il réinvente : L’art renvoie à l’expérience humaine universelle. « Approfondissons ce que nous éprouvons devant un Turner ou un Corot : nous trouverons que, si nous les acceptons et les admirons, c’est que nous avions déjà perçu quelque chose de ce qu’ils nous montrent. Mais nous avions perçu sans apercevoir.(…) Le peintre l’a isolée; il l’a si bien fixée sur la toile que, désormais, nous ne pourrons nous empêcher d’apercevoir dans la réalité ce qu’il y a vu lui-même. » in La pensée et le mouvant, p.150. La vocation de l’art consiste à déchirer les apparences qui dissimulent sous leur abstraction le concret pour faire apparaître ce qui n’apparaît pas à la perception banale. Pour Bergson ce qui se passe dans l’art est comparable à ce qui se passe pour l’image photographique. Le bain dans lequel on plonge la pellicule pour faire apparaître l’image ne crée pas cette dernière, il ne fait que la révéler mais sans la solution nécessaire à la fixation de l’image, celle-ci demeurerait invisible. Ainsi en est-il de l’art. L’artiste n’invente pas la réalité qu’il donne à voir mais sans lui elle demeurerait invisible. Et, de manière paradoxale, si l’artiste est le révélateur du réel, c’est parce qu’à la différence des autres hommes, il y est moins « attaché ». Il est, dit-on, « un distrait », un « idéaliste ». Il a une manière d’être présent au monde donnant le sentiment de l’absence. Chez lui le détachement n’est pas volontaire il est un état « naturel ». Pour le commun des mortels, vivre c’est agir. Nous avons des besoins à satisfaire, des intérêts vitaux et nous sommes tout naturellement enclins à ne saisir du réel que ce qui est en rapport avec ces besoins et ces intérêts matériels. L’arbre en fleurs est pour le paysan la promesse d’une bonne récolte, il n’en perçoit que ce qu’il lui est utile d’en percevoir. Sa perception est intéressée, ses préoccupations le détournant de regarder l’arbre à la manière du peintre Bonnard. Ce dernier ne le voit pas pour ce qu’il pourra en tirer, il le voit pour lui-même. Aux nécessités de l’action structurant la perception des uns, s’oppose l’attitude contemplative de l’autre. Il est donc bien vrai que l’art donne à voir. « Il n’imite pas le visible, il rend visible » disait Klee. Il ouvre sur un monde qui, en un certain sens, est bien le monde de tel ou tel artiste. Mais si ce monde était purement subjectif, l’oeuvre ne nous parlerait pas. Il en est de même en littérature. Si le poète ou le romancier ne savait pas donner à son expérience une dimension universelle, nous ne serions pas émus. Il nous permet de découvrir quelque chose de nous, que nous portions en nous intuitivement mais qui en même temps nous était inaccessible et qui nous est révélé dans l’œuvre. L’artiste est l’homme en qui la nature ou l’âme se sent, se pense et s’exprime. C’est dire que l’artiste ne fait pas exister arbitrairement ce qu’il dépeint. Ni il ne le crée absolument, ni il ne se contente de l’imiter. Il n’invente pas ; il découvre au regard une réalité préexistante. Nous voyons le monde extérieur (nature) et intérieur (esprit) à travers nos sens. C’est à dire une perception. Or c’est précisément la perception de l’artiste et celle du commun des mortels qui diffèrent. La richesse du réel « ne frappe pas explicitement nos sens et notre conscience » donc notre perception est en quelque sorte appauvrie.
Marcel Proust : L' artiste est un traducteur
“L’art, c’est l’homme affranchi de l’ordre du temps” Marcel Proust

Pour Marcel Proust, comme pour Bergson, l’art est une forme de dévoilement de l’existence. L’art démultiplie notre perception et nous ouvre à la pluralité du réel. L’art n’est pas seulement ce qui nous permet de nous évader du réel. Il est aussi ce qui nous ouvre au réel et nous apprend à le voir
“… je m’apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n’a pas, dans le sens courant, à l’inventer, puisqu’il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur.” Proust, RTP
« Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous voyons le monde se démultiplier, et, autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent à l’infini, et, bien des siècles après que s’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial ».
Marcel Proust, (1871-1922), in Recherche du temps perdu (1927)
La grandeur de l’art véritable, (…) c’était de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d’épaisseur et d’imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue, et qui est tout simplement notre vie. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. Cette vie qui en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas «développés». Notre vie ; et aussi la vie des autres car le style pour l’écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de technique, mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients de la différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il n’y avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini, et bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial.
Le texte s’ouvre sur l’idée, paradoxale, que le plus souvent, nous nous ignorons nous-mêmes, nous méconnaissons cette intimité, cette richesse de notre monde intérieur. Parce que nous sommes envahis par “la connaissance conventionnelle”, qui se départit des nuances et vit de préjugés et de lieux communs. Or pour Proust, c’est par l’art que nous pouvons nous révéler à nous mêmes et aux autres. Et ce que l’art révèle de nous, c’est précisément notre part la plus intime, notre réalité authentique, ce qui fait que nous sommes qui nous sommes et non un autre. C’est la finalité de l’art. Et si “la vraie vie, c’est la littérature”, ce qui peut aussi sembler paradoxal, puisque la littérature relève de l’imaginaire, du fictif- c’est que la littérature (et l’art) est l’expression de notre vie intérieure.
analyse du texte ici : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=949
Heidegger, L’origine de l’œuvre d’art
Dans L’Origine de l’oeuvre d’art (1935), Heidegger prend l’exemple, devenu célèbre, des Vieux Souliers aux lacets (1886) de Van Gogh. La modernité du tableau et sa valeur tiennent au fait que Van Gogh n’a pas présenté ces souliers dans un contexte qui leur assigne, logiquement – et utilitairement – leur signification : « autour de cette paire de souliers de paysan, il n’y a rigoureusement rien où ils puissent prendre place : rien qu’un espace vague » (Chemins qui ne mènent nulle part, pp.33-34). Cela ne signifie nullement que ces chaussures restent enfermées dans leur muette présence, au contraire. Mais ce qu’elles ont à nous dire ne porte pas sur une situation, une histoire, ou un scénario. Ce qu’elles ont à nous dire est plus fondamental. Peints par Van Gogh, les souliers dévoilent l’être dont ils proviennent.

Dans l’obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le long des sillons toujours semblables, s’étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par la terre grasse et humide. Par-dessous les semelles s’étend la solitude du chemin de campagne qui se perd dans le soir. A travers ces chaussures passe l’appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d’elle-même dans l’aride jachère du champ hivernal. A travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre de nouveau au besoin, l’angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre, et il est à l’abri dans le monde de la paysanne (…). Nous n’avons rien fait que de nous mettre en présence du tableau de Van Gogh. C’est lui qui a parlé. La proximité de l’œuvre nous a soudain transporté ailleurs que là où nous avons coutume d’être. L’œuvre d’art nous fait savoir ce qu’est en vérité la paire de souliers »
Heidegger, L’origine de l’œuvre d’ar t, in Les Chemins qui ne mènent nulle part, 1936, Trad. Wolfgang Brokmeier, Gallimard, coll. Tel
Heidegger se réfère d’abord à un simple objet manufacturé, « un produit connu : une paire de souliers de paysan ». Objet qui est rattaché à son utilité : « Un tel produit sert à chausser le pied ».Mais l’art n’est pas une simple imitation du réel. Et pour Heidegger, ce que nous allons voir dans cette représentation des chaussures, c’est le monde familier du paysan… Il nous en montre la vérité parce que l’œuvre va engendrer un réseau de significations. Elle va permettre l’ouverture à un monde qu’elle porte en elle. L’œuvre va se dévoiler, révéler la réalité. L’illusion des chaussures va aboutir à un absolu. Ainsi, ces chaussures de Van Gogh, abîmées, usées, salies, trouvent leur sens dans la possibilité de nous rendre compte d’un au-delà. Pour Heidegger, l’oeuvre d’art est ce qui fait advenir la vérité de ce qui est. Elle ne se réduit pas à une copie du réel – puisqu’elle le dévoile – et n’est pas définie à partir du plaisir esthétique. La beauté est d’abord un mode d’éclosion de la vérité.

L'ART POUR SURVIVRE
« Tout peut craquer, mon corps, mes mains, mes jambes,
tant que reste l’Art, je vis. »
Tzvetan Todorov
Création musicale dans les camps d'extermination
Dans certaines situations extrêmes, l’art est un moyen de garder son humanité, de survivre et de se battre contre la barbarie. Vous trouverez dans la section Français 1° de ce site, une série de réflexions et d’exemples sur ce thème
Un exemple : La musique dans les camps
Certaines pratiques des nazis consistaient lors de pendaisons, auxquelles tous les déportés étaient obligés d’assister, de faire jouer un orchestre ou chanter des airs entraînants et joyeux et de contraindre les détenus à chanter pendant leur déplacement à pied, pendant le travail ou lorsqu’ils reçoivent des coups. Ceci explique que certaines musiques deviennent insupportables après la guerre pour les survivants.
Mais clandestinement, des détenus écrivaient de la musique.
Francesco Lotoro est un pianiste et compositeur hors norme. Cet italien épaulé par son épouse et entouré de son “Orchestre de musique concentrationnaire”, redonne voix aux musiciens oubliés. Pas n’importe lesquels : ceux qui furent déportés, emprisonnés, et qui souvent moururent dans les camps d’internement nazis. Avec plus de 4000 partitions déjà retrouvées en plus de 20 ans de recherches, il veut faire vivre cette musique écrite là où la création artistique était acte de résistance, là où la mort était la compagne de chaque jour, là où la vie ne tenait qu’à un fil. Une musique écrite clandestinement par des prisonniers de toutes origines, de toutes religions, dans l’une des périodes les plus sombres de l’Histoire entre 1933 et 1945. En les interprétant aujourd’hui, Francesco Lotoro, le Maestro, veut libérer ces musiques emprisonnées, ainsi que l’âme et l’esprit de tous ceux qui les ont composées. Plongé dans une mission solitaire, à la portée universelle, Francesco Lotoro réveille un pan entier de l’histoire de la musique jusqu’ici passé sous silence. Source de l’article : Fondation pour la mémoire de la Shoah
Art pictural et camps

Walter Spitzer , déporté alors qu’il a 16 ans, a été sauvé par les résistants du camp de Buchenwald car il savait dessiner. Une nuit de janvier 1945, Walter est réveillé et doit se rendre devant le chef du block du quartier de Buchenwald où il est interné. Quelques heures plus tard, il doit faire partie du “transport” qui mène vers un autre camp où l’espérance de vie est de “ huit jours “. Dans son livre Walter Spitzer se souvient des paroles formulées au milieu de la nuit : “Nous, le Comité international de résistance aux nazis, avons décidé de te soustraire à ce transport. Depuis que tu es là, nous t’observons. Tu dessines tout le temps, tu sais voir. C’est cela qui nous a décidés. Mais tu dois nous promettre solennellement que, si tu survis, tu raconteras, avec tes crayons, tout ce que tu as vu ici “.
A l’époque, entouré par la mort, l’adolescent ne prend pas conscience de l’importance historique de ses dessins. “Je n’avais aucune prétention historique, ni là, ni plus tard, ni jamais “, raconte-t-il, “et je n’ai jamais pensé que les dessins que je faisais dans les camps étaient un acte de résistance. Je dessinais, tout simplement “.
Avec beaucoup de détails et un trait fin et pointu, Walter dessine des scènes de vie, des gens qui mangent, qui dorment mais il choisit de ne pas dessiner la mort. Il est témoin de pendaisons, de décès à cause de la fatigue ou de la faim, de charrettes de corps entassés. “C’est trop dur “, confie avec pudeur le peintre, toujours profondément marqué par cette période, “c’est trop personnel, le visage de quelqu’un qui est supplicié comme ça, on ne peut pas y toucher “.

Aujourd’hui, dans son atelier aux mille et une peintures, il n’y a qu’à installer un chevalet pour dessiner. Mais, dans les camps, l’un des plus gros challenges était de trouver le support et les crayons. Walter raconte la fabrication de son premier dessin, lorsqu’il était à Auschwitz III : “ Je me suis procuré un sac de ciment. Il avait quatre couches de papier et celles de l’intérieur sont splendides, couleur papier kraft. Ensuite, j’ai chauffé du charbon de bois dans une gamelle et j’ai dessiné avec un bout de bois calciné “.
Syrie aujourd'hui

« Elle va nue, la liberté, Sur les montagnes de Syrie Dans les camps de réfugiés. Ses pieds s’enfoncent dans la boue Et ses mains gercent de froid et de souffrance. Mais elle avance Nous, les exilés, Rôdons autour de nos maisons lointaines Comme les amoureuses rôdent Autour des prisons Espérant apercevoir l’ombre de leurs amants. Nous, les exilés, nous sommes malades D’une maladie incurable Aimer une patrie Mise à mort (…) L’avez-vous vu ? Maram Al Masri
Randa Mdah , est née dans le village de Majdal Shams dans le Golan syrien occupé, en 1983. Après avoir terminé des cours de peinture et de sculpture au centre Adham Ismail en 2003, elle intègre la faculté des beaux arts de Damas pour obtenir son diplôme en sculpture en 2005. En 2007, elle suit des cours de gravure à « Bezalel», l’académie des arts et de la conception à Jérusalem.

L' ART DANS LES CAMPS
L' art dans la guerre, rapports art -technique au xx°s..

La question des rapports entre art et technique engage deux types de débats qui traversent l’histoire de l’art du 20e siècle.
D’une part, le développement des techniques industrielles entraîne une transformation du monde, une modification des rapports sociaux et de notre rapport à ce monde. Comment les artistes parviennent-ils à l’exprimer ? D’autre part le développement technique remet en question la place des savoir-faire traditionnel : en quoi les nouvelles techniques modifient-elles les pratiques artistiques ? Baudelaire définit ainsi la modernité « (elle) est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable[1] ».
Pour Fernand Léger, le contraste, la rupture et l’angle droit sont les notions qui déterminent l’esthétique des temps modernes. Et, avec elles, le caractère lisse des matériaux usinés, dont les tubes métalliques des chantiers ou les obus lustrés de la Première Guerre offrent une image synthétique. On sait quelle importance aura pour la postérité cette question que Marcel Duchamp adresse à Constantin Brancusi alors qu’il s’extasie avec lui sur le galbe d’une hélice au Salon de l’Aviation de 1912 : « Qui pourra faire mieux que cette hélice ? », « La peinture est morte ».

En effet, l’art contemporain remet en question l’originalité des œuvres d’art, c’est-à-dire leur caractère unique. Les œuvres d’art, comme les autres produits, peuvent être reproduites ou produites en série. C’est ce qu’illustre l’œuvre d’Andy Warhol (1928 − 1987), et plus généralement le mouvement du pop’art, qui utilise la sérigraphie pour reproduire des photographies ou des dessins par dizaines.
Le philosophe Walter Benjamin s’est intéressé à cette question de la reproduction des œuvres d’art dans son texte L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1936). Il y montre en effet comment la reproduction technique ruine l’idée même d’authenticité de l’œuvre d’art, c’est-à-dire son caractère unique. À l’époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l’œuvre d’art, c’est son aura.
Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique , 1939
Pour Benjamin, la possibilité de produire un nombre infini de reproduction de l’œuvre d’art lui fait perdre de son aura : son caractère sacré s’appauvrit. Pour Benjamin, ce qui a toujours caractérisé l’œuvre d’art est son “authenticité”, ou encore son statut d’original. Un original, explique Benjamin, est un objet physique unique et situé en un lieu et un temps précis (hic et nunc). Or la reproduction transporte l’œuvre à domicile, et rapproche l’œuvre du spectateur. En s’intégrant à la culture de masse, l’œuvre d’art est désacralisée. De ce fait, la distinction entre art et technique n’apparaît plus si tranchée, puisque l’art, colonisé par la technique, semble perdre une part de sa dimension sacrée.

La réhabilitation de la technique, Simondon

GILBERT SIMONDON
L’oeuvre philosophique de Gilbert Simondon (1924-1989) réhabilite la technique moderne et permet de penser à nouveaux frais la complexité de sa relation à la pensée esthétique et à l’art. Cette réhabilitation réclame de s’intéresser au « mode d’existence des objets techniques » selon les mots qui composent l’ouvrage le plus connu du philosophe français. Il s’agit d’en finir avec l’ignorance dont beaucoup de théoriciens se rendent coupables à l’égard de la technique, et en particulier à l’égard des machines, ces mal-aimées des temps modernes. De cette ignorance, on passe vite au désamour et à son exclusion de la culture, ce que Simondon regrette, dès le début de Du mode d’existence des objets techniques.
Se défaire de cette opposition entre technique et culture exige de penser les objets techniques pour eux-mêmes. Deux points sont ici particulièrement importants ; chacun d’eux remet en cause l’idée qu’on se fait habituellement de la technique.
En fait, les objets techniques ne sont pas directement beaux en eux-mêmes, à moins qu’on n’ait recherché un type de présentation répondant à des préoccupations directement esthétiques ; dans ce cas, il y a une véritable distance entre l’objet technique et l’objet esthétique ; tout se passe comme s’il existait en fait deux objets, l’objet esthétique enveloppant et masquant l’objet technique ; c’est ainsi que l’on voit un château d’eau, édifié près d’une ruine féodale, camouflé au moyen de créneaux rajoutés et peints de même couleur que la vieille pierre : l’objet technique est contenu dans cette tour menteuse, avec sa cuve en béton, ses pompes, ses tubulures : la supercherie est ridicule, et sentie comme telle au premier coup d’œil ; l’objet technique conserve sa technicité sous l’habit esthétique, d’où un conflit qui donne l’impression du grotesque. Généralement, tout travestissement d’objets techniques en objets esthétiques produit l’impression gênante d’un faux, et paraît un mensonge matérialisé.
Mais il existe en certains cas une beauté propre des objets techniques. Cette beauté apparaît quand ces objets sont insérés dans un monde, soit géographique, soit humain : l’impression esthétique est alors relative à l’insertion ; elle est comme un geste. La voilure d’un navire n’est pas belle lorsqu’elle est en panne, mais lorsque le vent la gonfle et incline la mâture tout entière, emportant le navire sur la mer ; c’est la voilure dans le vent et sur la mer qui est belle, comme la statue sur le promontoire. Le phare au bord du récif dominant la mer est beau, parce qu’il est inséré en un point-clef du monde géographique et humain.
G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (1958) Paris, Aubier, 1989

L’objet technique n’est pas beau dans n’importe quelles circonstances et n’importe où ; il est beau quand il rencontre un lieu singulier et remarquable du monde ; la ligne à haute tension est belle quand elle enjambe une vallée, la voiture, quand elle vire, le train, quand il part ou sort du tunnel. L’objet technique est beau quand il a rencontré un fond qui lui convient, dont il peut être la figure propre, c’est-à-dire quand il achève et exprime le monde. L’objet technique peut même être beau par rapport à un objet plus vaste qui lui sert de fond, d’univers en quelque sorte. L’antenne du radar est belle quand elle est vue du pont du navire, surmontant la plus haute superstructure ; posée au sol, elle n’est plus qu’un cornet assez grossier, monté sur un pivot ; elle était belle comme achèvement structural et fonctionnel de cet ensemble qu’est le navire, mais elle n’est pas belle en elle-même et sans référence à un univers.
Le texte de Gilbert Simondon se propose de montrer en quel sens il est possible de ressaisir la beauté d’un objet technique partant de l’idée que « les objets techniques ne sont pas directement beaux en eux-mêmes ». En évoquant (paragraphe 1) la supercherie qui consiste à masquer un « château d’eau, édifié près d’une ruine féodale », l’auteur aborde ensuite les conditions de la « beauté propre des objets techniques » (paragraphes 2 et 3). C’est « l’insertion » de l’objet dans un monde « soit géographique, soit humain » qui rend compte d’une émotion esthétique(paragraphe 2), comme le soulignent les exemples de la voilure d’un navire sur la mer gonflée par le vent et « le phare au bord du récif ». C’est la rencontre, précise-t-il ensuite (paragraphe 3), entre l’objet et « un lieu singulier et remarquable du monde », soit « un fond qui lui convient » comme l’expression de ce même monde. Enfin, l’auteur conclut (paragraphe 4) sur la nécessité d’une « éducation technique » pour montrer la beauté de l’objet technique.
FICHE SYNTHESE ART
- Les œuvres d’art éduquent-elles notre perception ? (TL, 2014)
- L’art transforme-t-il notre conscience du réel ? (TS, 2008)
- Y a-t-il un progrès dans l’art ? (TL, Réunion, 2010)
- L’art sait-il montrer ce que le langage ne peut pas dire ? (TL, Polynésie, 2008)
- Pourquoi conserver les œuvres d’art ? (TL, Pondichéry, 2005)
- L’art est-il un langage ? (TES, Liban, 2005)
- L’artiste travaille-t-il ? (TS, Pondichéry, 2009)
- La sensibilité aux œuvres d’art demande-t-elle à être éduquée ? (TS, 2005)
- Peut-on aimer une œuvre d’art sans la comprendre ? (ST, 2008)
- Faut-il être cultivé pour apprécier une œuvre d’art ? (ST, 2012)
- L’artiste est-il un artisan ? (ST, Polynésie, remplacement, 2008)
- L’art peut-il se passer d’une maîtrise technique ? (ST, 2010)
- L’art nous fait-il connaître le réel ? (TL, Polynésie, 2012)
- L’art peut-il manifester la vérité ? (TL, Liban, 2008)
- Une œuvre d’art nous fait-elle rencontrer le réel ? (TL, Amérique du Nord, 2006)
- L’art est-il moins nécessaire que la science ? (TES, 2011)
- L’art a-t-il pour fonction d’exprimer ce qui échappe à la science ? (TES, Asie, 2007)
- Peut-on démontrer qu’une œuvre d’art est belle ? (TS, Amérique du Nord, 2006)
- L’art est-il un moyen d’accéder à la vérité ? (ST, 2011)
- L’art nous détourne-t-il de la réalité ? (ST, Polynésie, 2008)
- L’art est-il l’expression d’une révolte ? (TS, Polynésie, 2013)
- La liberté de l’artiste rend-elle impossible toute définition de l’art ? (TES, Polynésie, 2009)
- Peut-on reprocher à une œuvre d’art d’être immorale ? (TES, Pondichéry, 2006)
- Une œuvre d’art peut-elle être immorale ? (TS, Pondichéry, 2014)
- Y a-t-il un art d’être heureux ? (TS, Amérique du Nord, 2007)
- La valeur de l’art réside-t-elle dans son inutilité ? (TL, Asie, 2013)
- L’art n’est-il qu’un divertissement ? (TL, Liban, 2012)
- L’œuvre est-elle nécessairement la fin de l’art ? (TL, Antilles, 2010)
- Est-ce une fonction de l’art que d’embellir la vie ? (TL, Métropole, remplacement, 2009)
- Les œuvres d’art sont-elles des réalités comme les autres ? (TL, 2007)
- Une œuvre d’art n’est-elle qu’un objet ? (TL, Asie, 2006)
- L’art est-il un divertissement ? (TES, Afrique, 2013)
- Notre intérêt pour l’art s’explique-t-il par un besoin d’évasion ? (TES, Asie, 2012)
- Une œuvre d’art doit-elle nécessairement donner du plaisir ? (TES, Métropole, remplacement, 2012)
- La laideur peut-elle intéresser l’artiste ? (TES, Liban, 2012)
- L’artiste a-t-il besoin de modèles ? (TES, Réunion, 2010)
- L’art n’est-il qu’un jeu ? (TES, Polynésie, 2010)
- L’artiste est-il un créateur ? (TES, Pondichéry, 2009)
- Puis-je apprécier une œuvre d’art sans comprendre sa signification ? (TES, Amérique du Nord, 2008)
- Toute œuvre d’art veut-elle dire quelque chose ? (TES, Polynésie, 2007)
- L’artiste est-il maître de son œuvre ? (TS, 2014)
- L’originalité fait-elle la valeur de l’œuvre d’art ? (TS, Liban, 2012)
- L’œuvre d’art ne s’adresse-t-elle qu’à nos sens ? (TS, Métropole, remplacement, 2011)
- L’art peut-il se passer de règles ? (TS, 2010)
- L’art peut-il se passer de la référence au beau ? (TS, Afrique, 2010)
- L’humanité peut-elle se passer de l’art ? (TS, Antilles, 2010)
- L’artiste doit-il chercher à plaire ? (TS, 2009, Amérique du Nord)
- Peut-on reprocher à l’art d’être inutile ? (TS, 2008, Afrique)
- Qu’admire-t-on dans une œuvre d’art ? (TS, Pondichéry, 2007)
- L’art est-il utile ? (ST, Polynésie, 2013. Sujet déjà donné par ailleurs)
- L’œuvre d’art doit-elle d’abord plaire ? (ST, Antilles, 2013)
- L’art est-il inutile ? (ST, Antilles, 2011. Sujet déjà donné par ailleurs)
- L’art répond-il à un besoin ? (ST, Polynésie, 2009)

- Philosophie
- Cours : L'art
L'art Cours
L'art est une activité créatrice. C'est le moyen par lequel l'être humain se détache de la nature. Contrairement à la technique, son produit n'a pas comme finalité d'être utile, il est destiné à la contemplation plutôt qu'à l'action. L'art est lié à la question du beau et à son universalité. L'artiste doit être distingué de l'artisan, par l'absence de règles déterminant le travail de l'artiste. L'idée de génie répond à certaines caractéristiques identifiables. Ces caractéristiques peuvent toutefois être critiquées comme un mythe de l'esprit du spectateur.
Définition de l'art
L'étymologie du mot « art » est la même que celle du mot « technique », raison pour laquelle on compare souvent ces deux notions. L'art se définit comme une activité créatrice qui a une permanence dans le temps.
L'étymologie du mot
Le mot « art » a la même étymologie que le mot « technique » : technê , en grec, qui donne ars en latin. Au départ, l'art désigne toute activité de production humaine, puis ce terme a été compris comme les beaux-arts.
Les termes de technê et d' ars renvoient tous les deux à un savoir-faire. Ainsi, l'art désigne au départ toute activité de production humaine, par opposition aux productions naturelles.
Ce n'est que par la suite qu'est apparue une distinction entre, d'un côté, la production technique et, de l'autre côté, l'art compris comme les beaux-arts. Aujourd'hui, la distinction entre l'art et la technique semble aller de soi : on dira ainsi du garagiste qu'il est technicien tandis que le sculpteur ou le peintre sont des artistes. En effet, le type d'activité qu'ils mettent en œuvre n'est pas le même : le technicien cherche à produire ou à réparer un objet, l'artiste cherche à créer. Il y aurait ainsi une supériorité de l'art sur la technique, qui suppose que l'art nécessite à la fois de la technique et quelque chose de plus, de l'ordre du génie.
L'art, une activité créative en opposition à la technique
L'art s'approprie les applications rendues possibles par les découvertes scientifiques (notamment les lois physiques et mathématiques) mais se distingue de la technique par sa finalité. La production technique vise de plus en plus la réalisation en plusieurs exemplaires d'un même type d'objet, tandis que l'œuvre d'art tend à devenir une production unique, originale, issue de l'imagination créatrice de l'artiste.
Le savoir-faire et l'habileté jouent un rôle différent dans la technique et dans l'art :
- Dans la technique, le savoir-faire permet la répétition d'un modèle grâce à l'application mécanique de règles de production définies.
- Dans la création artistique, le savoir-faire technique est certes nécessaire, mais il n'est pas suffisant. L'artiste est aussi celui qui met en œuvre son génie, qui possède un don.
Il est ainsi possible de distinguer l'art de la technique en fonction de la finalité de chacun :
- Le produit technique vise une utilisation de l'objet lui-même en vue d'une fin autre. L'objet technique s'inscrit dans l'espace ordinaire du quotidien : il est destiné à être remplacé dès lors qu'il ne remplit plus adéquatement la fin pour laquelle il a été pensé.
- À l'inverse, l'œuvre d'art est à elle-même sa propre fin. Destinée à la contemplation, l'œuvre d'art doit durer et s'inscrit dans un espace qui lui est propre (le socle de la statue, le cadre de la peinture, la scène, le musée). Cet espace est distinct de celui du quotidien.
On peut résumer ces deux finalités de la façon suivante :
- Une finalité externe : la finalité des objets techniques est dans leur utilité, leur usage. Les objets techniques sont des moyens en vue d'une fin qui leur est extérieure.
- Une finalité interne : la finalité de l'œuvre d'art n'est autre qu'elle-même. L'œuvre d'art est en elle-même une fin, et non un moyen en vue d'autre chose.
La permanence des œuvres d'art
Les œuvres d'art sont permanentes, elles ont quelque chose d'éternel.
L'œuvre d'art a quelque chose d'éternel, contrairement aux techniques qui peuvent tomber en désuétude. En effet, on continue à admirer des œuvres d'art anciennes.
On admire encore aujourd'hui les peintures rupestres dans les grottes comme Lascaux.
« [À] proprement parler, [les œuvres d'art] ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des objets d'usage : mais elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d'utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine. »
Hannah Arendt
La Crise de la culture
Les œuvres d'art, contrairement aux objets techniques, ne s'inscrivent pas dans la vie ordinaire : elles n'ont aucune fonction dans la société (ce qui les soustrait à la consommation et à l'usure). Les œuvres d'art existent pour le monde, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à survivre aux générations.
La singularité de l'œuvre d'art et les principes du beau
On s'interroge souvent sur la singularité de l'œuvre d'art et sur les principes du beau en art.
La singularité de l'œuvre d'art
L'œuvre d'art est souvent perçue comme une œuvre unique qui aurait une « aura » singulière. À l'ère de la reproductibilité, l'œuvre d'art semble perdre cette singularité, elle est désacralisée.
Une œuvre unique transmettant une idée
Si « art » est utilisé au singulier, c'est que chaque œuvre a un caractère unique, singulier, mais que quelque chose de commun lie toutes les œuvres d'art. L'œuvre d'art est une œuvre unique qui exprime une idée spirituelle de l'artiste dans la matière. En cela, l'œuvre d'art est originale.
Généralement, on désigne par la notion d'art les beaux-arts, c'est-à-dire l'ensemble des activités tournées vers la production d'œuvres qui ont pour fonction de susciter une émotion.
Pourtant, parler de l'art en général semble problématique : il existe une pluralité d'arts. Friedrich Hegel en définit cinq : l'architecture, la peinture, la sculpture, la danse, la musique. Aujourd'hui, le cinéma est également considéré comme un art.
L'emploi du singulier « art » rend compte de deux idées :
- une singularité propre à l'expérience de l'œuvre d'art ;
- quelque chose de commun à toutes les œuvres d'art.
Pour Friedrich Hegel, la singularité d'une œuvre d'art tient au fait qu'elle rend sensible une idée. En effet, l'œuvre d'art est la traduction d'une idée spirituelle dans la matière. En ce sens, l'art n'est pas une belle imitation de la nature, comme la définit Aristote. L'œuvre d'art correspond plutôt à l'expression de l'être humain, à la marque qu'il laisse dans le monde. L'art est l'activité par laquelle l'être humain, à travers son action de transformation du monde extérieur, prend conscience de lui-même.
L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité
L'art contemporain remet en question la singularité des œuvres d'art, elles ne sont plus uniques ou originales. Les œuvres d'art, comme les autres produits, peuvent être reproduites ou produites en série.
Le philosophe Walter Benjamin s'est intéressé à la question de la reproduction des œuvres d'art dans son texte L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (1936). Pour Benjamin, ce qui a toujours caractérisé l'œuvre d'art est son authenticité ou encore son statut d'original. Un original, explique-t-il, est un objet physique unique et situé en un lieu et un temps précis ( hic et nunc ) Dans son ouvrage, Benjamin montre comment la reproduction technique ruine l'idée même d'authenticité de l'œuvre d'art, c'est-à-dire son caractère unique.
L'œuvre d'Andy Warhol, et plus généralement le mouvement du pop art, illustre l'idée que l'œuvre d'art est reproductible. Andy Warhol utilise la sérigraphie pour reproduire des photographies ou des dessins par dizaines.
La reproduction permet d'avoir l'œuvre à domicile et rapproche l'œuvre du spectateur. En s'intégrant à la culture de masse, l'œuvre d'art est désacralisée.
« [À] l'époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l'œuvre d'art, c'est son aura. »
Walter Benjamin
L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique
Le caractère particulier et unique d'une œuvre d'art s'appauvrit car on peut la reproduire indéfiniment.
Les principes du beau
En art, la question du beau est fondamentale. Qu'est-ce qui permet de dire qu'une œuvre est belle ? Pourquoi un tel jugement ? Pour répondre à cette question, Kant, qui s'intéresse au jugement en art, distingue le beau de l'agréable. Pour Bourdieu, les principes du beau sont liés à l'éducation et ne sont pas universels.
La distinction entre le beau et l'agréable
Pour Kant, une œuvre d'art est une œuvre qui répond aux critères du beau. Le beau doit être distingué de l'agréable. Quand on dit « c'est beau », on suppose que tout le monde va éprouver le même sentiment de beauté devant l'œuvre, on présume que ce jugement est universel. D'après Kant, celui qui affirme qu'une œuvre est belle attend que tous les autres la reconnaissent comme belle.
Les adages populaires tels que « à chacun ses goûts » ou « des goûts et des couleurs, on ne discute point » illustrent la difficulté à s'accorder sur la catégorie du beau.
Pour répondre à cette difficulté, Kant distingue, dans la Critique de la faculté de juger , l'agréable et le beau. L'agréable touche aux sens d'un individu, ce jugement est restreint à la sphère particulière des goûts de chacun.
Le goût du vin est agréable ou désagréable.
« Lorsqu'il s'agit de ce qui est agréable, chacun consent à ce que son jugement, qu'il fonde sur un sentiment personnel et en fonction duquel il affirme d'un objet qu'il lui plaît, soit restreint à sa seule personne. [...] Le principe « à chacun son goût » (s'agissant des sens) est un principe valable pour ce qui est agréable. »
Emmanuel Kant
Critique de la faculté de juger
Pour Kant, le jugement esthétique, c'est-à-dire le jugement qui affirme la beauté d'une œuvre d'art, n'est pas restreint au goût de chacun. Kant souligne que lorsque l'individu s'exclame « c'est beau ! », il n'exprime pas qu'un avis personnel, il se prononce sur une qualité qu'il attribue à l'œuvre d'art.
« [L]orsqu'il dit qu'une chose est belle, il attribue aux autres la même satisfaction ; il ne juge pas seulement pour lui, mais pour autrui et parle alors de la beauté comme si elle était une propriété des choses. »
D'après Kant, celui qui affirme qu'une œuvre est belle attend que tous les autres la reconnaissent comme belle.
C'est la particularité du jugement esthétique : bien que ne répondant à aucun concept, on présume toujours que le sentiment du beau serait partagé par autrui. C'est pourquoi Kant postule qu'il devrait exister un accord entre les individus sur le beau. Dire qu'une œuvre est belle, c'est présupposer que chacun éprouverait le même sentiment face à elle. Le jugement esthétique présuppose l'universalité sans réussir à la prouver.
La construction sociale de la notion de beauté
Pour Bourdieu, le jugement esthétique est davantage le produit d'un apprentissage qu'un jugement universel. En ce sens, il est largement déterminé par la culture à laquelle un individu appartient. Ainsi, la notion de beauté d'une œuvre d'art n'est pas universelle. Pour Bourdieu, la notion de goût exprime davantage l'appartenance à une classe sociale.
Dans La Distinction. Critique sociale du jugement , Pierre Bourdieu montre comment l'idée même d'une catégorie du beau existant universellement est en fait le résultat de l'histoire d'une civilisation particulière. Apprendre à apprécier une œuvre d'art pour elle-même, pour ses qualités formelles, suppose déjà l'apprentissage d'une certaine conception de l'art, ainsi qu'une éducation du regard qu'il faut porter sur l'œuvre pour la juger adéquatement.
« L'"œil" est un produit de l'histoire reproduit par l'éducation. »
Pierre Bourdieu
La Distinction. Critique sociale du jugement
© Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1979
Le bon goût est la capacité à apprécier les œuvres d'art selon un ensemble de critères définis et transmis par l'éducation et donc par la classe sociale, la culture à laquelle on appartient.
Discriminer entre le bon et le mauvais goût permet à la classe dominante d'affirmer sa domination. Bourdieu affirme que : « Le goût classe, et classe celui qui classe. » Ainsi, dire que la musique classique est plus noble que le rap, c'est asseoir la domination d'une classe qui écoute de la musique classique sur tous ceux dont la culture est d'apprécier le rap.
Affirmer qu'un style musical est plus beau et plus noble qu'un autre peut être interprété comme un mode symbolique de domination.
Le statut de l'artiste
L'artiste n'est pas un artisan. Les règles qu'il applique naissent quelquefois de sa propre production. Le mythe du génie de l'artiste existe, il est dénoncé par Friedrich Nietzsche pour qui l'art est le résultat d'un travail acharné.
La différence entre l'artiste et l'artisan
L'activité de l'artiste, contrairement à celle de l'artisan, ne se soumet à aucune règle préalablement définie.
Alain, dans Système des Beaux-Arts , distingue l'artisan de l'artiste :
- L'artisan est maître des règles qui le rendent compétent dans son métier.
- L'artiste est un artisan, dans la mesure où il apprend les techniques nécessaires à la production de son art, mais il va au-delà des règles, il y a « débordement ». L'œuvre d'art prend forme au fur et à mesure sous la main de l'artiste, il n'y a pas de règle préalable.
« Il reste à dire en quoi l'artiste diffère de l'artisan. Toutes les fois que l'idée précède et règle l'exécution, c'est industrie. [...] Pensons maintenant au travail du peintre de portrait ; il est clair qu'il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu'il emploiera à l'œuvre qu'il commence ; l'idée lui vient à mesure qu'il fait ; il serait même rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c'est là le propre de l'artiste. »
Système des Beaux-Arts
© Gallimard, coll. « Tel », 1920
L'artiste ne possède pas une idée déterminée de l'œuvre qu'il réalise. C'est en réalisant son œuvre que la règle qui la détermine apparaît.
L'absence préalable de règle permet la réalisation d'une œuvre artistique. C'est pourquoi l'œuvre d'art est toujours singulière, alors que l'œuvre technique, qui suit un procédé de réalisation prédéfini, peut être reproduite à l'infini. L'artiste n'est donc pas seulement un artisan, car il ne fabrique pas seulement, il crée.
Le génie de l'artiste
La spécificité de l'art ne réside peut-être pas dans l'œuvre produite, mais plutôt du côté de ce qui fait un artiste. Kant, cherchant à comprendre l'origine de l'art, en vient à penser que les règles de l'art découlent du génie de l'artiste. Ce génie repose sur l'originalité, l'exemplarité et l'inexplicable.
Dans la Critique de la faculté de juger , Kant souligne que tout art suppose des règles. Pourtant, les beaux-arts, s'ils utilisent des procédés techniques, ne fournissent pas eux-mêmes les règles qui produisent la beauté de leurs œuvres. Kant en conclut que les règles des beaux-arts sont à chercher ailleurs : dans la nature.
Plus précisément, pour Kant, c'est la nature qui donne ses règles à l'art, par le biais du talent particulier des génies. Le génie est celui qui, grâce à son talent, donne ses règles à l'art.
Kant énonce trois caractéristiques du génie :
- L'originalité : le génie consiste à produire « ce dont on ne saurait donner aucune règle déterminée ». Quand on peut donner une telle règle, l'œuvre ne relève pas de l'art, mais de la technique. Le génie n'est donc pas une qualité acquise, mais un talent inné.
- L'exemplarité : il ne suffit pas au génie d'être original, car « l'absurde aussi peut être original ». Les œuvres d'art produites par le génie doivent être des modèles : l'œuvre géniale doit servir d'exemple du bon goût.
- L'inexplicable : le talent du génie est inné, ce qui signifie que le génie lui-même ne peut expliquer comment il parvient à réaliser ses œuvres.
La remise en question du mythe du génie de l'artiste
Nietzsche affirme que la théorie du génie doué d'un talent naturel inné et inexplicable est fausse. Pour être un artiste, il faut beaucoup travailler. Si le mythe de l'artiste existe, c'est à la fois parce qu'il est entretenu par l'artiste et parce que l'humain cherche à justifier ce qu'il ressent face à l'œuvre. Pour ne pas être envieux de la beauté d'une œuvre, l'humain se convainc que l'artiste est génial.
Pour Nietzsche, le mythe du génie de l'artiste est une illusion entretenue par les artistes eux-mêmes dans le but de se démarquer des artisans. En vérité, l'acte de création est lié à un travail acharné et méthodique, comme dans l'artisanat. Aucune œuvre, aucune création humaine, qu'elle soit scientifique, technique, militaire ou artistique, n'est le produit d'un miracle. Pour Nietzsche, la différence entre l'artiste et l'artisan ne tient pas au processus de travail, mais au rapport que l'on entretient avec son résultat : on attend de la technique des objets utiles, et de l'art de la beauté. On parle de génie en face des œuvres qui sont belles. Le plaisir esthétique ne veut pas être gâché par l'envie, c'est-à-dire la haine pour celui qui possède ce dont on est privé : le talent. En attribuant au génie la capacité de créer des œuvres belles de façon innée, on empêche ce sentiment : on éprouve alors uniquement de l'admiration pour le créateur de l'œuvre.
En fin de compte, c'est bien parce que l'œuvre n'est admirée que comme produit fini que l'on peut penser qu'elle est celle d'un génie. L'œuvre réussi paraît naturelle, miraculeuse, comme si elle avait été facile à réaliser. On ne voit plus le long travail d'élaboration derrière. La perfection sous laquelle se présente l'œuvre d'art fait oublier qu'elle est le résultat d'une patiente et difficile gestation.
- Philosophie niveau bac 2024
- L'existence humaine et la culture. Bac de philosophie 2024

L'art,le beau, la création,la technique. A t'il pour fonction d'être beau?Peut-il se passer de maîtrise technique?Choisit-on d'être artiste?
- lexiques citations, définitions. qu’est-ce que l’art imitation, dévoilement-l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique - désacralisation-.
Premier lieu commun : L'artiste doit imiter la nature.
Deuxième lieu commun : Une œuvre d'art doit représenter quelque chose, être figurative !
Troisième lieu commun : Produire une œuvre d'art réclame un savoir-faire technique.
Quatrième lieu commun : L'art c'est forcément beau Cette idée rejoint une définition classique de l'art.
Cinquième lieu commun : L’art, "Ça ne sert à rien !"
Le goût peut-il être instrument de discernement esthétique?
Questionnaire bac sur l'art pour réviser
Faut-il être cultivé pour apprécier l'art?
Une oeuvre d'art a t'-elle toujours un sens?
Peut-on être insensible à l’art ?
Peut on reprocher à une œuvre d’art de ne rien vouloir dire?
Les œuvres d’art éduquent-elles notre perception?
Pouvons-nous parler objectivement lorsqu'il s'agit d'une oeuvre d'art ?
L'art peut-il se passer de règles? Corrigé 1 - Corrigé 2
Hume, extrait De la norme du goût. pourquoi l’expérience esthétique faite d’un point de vue singulier fausse-t-elle le goût ?
Manuel de philosophie : les textes de référence sur le thème de l'art au bac de philosophie, toutes séries, l’art : lexique de définitions pour bien comprendre les concepts.
ART, ARTISTE
En latin « ars », désignait « l‘habileté acquise par l’étude ou la pratique ». Le mot peut donc s’appliquer à toutes les activités humaines qui impliquent la maitrise d’un savoir faire codé : art de la guerre, art oratoire, art d’être ceci ou cela…
Au XVIème et au XVIl ème siècle, le nom de celui qui pratique les arts est artisan . (de l’italien artigiano .)
Ce n’est que depuis le XVIIIème siècle et parallèlement à l’apparition du mot « technique » que l’art est qualifié par le terme « beaux-arts . C’est donc au XVIIIème siècle que la distinction entre artiste et artisan commence à se faire.
Beau : valeur à laquelle renvoie le jugement esthétique
Esthétique : étymologiquement, esthétique vient du grec « aisthétiko » qui signifie ce que les sens peuvent percevoir. Le mot esthétique s’emploie couramment comme synonyme de beau. Art : le terme art (ars en latin traduit le mot grec technè) désigne aussi bien la technique, le savoir faire que la création artistique, la recherche du beau. L’art vise la création du beau. Il s’affranchit de l’utile et d’une fin déterminée à l’avance.
Laid : désagréable à la vue, à l’esprit. Qui inspire le dégoût, qui est méprisable
TECHNIQUE :
Du grec “ tecknè “ , “art, habileté” .
D’abord synonyme d’art au sens de savoir faire dont la mise en œuvre permet d’obtenir volontairement un résultat déterminé .
La technique :vise l’utilité et l’efficacité .
La technique permet la maitrise de la nature par l’homme posant du même coup l’irréversibilité de ses progrès.
L’outil est devenu le médiateur entre l’homme et la nature . Les outils sont les prolongements du corps de l’homme. Ce qui lui permet de survivre (cf. Mythe de Prométhée ). Ces outils sont aussi un moyen de se rendre « comme maitre et possesseurs de la nature »( Descartes ).
Dans le champ de l’art, le terme de technique recoupe au moins quatre définitions distinctes, il désigne :
les matériaux employés dans la réalisation de l’objet exposé
le savoir faire artisanal de l’artiste
une simple manière de procéder, qui ne suppose pas nécessairement l’acquisition d’un savoir-faire particulier. (certaines techniques compromettent la spontanéité d’un geste ou entravent les possibilités de découvertes accidentelles).
Enfin, renvoyant aux productions industrielles, la technique désigne l’ensemble des machines
Exercices, questionnaires, quiz de philosophie pour réviser "l'art". Progressez avec les quiz
Exercices, questionnaires, quiz de philosophie pour réviser "l'art", existence humaine/culture-progressez avec les quiz, questionnaires corrigés .
Exercices, questionnaires, quiz de philosophie pour réviser "l'art", Existence humaine/Culture - Progressez avec les quiz, questionnaires corrigés pour le bac
Qu’est-ce que l’art ?
Emmanuel Kant (1724-1804) Philosophe allemand. La Critique de la faculté de juger s’intéresse, en particulier, au jugement de goût, dont l’objet est l’œuvre d’art.
En droit on ne devrait appeler art que la production par liberté, c’est-à-dire par un libre arbitre qui met la raison au fondement de ses actions. On se plaît à nommer une œuvre d’art le produit des abeilles (les gâteaux de cire régulièrement construits), mais ce n’est qu’en raison d’une analogie avec l’art ; en effet, dès que l’on songe que les abeilles ne fondent leur travail sur aucune réflexion proprement rationnelle , on déclare aussitôt qu’il s’agit d’un produit de leur nature (de l’instinct), et c’est seulement à leur créateur qu’on l’attribue en tant qu’art.
Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger (1750)
Pour qu’il y ait « art », il faut qu’il y ait intention. Les abeilles n’ont pas une intention. Elles fabriquent ce que pour quoi elles sont programmées. Elles ne savent rien faire d’autre. . C’est une activité innée et non une manifestation de l’esprit. Pour Kant, on ne peut donc « appeler art » que la production par liberté ».
« Parmi les choses qu’on ne rencontre pas dans la nature, mais seulement dans le monde fabriqué par l’homme, on distingue entre objets d’usage et œuvres d’art ; tous deux possèdent une certaine permanence qui va de la durée ordinaire à une immortalité potentielle dans le cas de l’œuvre d’art. En tant que tels, ils se distinguent d’une part des produits de consommation, dont la durée au monde excède à peine le temps nécessaire à les préparer, et d’autre part, des produits de l’action, comme les événements, les actes et les mots, tous en eux-mêmes si transitoires qu’ils survivraient à peine à l’heure ou au jour où ils apparaissent au monde, s’ils n’étaient conservés d’abord par la mémoire de l’homme, qui les tisse en récits, et puis par ses facultés de fabrication. Du point de vue de la durée pure, les œuvres d’art sont clairement supérieures à toutes les autres choses; comme elles durent plus longtemps au monde que n’importe quoi d’autre, elles sont les plus mondaines des choses. Davantage, elles sont les seules choses à n’avoir aucune fonction dans le processus vital de la société; à proprement parler, elles ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des objets d’usage: mais elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine. »
Hannah Arendt , La Crise de la culture
Quiz ton bac philo Exercices pour la classe de terminale. L'art et la technique
Quiz bac philosophie, l'art, la technique. existence humaine/culture.
Quiz ton bac philo Exercices pour la classe de terminale Support cours : l'art, la technique. Existence humaine/Culture
Questionnaire sur l'art
Les réponses aux questions sont données - Le document comprend 44 questions réponses
Quiz bac dissertation de philo sur le thème de l'art, l'idée de beau
- Quiz ton bac philo Exercices pour la classe de terminale - l'art, la technique. Existence humaine/Culture
- Support cours et dissertation :
- L'art a t'-il pour fonction d'être beau? Avons-nous besoin de l'art pour nous faire une idée du beau?
Kant nous disait que l'art n'est pas «la représentation d'une belle chose mais la belle représentation d'une chose».
La beauté naturelle et la beauté artistique Emmanuel Kant (1724-1804) Philosophe allemand. La Critique de la faculté de juger s’intéresse, en particulier, au jugement de goût, dont l’objet est l’œuvre d’art.
Il existe deux espèces de beauté la beauté libre ou la beauté simplement adhérente. La première ne présuppose aucun concept de ce que l’objet doit être ; la seconde suppose un tel concept et la perfection de l’objet d’après lui. Les beautés de la première espèce s’appellent les beautés (existant par elles-mêmes) de telle ou telle chose ; l’autre beauté, en tant que dépendant d’un concept (beauté conditionnée), est attribuée à des objets compris sous le concept d’une fin particulière.
Des fleurs sont de libres beautés naturelles. Ce que doit être une fleur, peu le savent hormis le botaniste et même celui-ci, qui reconnaît dans la fleur l’organe de la fécondation de la plante, ne prend pas garde à cette fin naturelle quand il en juge suivant le goût. [..,]
Dans l’appréciation d’une libre beauté (simplement suivant la forme) le jugement de goût est pur, On ne suppose pas le concept de quelque fin pour laquelle serviraient les divers éléments de l’objet donné et que celui-ci devrait ainsi représenter, de telle sorte que [par cette fin] la liberté de l’imagination, qui joue en quelque sorte dans la contemplation de la figure, ne saurait qu’être limitée.
Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Éd. Vrin, 1974
Kant distingue deux types de beauté :
- L’une, la beauté libre , ne dépend d’aucun but. Sa beauté n’est pas liée à sa fonction . C’est une beauté purement esthétique. (La beauté naturelle sera donc plus souvent une beauté libre .(Oiseaux, crustacés..) Mais même dans ce cas, si on s’intéresse à la fonction, il ne s’agit plus alors de beauté libre
- L’autre, la beauté adhérente , ne peut pas être pensée indépendamment de sa fin ou de sa fonction. Plus loin dans le texte, Kant donne l’exemple d’une église. Pour lui, la beauté du lieu ne peut pas être détachée de sa fonction (la prière) et de son but.
Donc pour lui, la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique car elle est purement esthétique tandis qu’il y a une part de plaisir lié à la connaissance dans l’œuvre artistique
L'art et le goût : notions essentielles à maîtriser
Le goût comme instrument de discernement esthétique
Si la production artistique a pour fonction d'être belle alors l'art serait affaire de goût, le beau serait la finalité
. Pour reprendre les mots de Kant, nous dirons que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose.
Si le beau comme finalité esthétique suppose l'authenticité et la liberté de l'artiste alors l'art est plus qu'une affaire de goût.
Marcel Duchamp affirme que, «le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût . L'artiste n'a pas à se préoccuper des modes des goûts et des notions du beau qui prédominent dans une société»
Quête non pas du beau mais de liberté et d'authenticité.
D'un point de vue synthétique, on peut supposer que l'art est
une affaire de goût
cependant l'artiste doit être libre de créer, donc non contraint de suivre les règles fixes des canons esthétiques.
Le goût selon Kant
Le goût est l'instrument de discernement esthétique
. Dans sa Critique de la faculté de juger, Kant étudie le goût selon quatre points
1 – Le goût du point de vue de la qualité
Le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Il se rapporte aux sentiments de plaisir et de peine.
2 – Le goût du point de vue de la quantité
Est beau ce qui plaît universellement sans concept.
3 – Le goût du point de vue de la relation à une fin
La beauté est définie comme la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle est perçue en celui-ci sans représentation d'une fin. C'est la définition de la beauté comme finalité sans fin, formelle.
4 – Le goût du point de vue de la modalité du jugement de goût
«Est beau ce qui est reconnu sans concept comme objet d'une satisfaction nécessaire».
En rapport avec la question de savoir si le goût peut ou non être un instrument de discernement esthétique, nous vous proposons d'étudier la question kantienne du jugement de goût : Allons plus loin Le goût est l'instrument de discernement esthétique, la capacité de reconnaître le beau, de porter un jugement. Dans sa Critique de la faculté de juger, Kant étudie le goût comme une exposition et une déduction transcendantale du jugement qui pose qu'une chose est belle. Il en pose quatre aspects : 1 – Le goût du point de vue de la qualité La première définition est déduite de la qualité du jugement de goût. Le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Il se rapporte aux sentiments de plaisir et de peine. Dans le goût, le sujet ne porte pas de jugement sur l'objet. Il est juste affecté par une représentation. Il y a un plaisir pur qui n'est pas lié à l'existence de l'objet par opposition à la notion d'agréable relativement à la consommation d'un objet. 2 – Le goût du point de vue de la quantité
Est beau ce qui plait universellement sans concept. C'est la conséquence de notre point précédent., puisque la satisfaction donnée par la représentation de l'objet est libre de tout intérêt, celui qui juge est amené à attribuer à chacun une semblable satisfaction qui ne constitue pas une connaissance objective mais elle est valable pour tous. L'art est affaire de goût qui relève d'un jugement esthétique du point de vue de la quantité qui nous révèle une universalité subjective et qui nous sépare de l'agréable. Lorsque dans un jugement réfléchi on dit qu'un chose est belle, on juge aussi pour autrui, nous avons donc une universalité subjective et cela nous permet d'échapper à l'empirisme, car cette universalité est une idée. 3 – Le goût du point de vue de la relation à une fin
La beauté est définie comme la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle est perçue en celui-ci sans représentation d'une fin. C'est la définition de la beauté comme finalité sans fin, formelle. Cela nous informe sur le principe transcendantal du goût . La finalité qui sert de principe au goût est une finalité subjective, formelle. Si la finalité admettait une fin elle ferait dépendre la beauté de l'agréable. Il n'y a pas de finalité objective. 4 – Le goût du point de vue de la modalité du jugement de goût «Est beau ce qui est reconnu sans concept comme objet d'une satisfaction nécessaire». La nécessité du jugement esthétique est une nécessité exemplaire, tous doivent adhérer à un jugement qui apparaît comme un exemple d'un règle que l'on ne peut énoncer. Le quatrième moment de l'analytique du jugement de goût permet de définir l'art comme une affaire de goût au sens où le goût est vu comme la faculté de juger d'un objet en rapport avec la libre légalité de l'imagination.
A consulter
Dans ce cours = Repérage et analyse des distinctions conceptuelles autour des corrigés des sujets suivants :
Commentaire philosophique : De la norme du goût, Hume
L'art est-il une imitation? Aristote, Platon et Hegel
L'art n'est pas une imitation. Il n'est pas fidèle à la nature comme l'art de la photographie par exemple.
Malraux, «de même qu'un musicien aime la musique et non les rossignols, un poète des vers et non les couchers de soleil, un peintre n'est pas d'abord un homme qui aime les figures et les paysages. C'est un homme qui aime les tableaux. Malraux nous montre qu'un jeune peintre commence par imiter, mais par imiter les toiles de ses maîtres, et non pas la nature, avant de trouver sa manière propre de peindre;
Donc l'art serait une transposition et non pas un reflet du réel. Cela fait de la création, une recréation.
La poésie* semble bien devoir en général son origine à deux causes, et deux causes naturelles. Imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès leur enfance (l’homme diffère des autres animaux en ce qu’il est très apte à l’imitation et c’est au moyen de celle-ci qu’il acquiert ses premières connaissances) et, en second lieu, tous les hommes prennent plaisir aux imitations.
Un indice est ce qui se passe dans la réalité : des êtres dont l’original fait peine à la vue, nous aimons à en contempler l’image exécutée avec la plus grande exactitude ; par exemple les formes des animaux les plus vils et des cadavres.
Une raison en est encore[1] qu’apprendre est très agréable non seulement aux philosophes mais pareillement aussi aux autres hommes ; seulement ceux-ci n’y ont qu’une faible part. On se plaît à la vue des images parce qu’on apprend en les regardant et on déduit ce que représente chaque chose, par exemple que cette figure c’est un tel[2]. Si on n’a pas vu auparavant l’objet représenté, ce n’est plus comme imitation que l’oeuvre pourra plaire, mais à raison de l’exécution, de la couleur ou d’une autre cause de ce genre.
Aristote , Poétique , 4, 1448 b, Éd. Les Belles Lettres,
[1] Une raison en est encore : l’exemple qui précède constitue une première explication du plaisir lié à l’imitation.
[2] Cette figure c’est un tel : le même thème est repris dans Rhétorique, livre I, ch. 11, § XXIII (LGF, 1991). » Comme il est agréable d’apprendre et de s’étonner […] il en résulte nécessairement que ce qui est imitation l’est aussi […] ce n’est pas le sujet qui plaît mais plutôt le raisonnement qui fait dire :” c’est bien cela “, et par suite duquel il arrive qu’on apprend quelque chose. »
l’esthétique de la mimesis n’a jamais été une invitation à reproduire le réel
propos aristotélicien = « l’art imite la nature ou l’achève» signifie que l’artiste doit être un aussi bon artiste que la nature pour porter à l’expression ce qu’il cherche à en montrer. Or pour rivaliser avec la nature, il faut savoir lui être infidèle. Le corps humain n’a jamais eu les proportions de la statuaire grecque mais ce sont ces proportions qui en montrent la force et l’harmonie.
L’art est un mensonge qui dit la vérité (il ne s'agit pas d'une fidèle reproduction, elle suppose transposition, idéalisation)= l'imitation est naturelle aux hommes, elle apporte selon Aristote plaisir et connaissance par opposition à Platon.
la mimèsis est condamnée par Platon dans La République, livre III, 393-398, et livre X, 595-608
Pour Platon , l’art reste l’illusion d’une illusion. Platon critique l’art en tant que copie – il vaut moins que son original – et en tant que discours enchanteur – il nous ment. L’art nous éloigne donc du Vrai et du Bien. Dans Les Lois, il recommande même de « chasser les poètes de la cité ». Mais s’il approuve la censure, il ne rejette pas tous les arts : formé à l’école de Pythagore qui trouva les lois de l’harmonie, il estime que la musique a une grande valeur pédagogique et qu’elle élève l’âme.
Socrate – Il y a donc trois espèces de lit ; l’une qui est dans la nature, et dont nous pouvons dire, ce me semble, que Dieu est l’auteur ; à quel autre, en effet, pourrait-on l’attribuer ?
Glaucon – A nul autre Socrate – Le lit du menuisier en est une aussi Glaucon – Oui Socrate – Et celui du peintre en est encore une autre, n’est-ce pas ? Glaucon – Oui Socrate – Ainsi le peintre, le menuisier, Dieu, sont les trois ouvriers qui président à la façon de ces trois espèces de lit. […] Donnerons-nous à Dieu le titre de producteur de lit, ou quelqu’autre semblable ? Qu’en penses-tu ? Glaucon – Le titre lui appartient, d’autant plus qu’il a fait de lui-même et l’essence du lit, et celle de toutes les autres choses. Socrate – Et le menuisier, comment l’appellerons-nous ? L’ouvrier du lit, sans doute ? Glaucon – Oui Socrate – A l’égard du peintre, dirons-nous aussi qu’il en est l’ouvrier ou le producteur ? Glaucon – Nullement Socrate – Qu’est-il donc par rapport au lit ? Glaucon – Le seul nom qu’on puisse lui donner avec le plus de raison, est celui d’imitateur de la chose dont ceux-là sont ouvriers. […] Socrate – Le peintre se propose-t-il pour objet de son imitation ce qui, dans la nature, est en chaque espèce, ou plutôt ne travaille-t-il pas d’après les œuvres de l’art ? Glaucon – Il imite les œuvres de l’art.(…)
Socrate – Pense maintenant à ce que je vais dire ; quel est l’objet de la peinture ? Est-ce de représenter ce qui est tel, ou ce qui paraît, tel qu’il paraît ? Est-elle l’imitation de l’apparence, ou de la réalité ? Glaucon – De l’apparence. Socrate – L’art d’imiter est donc bien éloigné du vrai ; et la raison pour laquelle il fait tant de choses, c’est qu’il ne prend qu’une petite partie de chacune ; encore ce qu’il en prend n’est-il qu’un fantôme. Le peintre, par exemple, nous représentera un cordonnier, un charpentier, ou tout autre artisan, sans avoir aucune connaissance de leur métier ; mais cela ne l’empêchera pas, s’il est bon peintre, de faire illusion aux enfants et aux ignorants, en leur montrant du doigt un charpentier qu’il aura peint, de sorte qu’ils prendront l’imitation pour la vérité. Glaucon – Assurément.
Platon, La République
Dans ce texte extrait de La République, Platon inventorie 3 formes de lits :
a)L’Idée du lit, dans le monde Intelligible (dimension divine)C’est le lit absolu. Le « vrai » lit. (Il n’en existe qu’une seule forme)
b) Le lit de l’artisan, le lit de l’artisan traduit dans la matière le lit idéal. Il imite la forme Il n’est lit que par ressemblance avec l’Idée du lit . (Il en existe plusieurs formes).Mais il garde unlien avec « l’essence » du lit idéal
c)Le lit de l’artiste n’est plus un lit puisqu’il ne représente qu’ « une petite partie du lit ». C’est une imitation de l’apparence du lit de l’artisan qui est déjà lui-même une apparence. Le lit de l’artiste n’a donc plus rien à voir avec l’essence du lit. Le lit de l’artiste imite l’apparence sensible. Aussi on ne pourra atteindre l’idée du lit grâce au lit de l’artiste
En fait, la représentation du lit par l’artiste nous égare, nous trompe, nous éloigne de la vérité du lit. C’est pourquoi l’artiste représente un danger.
Hegel souligne l’insuffisance du concept d’imitation pour penser l’essence de l’art.
• idée inutile car il n’y a aucune raison à vouloir représenter ce qui existe déjà et parce que le résultat ne peut être qu’inférieur à l’original (Hegel reprend en un sens la critique de Platon) ; • l’invention y est absente
L’art comme « caricature de la vie ».
En indiquant qu’un art qui vise l’imitation n’est qu’une caricature de la vie, Hegel souligne l’imperfection de toute imitation par rapport à la réalité. L’artiste ne peut pas, par ses propres moyens techniques, parvenir à reproduire ce que fait la nature, la vie, et qui est perceptible par tous les sens
C’est un vieux précepte que l’art doit imiter la nature ; on le trouve déjà chez Aristote. Quand la réflexion n’en était encore qu’à ses débuts, on pouvait bien se contenter d’une idée pareille ; elle contient toujours quelque chose qui se justifie par de bonnes raisons et qui se révélera à nous comme un des moments de l’idée ayant, dans son développement, sa place comme tant d’autres moments.
D’après cette conception, le but essentiel de l’art consisterait dans l’imitation, autrement dit dans la reproduction habile d’objets tels qu’ils existent dans la nature, et la nécessité d’une pareille reproduction faite en conformité avec la nature serait une source de plaisirs. Cette définition assigne à l’art un but purement formel, celui de refaire une seconde fois, avec les moyens dont l’homme dispose, ce qui existe dans le monde extérieur, et tel qu’il y existe. Mais cette répétition peut apparaître comme une occupation oiseuse et superflue, car quel besoin avons-nous de revoir dans des tableaux ou sur la scène, des animaux, des paysages ou des événements humains que nous connaissons déjà pour les avoir vus ou pour les voir dans nos jardins, dans nos intérieurs ou, dans certains cas, pour en avoir entendu parler par des personnes de nos connaissances ? On peut même dire que ces efforts inutiles se réduisent à un jeu présomptueux dont les résultats restent toujours inférieurs à ce que nous offre la nature. C’est que l’art, limité dans ses moyens d’expression, ne peut produire que des illusions unilatérales, offrir l’apparence de la réalité à un seul de nos sens ; et, en fait, lorsqu’il ne va pas au-delà de la simple imitation, il est incapable de nous donner l’impression d’une réalité vivante ou d’une vie réelle : tout ce qu’il peut nous offrir, c’est une caricature de la vie.
Hegel,Esthétique, Introduction : Chap. I, Section II, §. 1,tr. fr. S. Jankélévitch, éd. Champs Flammarion, pp. 34-35
HLP -La mimèsis comme pouvoir de la parole-Aristote, Platon-De l'agréable à l 'horreur.Une ekphrasis : le bouclier d’Achille
La mimèsis, pouvoir de la parole-Aristote, Platon-De l'agréable à l 'horreur.Une ekphrasis : le bouclier d’Achille- Le Vase, Hérédia. PHILOSOPHIE La finalité visée par la tragédie- relation divine menacée par l’hybris du héros-Humanités, littérature, philosophie bac 2021 Semestre 1 1ère : Les pouvoirs de la parole
Les fonctions de l'art - L'art comme dévoilement- L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique - Désacralisation de l'art
Pour Bergson , comme pour Proust, l'art est un dévoilement, l'artiste est un révélateur, il révèle, il donne à voir. Mais s’il révèle ce qui est, c’est que ce que l’artiste donne à voir ce n’est donc pas une invention, ce n’est pas une réalité qu’il réinvente : L’art renvoie à l’expérience humaine universelle.
« A quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience? Le poète et le romancier qui expriment un état d’âme ne le créent certes pas de toutes pièces ; ils ne seraient pas compris de nous si nous n’observions pas en nous, jusqu’à un certain point, ce qu’ils nous disent d’autrui. Au fur et à mesure qu’ils nous parlent, des nuances d’émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps mais qui demeuraient invisibles telle l’image photographique qui n’a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. […]
Remarquons que l’artiste a toujours passé pour un «idéaliste ». On entend par là qu’il est moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie. C’est, au sens propre du mot, un «distrait ». Pourquoi, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses? On ne le comprendrait pas, si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes n’était une vision que notre attachement à la réalité, notre besoin de vivre et d’agir, nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait, il serait aisé de montrer que, plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à contempler, et que les nécessités de l’action tendent à limiter le champ de la vision.
Henri Bergson . La pensée et le mouvant, 1938. PUF, Quadrige1990. p.149 à 151.
« Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous voyons le monde se démultiplier, et, autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent à l’infini, et, bien des siècles après que s’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial ». Marcel Proust, (1871-1922), in Recherche du temps perdu (1927)
En s’appuyant sur l’étude du pop art, et singulièrement des travaux d’Andy Warhol, Arthur Danto, philosophe américain, a questionné la création artistique
Quelle est la différence entre les œuvres d’art et les objets qui nous entourent ? Comment comprendre la différence entre l'art et les produits fonctionnels ?
«?Les œuvres d’art sont des significations incarnées?», conclut-il, toute œuvre est une matière à interpréter.
Pour Danto, l’art est une «?pensée visuelle?». L'objet est une œuvre après l'acte d'interprétation. C'est par l'interprétation que l'on donne une identité à l'objet. L'interprétation est un processus de transformation, d'un statut = une certaine théorie de l'art. C'est cette théorie qui fait entrer l'objet dans le monde de l'art.
Andy Warhol
Campbell's Soup Cans 1962
Objet emblématique d'une société de consommation qui érige en icône n'importe quel objet, même le plus banal comme c'est le cas ici, la boîte de conserve pour soupe. Elle est consacrée comme une œuvre d'art, elle est admirée indépendamment de son usage pratique, elle est consommée en série. On a l'idée de fétichisme car la collection des boîtes de conserve y ressemble. Il s'agit de posséder des objets, cela répond à un désir de maîtrise totale. Donc, la Campbell's Soup Can devient un objet mythique. L'objet fétiche participe à l'élaboration d'un mythe dans l'inconscient. L'objet ordinaire devient une icône parfaite, reproductible à son tour indéfiniment. L'objet devient esthétique. Il devient un système complexe de signes. On aime l'objet non pour ce qu'il est mais pour ce qu'il signifie, ce qu'il représente, symbolise, d'où sa puissante attraction. La Campbell 's Soup Can esst consacrée en tant qu'objet d'art. La boîte de conserve est sublimée, elle devient une icône moderne. L'objet courant et banal devient un objet culte, un signe, un objet d'art.
L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique
Walter benjamin, essai rédigé en 1935 et publié à titre posthume en 1955.
Le philosophe Walter Benjamin s’est intéressé à cette question de la reproduction des œuvres d’art dans son texte L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1936). Il y montre en effet comment la reproduction technique ruine l’idée même d’authenticité de l’œuvre d’art, c’est-à-dire son caractère unique.
Il évoque la déperdition de l'aura. Les œuvres issues de techniques de reproduction de masse comme la photographie ont participé de la déperdition de l'aura propre de l'oeuvre unique à cause de la reproductibilité et des sous-modèles. Cela annonce un changement de statut de l'oeuvre d'art. Elle est privée de ses ornements classiques, elles perdent leur caractère sacré = ex, le Pop Art = fabrication industrielle d'artefacts. On peut parler de désincarnation de l'oeuvre d'art
Walter Benjamin fait sa réflexion autour de trois axes, la reproduction technique et ses conséquences sur l'art, l'image cinématographique et enfin le cinéma, art de masse. Les techniques de reproduction sont des nouvelles techniques qui s'affirment comme de nouvelles formes d'art. Mais ce qui se perd dans l'oeuvre d'art c'est l'aura de l'oeuvre, c'est-à-dire, «son unique apparition d'un lointain si proche ». Ainsi la technique de reproduction a changé la perception du spectateur lui donnant l'impression que l'art est enfin devenu plus accessible. Ainsi l'acteur de cinéma n'est plus qu'une image au regard du public. Son corps est subtilisé par l'appareil cinématographique. C'est cette image qui offre au spectateur une représentation du réel. Si l'aura disparaît avec la reproduction technique, elle en révèle aussi l'absence.
Hergé, L'Oreille cassée
Texte l oreille cassee (346.95 Ko)
Désacralisation : reproduction de masse
les copies du fétiche se multiplient dans ce passage, on peut dire qu’il perd de sa valeur il est désacralisé.
Désacralisation
La désacralisation consiste à retirer le caractère sacré à un objet.
La sacralisation au contraire est le fait de donner un caractère sacré
- avec le rassemblement de tous ces différents objets le vrai fétiche disparaît ; surtout dans la multitude de fétiches de la dernière vignette et aussi chez le vendeur d’apothicaire.
- la vitrine dans la 4ème vignette représente bien la situation chaotique dans laquelle tintin se trouve puisqu’elle est pleine d’objets provenant de différents endroits du monde et époques.
- Le nombre de fétiches double triple se multiplie pour atteindre les 40 fétiches dans la dernière vignette
- avec la présence de tous ces fétiches on ne sait plus comment faire la différence entre le vrai et le faux, ainsi le fétiche perd de son unicité, soit son aura ce qui signifie son authenticité et valeur religieuse.
- Malgré l’existence de tous ces fétiches, l’original reste absent et l’énigme reste irrésolue
La valeur du fétiche change en fonction du temps et sur cette planche il passe d’un objet de culte, à un objet d’art, à un objet de consommation.
Un objet culte :
- Le fétiche a un pouvoir de présence et d’absence, il est à la fois visible et invisible, on ne sait plus comment faire la différence entre le vrai et le faux : le seul moyen d'y parvenir, est de l’ouvrir pour trouver le diamant qui y est caché.
- Le fétiche est partout et nul part en même temps, on trouve toutes ses copies mais pas le véritable fétiche.
Un objet d’art :
Le fétiche est à vendre chez le vendeur d’apothicaire, c’est -à -dire, qu’il a la même valeur que le tableau, le vase, les bustes, les meubles …
- le fétiche a une valeur d’exposition puisqu’il est dans une vitrine dans la 4ème vignette comme s’il était exposé dans un musée pour que les gens l’admirent.
Un objet de consommation :
- On donne au fétiche un prix comme si c’était une marchandise « 200 fr ! ... c’est pour rien ! … » Vignette 4, on peut lire « 17.50 la paire » et son prix diminue au fur-et-à-mesure que l’on avance dans la planche ; le fétiche est dévalué.
- Le fétiche est standardisé, il est produit comme n’importe quel objet de consommation, en masse dans un atelier par des ouvriers qui ont chacun une tache à réaliser à la chaîne ; on en voit un qui est chargé de casser les oreilles des fétiches.
- ainsi le fétiche perd de sa valeur.
Sujets corrigés, l'art
Corrigé du sujet n° 2, dissertation philosophique, sujet national 2019, série l-à quoi bon expliquer une œuvre d’art .
Correction du sujet n° 2 de philosophie : la dissertation philosophique de métropole , bac série L, année 2019 - Les corrigés en ligne à la sortie de l'épreuve À quoi bon expliquer une œuvre d’art ?
L'art a t'-il pour fonction d'être beau?
Arguments pour une thèse
*** L'art a pour fonction d'être beau
On peut affirmer que l'art a pour fonction d'être beau si la notion de beau signifie conformité aux goûts d'une époque et si on se place dans la position d'un spectateur habitué à une forme plutôt qu'à une autre de langage artistique.
Chacun a son esthétique, le beau est une notion relative. Aujourd'hui les peintres impressionnistes sont admirés alors qu'ils étaient à peine regardés par les salons officiels de la fin du XIXème siècle. Nous pouvons donc affirmer que l'art a pour fonction de nous offrir «du beau» et que l'homme a une certaine idée de la beauté. «L'art n'est pas la représentation d'une belle chose mais la belle présentation d'une chose» Kant
En tant que création libre, l'art peut produire du beau. Il ajoute de la beauté au réel et au quotidien. Il doit garder le beau comme finalité, donc l'art n'est pas pour reprendre les mots de Kant de «représenter une belle chose» mais «une belle présentation»
La notion de beau est relative, le spectateur et l'artiste n'aspirent pas forcément à la même notion du beau mais l'artiste ne tient pas compte de celle du spectateur au moment de la création. Il ne se conforme à aucun goût particulier, d'une époque ou d'une culture. Le but est de créer en exprimant le beau.
Arguments pour une antithèse
*** l'art a pour fonction d'être vrai et libre
En tant que l'art est la mission des artistes, les notions essentielles sont l'authenticité, la vérité et la liberté. Dans ce cas on répond non à la question de savoir si l'art a pour fonction d'être beau. Beau = Vrai
L'art ne vise pas le beau mais l'invisible (fonction du créateur de l'antiquité, intermédiaire entre l'homme et les Dieux) ou encore d'un point de vue moderne, l'art est une intériorité, il reflète l'inconscient et tout ce qui échappe à l'homme. L'artiste nous offre sa vision du monde
L'artiste n'est limité par aucune finalité esthétique ni aucune contrainte technique, il doit pouvoir s'exprimer dans la plus grande authenticité possible
Atteindre le Vrai par la beauté. Nous savons avec Marcel Duchamp que «le grand ennemi de l'art est le bon goût», par conséquent aucun critère ne doit guider l'acte créateur de l'artiste. Sa liberté doit être totale afin de lui donner le loisir d'exprimer tout à fait sans contraintes ses émotions.
Avons-nous besoin d'art? Corrigé de la dissertation du bac de philosophie Washington S 2019
Avons-nous besoin d'art? Corrigé de la dissertation série S Washington, bac 2019 - Double enjeu du sujet : notre nature : connaître nos besoins, ce qui structure notre existence valeur de l'art : activité gratuite ou liée à des besoins anthropologiques ?
L'art peut il se passer de maitrise technique ?
art : le beau , l'artisan ,l'artiste peut : la capacité , l'autorisation
technique : le savoir faire , le savoir enseigner, l'entrainement , les règles .
Il semble évident que l'art ne puisse pas se passer de maitrise technique .En effet, un pianiste qui ne maitrise pas la technique du piano ne pourrait être un artiste. Sans les règles de l'harmonie , sans la capacité à lire les notes, sans la dextérité des doigts en un mot sans technique du piano il n'y a pas d'artiste pianiste possible .Cependant certains artistes contemporains semblent produire des œuvres d'art ne nécessitant aucune maitrise technique. Marcel Duchamp par exemple s'est contenté dans son œuvre "fontaine" en 1917 de retourner un urinoir et de le signer . On peut donc se demander si l'art peut se passer de maitrise technique . On peut dire que l'art repose sur une maitrise technique .En grec ancien on ne sépare pas l'art et la technique .Le peintre et le cordonnier pratiquent tout deux une techné .C'est à dire une activité réfléchie que l'on peut transmettre constituée de règles à respecter . Platon explique dans le mythe de Prométhée que la technique ou l'art a été donné aux hommes pour compenser leurs faiblesses biologiques originelles .Prométhée a dérobé aux Dieux l'habileté pour la donner aux hommes . Cette origine divine traite ce que la technique à de dangereux pour l'homme comme une force qui le dépasse .Pour les grecs la technique se distingue de la chance ou du hasard . L'activité technique est réfléchie, constituée de règles que l'on peut restituer ou transmettre . Art et technique sont des savoirs faire , des savoirs pratiques . Les œuvres d'art sont peut être simplement des réalisations techniques exceptionnelles. Traditionnellement le chef d'œuvre est une production technique réalisée par un artisan à la fin de sa formation. L'excellence technique se confond avec l'art . L'artiste n'est rien d'autre qu'un technicien exceptionnel capable de produire un effet esthétique grâce à ses œuvres . Par exemple un cuisinier sera dit un artiste s'il est exceptionnel, si sa technique est difficilement imitable. L'artiste n'est donc rien d'autre qu'un technicien particulièrement doué. Finalement, on peut dire que l'art est inséparable d'une forme de maîtrise technique et tous deux sont des savoirs faire . Cependant, ll est impossible de distinguer l'ingéniosité du technicien de la créativité de l'artiste. L'art s'appuie sur la technique mais la dépasse. Le technicien se contente le plus souvent d'appliquer des règles existantes même s'il peut les améliorer à l'occasion. L'artiste en créé de nouvelles. Il est capable d'inventer un nouveau type de Beauté. Le sculpteur crée de l'artitistique, l'ouvrier fabrique de l'utilitaire, si l'ouvrier parvient à faire une oeuvre esthétique, il devient artiste. Le technicien est aussi doué que l'artiste d'un point de vue technique. Mais l'artiste est capable d'inventer un nouveau genre de beauté. Ce dont le technicien même le plus doué est incapable. L'artiste a besoin de technique, d'imagination, d'audace, de créativité.
l'art contemporain a un rapport paradoxal à la technique Il semble que l'art contemporain n'ait pas besoin de technique Mais la règle contemporaine ne peut-elle pas être de rompre avec la règle ? N’est-ce pas là encore une nouvelle règle de l’art ? Au nom de la liberté, l’art moderne, puis contemporain, refuse la définition de l’œuvre d’art du XVIIIe – XIXe siècle. L'art contemporain se révolutionne jusque dans sa définition, l'oeuvre n'est plus l'objet mais ce qui compte pour l'artiste c'est la démarche adoptée pour créer. L'artiste se donne ses propres règles. Dans l'art contemporain, l'art devient la mise en oeuvre d'un projet propre à l'artiste qui reflète son individualité propre Les artistes utilisent des techniques industrielles Les artistes modernes, futuristes, dadaistes cherchent à traduire à travers leur art, leur rapport au monde, au monde moderne findé sur la transformation des choses à un niveau spatial, temporel et autres transformations importantes pour l'humanité. La technique a sa place car elle est sur quoi le monde repose et que l'art représente : une nouvelle esthétique dans laquelle le spectateur retrouve le reflet de son propre monde. L'art devient un moyen d'investigation du réel. L'oeuvre d'art est ainsi désacralisée pour une originalité nouvellement investie de techniques. L'art peut aussi devenir l'expression de la productivité, expression de l'ère moderne. Cependant l'artiste n'est pas pour autant technicien car il dépasse l'appréhension des choses par la simple raison théorique, son mode de vérité est plus profond, sa raison n'est pas purement technicienne. L'artiste dévoile l'Etre et renvoie sa perception bien singulière qu'il façonne avec sa propre matière L'art est un accomplissement de la technique mais chaque artiste développe sa propre technique En effet, l'art ne se limite pas à une industrialisation même s'il ne peut l'ignorer. Le créateur recherche sa maîtrise formelle, l'unité au delà de la technique dominatrice. Pour reprendre les mots d'Adorno, nous dirons que "l'art est absorption des techniques" et le but de l'artiste consiste à les porter jusqu'à leur négation. L'accomplissement de la technique serait sa mort même au profit d'une technique personnelle, singulière, celle de l'artiste qui se laisse dépasser par son moi "je est un autre" Rimbaud au plus profond de sa force imaginaire et créatrice. Si, à regarder une œuvre d’art, on a la nette impression qu’il s’en dégage une cohérence interne, ces régularités ne résultent pas pourtant de l’application mécanique d’une technique. C’est le paradoxe que souligne Kant : l’art procède bien d’une maîtrise technique mais les règles ainsi appliquées ne préexistent pas à l’œuvre mais n’apparaissent qu’après coup. uniquement pour approcher d'une autre manière la vérité de l'objet.
Avons-nous besoin de l’art pour nous faire une idée du beau ?
Concepts :
L’art et le beau
Ce sujet question le rôle de l’art : nous sert-il à voir la beauté ? à former le concept, l’idée du beau ?
Comment se forme ce concept ? Soit c’est une idée innée, préexistante aux œuvres d’art, soit c’est l’expérience de l’art qui permet de former cette idée empiriquement.
Se faire une idée : au sens strict, former l’idée. Dans un sens plus large : comprendre, approcher de la compréhension
Problématique : L’art est-il ce qui crée la beauté ?
La beauté naturelle, une idée de la beauté sans la médiation de l’art ?
Il existe une beauté naturelle, une beauté du monde : nous n’avons pas besoin de l’art pour voir la beauté d’un paysage ou la beauté d’une personne. C’est une beauté en mouvement que l’on comprend intuitivement
L’art doit imiter la nature (Aristote) car c’est un moyen de connaissance des choses. Mais si l’art doit imiter la nature, n’est-ce pas aussi parce qu’il nous permet de voir le beau alors qu’au quotidien, l’homme n’est pas forcément sensible à la beauté naturelle ?
L’imitation de la nature est une fin médiocre pour l’art et la beauté artistique est mille fois supérieure à la beauté naturelle (Hegel). Nous pouvons observer la beauté naturelle tous les jours, alors pourquoi la reproduire par l’intermédiaire de l’art ? Nous avons déjà une idée du beau par la nature, mais l’art est l’œuvre d’un esprit libre.
Existe-t-il une idée du beau préexistante à l’art ?
Platon : il y a une idée du Beau, qui fait partie des principes du monde. L’esprit doit contempler les idées pour les saisir. L’imitation ne produit que des images, de pâles copies des idées
Certes, il y a peut-être une idée du beau mais cette idée se saisit à travers la manifestation sensible de l’art (Hegel)
Le beau est universel : pour qu’il y ait universalité, il faut qu’il y ait une idée de beauté indépendante des productions artistiques (Kant)
L’art crée sa propre beauté : nous avons besoin de l’art pour penser la beauté
L’art est une démarche libre. Alain : la beauté émerge avec l’œuvre, pas de critères de la beauté qui sont préétablis
L’art trouve de la beauté, crée une idée de beauté là où on ne la voit pas. Kant : « l’œuvre d’art n’est pas la représentation d’une belle chose mais la belle représentation d’une chose » (ex de La Charogne , Baudelaire)
L’art est-il une forme de connaissance ?
Les distinctions conceptuelles qu'il nous faudra travailler et développer dans notre dissertation :
Connaissance / et Savoir
Nature / et Culture
La culture se distingue de la Nature en ce sens qu'elle n'est pas ce qui est inné à l'Homme mais ce qui est acquis par celui-ci. L'Homme est un être de culture, il transforme le monde dans lequel il vit pour l'habiter. Il se sort de son état d'animalité, de Nature, par le langage, les traditions, le savoir mais aussi l'art.
Il nous sera utile de comprendre que la culture peut s'entendre dans le sens d'une transformation, d'une amélioration. Amélioration de soi, transformation de soi vers une (pleine) humanité.
Ce qui est inné // et ce qui est acquis
Art // et Technique
Les beaux-arts // l'artisanat
Savoir-faire
Le questionnement s'organise donc autour de la relation entre l'Art et de la connaissance.
Reformulation du sujet :
L'art peut-il contribuer à la constitution d'un savoir ?
Peut-on appréhender une œuvre d'art d'une autre manière que par notre perception et notre sensibilité ?
Peut-on connaître grâce à l'art ?
Problématisation:
Le sujet de la dissertation présuppose que la réception et la création artistique puissent être autre chose qu'une expérience simplement esthétique . Il soulève les questions suivantes :
Quelle est le but de l'art ?
Plan possible :
I. L'art est avant tout une expérience esthétique
A. . L'oeuvre d'art est la réalisation sensible d'une idée. C'est une réalisation sensible et esthétique de l'idée ou des pensées d'un artiste. Ici nous parlons de l'art au sens de Beaux-arts (distinction art et artisanat).
B. « L'art » au singulier montre qu'il a quelque chose de singulier et de commun à toutes les œuvres d'art et c'est l'expérience esthétique que nous en faisons. En effet, l'art a pour fin la beauté, la satisfaction esthétique ou pas. En ce sens, la réception n'encourage pas une forme de connaissance quelconque puisqu'elle concentre ses efforts dans les émotions suscitées, plaisir....
C. Cependant, ce goût s'éduque tout comme le jugement esthétique résulte d'un apprentissage. Dans La Distinction.Critique social du jugement, Bourdieu explique qu'apprécier les qualités d'une œuvre d'art relève d'un apprentissage d'une certaine conception de l'art, du beau, d'après la civilisation dans laquelle on appartient. On l'acquiert par l'éducation et la transmission . Il y aurait donc autant de concepts du beau que d'éducation et de cultures.
II. L'art éduque notre perception
A. Nelson Goodman a tenté de théoriser la réception perceptive des œuvres d'art, de la musique, des performances artistiques. Théorie de la partition. En cela, nous pouvons dire que l'art devient une forme de connaissance par les nombreux théoriciens de la musique, de la danse, etc.
B. Selon Kant, la culture (au sens de culture artistique) s'acquiert au contact de l'art car par l'art, l'Homme épanoui (éduque) la sensibilité de son esprit. Le plaisir que suscite l'art met en mouvement l'imagination et la réflexion, deux facultés de l'esprit humain. L'art devient une forme de connaissance.
C. Il conviendrait ici de rappeler une définition de la connaissance.
III. Le rôle de l'art dans la société
A. Ici, par « art », nous entendrons toutes les formes artistiques y compris l'artisanat. L'art au sens de création esthétique demandant un certain savoir-faire. Le savoir-faire de l'artisan se transmet, c'est une forme de connaissance
B. L'art est une représentation du monde, de l'Homme par l'Homme. Les œuvres d'art permettent donc d'apporter aux spectateurs un savoir sur le monde qui les entoure, à percevoir des choses qu'ils ne percevaient pas auparavant.
Choisit-on d'être artiste? Sujet corrigé série S Pondichéry 2016
Compréhension du sujet : Problématisation
Thèmes de l'art/ Liberté
Sommes nous libres de créer? Choisis t'-on d'être artiste?
Le choix nous ramène au libre arbitre = liberté.
Choisit on d'être artiste? Est-ce une aspiration, une vocation? Doit-on être fait pour ça? Etre artiste serait une vocation, ce qui suppose aussi la reconnaissance de l'artiste = tout le monde ne peut donc pas être artiste.
Comment créer?
Faut-il vouloir créer? Ou créer est-ce une inspiration qui nous transcende? Un artiste est-il un génie?
Créer = être artiste n'est pas produire un objet de type artisanal.
Un artiste est-il un génie ou un travailleur acharné?
Un artiste peut-il vouloir être artiste ou cela est-il indépendant de sa volonté?
Plan possible
I - on ne choisit pas d'être artiste
Un génie qui pour déployer son art est peut-être d'abord un travailleur acharné, aiguisant son art pour le rendre plus puissant : l'artiste sait qu'il doit développer ses talents qu'il a déjà en lui.
L'artiste doit-être possédé par sa création. Le génie est toujours dépassé par le fruit de son art. L'inspiration fait de lui un Elu. Le créateur devient l'instrument de sa création
Ainsi Klee affirme que l'artiste a pour seule préoccupation de «rendre visible, non rendre le visible ». Le génie s'affirme donc en imposant ses propres règles et ses créations ne sont pas de fidèles reproductions de la nature, des exercices purement techniques. L'art créé, recréé les choses offertes par la vie et ne se contente pas de les reproduire. La technique et sa maîtrise permet de créer mais l'art recréé les choses
Un élu qui est chargé d'une mission particulière car il est porteur de l'humanité : il transmet un message au sens commun.
II - Je me fais artiste : c'est mon choix
Je détermine mon essence librement, mon choix est d'être un artiste reconnu et je travaille pour être à la hauteur de mes ambitions. Pas de déterminisme pour craindre l'échec ou croire en une réussite non méritée. je suis ma décision, je veux être artiste. Je choisis d'être artiste.
Un artiste doit travailler et en ce sens en tout artiste, il y a un artisan
L'artiste se définit par son habileté. En matière d'art son habileté et sa dextérité lui autorise la belle imitation de la nature. Sa reproduction est fidèle et reflète la réalité avec tout ce que cela suppose. Tout dans les détails est conforme à l'original, les couleurs, la perspective.... Dans ce cas de figure, la technique est maîtrisée. Un artiste se définit donc d'abord comme un artisan. La technique précède l'art car pour faire de l'art, il faut de la technique.
L'artiste n'est pas qu'un artisan et son art n'est pas qu'une technique acquise. Chaque artiste a sa manière de voir, elle est singulière, elle lui est propre et le définit en tant que créateur.
Avoir des dispositions et de la volonté suffisent parfois à faire un artiste si celui-ci a cette aptitude particulière à saisir l'ineffable, l'indicible et à le transcrire pour faire de son "je" un autre lui-même, un autre moi qui me crée en créant. On retrouve la question de la création bien au-delà de son point de départ, travailler ne suffit jamais pour s'élever à la création mais elle suppose une ouverture particulière au monde, un regard offert au monde.
Citations sur le thème de l'art
- Lalande : « L’art ou les arts désignent toute production de la beauté par les œuvres d’un être conscient ».
- Léonard de Vinci : « L’œil reçoit de la beauté peinte le même plaisir que la beauté réelle ».
- Boileau : « Il n’est pas de serpent, ni de monstre odieux qui par l’art imité ne puisse plaire aux yeux ».
- Kant : « L’art n’est pas la représentation d’une belle chose mais la belle représentation d’une chose ».
- Pascal : « Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par la ressemblance de choses dont on n’admire pas les originaux ».
- Malraux : « De même qu’un musicien aime la musique et non les rossignols, un poète des vers et non les couchers de soleil, un peintre n’est pas d’abord un homme qui aime les figures et les paysages. C’est un homme qui aime les tableaux ».
- Malraux : « l’art est un anti-destin ».
- Cocteau : « L’art est un mensonge qui dit la vérité ».
- Cocteau : « Le mystère nous échappe, feignons d’en être l’auteur ».
- Nietzche : « L’imagination du bon artiste produit constamment du bon, du médiocre et du mauvais. Mais son jugement extrêmement aiguisé choisit, rejette, combine ».
- Paul Valery : « Si les dieux gracieusement nous donnent tel premier vers, c’est à nous de façonner le second ».
- Alain : « La loi suprême de l’invention humaine c’est qu’on n’invente rien qu’en travaillant ».
- Stendhal : « La beauté est promesse de bonheur ».
- Kant : « Le beau est l’objet d’un jugement de goût désintéressé ».
- Kant : « Le beau est ce qui plaît universellement sans concept ».
- Kant : « La beauté est la forme de la finalité d’un objet en tant qu’elle est perçue dans cet objet sans représentation d’une fin ».
- Kant : « Est beau ce qui est reconnu sans concept comme l’objet d’une satisfaction nécessaire ».
- Kant : « Le goût esthétique est un universel nécessaire affectif ».
Freud, Derrida, Hegel, Kant, Marcuse... / Qu'est-ce que la beauté?
Qu'est ce qu'une Vanité ?
Exemples de sujets de dissertation
Art, réalité, vérité.
- L'artiste a-t-il besoin d'un modèle ? - L'art modifie-t-il notre rapport à la réalité ? - L'art nous éloigne-t-il du réel ? - L’œuvre d'art est-elle une imitation de la nature ? - En quoi l'art permet-il d'accéder à la vérité ? - L'artiste fuit-il la réalité ? - Peut-on assimiler l'art à une connaissance ? - L'art est-il le règne de l'apparence ? - Existe-t-il un progrès dans les arts ?
La question du goût et de la réception des œuvres
- L'art s'adresse-t-il à tous ? - Faut-il être connaisseur pour apprécier une œuvre d'art ? - Est-il nécessaire d'être cultivé pour apprécier une œuvre d'art ? - L'art s'adresse-t-il principalement aux sens ? - Qu'admire-t-on dans une œuvre d'art ?
Fonctions de l'art ?
- Peut-on concevoir une société sans art ? - L'homme a-t-il besoin de l'art ? - Une œuvre d'art est-elle utile ? - Une œuvre d'art est-elle un objet sacré ? - A quels besoins l'art peut-il répondre ?
Quand y a-t-il "art" ?
- Peut-on reprocher à une œuvre d'art de "ne rien vouloir dire" ? - Pourquoi ce qui nous déplaît dans la vie nous plaît-il dans une oeuvre d'art ? - L'artiste doit-il chercher à plaire ? - Devient-on artiste en imitant d'autres artistes ? - Est-ce le regard du spectateur qui fait une oeuvre d'art ?
Qu'est-ce qui fait de l'homme un être de culture? Ethnocentrisme et relativité des cultures- Cours, réflexions sur la séquence culture, bac 2024
Exercices, questionnaires, quiz de philosophie pour réviser la conscience et l'inconscient, existence humaine/culture-progressez avec les quiz, questionnaires corrigés, religion, foi, croyance. définition, opposition ou réconciliation avec la raison critiques de la religion bac philosophie 2024 cours, dissertations, le sujet, le désir philosophie 2024. -est-il absurde de désirer l'impossiblechanger ses désirs plutôt que l'ordre du mondedésirer sans souffrir, conscience, humanité et subjectivité : conscience, liberté et responsabilité - conscience et phénoménologie, la découverte de l'inconscient - critiques de l'hypothèse de l'inconscient, alain et sartre. bac de philosophie 2024, le travail, séquence culture bac philo 2024-travail, technique et humanités-finalités du travail et du progrès technique, science, travail et technique - la culture, bac de philosophie bac 2024 - cours, dissertations corrigées et questionnaires bac, exercices, questionnaires, quiz de philosophie pour réviser "le désir", existence humaine/culture-progressez avec les quiz, questionnaires corrigés, exercices, questionnaires, quiz de philosophie pour réviser "l'art", existence humaine/culture-progressez avec les quiz, questionnaires corrigés, les pratiques artistiques transforment-elles le monde dissertation corrigée bac général 2022, exercices, questionnaires, quiz de philosophie pour réviser la séquence nature/culture - progressez avec les quiz, questionnaires corrigés, exercices, questionnaires, quiz de philosophie pour réviser le langage - progressez avec les quiz, questionnaires corrigés.
Date de dernière mise à jour : 01/08/2023
Ajouter un commentaire
Commentaire / Dissertation
Méthode simple pour réussir
Le repérage sur texte
- Kant Qu'est-ce que les Lumières?
- Husserl, rapports vérité/science
- Exercice de reformulation
- Exercices de philosophie
Problématiser
- Exercices. Concepts/Repères
- Exercices sur les présupposés
L'existence humaine/ La culture
- Le désir- le besoin / Le langage
- Art et technique
- Nature et Culture
- Conscience/Inconscient
Humanités, Littérature, Philosophie, bac 2021
Misterprepa
Ce qu’il faut savoir sur Platon
Comment organiser son tour de france des écoles de commerce , excelia : une école qui monte et qui séduit les étudiants, compétences futures des étudiants : quel est le rôle de l’ia , quelles sont les questions à maîtriser pour les oraux .

- Culture générale
L’art en philosophie : quelques thèses incontournables
- décembre 13, 2022
- Par : Gabin Bernard

Cet article s’intéresse aux différentes thèses philosophiques sur l’art. Il tente de recenser les plus importantes d’entre elles.
PLATON, La République , Livre X : l ’art n’est qu’imitation et illusion
La poésie, génératrice d’illusion, est bannie de la cité idéale chez Platon. Dans un extrait, le philosophe grec prend l’image des trois lits : son essence , celui du menuisier ( matériel ) et celui du peintre ( idéal ). L’artiste copie en réalité le lit de l’artisan, lui-même créé à partir du concept. De ce fait, l’art est mensonge et illusion, il ne fait que copier la représentation matérielle d’un concept et non le concept même. “Est-ce représenter ce qui est tel qu’il est, ou ce qui paraît tel qu’il paraît; est-ce l’imitation de l’apparence ou de la réalité ? – De l’apparence dit-il.” Le Beau artistique n’existe pas pour Platon.
ARISTOTE, Poétique : l’art est imitation
Le disciple de Platon s’en distingue nettement ici. Il observe que les hommes ont tendance à imiter : “Imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes”, et ils prennent plaisir à contempler ces imitations. De plus, l’homme aime à apprendre par la contemplation. “Apprendre est un grand plaisir […]. On se plaît en effet à regarder les images car leur contemplation apporte un enseignement.” Notons que Pascal fait référence à cet extrait dans ses Pensées : “Quelle vanité que la peinture qui n’attire l’admiration que par la ressemblance des choses, dont on admire point les originaux.” En résumé, selon Aristote, l’art prend sa source dans le plaisir de l’imitation.
Lire plus : Philosophie du langage : les principales thèses à connaître
HEGEL, Esthétique : distinction entre beauté naturelle et beauté esthétique
L’Esthétique chez Hegel renvoie à la philosophie des beaux-arts. “L’esthétique a pour objet le vaste empire du beau […] c’est la philosophie de l’art, ou plus précisément des beaux-arts.” Mais cette définition exclut le beau dans la nature et ne considère que le beau dans l’art. Cela est d’autant plus vrai que les thèses courantes privilégient le beau naturel. “Mais il est permis de soutenir dès maintenant que le beau artistique est plus élevé que le beau dans la nature.” L’esprit est toujours supérieur à la nature , en toute idée sont présents toujours l’esprit et la liberté. Hegel conclut : la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle car elle est le fruit de l’esprit.
HEGEL, Esthétique : l’art n’est pas pure imitation
L’art ne saurait se borner à une simple imitation de la nature. L’opinion courante considère que l’art doit imiter la nature. L’imagination désigne donc cette habileté à reproduire avec fidélité les objets naturels et constituerait alors le but essentiel de l’art. Mais c ette idée restreint l’art à ne reproduire que ce qui existe déjà dans le monde, or l’art est création, il introduit de la nouveauté. Cette tâche reproductrice est inutile (“cette reproduction est du travail superflu”) et présomptueuse. L’art, “limité dans ses moyens d’expression et ne peut produire que des illusions partielles.”
L’art, en s’en tenant à cette définition, ne nous donne qu’une “caricature de la vie”. L’art d’imitation est mesquin et sans grandeur pour Hegel. “L’art, quand il se borne à imiter, ne peut rivaliser avec la nature, et qu’il ressemble à un ver qui s’efforce en rampant d’imiter un éléphant.” L’art est donc médiocre quand il se borne à la simple imitation de la nature. L’art a quelque chose de surnaturel dans son caractère créateur.
HEGEL, Esthétique : l’art doit exclure tout désir
Notre rapport pratique au réel est le désir : “le mode de relations aux choses extérieures est le désir”. L’homme est un être de désir (idée qu’on retrouve chez de nombreux philosophes, dont Spinoza et son conatus en particulier). Dans ce rapport pratique, l’objet est détruit par le sujet. L’homme puise dans les objets sa subsistance, en fait usage et les sacrifie à sa satisfaction personnelle. Le désir maintient l’objet dans son existence sensible et concrète. “Il n’a que faire de tableaux”.
Ainsi, ni l’objet ni le sujet n’y sont libres et indépendants : l’objet est destiné à être détruit et le sujet est prisonnier des intérêts individuels. Au contraire, l’art est libre contemplation par l’esprit : “Les relations de l’homme à l’œuvre d’art ne sont pas de l’ordre du désir. Il la laisse exister pour elle-même, librement, en face de lui, il la considère sans la désirer. ” L’œuvre d’art est vue comme un objet théorique et non pratique. Dès lors, sans même avoir une réalité tangiblement concrète, l’œuvre d’art est dotée d’une existence sensible. L’art est donc libre contemplation par l’esprit, dénuée de tout désir.
HEGEL, Esthétique : l’art est l’esprit se prenant pour objet
L’esprit a la faculté de se considérer lui-même (par la pensée) : l’esprit peut se prendre lui-même pour objet de pensée. Quant à l’œuvre d’art, bien qu’elle se rapporte au sensible, elle est œuvre d’esprit, “dans la mesure où elles sont jaillies de l’esprit et produites par lui.”. De ce fait, l’art se rapproche plus de l’esprit et de la pensée que de la nature. Les créations de l’art ne sont pas des pensées et des concepts mais “un déploiement extérieur du concept, une aliénation qui le porte vers le sensible.” L’art est l’expression de l’esprit sous forme sensible.
ARENDT, Condition de l’homme moderne : la durabilité de l’œuvre d’art
L’œuvre d’art, unique, n’est pas échangeable. Elle donne à l’artifice humain sa stabilité. Elle n’a pas d’utilité pratique : « l’œuvre d’art doit être soigneusement écartée du contexte des objets d’usage ordinaires.” “Les œuvres d’art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du monde; leur durabilité est presque invulnérable aux effets corrosifs des processus naturels.” Les véritables œuvres d’art traversent les temps, demeurant souvent inaltérées.
Elles acquièrent un statut d’objet immortel créé par l’homme. Arendt met en évidence la permanence de l’art, ce pressentiment d’immortalité “d’une chose immortelle accomplie par des mains mortelles.” L’œuvre d’art échappe par ailleurs à la pensée créatrice lorsqu’elle se matérialise. Le processus de la pensée doit s’interrompre pour la réification matérialisatrice de l’oeuvre. Dans la création de l’œuvre d’art, la pensée est inutile.
Lire plus : Le Monde chez Nietzsche
NIETZSCHE, La généalogie de la morale (IIIe Dissertation) : le Beau ne relève pas d’une connaissance mais d’une promesse de bonheur
Nietzsche, au début de cette troisième dissertation, propose une réflexion sur le Beau. Il prend ainsi partie pour la vision de Stendhal , lequel voit dans l’art “une promesse de bonheur”. Au contraire, Kant a défini le beau du point de vue du spectateur désintéressé. Son point de vue est marqué par l’impersonnalité et l’universalité.
“ Au lieu d’envisager le problème esthétique en partant de l’expérience de l’artiste, Kant a médité sur l’art et le beau du seul point de vue du spectateur”. Ce spectateur n’éprouve aucun ravissement face à la beauté: “Est beau, dit Kant, ce qui provoque un plaisir désintéressé.” A l’opposé, Stendhal voit dans le beau “une promesse de bonheur”, il récuse le désintéressement avancé par Kant. La beauté chez Nietzsche ne relève pas d’une connaissance, n’est pas théorique, mais est une expérience érotique.
NIETZSCHE, La volonté de puissance : l’art désigne un total épanouissement
“Sans la musique, vivre aurait été une erreur.” écrit Nietzsche. Pour ce dernier, l ’art est d’une importance vitale, il est joie et plénitude radicale , en plus d’apparaître comme le premier degré de l’effort vers le surhumain. “Ce qui est essentiel dans l’art, c’est qu’il parachève l’existence , c’est qu’il est générateur de perfection et de plénitude: l’art est essentiellement l’affirmation, la bénédiction, la divinisation de l’existence.” L’art, par essence, est affirmation de l’existence, création de nouvelles valeurs.
PLATON, Ion : le poète crée par don divin
D’où vient le génie qu’on accorde aux poètes ? Cette question suscite encore débat aujourd’hui. La vision de Platon est aussi celle de nombreux poètes tel Ronsard. C’est l’inspiration qui anime l’artiste. Le poète est inspiré, il perd la raison : ‘il n’est pas en état de créer avant d’être inspiré par un dieu”. Son privilège divin expliquerait sa spécialisation: il est le réceptacle de la Divinité. C’est aussi cette part de divin qui écarte l’artiste de la société et en fait un homme à part. Le poète crée par l’effet d’un don divin et se fait l’intermédiaire de cette divinité.
KANT, Critique du jugement : le beau plaît universellement sans concept
“Le beau est ce qui est représenté, sans concept, comme l’objet d’une satisfaction universelle.” Citation extrêmement connue, Kant pointe la satisfaction désintéressée et universelle comportant une ressemblance avec le jugement logique. Celui-ci constitue par des concepts une connaissance de l’objet esthétique. Toutefois, cette universalité est subjective et non pas logique: “il a droit à une universalité subjective.” L’universalité du jugement esthétique ne repose pas sur des concepts.
KANT, Critique de la faculté de juger : le jugement de goût ne peut se prouver
Le jugement de goût, dire si l’on apprécie ou non une œuvre, ne peut pas se prouver. Il se situe entre subjectivité et objectivité. En effet, chacun connaît le poncif : “à chacun son propre goût”. Il fonde le goût sur la pure subjectivité. Le second lieu commun du goût est le suivant : “on ne dispute pas du goût”. Celui-ci reconnaît l’absence de concepts déterminés du goût . Néanmoins, pour Kant, il manque une proposition intermédiaire : “on peut discuter du goût.” Or, “là où il est permis de discuter, on doit aussi avoir l’espoir de s’accorder”.
On constate donc l’antinomie du jugement de goût : le jugement ne se fonde pas sur des concepts (autrement on pourrait discuter à ce sujet), et pourtant le jugement se fonde aussi sur des concepts (autrement on ne pourrait même pas discuter à ce sujet). Le jugement de goût ne peut se prouver, et pourtant on peut en discuter.
KANT, Critique du jugement : le génie est une disposition innée par laquelle la nature fournit des règles à l’art
“Le génie est le talent de produire ce dont on ne peut donner de règle déterminée.” Par conséquent, “l’originalité est sa première qualité.” Donnant des règles à l’art, “ses productions doivent être des modèles, elles doivent être exemplaires”. Le génie ne peut “lui-même décrire” ou expliquer comment il a accompli ses productions “mais il donne la règle par une inspiration de la nature”. Dans le génie, la nature donne des règles à l’art.
NIETZSCHE, Humain trop humain : le génie n’est pas une disposition innée de l’esprit
Encore une fois Nietzsche s’oppose à Kant. Selon lui, c’est le travail qui crée l’œuvre. “L’activité du génie ne paraît pas le moins du monde quelque chose de foncièrement différent de l’activité de l’inventeur en mécanique”. Le génie représente un long travail. Nietzsche l’associe à quelque chose proche de l’activité artisanale. En réalité, c’est pour éviter de l’envier que l’on a employé le terme de génie (“Nommer quelqu’un “divin”, c’est dire: “ici nous n’avons pas à rivaliser.””) mais aussi par aversion pour la genèse laborieuse. Le génie ne relève d’un miracle, d’un talent inné, il est le fruit d’un long travail.
Bergson, Le Rire : Quel est l’objet de l’art ?
“Quel est l’objet de l’art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l’art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l’unissons de la nature.” Bergson
D’après sa thèse sur le langage “nous ne voyons pas les choses mêmes; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles.” Le langage est trompeur. “Ce sont aussi nos propres états d’âme qui se dérobent à nous dans ce qu’ils ont d’intime, de personnel, d’originalement vécu.” Nous n’apercevons de notre état d’âme “que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel”.
L’individualité nous échappe, “nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous, extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes.” Au contraire, l’artiste vit détaché de tout cela. Le détachement de l’artiste est naturel, inné, mais imparfait. “Si ce détachement était complet, si l’âme n’adhérait plus à l’action par aucune de ses perceptions, elle serait l’âme d’un artiste comme le monde n’en a point vu encore. Elle excellerait dans tous les arts à la fois […]. Elle apercevrait toutes choses dans leur pureté originelle.”
L’art n’a qu’un objet. Celui d’écarter les symboles pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et socialement acceptées, tout ce masque la réalité même. Bergson conclut avec cette fameuse phrase : “L’art n’est sûrement qu’ une vision plus directe de la réalité .”
BOURDIEU, La Distinction : Le goût est un habitus qui s’ignore
On finit par un peu de sociologie . Le goût est le produit d’un déterminisme social qui permet de se distinguer. D’après Bourdieu, la dimension esthétique s’élabore comme rapport désintéressé au monde: ce désintérêt est un signe distinctif d’une position privilégiée dans la société. La disposition esthétique “est aussi une expression distinctive d’une position privilégiée dans l’espace social“. “Comme toute espèce de goût, elle unit et sépare”. Le goût est également un marqueur social.
Il est “ce par quoi on se classe et par quoi on est classé.”, il est “l’affirmation pratique d’une différence inévitable.” De plus, Bourdieu fait remarquer que ce sont les dégoûts qui sont le plus révélateurs de cet habitus et finit même par affirmer : “les goûts sont avant tout des dégoûts”
Ainsi, le goût est un habitus qui s’ignore.
Lire plus : Trouver le meilleur artisan
Filière ECG ECT Littéraires
Année Bizuth Carré Cube
Prépa d'origine
Groupe d'école visé TOP 3 (HEC Paris, ESSEC, ESCP) TOP 5 (EDHEC, EMLYON) TOP 7 (SKEMA, AUDENCIA) TOP 10 (NEOMA, GEM, TBS) TOP 12 (KEDGE, RSB) TOP 15 (MBS, BSB, ICN) TOP 18 (IMT-BS, Excelia, EM Strasbourg) TOP 20 (EM Normandie, ISC Paris) TOP 24 (INSEEC, ESC Clermont, SCBS, BBS)
Le trophée des Parisiennes revient pour une deuxième édition !
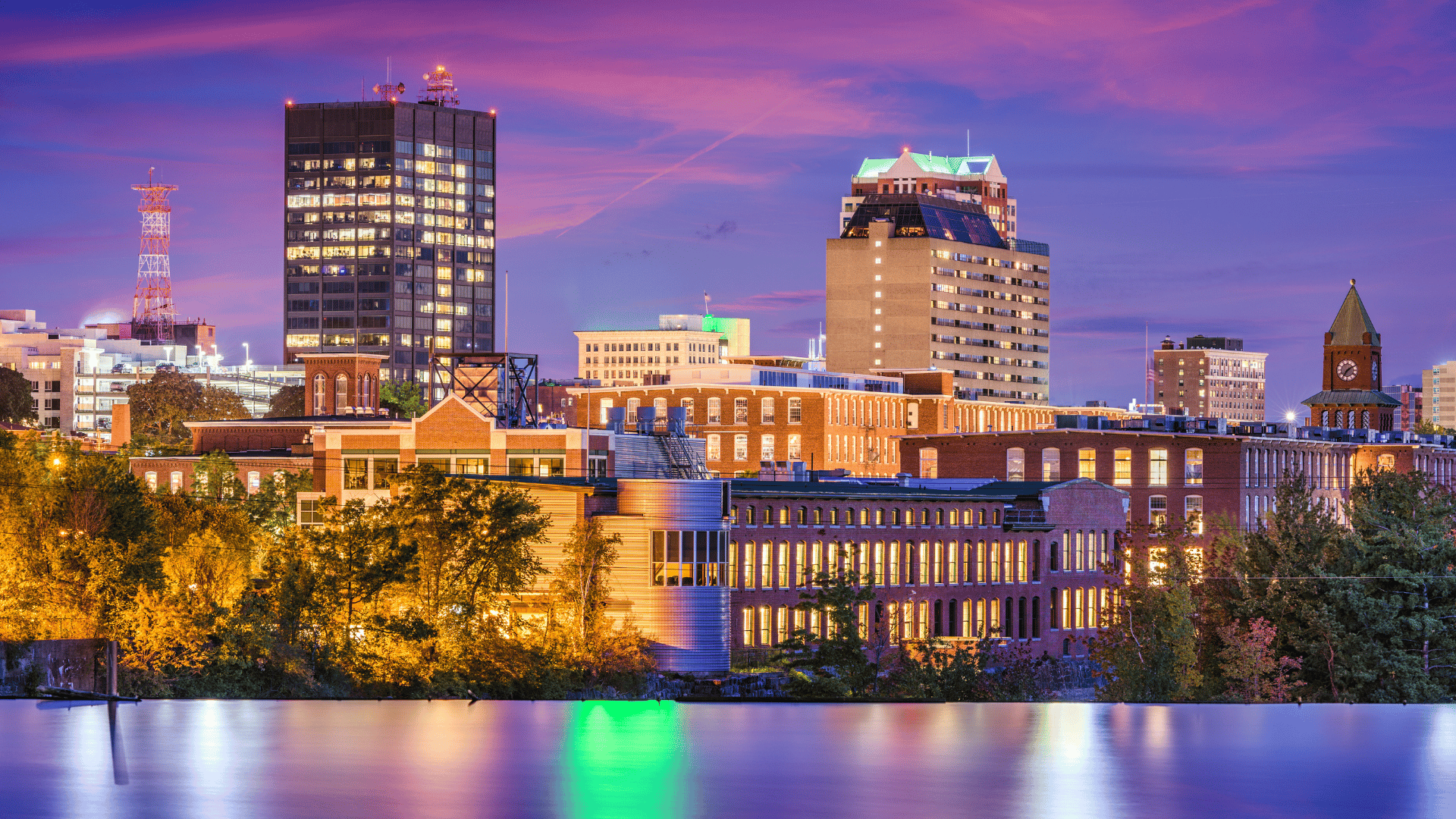
Comment réussir les épreuves orales d’anglais ?
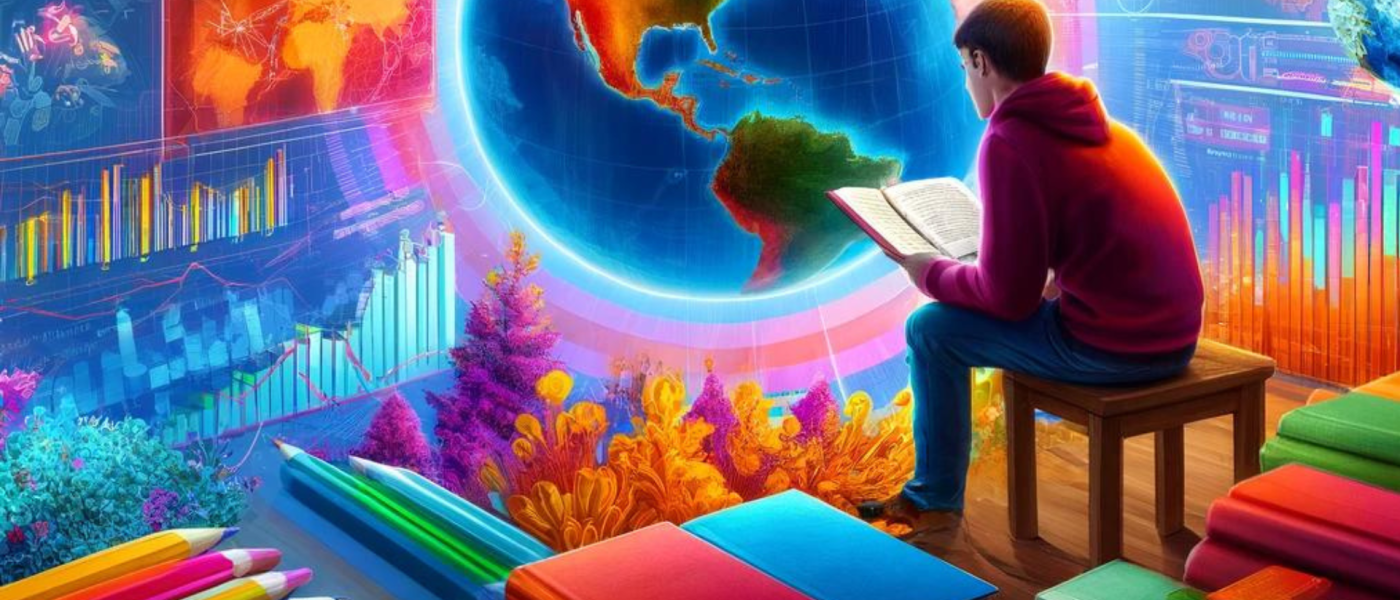
6 actus à connaître pour les oraux !
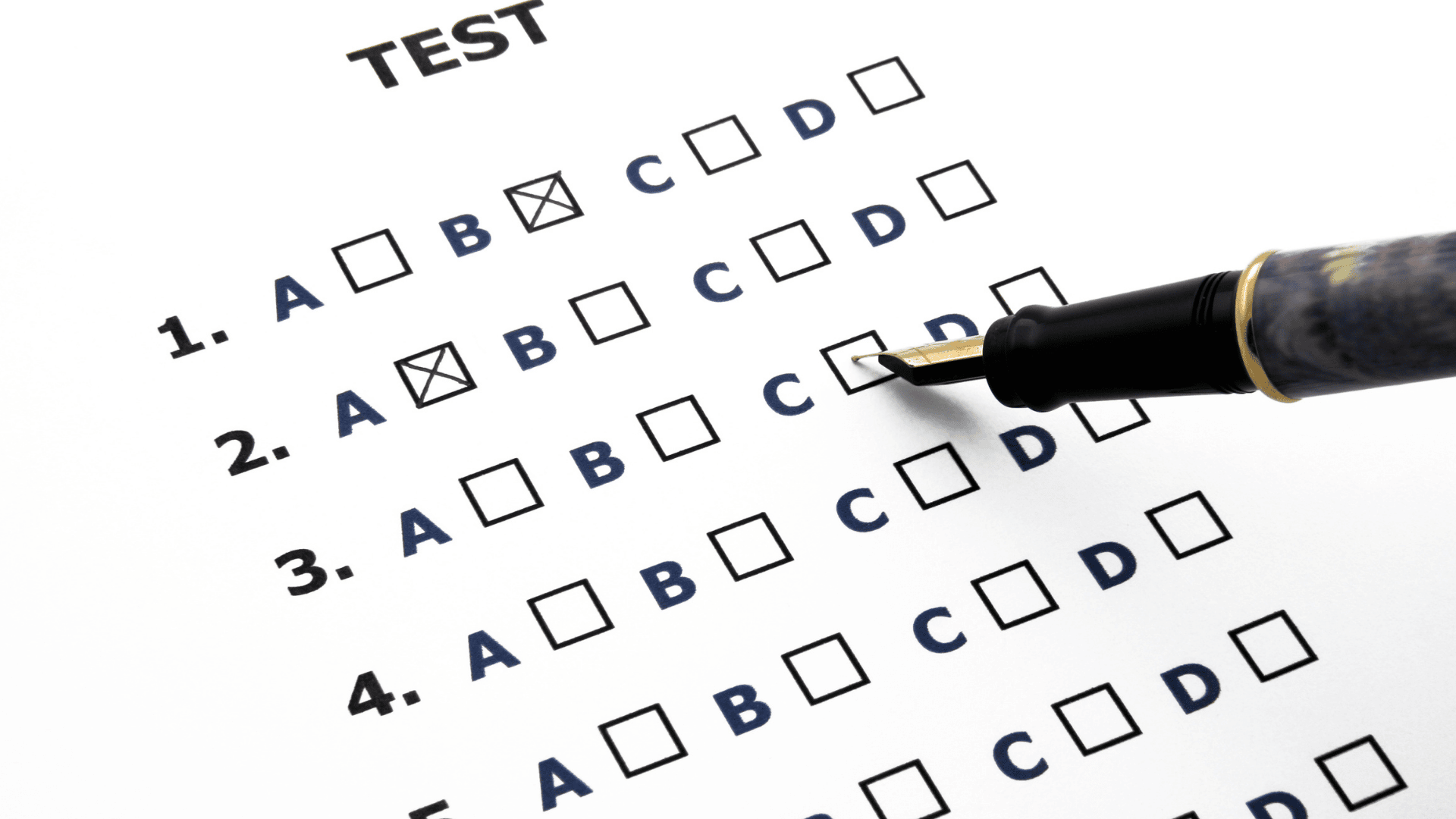
Entrainez-vous aux tests psychotechniques de l’ESSEC !

Mado – Comment réussir les tests psychotechniques de l’ESSEC ?

JO 2024 : toutes les infos clés !

La procédure SIGEM pour les concours 2024 expliquée !

Le Chili : tout ce qu’il faut savoir !

Performer en entretien de personnalité # 5 : avoir la bonne posture

ENQUÊTE : Les critères des préparationnaires dans leur choix d’école

Agence SEO : comment choisir l’employeur idéal pour votre carrière ?

Réussir le questionnaire ESCP point par point
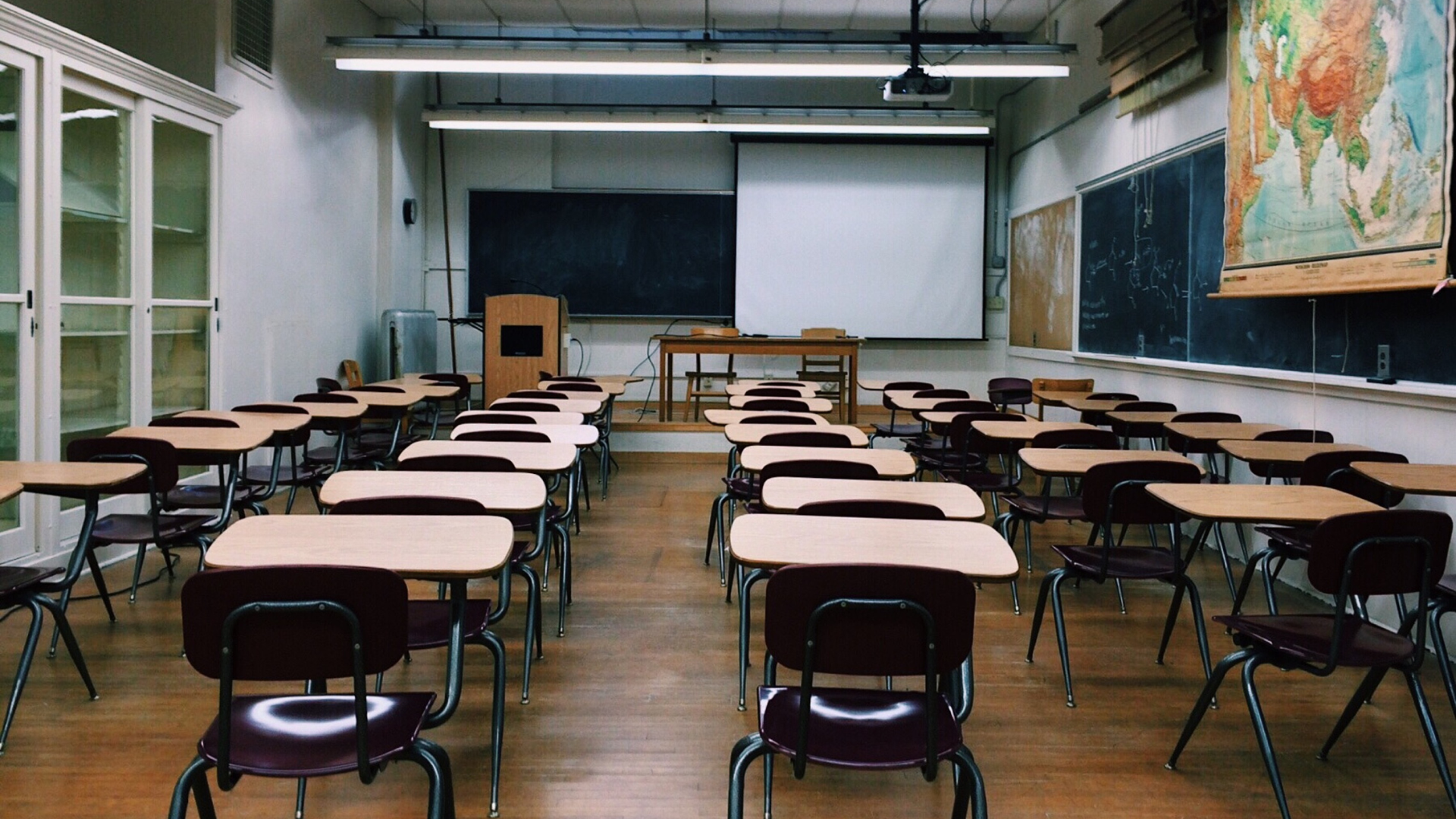
Les centres d’épreuves des oraux de langues pour les Concours BCE et Ecricome 2024

Calendrier Oraux BCE et ECRICOME 2024
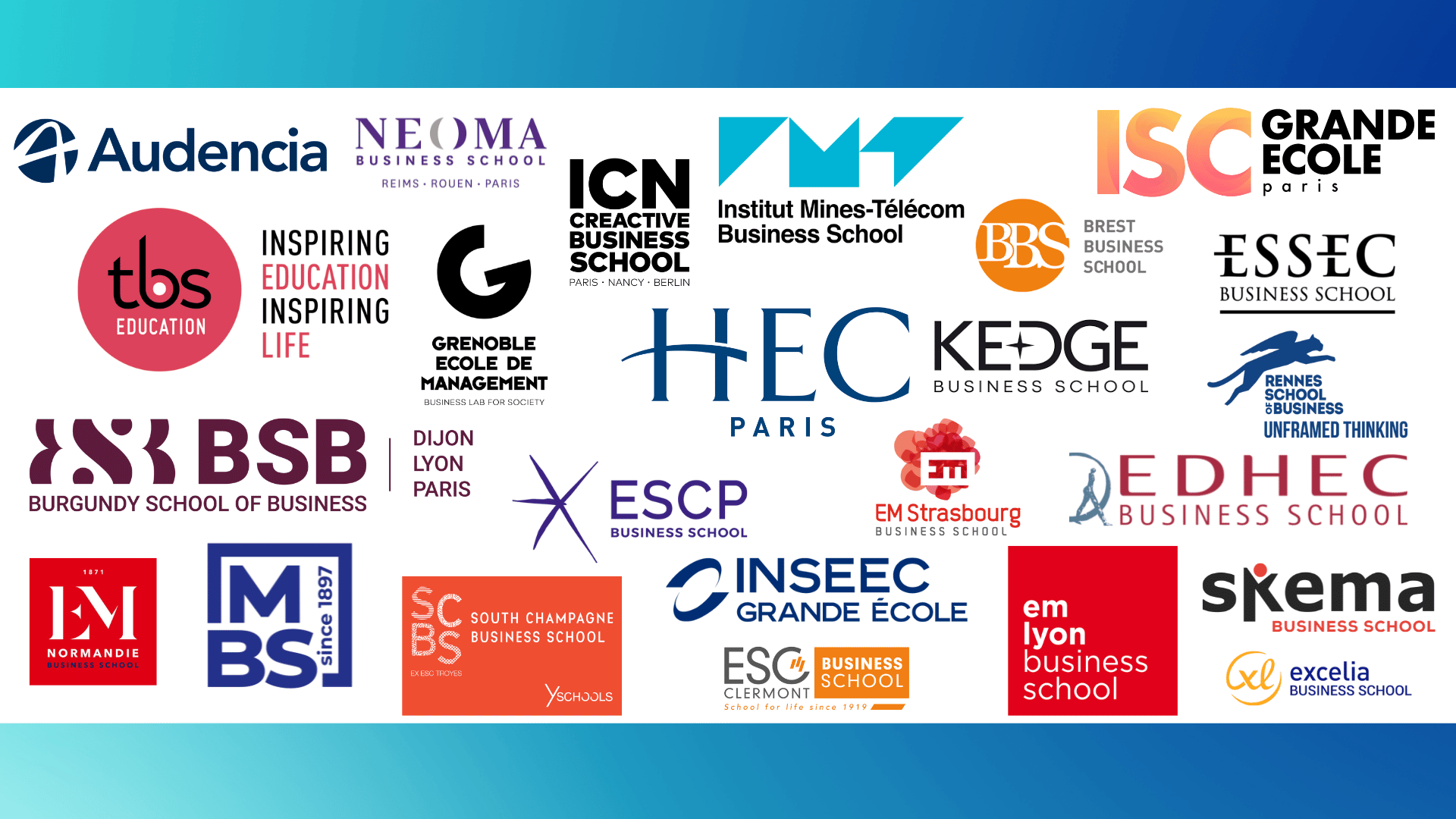
La signification « cachée » des noms et logos des Grandes Écoles

Bienvenue sur le site officiel Mister Prépa. Vous y trouverez des informations précieuses sur les grandes écoles de commerce ainsi que du contenu académique rédigé par d’ex-préparationnaires ayant performé aux concours.
- Planète Grandes Écoles
- Génération Prépa
- Objectif AST
- Start in Blockchain
- Ecoles-Commerce
- Les Ressources
- Recrutement
- Mentions Légales
- Politique de confidentialité
- La Prépa ECG (ex ECE-ECS)
- Tout savoir sur la prépa !
- Qui sommes nous
Copyright © 2024 Mister Prépa – Tous droits réservés
Laissez-nous vous aider, Indiquez ce que vous cherchez en quelques mots !
Pour vous faciliter la navigation sur le site, Mister prépa vous sélectionne tous les articles en relation avec votre recherche.

Citations sur l’art

L’art est un sujet brûlant de philosophie : il déchire les philosophes depuis Platon jusqu’à Heidegger. De discipline mineure à l’Antiquité, l’art est devenue une thématique propre (la philosophie esthétique ) tardivement.
Kant, dans la Critique de la faculté de juger , fait de l’art et du sentiment esthétique le troisième pilier de la raison. Certains, comme Nietzsche ou Kierkegaard, feront de l’esthétique un mode de vie, une catégorie existentielle (authentique chez Nietzsche, inauthentique chez Kierkegaard). Plus tard, l’Ecole de Francfort et la théorie critique feront de l’art une forme de résistance à la déshumanisation du monde moderne.
Les grandes questions relatives à l’art sont les suivantes :
– L’art est-il une technique ?
– Qu’est-ce que le génie ?
– Le beau est-il universel ?
– Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ?
– Quel est le rôle de l’artiste ?
Pour aller plus loin, voyez notre article sur la définition de l’art
Phrases célèbres sur l’art
Platon : L’art est l’illusion d’une illusion
Aristote : C’ est par l’expérience que la science et l’art font leur progrès chez les hommes
Baumgarten : Science de la connaissance sensible ou gnoséologie inférieure
Kant : Le jugement de goût, c’est-à-dire un jugement qui repose sur des fondements subjectifs et dont le motif déterminant ne peut être un concept, ni par suite le concept d’une fin déterminée (Critique du Jugement)
Arthur Schopenhauer : L’art est contemplation des choses, indépendante du principe de raison
Friedrich Nietzsche : Chez l’homme l’art s’amuse comme la perfection ( Nietzsche et l’art )
Oscar Wilde : La Vie imite l’Art bien plus que l’Art n’imite la Vie ( citations Oscar Wilde )
Alain : Tous les arts sont comme des miroirs où l’homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même
Martin Heidegger : L’essence de l’art, c’est la vérité se mettant elle-même en œuvre
Herbert Marcuse : L’art brise la réification et la pétrification sociales. Il crée une dimension inaccessible à toute autre expérience – une dimension dans laquelle les êtres humains, la nature et les choses ne se tiennent plus sous la loi du principe de la réalité établie. Il ouvre à l’histoire un autre horizon ( L’homme Unidimensionnel )
Bibliographie sur l’Art :
Nietzsche : La Naissance de la Tragédie
Kant : Critique de la faculté de juge
Hegel : L’esthétique
Platon : La République
Aristote : Poétique
Schopenhauer : Le Monde comme volonté et comme représentation
You may also like
Citations de la fontaine : critique morale et politique, citations de la bruyère, citations de hannah arendt.

Citations Rousseau

Citations du Fight Club
Citations de husserl.
- Ping : Citations de Nietzsche
- Ping : Nietzsche et l'Art
- Ping : Citations d’Oscar Wilde
la citation
Le jugement de goût est-il une pure contemplation ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.
philosophie
- informations

espace pédagogique > disciplines du second degré > philosophie > focus
Textes philosophiques : L'art
mis à jour le 21/08/2008

Cette ressource propose quelques textes philosophiques sur le thème de l'art.
mots clés : philosophie , culture , art , technique
Texte n° 1 :
Texte n° 2 :, texte n° 3 :, texte n° 4 :, texte n° 5 :, texte n° 6 :, texte n° 7 :, texte n° 8 :, texte n° 9 :, texte n° 10 :, texte n° 11 :, texte n° 12 :, texte n° 13 :, sujets de réflexions et de dissertations associés :, cours et conférences en ligne, ressources associées :, information(s) pédagogique(s).
niveau : tous niveaux, Terminale
type pédagogique : sujet d'examen
public visé : non précisé, élève
contexte d'usage : non précisé
référence aux programmes : philosophie, culture, art, technique
ressource(s) principale(s)
haut de page
- plan de l'espace pédagogique |
- accueil du site académique |
- accès rectorat |
- nous écrire |
- mentions légales
philosophie - Rectorat de l'Académie de Nantes
Meilleurs complexes touristiques près de Electrostal History and Art Museum, Elektrostal, Russie
Complexes touristiques près de electrostal history and art museum, types d'établissement, distance de, note attribuée.
- Rapport qualité-prix Établissements classés à l'aide des données Tripadvisor exclusives, dont les notes des voyageurs, les disponibilités confirmées auprès de nos partenaires, les tarifs, la fréquence de réservation sur notre site, l'emplacement, les préférences des utilisateurs et les hôtels consultés récemment.
- Classement des voyageurs Les hôtels les mieux notés sur Tripadvisor selon les avis des voyageurs.
- Distance de Electrostal History and Art Museum Voir en premier les établissements les plus près du point d'intérêt avec des disponibilités pour vos dates confirmées par nos partenaires
Current time by city
For example, New York
Current time by country
For example, Japan
Time difference
For example, London
For example, Dubai
Coordinates
For example, Hong Kong
For example, Delhi
For example, Sydney
Geographic coordinates of Elektrostal, Moscow Oblast, Russia
City coordinates
Coordinates of Elektrostal in decimal degrees
Coordinates of elektrostal in degrees and decimal minutes, utm coordinates of elektrostal, geographic coordinate systems.
WGS 84 coordinate reference system is the latest revision of the World Geodetic System, which is used in mapping and navigation, including GPS satellite navigation system (the Global Positioning System).
Geographic coordinates (latitude and longitude) define a position on the Earth’s surface. Coordinates are angular units. The canonical form of latitude and longitude representation uses degrees (°), minutes (′), and seconds (″). GPS systems widely use coordinates in degrees and decimal minutes, or in decimal degrees.
Latitude varies from −90° to 90°. The latitude of the Equator is 0°; the latitude of the South Pole is −90°; the latitude of the North Pole is 90°. Positive latitude values correspond to the geographic locations north of the Equator (abbrev. N). Negative latitude values correspond to the geographic locations south of the Equator (abbrev. S).
Longitude is counted from the prime meridian ( IERS Reference Meridian for WGS 84) and varies from −180° to 180°. Positive longitude values correspond to the geographic locations east of the prime meridian (abbrev. E). Negative longitude values correspond to the geographic locations west of the prime meridian (abbrev. W).
UTM or Universal Transverse Mercator coordinate system divides the Earth’s surface into 60 longitudinal zones. The coordinates of a location within each zone are defined as a planar coordinate pair related to the intersection of the equator and the zone’s central meridian, and measured in meters.
Elevation above sea level is a measure of a geographic location’s height. We are using the global digital elevation model GTOPO30 .
Elektrostal , Moscow Oblast, Russia

COMMENTS
L'art - dissertations de philosophie. La culture dénature-t-elle l'homme ? La culture fait-elle l'homme ? La culture nous permet-elle d'échapper à la barbarie ? La culture nous rend-elle plus humains ? L'art a t-il pour seule fonction de nous plonger dans l'imaginaire ? L'art est-il moins nécessaire que la science ?
Dissertations sur L'art - Philo bac. Catégorie : L'art. L'art, cette manifestation exceptionnelle de la créativité humaine, est bien plus qu'une simple expression esthétique. Il agit comme un miroir de l'âme collective de la société, suscitant des débats sur la signification, la perception et le pouvoir transformateur de la beauté.
L art : plans de dissertations et corrigés de commentaires de textes philosophiques. Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h: - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo
Bac philo 2023. "L'art nous apprend-il quelque chose ?". Découvrez le corrigé ! publié le 14 juin 2023 1 min. Les sujets du bac philo 2023 sont tombés ! Retrouvez dans cet article les ...
Bac philo 2022 : corrigé du sujet « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Evelyne Oléon, professeure agrégée de philosophie, propose un corrigé d'un des sujets de l ...
Téléchargez un exemple complet de dissertation de philosophie sur l'art et la technique, avec la problématique « en quoi peut-on dire que l'objet ordinaire diffère de l'oeuvre d'art ? ». Découvrez aussi des exemples sur le travail et la liberté.
Sujets de philosophie sur L'art. Voici une sélection de sujets de philo corrigés sur L'art. Si vous ne trouvez pas votre sujet sur cette page, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche de corrigés de philo. Afin de vous aider dans votre travail, nous vous conseillons de consulter le cours sur L'art en philosophie.
En conclusion, l'art ne nous détourne pas nécessairement de la réalité, il peut au contraire nous permettre de la comprendre, de l'interpréter, de la transformer. Il peut être un moyen de révéler la réalité, de la critiquer, de la questionner. Il peut être un moyen de donner une forme concrète à des idées, à des pensées, à ...
Afin de vous entraîner au mieux pour l'épreuve de philosophie du bac général ou technologique 2023, letudiant.fr vous propose des fiches de révisions ainsi que des quiz bac pour réviser de ...
L'homme a donc besoin d'art parce qu'il a besoin des valeurs que celui-ci incarne : l'attirance vers le beau, l'expression de ses émotions et désirs internes, mais surtout sa spiritualité. L'art est la manifestation de l'esprit, contrairement à la matière qui elle se désagrège dans l'immédiateté, l'art dure ...
Hannah Arendt, 1906 - 1975), est une philosophe allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l'activité politique, le totalitarisme et la modernité. Ses livres les plus célèbres sont Les Origines du totalitarisme (1951), Condition de l'homme moderne (1958) et La Crise de la culture (1961).
Cette ressource propose quelques sujets de réflexions et de dissertations philosophiques sur le thème de l'art. mots clés : philosophie, culture, art. L'art : 1. Ce qu'il faut apprécier dans l'art, n'est-ce que l'expression de soi de l'artiste ? 2. Comment comprendre l'amour du beau ? 3.
L'art Cours. L'art. Télécharger en PDF. L'art est une activité créatrice. C'est le moyen par lequel l'être humain se détache de la nature. Contrairement à la technique, son produit n'a pas comme finalité d'être utile, il est destiné à la contemplation plutôt qu'à l'action. L'art est lié à la question du beau et à son universalité.
Questionnaire sur l'art. Les réponses aux questions sont données - Le document comprend 44 questions réponses. Quiz bac dissertation de philo sur le thème de l'art, l'idée de beau. Quiz ton bac philo Exercices pour la classe de terminale - l'art, la technique. Existence humaine/Culture; Support cours et dissertation :
Le produit de l'art est donc cette œuvre qui se donne à saisir à travers notre sensibilité. Or, si la beauté est le propre de l'art, l'on constate que nombreuses sont les réalités qui s'attribuent le qualificatif de beau. Il ne s'agit pas d'une hiérarchie de beauté, mais plutôt le signe que le beau est une notion ...
Au contraire, l'art est libre contemplation par l'esprit : "Les relations de l'homme à l'œuvre d'art ne sont pas de l'ordre du désir. Il la laisse exister pour elle-même, librement, en face de lui, il la considère sans la désirer.". L'œuvre d'art est vue comme un objet théorique et non pratique.
L'art est un sujet brûlant de philosophie : il déchire les philosophes depuis Platon jusqu'à Heidegger. De discipline mineure à l'Antiquité, l'art est devenue une thématique propre (la philosophie esthétique) tardivement.. Kant, dans la Critique de la faculté de juger, fait de l'art et du sentiment esthétique le troisième pilier de la raison.
Textes philosophiques : L'art. mis à jour le 21/08/2008. Cette ressource propose quelques textes philosophiques sur le thème de l'art. mots clés : philosophie, culture, art, technique.
Elektrostal , lit: Electric and Сталь , lit: Steel) is a city in Moscow Oblast, Russia, located 58 kilometers east of Moscow. Population: 155,196 ; 146,294 ...
Animals and Pets Anime Art Cars and Motor Vehicles Crafts and DIY Culture, Race, and Ethnicity Ethics and Philosophy Fashion Food and Drink History Hobbies Law Learning and Education Military Movies Music Place Podcasts and Streamers Politics Programming Reading, Writing, ...
Complexes touristiques près de Electrostal History and Art Museum, Elektrostal sur Tripadvisor : Consultez des avis de voyageurs, des photos et les prix des complexes touristiques près de Electrostal History and Art Museum à Elektrostal, Russie.
Geographic coordinates of Elektrostal, Moscow Oblast, Russia in WGS 84 coordinate system which is a standard in cartography, geodesy, and navigation, including Global Positioning System (GPS). Latitude of Elektrostal, longitude of Elektrostal, elevation above sea level of Elektrostal.