Les inquiétantes faiblesses de la justice internationale
Plus de soixante-dix ans après le procès des nazis à Nuremberg, la justice internationale ne s'est toujours pas imposée comme instrument de réparation des dégâts causés par les conflits mondiaux. Outre les insuffisances de la Cour pénale internationale, elle affronte désormais l'opposition farouche de Washington.

Par Jacques Hubert-Rodier
« Rwanda : le génocide le plus jugé de l'histoire. » Vingt-cinq ans après le crime de masse perpétré par des Hutu, faisant plus de 800.000 morts du 7 avril au 17 juillet 1994, Thierry Cruvellier, grand reporter, et son confrère Ephrem Rugiririza, de JusticeInfo.net, dénombraient 12.000 tribunaux locaux créés par ce pays, plus d'un million d'individus jugés et la mise sur pied d'un Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) sous les auspices des Nations unies. Une instance qui a contribué à poursuivre les plus hauts responsables du génocide. A ce jour, sur 80 inculpés, 61 ont été condamnés. A tel point que le Rwanda est considéré comme l'un des cas les plus pertinents de justice transitionnelle, qui permet de passer d'une période de violence extrême à une forme de régime démocratique et à une réconciliation.

Bilan mitigé
Un exemple à suivre. Car plus de soixante-dix ans après le procès de 24 dignitaires nazis du Troisième Reich à Nuremberg, jugés par les puissances alliées, la justice internationale affiche un bilan plus que mitigé, et nombre de crimes commis lors des conflits restent encore impunis. La création d'une Cour pénale internationale (CPI) à La Haye en 2002, chargée de juger les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, notamment en l'absence de tribunaux nationaux compétents, n'a pas suffi à inverser la tendance. La justice internationale marque le pas.
A cela, plusieurs raisons. La première est qu'à la différence de l'ONU, qui compte 193 Etats membres, la CPI, avec 123 adhérents, n'est pas universelle.
Moyens limités
Autre raison : ses moyens budgétaires comme politiques sont limités. A preuve, les Etats-Unis peuvent sans problème faire obstacle à la justice internationale quand elle souhaite poursuivre des militaires et des agents américains suspectés de tortures et de crimes lors de la guerre en Afghanistan, un pays qui a adhéré en 2003 à la CPI. Autre exemple, en dépit des appels des victimes locales de l'armée syrienne régulière et de dirigeants de pays occidentaux, Bachar Al Assad est quasiment certain d'éviter une saisine par l'ONU de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en raison de l'opposition de la Russie.
De même, le président du Soudan, Omar El Béchir, mis en accusation en 2009 par la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide pendant la guerre du Darfour, entamée en 2003, a toujours évité la justice internationale. Ce qui ne l'a pas empêché de voyager à travers le monde en dépit des mandats internationaux émis contre lui, notamment dans des pays signataires du traité de Rome comme l'Afrique du Sud, le Kenya et la Jordanie. Du moins jusqu'à sa démission sous la pression de la contestation populaire.
Une justice expéditive
L'autre faiblesse de la justice internationale tient à la nature même des conflits. Après l'invasion de l'Irak par les troupes anglo-américaines en 2003, le procès de Saddam Hussein, laissé à une juridiction locale, a été bâclé pour aboutir à une mise à mort rapide par pendaison en 2006, sans que la lumière soit faite sur les accusations de crimes notamment contre les Kurdes irakiens et la communauté chiite. La mise à mort brutale du colonel Mouammar Kadhafi, en 2011, après l'intervention de la France et du Royaume-Uni en Libye, représente un autre échec pour la justice internationale, qui n'a pas pu enquêter sur les crimes dont il était accusé. Le brutal décès de l'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic dans sa prison de La Haye, en 2006, est également un sérieux revers pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé ad hoc par les Nations unies. Le dernier procès de cette instance s'est d'ailleurs achevé sur un drame avec le suicide par poison, en pleine séance, de Slobodan Praljak, le responsable des forces croates en Bosnie, qui venait d'entendre sa condamnation à vingt ans de prison.
Acquittements en série
Enfin, le 15 janvier dernier, l'acquittement par la CPI de Laurent Gbagbo , l'ancien président ivoirien, et de Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes Patriotes, a achevé de jeter le discrédit sur ce tribunal. La décision de la cour d'acquitter, en juin 2018, Jean-Pierre Bemba, l'ancien commandant en chef du Mouvement de libération du Congo (MLC) , deux ans après sa condamnation pour crimes de guerre et contre l'humanité en 2002 et 2003, en RCA, avait déjà créé une incroyable stupéfaction.
Lire aussi :
Le Rwanda, vingt-cinq ans après le génocide
Les Etats-Unis menacent la Cour pénale internationale de sanctions
Outre ses propres insuffisances, la justice internationale doit aussi faire face à une menace extérieure. Elle provient de la remise en cause du multilatéralisme par les Etats-Unis, qui furent pourtant à la source de la création des organisations internationales sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Dans une récente diatribe, le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, John Bolton, s'est lancé dans une attaque en règle contre la CPI, accusée d'être illégitime et de menacer les Etats-Unis et leurs alliés. Il n'est pas certain que la justice internationale puisse gagner son bras de fer avec la première puissance mondiale. D'autant que Moscou et Pékin voient aussi en elle une menace.
Jacques Hubert-Rodier (Editorialiste de politique internationale)

Nouveau : découvrez nos offres Premium !
Portugal, espagne, grèce : la revanche des « pays du club med ».

Les jeunes ont-ils vraiment un problème avec le travail ?

SNCF : la concurrence peut-elle faire baisser les prix des billets de train ?

Immobilier : la maison individuelle a-t-elle encore un avenir ?
Éditos & analyses.

Multi-alignement, la nouvelle stratégie gagnante ?

Eloge des rachats d'action

Cynisme et patriotisme, les deux mamelles du poutinisme

- THÈMES JURIDIQUES
- Méthodologies
- Commande & correction de doc
- LE BLOG JURIDIQUE
Consultez plus de 50325 documents en illimité sans engagement de durée. Nos formules d'abonnement >
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Commandez votre devoir, sur mesure !
- Droit public & international
- Droit international
- Dissertation
La justice internationale est-elle efficace ?
Thèmes abordés.
Justice internationale, CPI Cour Pénale Internationale, souveraineté des états , DUDH Déclaration Universelle de Droit de l'Homme, Chine, USA, communauté internationale, Rwanda, Ex-Yougoslavie, crime contre l'humanité, crime de guerre
Résumé du document
La justice internationale tire ses origines après la Seconde Guerre mondiale où se tenaient les procès des criminels nazis dans la ville de Nuremberg. Suite aux atrocités commises au Rwanda et en Ex-Yougoslavie, c'est vers les années 1990 que les Nations unies ont mis en place les tribunaux pénaux internationaux pour juger les personnes accusées de crime de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre.
- La justice internationale
- La souveraineté des États
[...] La justice internationale est-elle efficace ? La justice internationale tire ses origines après la Seconde Guerre mondiale où se tenaient les procès des criminels nazis dans la ville de Nuremberg. Suite aux atrocités commises au Rwanda et en Ex-Yougoslavie, c'est vers les années 1990 que les Nations unies ont mis en place les tribunaux pénaux internationaux pour juger les personnes accusées de crime de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre. C'est seulement en 2002 que verra le jour la Cour Pénale Internationale (CPI) basée à La Haye aux Pays-Bas. [...]
[...] Johnson, si on devait juger l'impact de la justice internationale sur les différents systèmes judiciaires locaux (nationaux), les choses se présentent plutôt bien. Cependant, si on devait juger son impact à l'échelle planétaire l'avancement n'y est pas, car les même anciens conflits et les atrocités persistent, de même que l'impunité. Pour lui, il faudrait des décennies, voire même, des siècles pour trouver et mettre en place un système judiciaire qui puisse marcher à l'échelle mondiale. Depuis les années 1990, les Nations Unies et autres institutions internationales avaient déjà du mal à affronter la question d'état de droit, car elles se heurtaient à cette fameuse notion de gouvernement souverain. [...]
[...] Deux moments de la constitution hésitante d'une justice de l'après-conflit, édition Hal PDF -Dr Paulin IBANDA KABAKA et Victor AMOUZOU, La souveraineté des États aux prises du droit d'ingérence internationale. [...]
[...] La justice internationale a pour but de faire asseoir la paix dans le monde. Nous pouvons dire que jusque-là cela a été une réussite, car depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde n'a pas connu une situation de cette ampleur. Si plusieurs mécanismes ont été mis en place, jusqu'à aujourd'hui l'impunité et les crimes continuent et la fonction de la justice internationale est remise en question, car désormais elle démontre qu'elle possède des insuffisances et des limites auxquelles il faudra remédier si nous devons espérer et persévérer à un développement de la justice internationale dans l'avenir. [...]
[...] La justice internationale Parler de la justice internationale n'est pas un sujet facile à aborder. Elle est à la base de plusieurs polémiques et de multiples interprétations. En allant de question comme qui protège-t-elle, cette justice internationale ? À qui s'applique-t-elle et quelle est sa vocation ? Bref, un sujet ambigu dont les seules certitudes se trouvent au point où l'on parle de la Cour Internationale de Justice, de la Charte des Nations Unies, du Statut de Rome, des tribunaux internationaux pénaux, etc. [...]
- Nombre de pages 5 pages
- Langue français
- Format .doc
- Date de publication 31/12/2020
- Consulté 25 fois
- Date de mise à jour 31/12/2020
Bibliographie, normes APA
Lecture en ligne
Contenu vérifié
Les plus consultés
- Les rapports entre le président de la République et le Premier ministre sous la Ve République - publié le 30/04/2021
- Les pouvoirs du Président sous la Vème République
- La présidentialisation sous la Ve République
- L'évolution du rôle du Conseil constitutionnel dans la Ve République : gardien de la Constitution ou législateur déguisé ?
- Dans quelle mesure le processus de rationalisation parlementaire dans un contexte de prépondérance de l'exécutif remet en cause le rôle du parlement sous la Ve République ?
Les plus récents
- Cour internationale de justice, 20 juillet 2012 ; Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 10 décembre 1998 ; Cour européenne des droits de l'Homme, 21 novembre 2001 ; Cour de justice des Communautés européennes, 3 septembre 2008 ; Convention de Vienne (1969) ; Réflexions sur le jus cogens - Virally (1966) - Le jus cogens a-t-il...
- Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice ; Cour internationale de Justice, 18 décembre 1951, 20 février 1969 et 27 juin 1986 ; Droit international - Dominique Carreau et Fabrizio Marrella (2012) - La coutume
- En quoi l'actuel statu quo de Taïwan est-il révélateur de l'ambiguïté de la notion d'État en droit international public ?
- Les organisations internationales ont-elles supplanté les États en droit international public ?
- Droit international public - publié le 22/05/2024
Le TPIY, force et limites de la justice internationale
professeur associé, Université de Neuchâtel
Disclosure statement
Pierre Hazan does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) provides funding as a member of The Conversation FR.
View all partners

Pressions politiques, intimidations de témoins, assassinat d’un premier ministre serbe pour sa collaboration avec la justice internationale, jugements controversés, l’histoire du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et de ceux qui l’ont côtoyé a l’odeur et le goût de la fiction. Mais pourtant derrière le roman du TPIY se dessinent des enjeux majeurs en termes de relations internationales ainsi qu’un héritage complexe pour les sociétés de l’ex-Yougoslavie.
Depuis longtemps, le TPIY n’avait plus fait l’actualité comme ces derniers jours : condamnation justifiée à 40 ans de prison pour Radovan Karadzic – le chef politique des Bosno-Serbes – pour sa responsabilité dans les politiques de nettoyage ethnique ; emprisonnement absurde à six jours de prison de la journaliste française Florence Hartmann , pour avoir divulgué des documents ; acquittement-surprise de l’ultranationaliste serbe, Vojislav Seselj. Une fois encore, les décisions du TPIY ont déçu certains et en ont ravi d’autres.
Justice à la solde de l’OTAN ? Cirque juridico-médiatique ? Instrument essentiel pour rétablir la paix et construire la réconciliation ? Vingt-trois ans après sa création et vingt mois avant sa fin programmée, le TPIY est toujours honni ou, au contraire, célébré comme une étape majeure dans la lutte contre l’impunité.
Trois acquittements controversés
L’acquittement, le 31 mars, de Vojislav Seselj restera sans doute comme l’un des trois grands procès du TPIY qui frustreront le plus les victimes, avec celui de l’ex-premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj et celui du général croate, Ante Gotovina.

Rappelons qu’en 1991, 200 blessés croates alors prisonniers de guerre avaient été froidement assassinés par des soldats serbes ainsi que par des paramilitaires, des volontaires du Parti radical serbe fondé par Seselj. Après l’avoir incarcéré pendant 12 ans, les juges du TPIY ont estimé, malgré tout, que Seselj s’était borné à défendre l’idée d’une grande Serbie et avait participé à « l’effort de guerre » sans avoir une responsabilité directe dans les crimes commis en Croatie et en Bosnie entre 1991 et 1995.
Pourtant, Seselj avait levé une milice, les Aigles blancs, qui s’était illustrée de sinistre manière, et avait affirmé que « si nécessaire, il achèverait lui-même les Croates avec une fourchette rouillée ». Des propos que le TPIY n’a curieusement pas assimilés à de l’incitation à la haine.
Ce jugement – qui pourrait être revu en appel – s’ajoute à deux autres acquittements très controversés du TPIY. On citera d’abord celui de Ramush Haradinaj, accusé de crimes de guerre contre des Serbes et des Roms et dont les témoins-clefs se sont, soit volatilisés, soit sont morts de manière suspecte ou se sont encore rétractés. Il en va de même pour le général croate, Ante Gotovina , condamné en première instance à 24 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité avant d’être acquitté en appel.
Gotovina avait été le responsable de l’opération « Tempête » qui visait à reconquérir en 1995 les Krajinas occupées par les forces serbes. Cette opération s’était soldée par la fuite de 200 000 Serbes, dont les familles étaient parfois établies depuis des siècles sur ces territoires.
Une révolution juridique
Alors que 149 procédures sont désormais closes (dont 19 acquittements), comment appréhender plus de deux décennies de vie du TPIY, au-delà de ces trois jugements qui ont, en partie, entaché la crédibilité du tribunal ? Sans doute faudrait-il répondre comme Zhou Enlai, qui interrogé sur l’analyse qu’il portait sur la Révolution française deux siècles après qu’elle se soit produite, jugeait qu’il était encore trop tôt pour répondre.
Mais passons outre pour constater que le TPIY a été le déclencheur d’une révolution juridique aux effets très politiques. Qui aurait pensé que les murs de la souveraineté nationale puissent être remis en cause si fondamentalement ? Qui aurait imaginé il y a seulement 25 ans que des présidents en exercice puissent un jour être accusés de crimes contre l’humanité ? C’est pourtant ce qu’a fait la Cour pénale internationale créée dans le sillage du TPIY.
Les décisions du TPIY font aujourd’hui jurisprudence sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. Le viol a reçu une attention sans précédent puisque près de la moitié des personnes condamnées par le TPIY ont été déclarées coupables pour des crimes impliquant des violences sexuelles. C’est aussi le premier tribunal pénal international à avoir considéré que le viol utilisé comme une torture ou à des fins d’esclavage sexuel constituait un crime contre l’humanité.
Dans le temps de la guerre
Institution post-Guerre froide, le TPIY a introduit la justice internationale dans le temps même de la guerre. Un audacieux pari aux résultats mitigés. En réalité, l’impératif de la recherche de la paix a primé sur celle de la justice. Ainsi, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, les deux principaux chefs bosno-serbes en charge des politiques de nettoyage ethnique, n’ont été inculpés qu’après les massacres de Srebenica de juillet 1995, car jusque-là, ils étaient considérés comme des partenaires indispensables pour un accord de paix.

Depuis, de nombreux efforts ont été accomplis pour mieux réguler la tension entre la recherche de la paix et de la justice , mais celle-ci subsiste toujours : il suffit de voir les tergiversations et les volte-face des puissances occidentales à l’égard du président syrien, Bachar al-Assad. Pour moralement séduisante que soit l’idée d’une justice en temps de guerre, est-elle efficace ?
De fait, l’environnement politique a conditionné l’action du TPIY, indépendamment de la qualité des juges. Cela s’est vérifié une nouvelle fois lorsque les grands pays occidentaux, principaux soutiens du TPIY, se sont trouvés engagés dans une confrontation militaire avec la Serbie, et que le porte-parole de l’OTAN mit en garde le tribunal, affirmant « qu’il ne fallait pas mordre la main qui vous nourrit »… Difficile exercice d’indépendance pour un tribunal, soumis à la bonne volonté des Etats pour accéder aux lieux de crimes, obtenir des preuves, consolider des actes d’accusation et appréhender des inculpés.
Négationnisme vivace
Reste le point le plus délicat : quel a été l’impact du premier tribunal pénal international pour les sociétés de l’ex-Yougoslavie ? Même s’il est trop tôt pour prononcer un jugement d’ensemble, le résultat à l’heure actuelle est en demi-teinte. En dépit des quelques jugements controversés, le TPIY a écrit l’histoire des guerres de l’ex-Yougoslavie des années 1990. Il a amplement documenté les crimes commis par tous les protagonistes. Vingt accusés, et non des moindres, ont plaidé coupables. Ce n’est pas rien.
Il faut cependant ajouter que la majorité des populations de l’ex-Yougoslavie n’ont jamais adhéré au travail du tribunal et que le négationnisme reste vivace. Les propagandes nationalistes ont leur part de responsabilité dans cet échec. In fine, l’expérience du TPIY suggère surtout qu’un tribunal international ne peut trouver sa véritable efficacité comme instrument de réconciliation que s’il s’inscrit dans un processus politique de rapprochement entre ex-ennemis infiniment plus vaste.
- justice internationale
- crimes contre l'humanité
- ex-Yougoslavie
- Bosnie-Herzégovine

Chief Operating Officer (COO)

Technical Assistant - Metabolomics

Data Manager

Director, Social Policy

Head, School of Psychology

Académie des Sciences Morales et Politiques

Progrès et limites de la justice internationale
Séance du lundi 4 décembre 2006
par M. Gilbert Guillaume
Pendant longtemps le droit international fut un droit dont l’observation reposait exclusivement sur la parole donnée. Les différends entre Etats, quelle qu’en soit la nature, se réglaient par la négociation ou par la guerre. Le XIXe siècle vit cependant se développer l’arbitrage inter étatique, première forme de règlement obligatoire des litiges. Les premiers arbitrages furent le fait de chefs d’Etat appelés à se prononcer à titre personnel. Puis l’arbitrage s’institutionnalisa et la convention de La Haye établit en 1889 la Cour permanente d’arbitrage (CPA) qui n’avait d’ailleurs de Cour que le nom, puisque cette convention se bornait à mettre des listes d’arbitres et un règlement de procédure à la disposition des Etats. La CPA devait rendre une quinzaine de sentences avant la première guerre mondiale, avant d’entrer en sommeil.
A l’issue de cette guerre, la Société des Nations et la Cour permanente de justice internationale furent créées. L’une et l’autre étaient mises au service de la paix qui devait être assurée par le respect du droit. Désormais, les différends juridiques entre les Etats pouvaient être soumis à des juges constituant une véritable cour permanente à compétence générale et à vocation universelle.
L’édifice ainsi mis sur pied fut revu au lendemain de la seconde guerre mondiale et l’Organisation des Nations Unies se substitua à la Société des Nations. Un pas décisif fut alors franchi en droit puisque la Charte mit la guerre hors la loi. Elle condamna en effet le recours à la force, sauf cas de légitime défense. Par voie de conséquence, elle rendit obligatoire le règlement pacifique des différends et précisa que les différends d’ordre juridique devraient être soumis à la Cour internationale de Justice qui succédait à la Cour permanente.
Tous les Etats membres des Nations Unies sont désormais automatiquement Parties au Statut de la Cour. En outre soixante-trois d’entre eux ont depuis lors accepté de manière générale sa compétence ; près de 300 traités lui ont confié le soin de trancher les litiges nés de leur application ou de leur interprétation ; de nombreuses affaires lui ont été soumises par compromis intervenu entre les gouvernements intéressés. Depuis 1945, la Cour a connu de 106 affaires contentieuses et 13 (dont deux concernent la France) figurent actuellement à son rôle.
La seconde moitié du XXe siècle a vu par ailleurs se multiplier les juridictions internationales, régionales ou spécialisées. Parmi les premières, il convient de mentionner la Cour de justice des Communautés européennes qui s’assure depuis Luxembourg du respect du droit communautaire par les institutions de l’Union et de la cohérence de l’application de ce droit dans les Etat membres. Il faut également relever l’établissement des Cours européennes et interaméricaines des droits de l’homme installées respectivement à Strasbourg et à San José de Costa Rica.
Au plan mondial sont apparus de multiples tribunaux administratifs internationaux en charge du contentieux opposant les fonctionnaires internationaux et les institutions qui les emploient. Ensuite, a été crée le Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis d’Amérique chargé de liquider le contentieux né entre les deux pays en 1979. Puis, le Tribunal international du droit de la mer de Hambourg a été institué en vue de trancher divers différends en ce domaine. Enfin, l’Organisation mondiale du commerce a mis sur pied un mécanisme quasi-juridictionnel de règlement des différends fort actif ces dernières années.
L’attention du grand public a cependant a été attirée avant tout sur les premiers pas de la justice pénale internationale. Le traité de Versailles avait prévu le jugement de l’Empereur Guillaume II, mais celui-ci se réfugia aux Pays-Bas et le gouvernement néélandais en refusa l’extradition. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Tribunaux de Nuremberg et Tokyo jugèrent les grands criminels de guerre allemands et japonais. Puis, en 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies créa un Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ayant compétence pour juger les personnes accusées d’avoir commis dans ce pays des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide. Ce tribunal qui siège à La Haye a pour l’heure condamné définitivement quarante huit personnes. Un autre tribunal, institué dans les mêmes conditions pour le Rwanda, en a définitivement jugé vingt et une . Enfin, une convention signée à Rome en 1998 a prévu la création d’une Cour pénale internationale permanente. Cette convention, ratifiée par 104 pays (dont la France), est entrée en vigueur en 2002. La Cour s’est alors installée, elle aussi, à La Haye et son parquet a depuis lors entamé des enquêtes dans quatre affaires concernant l’Ouganda, la République démocratique du Congo, la République Centre Afrique et le Soudan.. Enfin des tribunaux nationaux à composante internationale ont été crées en Sierra Leone, à Timor oriental et au Cambodge. Il est envisagé d’en instituer un au Liban.
Au total, la justice internationale a fait au cours du XXe siècle des progrès considérables. La confiance nouvelle dont les Etats ont témoigné envers la Cour Internationale de Justice au cours de la dernière décennie et la multiplication des juridictions spécialisées a conduit à une augmentation sensible du nombre des affaires soumises au juge dans des domaines de plus en plus nombreux.
Ces changements répondent largement à certaines transformations de la société internationale : rôle croissant du droit dans une économie libérale mondialisée et dans des sociétés nationales privilégiant la répression pénale ; multiplication des relations interétariques en des domaines nouveaux ; apparition de nouveaux acteurs de la vie internationale et de groupes de pression divers, commerciaux, financiers ou idéologiques.
La prolifération des tribunaux n’en pose pas moins des problèmes sérieux. Elle augmente en premier lieu les risques de chevauchement de compétence entre juridictions concurrentes. Elle autorise de ce fait dans de nombreux cas un choix entre diverses enceintes juridictionnelles et ouvre ainsi la porte à ce qui est trop souvent dénommé « forum shopping », c’est- à dire à une « élection de juridiction » par les demandeurs qui se traduit par une course aux tribunaux entre lesquels ces derniers font leur marché. L’existence de plusieurs fors pouvant se déclarer compétents pour connaître d’un même différend permet en effet aux parties de choisir la juridiction qui leur convient le mieux. Des considérations relatives à l’accès aux tribunaux, à la procédure suivie, à la composition de la Cour, à sa jurisprudence ou encore à sa capacité à prendre des mesures d’urgence motivent généralement le choix des Etats. Ainsi a-t-on vu le Chili et l’Union européenne prêts à saisir l’un le Tribunal du droit de la mer et l’autre l’Organisation mondiale du commerce d’un différend les opposant sur la pêche à l’espadon.
La course aux tribunaux peut sans doute créer une certaine émulation entre les juges et stimuler leur imagination. Elle n’en a pas moins des conséquences négatives. Le choix d’une juridiction peut être motivée par exemple par le fait que la jurisprudence d’un tribunal déterminé se trouve être plus favorable à certains intérêts que celle d’une autre instance. Or toute institution judiciaire évalue son importance en fonction de la fréquence avec laquelle elle est saisie. Certains tribunaux pourraient de ce fait être amenés à orienter leur jurisprudence en vue de développer leurs activités au détriment d’une approche plus objective de la justice. Une telle évolution serait profondément dommageable à la justice internationale. Le loi du marché sous la pression des médias ne saurait être la loi de la justice.
Les chevauchements juridictionnels emportent une seconde conséquence préoccupante du fait qu’ils augmentent les risques de contrariété de jugements. Deux tribunaux peuvent en effet être saisis concurremment d’un différend et rendre des décisions contradictoires. Ils peuvent aussi dans les motifs de leurs jugements interpréter différemment une même règle de droit et porter ainsi atteinte à l’unité du droit international, voire à sa certitude.
Ces situations se sont déjà rencontrées. Ainsi dans l’affaire Tadic , le Tribunal Pénal International pour l’ex.Yougoslavie a en 1999, adopté des positions diamétralement opposées à celles retenues par la Cour internationale de justice quelques années auparavant dans une affaire opposant le Nicaragua aux Etats-Unis, pour ce qui est des responsabilités encourues par un Etat qui intervient dans une guerre civile sur le territoire d’un autre Etat.
En réalité, la spécialisation croissante des juridictions internationales comporte un danger grave : celui que soient oubliées les perspectives d’ensemble. Certes, le droit international doit s’adapter aux divers domaines qu’il aborde. Il doit aussi s’adapter aux besoins locaux et régionaux. Mais, il doit conserver son unité et fournir aux acteurs de la vie internationale un cadre sûr. La multiplicité des juridictions doit être source d’enrichissement et non d ’anarchie.
Comment y parvenir ?
Il convient tout d’abord d’éviter d’aggraver la présente situation. Avant de créer une nouvelle juridiction, le législateur internationale doit s’interroger sur la question de savoir si les fonctions qu’il entend ainsi soumettre à un contrôle juridictionnel ne pourraient pas être avantageusement remplies par une juridiction existante.
Par ailleurs, les juges doivent prendre eux-mêmes conscience des dangers résultant de la prolifération des juridictions internationales, s’informer des jurisprudences développées par leurs collègues et entretenir des relations suivies.
On peut craindre cependant que ces solutions minimales ne soient pas suffisantes. Tout organe, qu’il soit judiciaire ou non, a tendance à se développer de manière autonome et le délibéré judiciaire comporte à cet égard des risques particuliers.
Les systèmes nationaux ont résolu ces problèmes en instituant des cours suprêmes chargées d’assurer la cohérence de la jurisprudence. Cette solution pourrait être transposée au plan international et certains ont proposé que la Cour internationale de justice se voit reconnaître le soin de connaître en appel ou en cassation des jugements rendus par les autres tribunaux internationaux. Mais une telle réforme impliquerait une volonté politique forte des Etats qui n’existe certainement pas et l’on pourrait tout au plus songer, comme je l’avais proposé en 2001 à l’Assemblée générale des Nations-Unies, à donner à la Cour compétence pour répondre aux questions préjudicielles que d’autres tribunaux internationaux pourraient lui poser.
Le développement rapide de la justice internationale a non seulement remis en cause la cohérence du système pris dans son ensemble, mais encore posé dans chaque juridiction des problèmes difficiles d’organisation et de fonctionnement.
Les Etats ont toujours été très sensibles à la composition des tribunaux internationaux et la plupart d’entre eux souhaitent pouvoir désigner un juge siégeant en leur sein. Une telle solution a été retenue dans les juridictions régionales, telles les Cours de Luxembourg et de Strasbourg, mais elle était à l’évidence impossible à mettre sur pied au niveau mondial. Il a alors été convenu que les juges devraient être choisis de manière à assurer une représentation des « grandes formes de civilisation » ou une répartition géographique équitable de postes. Ainsi, la Cour internationale de Justice est composée actuellement de 15 juges dont 5 ont traditionnellement la nationalité des membres permanents du Conseil de Sécurité, tandis que les autres proviennent en ce moment de l’Allemagne, du Japon, de la Jordanie, de Madagascar, du Maroc, du Mexique, de la Nouvelle Zélande, du Sierra Leone et du Venezuela.
De telles préoccupations pouvaient à première vue sembler étrangères aux tribunaux pénaux internationaux chargés de juger des individus et non des Etats. Aussi bien, aucun juge yougoslave ou rwandais n’a-t-il été désigné comme membre des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Mais l’enjeu est réapparu lors de l’élaboration de la convention de Rome créant un Tribunal pénal permanent et les Etats, soucieux de voir leurs nationaux jugés dans des conditions telles que leur comportement soit apprécié dans une juste perspective, ont introduit dans la convention des dispositions complexes relatives aux conditions que doivent remplir les futurs juges : origine nationale, compétence en droit pénal ou en droit international public, équilibre entre les hommes et les femmes, etc.
En tout état de cause et quelles que soient les précautions dont les Chancelleries s’entourent lors de la rédaction des statuts, l’expérience montre que les juridictions permanentes internationales, une fois crées, ont leur vie propre. Dès lors que les Etats décident de confier à un corps permanent de magistrats le soin de dire le droit, l’application et l’interprétation de ce droit leur échappera très largement.
Aboutir à une décision au sein d’une juridiction internationale implique cependant une procédure agréee et un délibéré approprié. Sur ces divers points, les juges internationaux font face à des problèmes différents de ceux que rencontrent les juges nationaux.
Ils doivent en premier lieu pouvoir communiquer et de se comprendre. Dès l’abord se pose donc le problème de la langue. Lorsqu’en 1922 avait été préparé le statut de la Cour permanente, il avait été envisagé que le français soit la langue unique de la Cour. Le Royaume-Uni s’y était opposé et finalement le français et l’anglais furent alors adoptés et sont depuis lors restées les langues officielles de la Cour. La même solution a été retenue en droit à Strasbourg, à Hambourg et dans les juridictions pénales internationales. A Luxembourg, toutes les langues des pays membres de l’Union européenne sont en droit sur un plan d’égalité, mais en fait la Cour délibère en français. L’anglais progresse cependant partout, en particulier à Strasbourg, encore que le français conserve en ce domaine, tant au barreau que parmi les juges, une place nettement plus importantes que celle qu’il a dans bien d’autres secteurs.
Une langue n’est pas seulement un moyen de communiquer ; elle est porteuse de concepts et la multiplicité des langues ne constitue que la forme la plus apparente de la diversité des civilisations. Aussi, les juges internationaux ont-ils à surmonter non seulement des barrières linguistiques, mais encore des barrières culturelles.
Ces différences d’approche sont particulièrement nettes dans le domaine procédural et les débats se poursuivent à l’infini sur les mérites respectifs des procédures écrites et orales, sur la longueur souhaitable des arrêts et leur mode de rédaction, ou sur l’utilité des opinions individuelles ou dissidentes. Les solutions varient en ce domaine. A la Cour internationale de Justice les mémoires écrits étaient traditionnellement abondants, les plaidoiries orales importantes, les arrêts fort longs et les opinions séparées nombreuses. Dans les dernières années, les procédures se sont cependant allégées et les arrêts raccourcis. A Luxembourg, les plaidoiries ont été dès l’abord réduites au minimum et les opinions séparées exclues. Au Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, comme au Tribunal sur le Rwanda, la procédure accusatoire adoptée en suivant le modèle américain a conduit à multiplier les audiences en vue de l’audition, dans la plupart des cas, de centaines de témoins soumis à interrogatoire et contre-interrogatoire. Dans l’affaire Milosevic le procureur a fait comparaître près de 400 témoins et le procès avait déja duré quatre années lorsqu’il fut interrompu en 2006 par le décès de l’accusé.
Il n’est pas aisé de porter une appréciation globale sur l’œuvre accomplie par ces diverses juridictions. Certains jalons peuvent cependant être posés.
En termes quantitatifs, il convient de noter que le nombre des affaires soumises au juge international a été en augmentant constamment. Les tribunaux ont par suite été amenés à solliciter des ressources supplémentaires pour faire face à ces nouvelles charges. Ainsi le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie dispose aujourd’hui d’un budget annuel de plus de 130 millions de dollars des Etats-Unis et son personnel est-il de près de 1200 agents. Son coût dépasse 10 % du budget des Nations Unies et le coût de chaque affaire atteint les 10 millions de dollars . D’autres tribunaux sont plus raisonnables, et la Cour internationale de justice dispose par exemple de moins de 100 agents (toutes catégories confondues).
Quoi qu’il en soit, la productivité des juridiction inter étatiques a dans l’ensemble été en s’améliorant au cours des dernières années. La Cour de Luxembourg a rendu 375 arrêts en 2004 et la Cour de Strasbourg 1105 en 2005. L’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce prend tous les ans une dizaine de décisions. Le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie fait de même. Le Tribunal pénal pour le Rwanda a rencontré plus de difficultés puisque depuis ses origines seulement vingt et un cas ont été tranchés par ses soins. Quant à la Cour internationale de justice, elle s’est prononcée en 2005 sur dix affaires. Les dossiers en instance n’en continuent pas moins de s’accumuler dans des proportions d’ailleurs variables : 13 pour la Cour internationale de justice, 840 pour la Cour de justice des Communautés européennes, 82.100 pour la Cour européenne des droits de l’homme, tandis que 45 prisonniers sont détenus à Scheveningen dans l’attente d’être jugés par le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie. Enfin, le parquet de la Cour pénale internationale s’est lancé dans plusieurs enquêtes sans que la Cour elle même ait pour l’heure rendu de jugement au fond. A l’évidence, des réformes s’imposent.
Elles sont probablement de nature différente selon les cas. Les juridictions pénales créees pour juger certains crimes commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda se trouvent devant un dilemme : soit libérer des prisonniers en détention provisoire prolongée, ce qu’a déjà fait une chambre du tribunal, soit accélérer les procédures en les modifiant profondément, soit transférer certains dossiers aux juridictions nationales (solution qui a été retenue pour douze accusés). La Cour internationale de justice va devoir réfléchir aux conditions dans lesquelles elle pourrait accélérer ses procédures et statuer en formations plus restreintes. La Cour de Strasbourg devra s’interroger sur la mise au point d’un système de filtre plus rigoureux analogue à ceux existant maintenant en France pour le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Quant à la Cour de Luxembourg, elle continuera probablement à transférer certaines affaires au tribunal de première instance. Les Etats et les contribuables ne pourront indéfiniment voir croître le coût de la justice internationale. La mission de celle-ci doit être clairement définie, des moyens appropriés lui être fournis et les juges doivent en tirer le meilleur parti.
Au-delà de ces réflexions portant sur la justice internationale telle qu’elle se présente à l’heure actuelle, quelle appréciation peut-on porter sur le rôle qui pourrait être le sien dans la société du XXIème siècle ? Le juge international parviendra-t-il en d’autres termes à maintenir demain la paix entre les nations en remplissant une mission comparable à celle confiée au juge national ? La question doit être posée à la fois en ce qui concerne les différends inter étatiques et pour ce qui est de la justice pénale.
Le rôle du juge dans la solution des litiges entre Etats s’est considérablement accru et continuera certainement à se développer . Il comporte cependant des limites qu’il apparaît difficile de franchir.
La première limite de ces limites tient à la nature même du droit. Le ministère du juge consiste en effet à restaurer la paix sociale en appliquant le droit dans les rapports entre les justiciables. Mais le droit ne résout pas tous les désordres et tous les déséquilibres. Il ne peut prétendre saisir l’ensemble du réel. Dans toute société, il est des tensions plus au moins diffuses qui doivent trouver une réponse par des moyens autres que l’application par le juge de la règle de droit. Il en est ainsi par exemple de certaines tensions familiales ou de difficultés apparues au sein de l’entreprise. Il en est de même dans la société internationale.
Par ailleurs, les différends sont souvent complexes. Il n’est pas de différend juridique pur : ceux apparus entre les Etats ont toujours un aspect politique. Et l’on peut chercher à les résoudre par des méthodes telles que la négociation ou la médiation qui ne conduisent pas à appliquer purement et simplement le droit. Dans l’affaire du Canal de Beagle , un arbitrage rendu conformément au droit applicable fut sur le point de déclencher un conflit armé entre l’Argentine et le Chili ; en revanche, une médiation pontificale permit par la suite de mettre un terme au différend. De même, dans l’affaire du Rainbow Warrior , le Secrétaire général des Nations-Unies fut capable, en tant que médiateur, de trouver une solution aux difficultés nées entre la France et la Nouvelle Zélande du fait de l’action des services secrets français, alors qu’un examen de l’affaire en droit n’aurait fait qu’envenimer les rapports entre les deux pays.
Outre ces limites liées à la nature même du droit, il en est d’autres résultant de la structure même de la société internationale. Cette société a certes connu certaines formes d’intégration au niveau régional, mais, elle demeure pour l’essentiel composée d’Etats souverains, qui demeurent les garants de la vie des peuples et de l’existence de la société internationale. Ce sont donc les Etat eux-mêmes qui créent l’essentiel du droit. Ce sont le plus souvent les Etats seuls qui peuvent saisir le juge. Ce sont enfin les Etats qui assurent eux-mêmes l’exécution des décisions de justice. De ce fait, les progrès de la justice internationale sont étroitement liés à l’existence des Etats et à leur volonté.
Il en est bien entendu de même de la justice pénale internationale. Celle-ci n’en pose pas moins des problèmes spécifiques qui méritent un examen attentif.
La justice pénale internationale s’est jusqu’à présent exercée pour l’essentiel sur des nations ou des communautés vaincues à la suite de conflits armés internationaux ou de guerres civiles. Certains avaient pensé que ce stade pourrait être dépassé du fait de la création de la Cour pénale internationale. Toutefois, la compétence de cette dernière, demeure pour l’heure réduite du fait que ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l’Inde, ni les Etats arabes (à l’exception de la Jordanie), ni Israël ne sont devenus parties à la Convention de Rome. Bien plus, les premières affaires dont celle-ci a eu à connaître concernent les vaincus de guerres civiles menées en Ouganda et au Congo et si le Conseil de sécurité l’a saisi de la situation au Darfour, le parquet de la Cour semble avoir de grandes difficultés à progresser dans cette affaire.
Par ailleurs, la répression pénale a ses limites propres. La Convention de Rome précise certes en son préambule que les Etats Parties sont « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs » de certains « crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ». Mais, les politiques pénales ont leurs limites souvent rappelées d’ailleurs en droit interne dans les cercles mêmes qui militent en faveur de la justice pénale internationale. C’est que la crainte du châtiment n’a pas toujours un effet dissuasif et si la Société des Nations avait établi un tribunal pénal international, comme elle l’avait envisagé en 1937, le comportement d’Adolf Hitler et des dirigeants nazis n’aurait probablement pas été bouleversé de ce fait.
Enfin la question doit être posée de savoir si, en toutes circonstances la sanction pénale est nécessaire (en particulier à l’issue de guerres civiles ou des dictatures méconnaissant les droits les plus élémentaires de la personne humaine). Il est des pays, telle l’Afrique du Sud, qui ont préféré mettre sur pied des mécanismes de réconciliation ; il en est d’autres qui ont opté pour le silence. Il y va là des rapports difficiles entre la justice et la paix et il appartient, me semble-t-il, en ce domaine comme en tout autre, à chaque peuple de choisir librement son destin.
En définitive, le recours à la justice pénale internationale, pour les Etats qui y consentent, semble justifié dans le cas de crimes particulièrement graves, tels le génocide ou les crimes contre l’humanité. En revanche, on ne saurait lui confier le jugement de tous les crimes de guerre sans lui faire courir le risque d’une asphyxie totale. La plupart d’entre eux devraient être laissés à l’appréciation du juge national.
Selon la Charte des Nations Unies , celle-ci a pour premier but de « maintenir la paix et la sécurité internationales ». La Charte a établi à cette fin le Conseil de sécurité qui a la responsabilité principale en ce domaine. Elle a aussi posé le principe que les différends internationaux doivent être réglés « conformément aux principes de la justice et du droit international ». C’est en application de ce principe qu’a été institué la Cour internationale de justice, puis que l’ont été de nombreuses autres juridictions inter étatiques spécialisées. Bien plus, c’est au nom du maintien de la paix que le Conseil de sécurité a crée les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. La paix apparaît ainsi comme la suprême valeur de la société internationale et la justice comme un des instruments de la paix.
A cet égard, la prévention est à l’évidence toujours préférable à la répression. L’action pénale peut parfois être nécessaire ; elle n’en traduit pas moins un échec. Loin des projecteurs médiatiques, la négociation, la médiation, l’arbitrage et la justice inter étatique conservent un rôle essentiel à jouer. Espérons que le XXIème siècle marquera de nouveaux progrès dans cette direction.
J’aime ça :
Ce prix biennal créé en 1977 est décerné « à l’auteur d’un ouvrage juridique de valeur ou à l’auteur d’une action ou d’une œuvre civique méritoire ».
Le jury est composé des membres de la section Législation, Droit public et Jurisprudence.
Les lauréats
2019 – Benjamin Lloret pour sa thèse, La protection internationale des minorités. Le regard de la doctrine française de l’entre-deux-guerres , soutenue le 18 mai 2018 à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.
2017 – Olivier Jouanjan pour son ouvrage Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi , Paris (PUF), 2017.
2015 – Athanasia Petropoulou pour son ouvrage Liberté et sécurité. Les mesures antiterroristes et la Cour européenne des Droits de l’Homme , Paris (Pedone), 2014.
2013 – Michel Troper et Dominique Chagnollaud (sous la direction de), Traité international de droit constitutionnel. Théorie de la Constitution , Paris (Dalloz), 2012, 3 tomes.
2011 – Brunessen Bertrand, pour sa thèse de doctorat Le juge de l’Union européenne, juge administratif , soutenue le 19 juin 2010 (Paris II).
2009 – prix non attribué.
2007 – François Givord , Claude Giverdon et Pierre Capoulade pour leur ouvrage La copropriété , Paris (Dalloz), 2006.
2005 – Béhibro K. Guy Claude Kouakou pour sa thèse de doctorat en droit Le contentieux de la fonction publique internationale. Contribution à l’étude du régime juridique des commissions de recours et d’appel de l’agence intergouvernementale de la francophonie , soutenue le 15 juin 2004 à l’Université René Descartes-Paris V.
2003 – Claire Bouglé – Le Roux, pour sa thèse de doctorat La cour de cassation et le code pénal de 1810. Le principe de légalité à l’épreuve de la jurisprudence (1811 – 1863) , soutenue le 5 janvier 2002 à l’Université de Rennes-I
2001 – Roger -A. Lhombreaud , Mémoires et destin , fin d’une adolescence en temps de guerre , Paris (XXIe siècle – Gutenberg), 2000.
1999 – Matthieu Reeb pour l’édition du Recueil des sentences du Tribunal arbitral du sport , Berne (Stæmpfli), 1998.
En savoir plus sur Académie des Sciences Morales et Politiques
Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.
Continue reading
Le moteur de recherche des thèses françaises
Les personnes liées aux thèses, recherche avancée, limites au principe du consentement des états à la compétence de la cour mondiale : (droit et politiques juridiques), mots clés contrôlés, mots clés libres.
Le principe du consentement des Etats à la compétence de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI), est un principe fondamental du procès international. Selon la Cour, appuyée par la doctrine, la compétence de la Cour serait même entièrement gouvernée par ce principe. Affirmer l’existence de limites induit un hiatus entre la théorie et la pratique. L’étude des sources de la compétence de la Cour conduit en effet à identifier des éléments qui ne s’accordent pas avec ce discours. La réalité des affaires devant la Cour contraste avec l’image renvoyée d’une juridiction sous la tutelle du consentement des Etats à sa compétence, et met en lumière les politiques juridiques poursuivies par les principaux acteurs du procès devant la Cour : les Etats et la Cour elle-même.
- français
- Home
- Faculté de droit
- Faculté de droit – Thèses et mémoires
L'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice : faiblesses et malentendus

- Cour internationale de justice
- Conseil de sécurité
- Exécution volontaire
- Exécution forcée
- Nations Unies
- Décisions
- Droit de véto
- Souveraineté nationale
- Droit international
- International Court of Justice
- Security Council
- Power of Veto
- United Nations
- Intemational Law
- Enforcement
- National Sovereignty
Abstract(s)
Collections.
- Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [24009]
- Faculté de droit – Thèses et mémoires [760]
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.
Les défis et les limites de la justice internationale

Afrique du Sud : pourquoi le pays attaque Israël en justice?

Guerre Israël-Hamas : quel rôle la justice internationale peut-elle jouer ?
Les actions en justice pour inaction climatique peuvent-elles faire bouger les États ?

Guatemala : 20 ans de prison après le massacre d'indigènes

Génocidaires : la parole aux accusés

Wagner classée comme organisation criminelle : quelles répercussions pour le groupe paramilitaire russe ?

Angola : Isabel dos Santos nie être visée par une enquête d’Interpol

La Belgique prête à passer un accord avec l'Iran pour libérer un travailleur humanitaire

Génocide Tutsi au Rwanda : Vénuste Nyombayire bénéficie d'un non-lieu

Condamnation d'un ancien responsable iranien par un tribunal suedois

Rwanda : Laurent Bucyibaruta reconnu coupable de complicité de génocide

Génocide des Tutsi au Rwanda : réactions après la condamnation de Laurent Bucyibaruta

Génocide Tutsi au Rwanda : l’ex préfet Laurent Bucyibaruta comparaît pour complicité

Crimes de guerre en Ukraine : un casse-tête juridique

Ukraine : quelles attentes pour le premier procès pour crimes de guerre dans le pays ?

Ukraine : un soldat russe devant la justice

Guerre en Ukraine : que peut-on attendre de la justice internationale ?

Comment indémniser les victimes ? "Il faudrait une volonté politique réelle"

Corruption : 4 questions à Sara Brimbeuf de Transparency International sur l'affaire des biens mal acquis

La Syrie accusée de crimes contre l'humanité

Justice internationale : "La CPI n'a connu que des procès africains, mais le futur devrait être différent"


Paradis fiscaux : que révèle l'enquête OpenLux ?
Justice internationale : Karim Khan élu procureur de la Cour pénale internationale
Direct - l'armée israélienne annonce la mort de quatre otages à gaza, quelle influence possible pour l'extrême droite au parlement européen , israël : zone de non-droit , claudia sheinbaum, première présidente du mexique : "le peuple avant tout" , direct - l'ukraine s'attend à plus de coupures de courant après les frappes russes sur son réseau électrique, afrique du sud : "l'anc paie l'héritage de jacob zuma", élections européennes : mode d’emploi.

Immunités des organisations internationales : l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, Jam et al. v. international finance corp.

- Référence bibliographique
Dreysse Daphné, Cahin Gérard, Lagrange Évelyne. Immunités des organisations internationales : l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, Jam et al. v. international finance corp. . In: Annuaire français de droit international , volume 65, 2019. pp. 238-252.
DOI : https://doi.org/10.3406/afdi.2019.5303
www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2019_num_65_1_5303
- RIS (ProCite, Endnote, ...)
- 1. Le contexte légal et factuel du différend [link]
- a) L’immunité des États étrangers comme référence : vers l’immunité restreinte [link]
- b) Mêmes exceptions, mêmes conditions [link]
- 1. La préférence donnée au sens ordinaire : le refus d’une interprétation téléologique [link]
- 2. Une application différente du canon d’interprétation : un renvoi général susceptible d’évolution [link]
- 1. La remise en cause de la solution d’Atkinson [link]
- 2. La cohérence globale : un régime unique commun [link]
- 1. Restreindre l’immunité pour rendre effectif le droit au juge ? [link]
- a) Le coût ou les effets négatifs de l’assimilation : insécurité et ingérence [link]
- b) La pérennité des organisations internationales assurée par deux protections : l’existence de conditions et la conclusion d’un nouvel accord [link]
Texte intégral
238 droit et pratique des organisations internationales
IMMUNITÉS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES : L’ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS,
JAM ET AL. V. INTERNATIONAL FINANCE CORP.
Daphné DREYSSÉ*
L’arrêt Jam et al. v. International Finance Corp. sonne comme un coup de tonnerre dans le droit des immunités et des privilèges accordés aux organisations internationales aux États-Unis. Longtemps – et depuis l’évolution du régime des immunités des États – la question de l’étendue de l’immunité des organisations
internationales y est demeurée ouverte et une clarification de la Cour suprême
était attendue 1. Dans des termes qui ne laissent guère de doute – «[ t] he International Finance Corporation is therefore not absolutely immune from suit » 2 – la Cour suprême a remis en cause le caractère absolu de l’immunité de juridiction
dont bénéficiait jusqu’alors la Société financière internationale sur le fondement
de la loi sur les immunités des organisations internationales (International Organizations Immunities Act de 1945, ci-après «IOIA » ) et semble redéfinir la portée
de l’immunité de juridiction à laquelle les organisations internationales peuvent prétendre en vertu du droit interne. En effet, dans une décision adoptée à la majorité
3, les juges de la Cour suprême ont décidé d’interpréter la loi sur les immunités des organisations internationales de manière évolutive et d’aligner l’étendue de l’immunité de juridiction des organisations internationales sur celle conférée aux États étrangers en vertu du Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (ci-après : «FSIA » ). L’immunité de juridiction est ainsi limitée : les organisations internationales
ne pourront plus bénéficier, sauf exceptions 4, d’une immunité de juridiction pour leurs activités commerciales (pour les actes jure gestionis). L’arrêt de la Cour suprême semble bien révolutionner la matière et vient clore un débat doctrinal 5.
Dans le même temps, la solution soulève de nombreuses interrogations notamment sur la portée et les conséquences pratiques pour les organisations internationales,
et en particulier pour les organisations internationales financières comme la Société financière internationale et les autres banques de développement. Ces
(*) Docteure en droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas.
1. I. Pingel, «Les privilèges et immunités de l’organisation internationale » , in É. Lagrange et
droit et pratique des organisations internationales 239
organisations seront-elles en mesure de continuer à exercer leurs missions en toute indépendance ? Cette décision nationale s’inscrit-elle dans un courant plus hostile aux immunités des organisations internationales ? Ainsi, si la solution est claire (I), de nombreuses questions se posent concernant sa portée (II).
I. – La solution : le choix de l’alignement de l’immunité de juridiction des organisations internationales sur celle des états
Au terme d’un arrêt d’une quinzaine de pages, accompagné d’une opinion dissidente presque aussi longue du Juge Breyer, la Cour suprême semble avoir
renversé la solution : les organisations internationales qui bénéficiaient jusqu’alors
d’une immunité absolue de juridiction, souvent critiquée, peuvent désormais être attraites devant une juridiction des États-Unis dès lors que le différend qui les oppose à une personne privée est fondé sur une activité commerciale (A). Si la solution est en elle-même d’une importance capitale et conduit à annuler des décennies de précédents 6, le raisonnement de la Cour en matière interprétative est également riche d’enseignements (B).
A. La solution : l’absence d’immunité pour les actes de nature commerciale
1. le contexte légal et factuel du différend.
Contexte et faits de l’espèce. – «Plus importante institution mondiale d’aide au développement » 7, la Société financière internationale (ci-après : «SFI » ) est
une organisation internationale, dont le siège est à Washington, et fait partie du groupe Banque mondiale. Pour «stimuler l’expansion économique » du secteur
privé conformément à son objet, la SFI finance des projets de développement en
accordant des prêts à des entreprises dans le secteur privé dans les régions moins
développées. C’est ainsi dans le cadre de ses activités qu’elle a participé au financement
de la construction d’une des plus importantes centrales au charbon en Inde, en consentant un prêt de 450 millions de dollars en 2008 8. Dès 2011, une association représentant les intérêts des pêcheurs riverains de la centrale a déposé une plainte auprès du bureau du Compliance Advisor Ombudsman de la SFI 9, suivie
240 droit et pratique des organisations internationales
d’une seconde plainte en 2016 10. Les griefs de ces plaintes sont sensiblement identiques, si bien que les deux affaires ont été jointes. En effet, dans chacune d’elles, les demandeurs entendent agir en réparation pour des dommages environnementaux et sociaux causés par la centrale (destruction des habitats naturels, pollution de l’eau, diminution de la population de poissons, émissions atmosphériques, accès bloqué aux sites de pêche et de séchage). L’audit réalisé à la demande du
Compliance Advisor Ombudsman a révélé les lacunes de la SFI dans l’évaluation et la supervision du projet et de la société exploitante 11. Un groupe d’agriculteurs et de pêcheurs riverains ont alors intenté une action contre la SFI pour négligence
devant le tribunal fédéral pour le district de Columbia en 2015. La Société financière
internationale s’est prévalue de son immunité de juridiction sur le fondement de l’IOIA pour empêcher toute action en justice. Dans une décision, confirmée par
la suite par la Cour d’appel, le tribunal a reconnu le caractère absolu de l’immunité de juridiction, privant ainsi les demandeurs de toute action devant les juridictions américaines. L’affaire a alors été portée devant la Cour suprême des États-Unis, qui devait interpréter l’IOIA et déterminer l’étendue de l’immunité de juridiction
dont bénéficient les organisations internationales reconnues.
Contexte légal. – Aux États-Unis, les immunités et les privilèges des organisations
internationales sont principalement définis par le droit interne 12. C’est ainsi l’International Organizations Immunities Act qui vient garantir aux organisations internationales les privilèges et immunités dont elles ont besoin pour assurer leurs missions 13. S’agissant de l’immunité de juridiction, il est prévu qu’ «[ i] nternational
droit et pratique des organisations internationales 241
organizations, their property and their assets, wherever located, and by whomsoever held, shall enjoy the same immunity from suit and every form of judicial process as is enjoyed by foreign governments » 14. Ainsi, l’immunité de juridiction des organisations
internationales est définie par référence à celle dont bénéficient les États étrangers. Cette définition «par référence » est également retenue s’agissant d’autres privilèges comme les privilèges fiscaux. En revanche, l’IOIA définit l’immunité de perquisition,
l’inviolabilité des archives ou encore l’exonération des impôts sans référence aux États étrangers 15. S’agissant de la Société financière internationale, celle-ci ne peut prétendre bénéficier d’une immunité de juridiction que sur le fondement de l’IOIA 16.
En effet, selon ses Statuts, l’immunité de juridiction ne joue que dans l’hypothèse de poursuites engagées contre la Société par un État membre. Dans tous les autres cas, la Société peut être poursuivie devant tout «tribunal ayant compétence dans les territoires d’un État membre où elle possède un bureau, où elle a nommé un agent
chargé de recevoir des significations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti
des valeurs mobilières » 17. De plus, s’il existe bien un instrument conventionnel, la Convention du 21 novembre 1947 relative aux privilèges et immunités des Institutions spécialisées des Nations Unies qui s’applique aux institutions membres du
Groupe de la Banque mondiale (dont fait partie la Société financière internationale),
celui-ci n’est pas applicable aux États-Unis dans la mesure où ils n’y sont pas partie 18.
En tout état de cause, cette Convention a un rôle très limité concernant la SFI dans la mesure où l’annexe XIII fait référence aux Statuts de la SFI pour déterminer l’étendue de l’immunité 19. Ainsi, pour déterminer si la Société financière internationale bénéficie d’une immunité de juridiction concernant le différend l’opposant aux pêcheurs et agriculteurs riverains, la Cour doit déterminer ce que signifie «la
même immunité dont jouissent les États étrangers » , étant entendu que l’immunité de juridiction des États a évolué depuis l’adoption de la loi en 1945.
2. La «même immunité» que les États étrangers : l’application de la FSIA aux organisations internationales
a) L’immunité des États étrangers comme référence : vers l’immunité restreinte
Si le texte ne laisse place à aucun doute quant à l’existence d’une immunité de juridiction, et s’il lie celle accordée aux organisations internationales à celle des États étrangers, les deux parties s’opposent sur le sens et la manière d’interpréter
242 droit et pratique des organisations internationales
l’expression «the same immunity […] as is enjoyed by foreign governments » : le législateur a-t-il entendu conférer aux organisations internationales une immunité
semblable à celle dont bénéficiaient les États étrangers au moment où il a adopté
le texte, c’est-à-dire en 1945, ou bien a-t-il voulu que l’immunité des organisations internationales soit en tout point identique à celle des États étrangers, si bien que l’évolution de l’étendue de l’une implique nécessairement l’évolution de l’autre ?
Solution. – La réponse de la Cour est claire : elle lie irrémédiablement l’immunité des organisations internationales à celle des États et explique que l’expression
«means that the Foreign Sovereign Immunities Act governs the immunity of international organizations » 20. Ce faisant, elle rejette sans surprise un premier argument de la SFI qui soutenait que les deux immunités n’étaient pas liées, chacune
ayant une finalité différente. S’il est incontestablement exact qu’à la différence des
immunités des États étrangers, qui sont fondées sur la souveraineté et l’égalité des États 21, les organisations internationales bénéficient d’une immunité afin
d’assurer leurs missions et la réalisation de leurs objectifs en toute indépendance, l’IOIA ne mentionne pas la finalité de l’immunité de juridiction des organisations internationales et l’a définie exclusivement par référence à celle des États. In fine,
le raisonnement de la Cour se veut «neutre » : il ne s’agit pas de raisonner dans le cadre des organisations internationales, ou même plus généralement dans le cadre du droit international, mais bien d’interpréter une disposition législative – la Cour utilise par conséquent ses méthodes classiques d’interprétation (sens ordinaire, interprétation comparative, canon de référence). Ainsi, elle relève que l’expression «the same » est celle qu’utilise le Congrès «typically […] to make one thing continuously equivalent to another » 22.
Ainsi, c’est l’immunité de juridiction des États étrangers qui définit celle des
organisations internationales. En d’autres termes, la portée de l’immunité des
organisations internationales n’est pas définie en soi et il convient de se référer à l’immunité de juridiction des États étrangers telle qu’elle est définie par le Foreign Sovereign Immunities Act de 1976. Cette absence de définition dans l’IOIA a pour conséquence l’évolution possible de l’étendue de l’immunité de juridiction : l’immunité
des organisations internationales suit celle dont bénéficient les États. Cette
possibilité d’évolution se remarque à la temporalité dans laquelle la Cour inscrit sa décision : «today » apparaît en effet à de nombreuses reprises et figure explicitement
dans le dispositif. Ainsi, il est indifférent en soi de savoir que l’immunité de juridiction des États étrangers était presque absolue en 1945. Il s’agit de se placer à la date «d’aujourd’hui » . Depuis 1976, l’immunité de juridiction des États étrangers est restreinte, c’est-à-dire limitée aux actes jure imperii. Par voie de conséquence, «[ t] he International Finance Corporation is […] not absolutely immune from suit » .
b) Mêmes exceptions, mêmes conditions
Plus encore, c’est l’intégralité du régime de l’immunité de juridiction des États étrangers qui s’applique, «governs » 23 selon la Cour, aux organisations internationales. Ainsi, l’immunité est restreinte dans la même mesure que celle des États. La seconde exception générale liée à la nature de l’activité s’applique alors ;
la Société financière internationale – comme n’importe quelle autre organisation
internationale reconnue – n’est pas à l’abri de poursuites pour ses activités
droit et pratique des organisations internationales 243
commerciales. Sur ce point, la Cour précise qu’une activité est susceptible d’être
qualifiée comme commerciale dès lors qu’elle est une activité «by which a private party engages in trade or commerce » , reprenant la définition qu’elle avait donnée
dans son arrêt République d’Argentine c. Weltover 24. De même, les conditions nécessaires pour qu’une juridiction américaine puisse statuer sur un différend ayant pour défendeur une organisation internationale sont identiques à celles prévues dans la FSIA. Deux conditions doivent ainsi être réunies : l’activité commerciale
doit avoir un lien suffisant avec les États-Unis d’une part 25, et l’action en justice doit être fondée sur l’activité commerciale elle-même ou sur des actes accomplis en relation avec l’activité commerciale d’autre part 26. Dès lors c’est, semble-t-il, l’intégralité du régime, c’est-à-dire toutes les exceptions prévues à l’article 28 US Code § 1605, qui se trouve applicable aux organisations internationales mutatis mutandis. En ce sens, la Cour ne rend pas uniquement applicable la distinction entre acte jure imperii et jure gestionis, elle étend l’application de la FSIA aux organisations internationales 27, par transposition ou assimilation. C’est de cette manière qu’il convient de comprendre le terme «equivalent » utilisé par la Cour 28.
La Cour assoit sa solution sur un raisonnement en trois étapes qui est particulièrement convaincant : l’immunité de juridiction des organisations internationales
est liée à celle dont bénéficient les États ; l’immunité des organisations
internationales est plus précisément la même, c’est-à-dire équivalente à celle dont
bénéficient les États ; par conséquent, il convient d’appliquer les règles prévues
dans la FSIA aux organisations internationales. Dès lors les organisations internationales
ne bénéficient pas d’une immunité de juridiction absolue. Celle-ci est limitée et les organisations internationales ne bénéficient d’aucune immunité de
juridiction pour leurs activités commerciales. En appliquant les mêmes règles aux
États et aux organisations internationales qui ne bénéficient pas d’une protection
conventionnelle, la Cour crée un régime unique, gage, semble-t-il, de cohérence.
244 droit et pratique des organisations internationales
L’approche est didactique, la motivation détaillée et convaincante : chaque étape
du raisonnement est justifiée par l’application d’une règle ou d’une méthode d’interprétation. Ce faisant la Cour rejette chaque argument de la Société financière
internationale et l’interprétation retenue par d’autres juridictions. Aussi tant la technique que la rhétorique interprétative de la Cour sont-elles particulièrement intéressantes.
B. Les fondements de la solution : le choix interprétatif retenu
Il ne faudrait pas se tromper sur l’arrêt rendu : la question de droit soumise à la Cour est une question d’interprétation, c’est-à-dire qu’il s’agit d’établir le sens, de rechercher l’intention de sens ou la volonté de l’auteur. La solution, dont les implications pratiques pour les organisations internationales sont considérables, est le résultat de choix interprétatifs 29. Plus précisément, il apparaît, notamment à la lecture de l’opinion dissidente jointe à l’arrêt, que la Cour s’est fondée sur certaines règles d’interprétation et en a omis ou délaissé d’autres, ce choix n’étant pas anodin. Dans son raisonnement, la problématique du droit «intertemporel »
– le renvoi opéré par la loi aux immunités dont bénéficient les États est-il dynamique
ou statique ? – n’est pas mise en premier plan. Il s’agit pourtant, selon le Juge Breyer, de la question centrale posée à la Cour : «[ d] o the words of a statute refer to their subject matter ‘ statically’, as it was when the statute was written ? Or is their reference to that subject matter ‘ dynamic’, changing in scope as the subject matter changes over time ? » 30. En d’autres termes, lorsque le Congrès a
utilisé l’expression «la même immunité dont bénéficient les États » , a-t-il entendu conférer l’immunité quasi absolue dont bénéficiaient les États à l’époque, ou bien l’expression doit-elle être comprise, comme le fait la Cour, pour signifier que les
deux immunités doivent être équivalentes ? La réponse à cette question peut être différente selon les méthodes d’interprétation utilisées. Cette variabilité possible du sens résulte de l’absence de hiérarchie au sein des règles d’interprétation. Dans l’arrêt, la divergence entre la majorité et le juge dissident résulte tout d’abord du refus par la Cour de prendre en compte le contexte de la loi, ensuite du rejet d’une interprétation téléologique, puis de la place à accorder au canon de référence qui
permet d’interpréter les renvois en fonction de leur caractère général ou spécifique. La divergence entre la Cour et la Société financière internationale résulte quant
à elle également du refus d’une interprétation téléologique et d’une application différente du canon de référence.
1. La préférence donnée au sens ordinaire : le refus d’une interprétation téléologique
La Cour ne prend en compte ni le contexte, ni l’objet et le but de la disposition, le but étant d’encourager les organisations internationales à installer leur siège aux États-Unis et de leur permettre de poursuivre leurs missions en toute indépendance
31. La Cour utilise exclusivement dans un premier temps la règle d’interprétation du sens ordinaire, qui lui permet de dégager «the more natural reading of the
droit et pratique des organisations internationales 245
IOIA » 32. Elle ne semble ainsi pas connaître l’embarras du Juge Breyer qui relève que «language alone cannot resolve […] the statute’s linguistic ambiguity » 33. Or,
le contexte tout comme l’objet et le but fournissent de bons éléments pour identifier
l’intention de l’auteur et constituent des indices essentiels dans la recherche du sens à donner à un texte. En adoptant une approche linguistique, la Cour choisit de se placer uniquement sur le terrain législatif, c’est-à-dire uniquement sur ce que la loi indique. Elle refuse ainsi d’interpréter «the same » en fonction du but
poursuivi, précisément parce qu’il ne figure pas dans la loi. En outre, la Cour utilise
la méthode comparative fondée sur l’économie générale de la loi pour opposer cette disposition aux autres, et relève qu’à la différence d’autres articles, le Congrès a
choisi de ne pas définir la portée de l’immunité de juridiction, alors – et cet élément
est important – qu’il aurait pu le faire. Le sens qu’elle attribue à l’expression est ensuite comparé au sens donné à cette même expression par le passé. L’absence
de précisions quant au but et à la finalité des privilèges et immunités favorise
l’interprétation évolutive retenue par la Cour. En effet, si les circonstances peuvent changer et si les règles auxquelles la loi renvoie peuvent évoluer, l’objet et le but de la loi restent immuables, tout comme la raison d’être de l’immunité de juridiction des organisations internationales.
2. Une application différente du canon d’interprétation : un renvoi général susceptible d’évolution
La Cour trouve une confirmation de son interprétation en appliquant un
canon d’interprétation qui prévoit que «when a statute refers to a general subject, the statute adopts the law on that subject as it exists whenever a question under the statute arises » 34. Le canon doit permettre de déterminer si le renvoi est fixe
(statique) ou mobile (évolutif), c’est-à-dire si le législateur, ou plus généralement
l’auteur de l’acte, a voulu incorporer un ensemble de règles identifiées et insusceptibles
d’évolution 35 (dans ce cas, il doit renvoyer à une disposition spécifique comme une loi identifiée ou un contenu identifiable et directement applicable) ou
si, au contraire, l’auteur a renvoyé à un ensemble de règles générales, auquel cas il faut alors, pour déterminer le contenu de la loi, se placer au jour de la décision.
Cette difficulté est commune à tous les ordres juridiques, y compris au droit international
public 36. Sur ce point encore, la Cour analyse uniquement la disposition à interpréter et le raisonnement est sommaire. La Cour remarque en effet que, même lors de l’adoption de la loi en 1945, «the ‘ immunity enjoyed by foreign government’
246 droit et pratique des organisations internationales
did not mean ‘ virtually absolute immunity’ » 37. En ce sens, la référence ne renvoie ni à un texte, ni à un terme technique. De la même manière, elle n’a pas de sens ou de contenu en elle-même. La loi ne prévoit qu’une seule chose : elle impose de rechercher quelles sont les règles applicables à l’immunité de juridiction des États. Dès lors, la référence ne peut, selon la Cour, qu’être «a general reference to an external body of (potentially evolving) law » 38. Sans remettre en cause l’utilisation
du canon, qu’il qualifie de «at most a rule of thumb » 39, le Juge Breyer critique l’interprétation littérale de la Cour en rappelant que la distinction opérée par le
canon entre référence spécifique (renvoi fixe) et référence générale (renvoi mobile) est certes utile mais n’est pas suffisante à elle-seule, ni infaillible 40. En effet, dans cette hypothèse, il convient de déterminer l’intention du législateur. Cette intention, qui donnera alors le sens aux termes que ce dernier a employés, s’apprécie grâce aux règles d’interprétation 41. L’arrêt montre parfaitement que les choix faits en matière d’interprétation conditionnent la solution, et met en lumière à la fois la relativité de l’interprétation 42 et la liberté – le pouvoir de choix – de l’interprète. C’est ainsi en ne prenant en compte ni l’objet et le but de la loi, ni même les conséquences de sa solution sur les organisations internationales que la Cour revient sur la jurisprudence et aligne l’immunité des organisations internationales sur celle des États, au risque de mettre en péril, semble-t-il, l’action des organisations internationales.
II. – La portée : une recherche de cohérence au risque de mettre en péril les organisations internationales ?
Le Juge Breyer affirme, dans son opinion dissidente, que la majorité n’a pas pris
en compte les conséquences – désastreuses pour les organisations internationales
et spécifiquement pour les banques de développement – et que la solution retenue
«runs counter to the statute’s basic purpose » 43. À plusieurs reprises la Cour s’en défend ; la motivation de l’arrêt indique que la solution s’inscrit dans une recherche de cohérence (A) et d’équilibre (B).
A. Un «revirement» motivé par la recherche de cohérence générale ?
La solution constitue un frein à la tendance observée depuis des décennies à l’octroi aux organisations internationales d’une immunité absolue 44 (1). La solution permet cependant de créer un régime unique commun à tous les sujets de droit en matière d’immunité de juridiction (2).
droit et pratique des organisations internationales 247
1. La remise en cause de la solution d’Atkinson
En 1980, la Cour d’appel dans l’affaire Marvin R. Broadbent v. Organization of American States n’avait pas répondu explicitement à la question de savoir s’il fallait privilégier une interprétation évolutive et appliquer aux organisations la distinction applicable aux États entre les actes jure imperii et jure gestionis 45. En revanche, en 1998, dans l’affaire Atkinson v. Inter-American Development Bank
qui sera suivie par d’autres formations 46, la même Cour a affirmé que «Congress’ intent was to adopt that body of law only as it existed in 1945 – when immunity of foreign sovereigns was absolute » 47. C’est d’ailleurs sur la base de ce précédent que la Cour d’appel, dans notre affaire, avait reconnu à la SFI une immunité absolue de juridiction et avait rappelé que «international organizations were given complete immunity by the IOIA unless it was waived or the President intervened » 48. La Cour suprême n’ignore pas la solution d’Atkinson. Bien au contraire, elle l’intègre
à sa propre solution en affirmant très clairement que «[ w] e do not agree » 49. Dans
Atkinson, la Cour pour le District de Columbia avait interprété l’IOIA en prenant en compte l’intention du Congrès avant même d’utiliser le canon d’interprétation 50,
montrant ainsi une différence de méthodologie. Elle avait déduit de la possibilité,
prévue dans la loi, pour le Président de modifier les règles relatives aux immunités
51 l’intention du Congrès de réserver toute évolution future de la portée de l’immunité de juridiction à la seule compétence du Président. Pour la Cour suprême, la démonstration ne peut convaincre, tant sur la solution que sur la méthode 52 : en effet, la prérogative présidentielle est destinée à permettre des ajustements cas par cas, si les circonstances d’espèce l’exigent, et, comme la pratique le montre,
s’exerce uniquement de manière ponctuelle. En ce sens, elle s’oppose à la définition
générale de l’étendue de l’immunité de juridiction qui vaut pour toute organisation internationale reconnue. En d’autres termes, ces deux dispositions ne relèvent pas des mêmes réalités : la prérogative présidentielle ne peut en aucun cas présager
de l’évolution de la définition générale, ni être prise en compte pour déterminer le sens à donner à la référence faite dans la loi à l’immunité dont bénéficient les
États. Au surplus, comme le relève très justement la Cour suprême, la prérogative présidentielle est «perfectly compatible with the notion that those rules might themselves change over time in light of developments in the law governing foreign
248 droit et pratique des organisations internationales
sovereign immunity » 53. L’arrêt remet par conséquent en cause la jurisprudence qui semblait bien établie 54, malgré l’existence d’un débat doctrinal. Cette disposition occupe également une place importante dans l’argumentation du Juge Breyer et révèle un autre point de divergence entre lui et la majorité. En effet, et sans s’inscrire dans la ligne d’Atkinson, il montre un attachement au pouvoir de l’exécutif de suspendre, limiter ou retirer l’immunité. Selon lui, toute interprétation évolutive de l’IOIA porterait atteinte à ce pouvoir et à la «flexibility
» 55 de la protection légale. La lecture qu’il fait de cette prérogative semble permettre une intervention du pouvoir exécutif à tout moment pour «separate lawsuit sheep from lawsuit goats » 56. Ainsi, le pouvoir exécutif pourrait «créer une immunité sur mesure » une fois le différend né s’il l’estime nécessaire ou opportun 57. Une telle intervention, si elle est appelée à devenir le principe, semble
difficilement compatible avec l’indépendance dont ont besoin les organisations
internationales pour l’exercice de leurs fonctions, et heurte la sécurité juridique. Son analyse révèle par conséquent une conception troublante – voire inquiétante – de l’immunité : l’immunité apparaît en effet extrêmement fragile, précaire, révocable à chaque instant – ce que semble exclure la Cour. La nouvelle solution paraît reposer, au moins en partie, sur l’idée du «lien » qui unit l’immunité de juridiction des États et des organisations internationales.
2. La cohérence globale : un régime unique commun
Si le principal apport de l’arrêt Jam consiste dans la redéfinition de l’étendue de
l’immunité de juridiction des organisations internationales, l’arrêt marque également la création d’un régime unique commun à tous les sujets de droit international. En d’autres termes, ce n’est pas seulement la distinction entre les actes jure imperii et
jure gestionis qui s’applique aux organisations internationales, ce sont toutes les règles relatives à l’immunité de juridiction des États telles que prévues à l’article 28 US Code § 1605 qui se trouvent applicables mutatis mutandis. L’existence de ce régime commun n’est possible que parce que la Cour, qui s’appuie pour cela sur l’avis du Département d’État, a considéré les deux immunités comme indéfectiblement liées, les organisations internationales étant soumises aux règles applicables aux États. S’il existe des différences essentielles entre ces deux catégories de sujets de droit international, qui peuvent faire douter de l’adéquation de l’application du régime étatique aux organisations internationales 58, ce régime commun reste incontestablement un facteur de cohérence 59. De plus, il permet d’empêcher tout
droit et pratique des organisations internationales 249
contournement ou instrumentalisation de l’IOIA. L’arrêt de la Cour suprême est
silencieux sur ce point et ces justifications n’apparaissent qu’à la lecture d’autres
arrêts antérieurs. Parmi ceux-ci, la motivation de la solution dans l’affaire OSS Nokalva, Inc. v. European Space Agency est saisissante. Dans cette affaire, la Cour d’appel pour le troisième District avait abouti à la même solution que la Cour suprême et remis en cause le caractère absolu de l’immunité de juridiction. S’appuyant sur les travaux de la doctrine 60, et en particulier ceux de S. Herz, opposé à l’immunité de juridiction absolue 61, la Cour affirmait qu’il n’y avait «no compelling reason why a group of states acting through an international organization is entitled to broader immunity than its member states enjoy when acting alone » 62. Elle insistait sur le risque de détournement ou d’abus : «such a policy may create an incentive for foreign governments to evade legal obligations by acting through international organizations » 63. L’assimilation crée indubitablement une cohérence mais pose des
difficultés, qui conduisent à s’interroger sur l’équilibre de la solution.
B. Une solution équilibrée ?
La solution s’inscrit dans une tendance plus générale à la remise en cause du caractère absolu de l’immunité de juridiction, essentiellement parce qu’elle prive les personnes privées du droit au juge (1). Elle apparaît dès lors comme une avancée dans «la recherche d’un meilleur équilibre entre [ l’] objectif légitime de [ protection des organisations internationales] et celui, qui ne l’est pas moins pour les individus,
du droit au procès équitable et, plus spécifiquement du droit au juge » 64. D’un autre côté, l’idée sous-jacente à l’argumentation de la SFI consiste à soutenir que mettre
fin à l’immunité absolue de juridiction aboutirait à mettre en péril l’organisation et
l’empêcherait de réaliser ses objectifs. La solution de la Cour permet-elle de garantir un équilibre satisfaisant entre ces intérêts ? N’impose-t-elle pas un coût exorbitant pour les organisations internationales, en particulier pour les banques de développement ? (2).
1. Restreindre l’immunité pour rendre effectif le droit au juge ?
La Cour ne se place pas sur le terrain du droit au juge, ni sur la conciliation entre ce droit de l’homme et les intérêts et les besoins des organisations internationales
65. Mais il est impossible de lire cet arrêt sans prendre en compte le contexte plus général et la «tendance à l’érosion du caractère absolu des immunités des organisations internationales » 66. De très nombreux auteurs ont critiqué la
250 droit et pratique des organisations internationales
conséquence inévitable d’une immunité absolue de juridiction : l’impossibilité pour une personne privée d’accéder à un juge pour faire entendre sa cause. Or, ce droit est très largement reconnu 67. Ainsi compte tenu de «l’importance croissante des
organisations, […] leur intervention dans des domaines variés » 68, la question de l’adéquation de cette règle avec «[ l] es exigences de justice moderne » 69 se pose, et la restriction de l’immunité de juridiction apparaît de plus en plus nécessaire. D’autres juridictions nationales ont déjà appliqué la distinction entre acte jure imperii et jure gestionis aux organisations internationales 70.
L’immunité absolue semble néanmoins pouvoir se justifier dès lors qu’il existe
une procédure interne à l’organisation ou un autre mode de règlement des différends permettant aux personnes qui s’estiment lésées de faire entendre leur cause 71. Ici, force est de constater qu’il existe une procédure interne, que les demandeurs ont pu faire entendre leur cause et que l’audit interne a constaté des manquements de
la Société financière internationale et a conduit à la mise en place d’une procédure
de contrôle. Cependant, les demandeurs n’ont pas pu obtenir une réparation pour les dommages subis et de nouveaux dommages sont apparus, malgré les mesures prises pour assurer une meilleure surveillance de la société exploitante.
2. L’équation vraiment équilibrée ?
a) Le coût ou les effets négatifs de l’assimilation : insécurité et ingérence
La ligne de défense de la SFI consiste à soutenir que la fin de l’immunité
absolue de juridiction mettrait en péril l’organisation elle-même ; l’exception de la nature commerciale l’exposerait à un nombre élevé d’actions en justice – principalement parce qu’étant une banque de développement, son activité principale
consiste à financer des opérations d’investissement et à consentir des prêts, des
activités qui semblent être par nature commerciales 72. Par voie de conséquence, ces actions judiciaires l’exposeraient à des frais de justice, auxquels viendrait s’ajouter le montant d’éventuels dommages et intérêts. Ces arguments rejoignent une partie
de la doctrine pour qui l’assimilation revient à nier la spécificité des organisations
droit et pratique des organisations internationales 251
internationales : celles-ci ne sont pas des États, elles n’ont pas de territoire et leur immunité est fonctionnelle et garantit leur indépendance. Ces différences fondamentales empêchent de les mettre sur un pied d’égalité avec les États de telle sorte que la restriction de l’immunité de juridiction, si elle est concevable, doit faire l’objet
d’une réglementation spécifique prenant en compte leurs caractéristiques et qui
permettrait de limiter les risques d’ingérence.
b) La pérennité des organisations internationales assurée par deux protections : l’existence de conditions et la conclusion d’un nouvel accord
Au contraire, la Cour soutient que l’assimilation – l’application du régime
initialement créé pour les États – offre des garanties suffisantes pour la survie
et le bon fonctionnement des organisations internationales. En effet, l’existence de conditions qui viennent encadrer les exceptions d’une part et la possibilité de
modifier la Charte constitutive de l’organisation d’autre part sont avancées comme
éléments d’équilibre.
Signature d’un nouvel accord. – S’il ne fait pas de doute que la modification
de la Charte – et l’inscription dans le texte fondateur ou la conclusion d’un nouvel instrument accordant une immunité absolue comme cela est le cas pour les Nations Unies 73 – est de nature à protéger l’organisation, l’hypothèse semble néanmoins
peu réaliste et difficile à mettre en pratique. Certes, les règles de l’IOIA et la
FSIA sont des règles par défaut si bien qu’il est loisible d’y déroger, mais tout amendement ou tout nouvel accord exigerait des renégociations entre les parties, c’est-à-dire des procédures longues, à l’issue incertaine, qui soulèveraient inévitablement
d’autres difficultés. Rappelons que les Statuts de la SFI, comme celui de
très nombreuses banques de développement, semblent poser une «présomption d’absence d’immunité » 74 et ne lui permettaient pas de bénéficier d’une immunité
de juridiction dans le cas d’espèce. En toute hypothèse, tout nouvel accord concernant l’immunité de juridiction se présenterait comme un remède a posteriori et révèlerait indubitablement que l’immunité restreinte porte atteinte à l’organisation ou à son fonctionnement.
L’encadrement de l’exception liée à la nature commerciale de l’activité. – Deuxièmement, selon la Cour, «restrictive immunity hardly means unlimited exposure to suit for international organizations » 75, principalement parce qu’il existe des conditions qui doivent être réunies 76. Cependant, l’existence de conditions ne constitue
pas à elle seule une garantie suffisante à la fois contre le risque d’insécurité juridique et contre les conséquences d’une augmentation significative du nombre de
procédures judiciaires. Tout d’abord, force est de constater que l’effet sur le volume contentieux dépend in fine des définitions des conditions et notamment de celle de l’ «activité commerciale » . Or, si la définition semble acquise pour les États, il n’est
pas certain que ce critère de distinction soit opérationnel concernant les banques de développement 77, ce critère pouvant «aboutir à accorder l’immunité en toute
252 droit et pratique des organisations internationales
hypothèse [ ou à la refuser] de manière systématique » 78. Or, la Cour explique clairement que, s’agissant des activités de prêt d’une banque de développement,
la qualification dépendra des circonstances de l’espèce, et plus précisément des
conditions d’obtention du prêt. La Cour illustre son propos en prenant l’exemple des prêts conditionnels consentis aux États qui «may not qualify as ‘ commercial’ » . L’utilisation de «may » n’est pas de nature à «rassurer » les organisations internationales et semble, au contraire, conforter leurs incertitudes. De plus, et de manière
plus inquiétante, la définition retenue pourrait exercer une influence sur la manière
dont les banques vont fonctionner, et risque précisément d’affecter les conditions d’octroi des prêts. Le risque d’une perte ou d’une diminution de l’indépendance de la SFI semble alors se dessiner. En outre, les autres conditions – l’activité en lien avec les États-Unis et le fondement de l’action – sont, elles aussi, relativement
floues et susceptibles de générer des incertitudes et de troubler la sécurité juridique.
En tout état de cause, la première conséquence sera inévitablement un déplacement du débat judiciaire : précédemment limité exclusivement à l’existence d’une immunité absolue, celui-ci portera désormais sur les conditions, à charge pour le demandeur de prouver qu’elles sont réunies en l’espèce et qu’ainsi l’organisation
ne bénéficie pas d’une immunité. Cette preuve peut être difficile à rapporter. En
effet, si la SFI prend ses décisions sur le sol américain (décision d’investissement, accord de prêt, surveillance, etc.), tant le fait générateur du dommage que les dommages se réalisent hors du territoire américain (en Inde dans le cas d’espèce). Les demandeurs devront alors établir que le «gravamen » de la plainte se situe sur le territoire américain. Force est de constater que les demandeurs n’ont pas pour l’instant réussi à rapporter cette preuve. La juridiction de renvoi a rendu sa décision
le 14 février 2020 et a conclu que la SFI bénéficie d’une immunité de juridiction,
les conditions de l’exception n’étant pas réunies 79. Il semble alors que le risque tant redouté par les organisations internationales de voir leurs responsabilités systématiquement engagées ne se soit pas produit. Les demandeurs ont annoncé leur volonté de faire appel. L’affaire reste donc pour l’instant en suspens. Quant au «boom » du nombre d’actions introduites, il semble également ne pas avoir eu lieu. Il reste que la solution de l’arrêt Jam a permis la poursuite d’affaires déjà introduites
contre la Société financière internationale, dont la très retentissante affaire Juna Doe et al. v. IFC dans laquelle la SFI est poursuivie pour complicité de violations des droits de l’homme 80. Ainsi, si des incertitudes demeurent et s’il est encore trop tôt pour dresser un bilan, il reste certain que le changement de paradigme entraîne des conséquences judiciaires pour les organisations internationales.
1. I. Pingel, «Les privilèges et immunités de l’organisation internationale » , in É. Lagrange et J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2014, p. 630. Voir également pour une présentation synthétique de la jurisprudence : C. Ryngaert, I. F. Dekker, R. A. Wess el et
J. Wouters, Judicial Decisions on the Law of International Organizations, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 380-384. 2. Cour suprême des États-Unis d’Amérique, Jam et al. v. International Finance Corp., arrêt, 27 février 2019, 586 USC _ (2019), p. 15. 3. La décision a été adoptée à sept voix pour et une contre (Juge Breyer, auteur d’une opinion dissidente), le Juge Kavanaugh n’ayant pas pris part à l’examen ou à la décision. Rappelons qu’avant sa nomination en 2018, il siégeait à la Cour d’appel pour le circuit de Columbia depuis 2006.
4. Les règles conventionnelles restent essentielles et peuvent prévoir et définir l’étendue des immunités
(H. Maigne, «Les immunités de juridiction et mécanismes d’accountability des institutions financières
internationales » , in D. Simon (dir.), Le Droit international des immunités : constantes et ruptures,
Paris, Pedone, IREDIES PARIS 1, 2015, pp. 217-242, spé. p. 221). Voir par exemple la Convention sur les immunités et les privilèges des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée générale, le 13 février 1946, entrée en vigueur le 17 septembre 1946, RTNU, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327, entrée en vigueur pour les États-Unis le 29 avril 1970). 5. S. Herz, «International Organizations in US Courts : Reconsidering the Anachronism of Absolute Immunity » , Suffolk Transnational Law Review, 2008, vol. 31, n° 3, pp. 471-532 ; G. B. Adams III, «Plain Reading, Subtle Meaning : Rethinking the IOIA and the Immunity of International Organizations » ,
Fordham Law Review, 2012-2013, vol. 81, pp. 241-282.
6. La Cour de District avait rejeté les arguments des demandeurs et conclu avec beaucoup de fermeté que «[ t] herefore, we conclude our precedent stands as an impassable barrier to appellants’s first argument » (DC, Budha Ismail Jam, et al. v. International Finance Corporation, arrêt, 23 juin 2017 (DC. 1 : 15-cv-00612),
p. 6). Dans son opinion concordante, le Juge Pillard justifiait les raisons pour lesquelles il serait peut-être
opportun de revenir sur les précédents mais précise que «because those decisions remain binding precedent in our circuit, I concur » (p. 10).
7. Site internet de la Société financière internationale, voir [ https :// www. ifc. org/ wps/ wcm/ connect/ multilingual_ ext_ content/ ifc_ external_ corporate_ site/ about-ifc-fr], consulté le 5 avril 2020. 8. Pour des précisions sur ce projet de construction d’une centrale au charbon, voir [ https :// www. ifc. org/ wps/ wcm/ connect/ region__ ext_ content/ ifc_ external_ corporate_ site/ south+ asia/ countries/ frequently+ asked+ questions], consulté le 5 avril 2020.
9. Le Compliance Advisor Ombudsman (CAO) ou le «bureau du conseiller médiateur » est une entité indépendante créée en 1998 à la suite de l’impossibilité pour les tierces-parties, populations locales,
subissant des dommages du fait des opérations financées par la SFI de déposer une réclamation. Ainsi,
«[ t] oute personne ou tout groupe de personne qui estime être affecté – ou risquer d’être affectée – par
les effets environnementaux et/ ou sociaux d’un projet d’IFC […] peut déposer une plainte auprès du
CAO [ sic] » (CAO, Directives opérationnelles, disponible sur [ http :// www. cao-ombudsman. org/ documents/
CAO_ OpGuide_ FRE_ Final. pdf], consulté le 5 avril 2020, p. 10). Néanmoins, le CAO exerçant une fonction de médiation, l’accord de toutes les parties (y compris celui du «client » de la SFI) est nécessaire. De
plus, le CAO ne se prononce pas sur le manquement du client à ses obligations au regard des Normes de performance. Dans la phase d’enquête, il se prononce sur la diligence de la SFI dans la surveillance. Voir V. N’Dior, La participation d’entités privées aux activités des institutions économiques internationales,
thèse Université Cergy-Pontoise, 2013, pp. 134-135 ; B. M. Saper, «The International Finance Corporation’s
Compliance Advisor/ Ombudsman (CAO) : an Examination of Accountability and Effectiveness from a Global Administrative Law Perspective » , International Law and Politics, 2012, vol. 44, pp. 1288-1291.
10. Les documents concernant ces plaintes sont disponibles sur le site du CAO, voir [ http :// www. cao-ombudsman. org/ cases/ case_ detail. aspx ? id= 171], consulté le 5 avril 2020.
11. Rappelons, comme le fait la Cour suprême, que la SFI inclut dans ses accords de prêt des normes de performance. Au nombre de huit, elles sont conçues «pour éviter, atténuer et gérer les risques et les impacts de manière à poursuivre leurs activités de manière durable » (pour le détail de ces normes, voir SFI, Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale, 1er janvier 2012, 64 p.,
disponible sur le site internet de la SFI [ https :// www. ifc. org/ wps/ wcm/ connect/ 2ae358ff-d348-4702-9840-1ed352b1f36f/ IFCPerformanceStandardsFrench. pdf ? MOD= AJPERES& CVID= j-BmV33], consulté le 5 avril
2020). S’agissant de notre affaire, l’accord de prêt prévoyait que Coastal Gujarat Power Limited devait respecter un plan d’action environnemental et social conçu pour protéger les zones autour de l’usine, et
que la SFI pouvait retirer son soutien financier en cas de manquement à ces engagements. 12. L’organisation internationale peut bénéficier d’une immunité en vertu d’un traité régulièrement ratifié. C’est par exemple le cas pour l’ONU. Il faudra pour que l’immunité puisse produire son effet que
le juge considère qu’il ou que la disposition en cause est self-executing, c’est-à-dire directement applicable dans l’ordre interne. Sur cette question, voir B. Taxil, «Les critères de l’applicabilité directe des traités internationaux aux États-Unis et en France » , RIDC, 2007, n° 1, pp. 157-176. Sur ce point, le Juge Breyer se montre particulièrement prudent dans son opinion dissidente et rappelle en prenant l’exemple de l’ONU que dans les cas ordinaires – c’est-à-dire si aucune loi spéciale n’est intervenue en la matière – «not even a treaty can guarantee immunity in cases arising from commercial activities » (p. 8). S’agissant de l’ONU, et depuis l’affaire Brzak v. United States (597 F 3D 107 (2d. Cir. 2010), «il a été considéré que l’ONU pouvait
revendiquer le bénéfice d’une immunité absolue prévue par le texte » (D.-S. Robin, «Les immunités des organisations internationales devant les juridictions internes aux États-Unis et en France » , in D. Simon
(dir.), op. cit., p. 169). Néanmoins dans tous les autres cas, c’est-à-dire si la charte constitutive n’est pas reconnue comme self-executing, ou si le texte conventionnel ne mentionne aucune immunité, alors le droit interne s’appliquera et l’organisation internationale si elle est reconnue par le Président des États-Unis dans un Executive order pourra bénéficier d’une immunité telle que définie par l’IOIA. 13. L’immunité est ainsi qualifiée de «fonctionnelle » . Sur ce point, voir M. Singer, «Jurisdictional Immunity of International Organizations : Human Rights and Functional Necessity Concerns » , Virginia Journal of International Law, 1995, vol. 36, pp. 53-165. L’arrêt rappelle ce point et énonce quelques privilèges reconnus dans la loi comme l’immunité de perquisition, l’exonération des impôts fonciers (Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 2).
14. 22 USC, Chapter 7, § 288a (c). L’article mentionne l’existence d’une exception et prévoit le cas où l’organisation renoncerait à son immunité en ces termes : «except to the extent that such organizations may expressly waive their immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract » . 15. Sur ces points, voir ibid., § 288a (b) et § 288c. Voir également, Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit. : «The IOIA defines certain privileges and immunities by reference
to comparable privileges and immunities enjoyed by foreign governments. For example, with respect to
customs duties and the treatment of official communications, the Act grants international organizations
the privileges and immunities that are ‘ accorded under similar circumstances to foreign governments’ » . Cette différence est d’ailleurs rappelée dans l’arrêt et n’est pas sans produire un effet sur l’interprétation de la disposition concernant l’immunité de juridiction.
16. La SFI ne pouvait prétendre bénéficier d’une immunité de juridiction ni sur le fondement de ses
Statuts ni sur celui de la Convention de 1947 (si elle était en vigueur), étant entendu que les demandeurs sont des personnes privées qui n’agissent pas pour le compte d’un État, et que la SFI possède bien un bureau (son siège en l’occurrence) aux États-Unis.
17. Statuts, modifiés le 27 juin 2012, p. 11, disponible sur le site de la Société financière internationale [ https :// www. ifc. org/ wps/ wcm/ connect/ ea84dc44-dacf-4bd3-bb95-c7cbbefadcbf/ Articles_ of_ Agreement_ French. pdf ? MOD= AJPERES& CVID= jExGnci], consulté le 5 mai 2020).
18. Convention du 21 novembre 1947 relative aux privilèges et immunités des Institutions spécialisées des Nations Unies, entrée en vigueur (objective) le 2 décembre 1948, RTNU, vol. 33, p. 261. 19. Voir le point 1 de l’annexe XIII de la Convention de 1947.
20. Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 15. 21. J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Paris, LGDJ, 2019, 13e éd., pp. 272-275. 22. Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 9. 23. La formule retenue dans le dispositif est là encore parfaitement explicite : «the Foreign Immunities Act governs the immunity of international organizations » .
24. La Cour reprend ici la définition qu’elle avait donnée dans l’affaire Republic of Argentina v. Weltover, Inc., arrêt, 12 juin 1992, 504 US 607 (1992). Rappelons que, dans cet arrêt, la Cour avait rappelé que comme le prévoit la loi, c’est davantage la nature de l’activité que le but qu’elle poursuit qui
permet de la qualifier («the issue is whether the particular actions that the foreign state performs (whatever
the motive behind them) are the type of actions by which a private party engages in ‘ trade and traffic or
commerce’ » , p. 614). Voir également l’article 28 US § 1603(d) : «A ‘ commercial activity’ means either a regular course of commercial conduct or a particular commercial transaction or act. The commercial character of an activity shall be determined by reference to the nature of the course of conduct or particular transaction or act, rather than by reference to its purpose » . 25. La Cour synthétise ici l’exception prévue à l’article 28 US § 1605 (2) qui prévoit que : «A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case […] (2) in which the action is based upon a commercial activity carried on in the United States by the foreign state ; or upon an act performed in the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere ; or upon an act outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere and that act causes a direct effect in the United States » . 26. La Cour a précisé le sens à donner à cette condition dans l’arrêt Saudi Arabia v. Nelson (arrêt, 23 mars 1993, 507 US 349 (1993) : «[ a] lthough the Act does not define ‘ based upon’ the phrase is most
naturally read to mean those elements of a claim that, if proven, would entitle a plaintiff to relief under his
theory of the case, and the statutory context confirms that the phrase requires something more than a mere
connection with, or relation to, commercial activity » . 27. Si d’autres restrictions semblent alors pouvoir s’appliquer, il ne faut pas en surestimer le nombre, d’une part parce que certaines exceptions étaient déjà applicables (comme par exemple l’hypothèse de la renonciation («waiwer » ), voir la jurisprudence Mendaro (US Cour d’appel pour le district de Columbia, arrêt, 27 septembre 1983, 717 F. 2d 610 (DC Cir 1983)) et d’autre part parce que certaines exceptions ne semblent pas pouvoir s’appliquer aux actions des organisations internationales. Sur ce point, pour une étude des autres exceptions et de leur application pour les organisations internationales, voir C. Rivière
et Th. Le Meur, «Intergovernmental Organization Immunity after JAM : A Copernican Revolution for International Cooperation » , Revue trimestrielle de Droit financier, 2019, pp. 105-107. 28. La solution et le raisonnement sont partagés par le Gouvernement des États-Unis (voir le mémoire d’amicus curiae, spé. pp. 15-16, disponible sur [ https :// earthrights. org/ wp-content/ uploads/ 20180731204649177_ 17-1011tsacUnited-States-REVISED-1. pdf], consulté le 5 avril 2020).
29. Sur ce point, la conclusion du J. Breyer est éloquente : «[ m] y decision rests primarily not upon linguistic analysis, but upon basic statutory purposes. Linguistic methods alone, however artfully employed, too often can be used to justify opposite conclusions » (Opinion dissidente, J. Breyer, précit., p. 17). 30. Ibid., pp. 1-2. 31. Opinion dissidente, J. Breyer, précit., p. 10.
32. Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 9 (le terme apparaît à plusieurs reprises). La pertinence de ce choix trouve un écho en doctrine, voir par exemple K. Whiteley, «Holding International Organizations Accountable under the Foreign Sovereign Immunities Act : Civil Actions against the United Nations for Non-Commercial Torts » , Washington University Global Studies Law Review, 2008, n° 3, pp. 627-629. 33. Opinion dissidente, J. Breyer, précit., p. 5. 34. Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 9. 35. Cela ne revient évidemment pas à dire que la loi ne peut pas évoluer, mais que l’unique possibilité
pour que la loi évolue réside dans sa modification selon les procédures en vigueur. 36. Par exemple, lors des travaux de codification des règles d’interprétation des conventions, P. Reuter
a posé la question en ces termes : «dans un traité conclu par le Royaume-Uni en 1912, il est fait mention de la mer territoriale ; cette mention est évidemment un renvoi aux règles du droit international concernant la mer territoriale. Pour interpréter ce traité en 1966, faut-il se référer à la mer territoriale telle qu’elle était
définie en 1912 ou telle qu’elle est définie en 1966 ? » (P. Reuter, in CDI, «Compte-rendu de la 871e séance du 16 juin 1966 – Droit des traités » , ACDI, 1966, I, pp. 212-218, p. 215, § 23). Pour Sørensen, il s’agit d’un problème d’interprétation (IDI, «Délibérations de l’Institut en séances plénières » , Ann. IDI, 1975, vol. 56,
pp. 339-343, p. 343), et en effet, soit les États «ont eu l’intention de renvoyer à une notion fixe, qui alors ne
peut être que celle de l’époque, mais parfois aussi elles ont eu l’intention de renvoyer à une notion variable, celle qui existe au moment de l’application » (P. Reuter, op. cit., p. 215, § 23).
37. Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 11 (souligné dans le texte). 38. Ibid.
39. Opinion dissidente, J. Breyer, précit., p. 5. 40. Ibid.
41. En ce sens, l’Institut de droit international considère que «[ l] orsqu’une disposition conventionnelle
se réfère à une notion juridique ou autre sans la définir, il convient de recourir aux méthodes habituelles
d’interprétation pour déterminer si cette notion doit être comprise dans son acception au moment de l’établissement de la disposition ou dans son acception au moment de l’application » (IDI, «Le problème intertemporel en droit international public » , Résolution, Session de Wiesbaden, 11 août 1975, Ann. IDI,
1975, vol. 56, p. 538, pt. 4). 42. Concernant les risques d’ «instrumentalisation » en cas d’interprétation évolutive : voir D. Alland,
«L’interprétation en droit international public » , RCADI, 2013, vol. 362, pp. 207-215. 43. Opinion dissidente, J. Breyer, précit., p. 11. 44. I. Pingel, op. cit., p. 630.
45. La Cour d’appel avait considéré qu’il n’était pas nécessaire en l’espèce de trancher cette «difficult
question of statutory construction » . En effet, dans les circonstances de l’affaire : «[ o] n either theory of
immunity absolute or restrictive an immunity exists sufficient to shield the organization from lawsuit on
the basis of acts involved » (DC, Marvin R. Broadbent v. Organization of American States, arrêt, 8 janvier 1980, 628 F 2D 27 (DC Cir. 1997)). 46. DC, Zuza v. Office of the High Representative, arrêt, 4 juin 2015, 107 F. Supp. 3d 90 (DC Cir. 2015) : «The IOIA, however, provides for near ‘ absolute’ immunity, at least under the DC Circuit’s decision in Atkinson v. Inter-American Development Bank » . 47. DC, Janet E. Atkinson v. The Inter-American Development Bank, arrêt, 9 octobre 1998, 156 F. 3d 1335 (DC Cir. 1998). 48. DC, Budha Ismail Jam, et al. v. International Finance Corporation, précit., p. 6 (souligné dans le texte). 49. Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 12. 50. DC, Janet E. Atkinson v. The Inter-American Development Bank, précit. : «before resorting to this or any other canon, however, we must search for indications of legislative intent » . La suite des développements est particulièrement intéressante sur l’utilisation des canons. 51. Ibid. : «the IOIA sets forth an explicit mechanism for monitoring the immunities of designated international organizations : the President retains authority to modify, condition, limit, and even revoke the otherwise absolute immunity of a designated organization. […] It seems, therefore, that Congress was content to delegate to the President the responsibility for updating the immunities of international organizations in the face of changing circumstances » . 52. La Cour suprême s’étonne ainsi du fait que la Cour de District ne se soit pas appuyée sur l’avis du Département d’État qui considérait que l’immunité des organisations et celle des États étaient liées, ce qui
pour la Cour confirme sa solution (Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 12).
53. Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 12. 54. D.-S. Robi n, op. cit., p. 170 : «les juges ont pour habitude d’interpréter strictement l’IOIA de telle sorte qu’il en a quasiment toujours découlé une immunité absolue » . 55. Opinion dissidente, J. Breyer, précit., p. 16. 56. Ibid.
57. En effet, selon le J. Breyer, le pouvoir de l’exécutif est de «tailor immunity » (ibid.). L’article 22 USC
§ 288 est rédigé très largement et n’encadre pas spécifiquement cette prérogative. Il est prévu que : «[ t] he President shall be authorized, in the light of the functions performed by any such international organization,
by appropriate Executive order to withhold or withdraw from any such organization or its officers or employees
any of the privileges, exemptions, and immunities […] or to condition or limit the enjoyment by any such
organization or its officers or employees of any such privilege, exemption, or immunity » . De la même façon, le retrait d’une organisation internationale de la liste des organisations reconnues, condition d’application de l’IOIA, est possible en cas d’abus apprécié librement («if in his judgment » ) ou «or for any other reason » . 58. Voir infra, II, B, 2, b), les développements concernant l’encadrement de l’exception liée à la nature commerciale de l’activité. 59. Sur cette question, voir les développements dans le mémoire d’amicus curiae soumis par plusieurs professeurs de droit international qui insistent sur l’absence de logique d’une telle asymétrie (disponible
sur [ https :// earthrights. org/ wp-content/ uploads/ Amici-Professors-of-International-Law. pdf], consulté le
5 avril 2020, p. 29.
60. Ce risque est également souligné par d’autres auteurs. Voir par exemple H. Ascensi o, «Le règlement des différends liés à la violation par les organisations internationales des normes relatives aux droits de l’homme » , in SFDI, La soumission des organisations internationales aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, Paris, Pedone, 2009, p. 108 : «[ l] e risque est alors que les États choisissent
d’agir par l’intermédiaire des organisations internationales afin de bénéficier de ces angles morts » . Voir
également I. Pingel, op. cit., p. 630. 61. L’auteur parle de «perverse incentives for member countries to try to use [ international organizations] to circumvent their own international law » (S. Herz, op. cit., p. 522). 62. OSS Nokalva, Inc. v. European Space Agency, arrêt, 617 F 3d 756 (3d Cir. 2010). Selon la Cour,
tout maintien de l’immunité absolue aboutirait à un résultat qualifié d’ «anormal » dans la mesure où «if a foreign government, such as Germany, had contracted with OSSN, it would not be immune from suit » . 63. Ibid.
64. I. Pingel, op. cit., p. 627. Sur cette problématique, voir A. Lagerwall et L. Weyers, «Le droit d’accès à un juge contre les immunités des États et des organisations internationales : une argumentation aux effets inexorablement limités » , Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2018, pp. 51-80. 65. Pour une analyse de l’arrêt de la Cour suprême au regard de cette problématique et de la jurisprudence de la Cour européenne, voir C. Rivière et Th. Le Meur, op. cit., p. 109. 66. J.-F. Flauss, «Immunités des organisations internationales et droit international des droits de l’homme » , in SFDI, op. cit., p. 73.
68. H. Maigne, op. cit., p. 219. 69. E. Gaillard et I. Pingel-Lenuzza, «L’immunité de juridiction des organisations internationales : restreindre ou contourner » , in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20e siècle : à
propos de 30 ans de recherche du CREDIMI – Mélanges Ph. Kahn, Paris, Litec, 2000, p. 205. 70. Pour une présentation de cette jurisprudence, voir É. Robert, «The Jurisdictional Immunities
of International Organizations : the Balance between the Protection of the Organizations Interest and
Individuals Rights » , Mélanges offerts à Jean Salmon – Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 1445. L’auteur fait référence aux arrêts rendus par la Cour de cassation italienne et à ceux de la Cour européenne des droits de l’homme. 71. Pour une analyse, voir A. Reinis ch et A. Weber, «In the Shadow of Waite and Kennedy. The Jurisdictional
Immunity of International Organizations, the Individual’s Rights of Access to the Courts and Administrative Tribunals as an Alternative Means of Dispute » , International Organizations Law Review, 2004, pp. 66-109. Rappelons que l’organisation peut toujours renoncer à son immunité mais les cas restent rares. 72. De prime abord, l’argument de la «mise en péril » soulevé par la SFI peut surprendre. En effet, si une telle immunité était indispensable à ses fonctions, il semble raisonnable de penser qu’elle aurait été prévue et inscrite dans les Statuts. Or, ceux-ci prévoient précisément le contraire : la SFI peut être attraite devant tout tribunal d’un État sur le territoire duquel elle possède un bureau, où elle a nommé
un agent de recevoir des significations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Cette disposition a été interprétée comme une «présomption d’absence d’immunité » justifiée par la
nature de ses activités et son mode de fonctionnement. En effet, les banques de développement sont aussi des «emprunteurs » , qui «obtiennent une grande partie de leurs ressources sur les marchés de capitaux internationaux » (H. Maigne, op. cit., p. 221). Dès lors, et afin d’assurer la confiance des prêteurs, ceux-ci
doivent pouvoir agir en justice contre la SFI. Néanmoins, cette hypothèse d’une action en justice initiée par des prêteurs est différente d’une action en responsabilité engagée par des tiers (du fait des conséquences
dommageables des projets financés par la SFI).
73. Convention sur les immunités et les privilèges des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée générale, le 13 février 1946, entrée en vigueur le 17 septembre 1946, RTNU, vol. 1, p. 15 et vol. 90, p. 327, spé. section 2. 74. H. Maigne, op. cit., p. 221. 75. Cour suprême, Jam et al. v. International Finance Corp., précit., p. 15. 76. Ibid. : «And even if an international development bank’s lending activity does qualify as commercial, that does not mean the organization is automatically subject to suit. The FSIA includes other requirements that must also be met » . 77. Pour une analyse de l’inadaptation de la distinction entre les actes souverains et les activités commerciales, voir le rapport d’amicus curiae déposé par la BIRD, disponible sur [ https :// earthrights. org/ wp-content/ uploads/ 17-1011bsacInternationalBankFor-ReconstructionAndDevelopmentEtAl.. pdf-A-1. pdf],
consulté le 5 avril 2020, p. 21.
78. I. Pingel, op. cit., p. 635. 79. L’essentiel des débats concernait la condition du lien avec les États-Unis. La juridiction ne s’est pas prononcée sur le sens à donner aux autres conditions, notamment sur la nature commerciale de l’activité. Tribunal fédéral pour le District de Columbia, arrêt, 14 février 2020, action n° 2015-0612 (DDC 2020), disponible sur [ https :// earthrights. org/ wp-content/ uploads/ Jam-Opinion-granting-2019-MTD. pdf# page= 23],
consulté le 5 avril, pp. 22-23 : «Plaintiffs’ suit is based upon IFC’s failure to ensure that the plant was designed, constructed, and operated with due care so as not to harm plaintiffs’ property, health, and way of life. That is the gravamen of the complaint. And plaintiffs have not established that such conduct was carried on in the United States ; instead, it was focused in India, where the plant is and the harms occurred. […] this Court concludes that plaintiffs’ lawsuit does not fall within the FSIA’s commercial activity exception because the suit is not, at its core, based upon activity – commercial or otherwise – carried on or performed in the United States. Accordingly, IFC is immune from suit » .
80. Pour des informations sur cette affaire, voir [ https :// earthrights. org/ case/ juana-doe-et-al-vifc/# media]. Précisons que c’est la même ONG qui apporte son soutien aux communautés locales honduriennes
et indiennes.

Consulter le journal
Les actions et les limites de la justice pénale internationale
Radio Cinq documentaires sur les difficultés de juger les crimes de guerre
Par Martine Delahaye
Temps de Lecture 2 min.
- Ajouter à vos sélections Ajouter à vos sélections
- Partager sur Twitter
- Partager sur Messenger
- Partager sur Facebook
- Envoyer par e-mail
- Partager sur Linkedin
- Copier le lien
Dans le contexte de l'après-guerre froide, en 1993, et en pleine guerre en ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) décide de créer un Tribunal pénal international (TPI). Reprenant un concept concrétisé à Nuremberg en 1945, et s'appuyant sur l'idée de "droit d'ingérence" théorisée à la fin des années 1980 par le juriste Mario Bettati et Bernard Kouchner, les Nations unies font ainsi savoir qu'elles entendent pouvoir juger les responsables de crimes de grande ampleur, y compris des chefs d'Etat.
Près de quinze ans plus tard, qu'en est-il ? C'est à cette question que se sont attelés Benjamin Bibas et Emmanuel Chicon, producteurs des cinq documentaires que comporte leur enquête, intitulée "A qui profite le crime de guerre ? Un bilan provisoire de la justice pénale internationale" , et réalisée par Yvon Croizier.
Bien que freinée par le manque évident de bonne volonté de nombre d'Etats, et confrontée à des obstacles différents selon les responsables incriminés, la justice pénale internationale a évolué, au fil des années et des critiques qui lui étaient adressées.
Les trois premiers volets d' "A qui profite le crime de guerre ?" portent sur les actions engagées par des juridictions à caractère international mais limitées dans le temps, tels le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone.
Juristes, responsables politiques, victimes et même ancien criminel de guerre interrogés permettent de mesurer la difficulté qu'ont ces tribunaux à remplir une de leurs missions statutaires : réconcilier les sociétés qui furent déchirées par un conflit. Les jugements des tribunaux internationaux donnent-ils le sentiment qu'une certaine forme de justice existe ? Un bilan ne pourra pas être fait avant longtemps.
Une étape est franchie en 1998, avec la création de la Cour pénale internationale (CPI) : non plus un tribunal ad hoc, lié à un conflit donné, mais une juridiction permanente, pour juger des responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide dans la mesure où un pays ne peut pas ou ne veut pas rendre justice lui-même. Le cinquième volet de la série revient sur les premiers pas de la CPI, sans cacher l'instrumentalisation qui peut en être faite.
Le documentaire le plus passionnant, jeudi 22 novembre, tient à la nature des pouvoirs extra-ordinaires dont la Belgique s'est dotée en 1996 : la "compétence universelle", qui permet à un résident de porter plainte contre tout individu pour violation grave des droits de l'homme, et ce quels que soient la nationalité du plaignant, de la personne mise en cause et le lieu où les crimes ont été commis. Une première dans l'histoire du droit international, puisque, en l'occurrence, ce sont les victimes qui, directement, peuvent déposer plainte.
Exemplaire des pressions politiques auxquelles se heurtent les plaignants, ce volet s'attache au dossier exceptionnel d'Hissène Habré, ancien dictateur tchadien, très encombrant pour l'Afrique.
"A qui profite le crime de guerre ? Un bilan provisoire de la justice pénale internationale", du lundi 19 au vendredi 23 novembre à 16 heures sur France Culture et sur www.franceculture.com
Martine Delahaye
Voir les contributions
Le Monde Boutique

Mai 68 : Cabu lance le grand Duduche
Le parcours de son alter ego

Franz Kafka
L’insaisissable

Le Chat du Rabbin vu par Joann Sfar
Un hymne à la tolérance

Le fascinant nombre Pi
Vivante énigme mathématique

Des débarquements à la libération de la France

Mots croisés n° 9
Cruciverbistes, à vos crayons !

Toutânkhamon
Les secrets du pharaon

Pour se tenir informé des nouveautés de la boutique du Monde
Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.
Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois
Ce message s’affichera sur l’autre appareil.
Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.
Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).
Comment ne plus voir ce message ?
En cliquant sur « Continuer à lire ici » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.
Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?
Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.
Y a-t-il d’autres limites ?
Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.
Vous ignorez qui est l’autre personne ?
Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe .
Lecture restreinte
Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article
Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.
Les Clionautes
- La Cliothèque
- Clio Prépas
- Clio Collège
- Accès Adhérent

- Programmation
- Thème 1 : Le monde méditerranéen : empreintes de l’Antiquité et du Moyen Âge
- Thème 2 : XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle
- Thème 3 : L’État à l’époque moderne : France et Angleterre
- Thème 4 : Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles
- Thème 1 : Sociétés et environnements : des équilibres fragiles
- Thème 2 : Territoires, populations et développement : quels défis ?
- Thème 3 : Des mobilités généralisées
- Thème 4 : L’Afrique australe : un espace en profonde mutation
- Les réseaux sociaux
- Les données structurées et leur traitement
- Localisation, cartographie et mobilité
- Informatique embarquée et objets connectés
- La photographie numérique
- Abibac/Euro allemand
- Euro anglais
- Esabac/Euro italien
- Bachibac/Euro espagnol
- Euro portugais
- Thème 1 : L’Europe face aux révolutions
- Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871)
- Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens
- Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial
- Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié
- Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production
- Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?
- Thème 4 conclusif : La Chine : des recompositions spatiales multiples
- Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution française (1789-1815)
- Thème 2 : Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870
- Thème 3 : La Troisième République : un régime, un empire colonial
- Thème 4 : La Première Guerre mondiale et la fin des empires européens
- Thème 3 : Les espaces ruraux : une multifonctionnalité toujours plus marquée
- Introduction
- Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie
- Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales
- Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
- Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication
- Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions
- Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale
- Thème 2 – La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des années 1970)
- Thème 3 – Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991
- Thème 4 – Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits
- Thème 1 – Mers et océans : au coeur de la mondialisation
- Thème 2 – Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation
- Thème 3 – L’Union européenne dans la mondialisation : des dynamiques complexes
- Thème conclusif – La France et ses régions dans l’Union européenne et dans la mondialisation : lignes de force et recompositions
- Thème 1 – Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale
- Thème 2 – Du monde bipolaire au monde multipolaire
- Thème 3 – La France de 1945 à nos jours:une démocratie
- T1- Mers et océans
- T2- Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation
- T3- La France et ses régions
- T1 – De nouveaux espaces de conquêtes
- T2 – Faire la guerre, faire la paix.
- T3 – Histoire et mémoires
- T4 – Le patrimoine
- T5 – L’environnement
- T6 – L’enjeu de la connaissance
- Droits et enjeux du monde contemporain
- Contrôle continu
- Épreuves de Spécialité
- Enseigner en langue étrangère
Sélectionner une page
Clio Lycée > Annales HGGSP – Histoire et mémoires
Annales HGGSP – Histoire et mémoires
- Histoire et mémoires
Deborah Caquet | Mar 21, 2023 | Épreuves de Spécialité , Thème 3 – Histoire et mémoires | 0 |
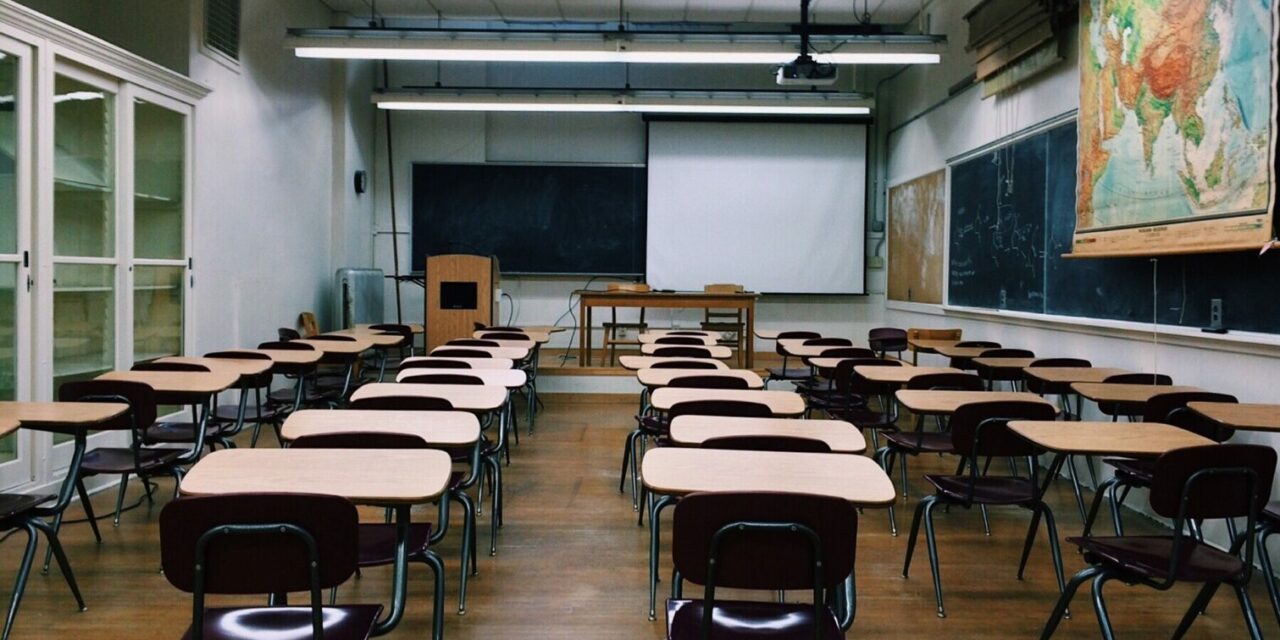
Quand on veut bien préparer ses élèves, rien de tel que de reprendre les sujets de l’examen. Vous trouverez ici les annales des années précédentes, classées par thème.
Dissertations sur Histoire et mémoires
- Juger les génocides et les crimes de masse, une justice uniquement internationale ? Amérique du Nord, jour 1 (2022).
- Histoire et mémoires, quels débats ? Asie, jour 2 (2022).
- Réparer les sociétés après un génocide : moyens et enjeux. Centres étrangers, Afrique, jour 1 (2022).
- Reconnaître la mémoire du génocide des Juifs et des Tsiganes, moyens et acteurs. Mayotte-Liban, jour 1 (2022).
- Juger les crimes de masse et les génocides après 1946. Mayotte-Liban, jour 2 (2022).
- Juger les génocides et les crimes contre l’humanité, quels objectifs ? Nouvelle-Calédonie, jour 1 (2022).
- Juger les génocides et les crimes de masse depuis 1945. Polynésie, jour 2 (2022) .
- L’État, seul acteur de la construction des mémoires ? Métropole, sujet de remplacement, jour 1 (2022).
- Expliquez la citation de l’historien Pierre Nora : « Si la mémoire divise, l’Histoire réunit ». Métropole, sujet de remplacement, jour 2 (2022).
Études critiques de document sur Histoire et mémoires
Amérique du nord, jour 2 (2022).
La justice à l’échelle locale : les tribunaux gacaca face au génocide des Tutsis. En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, vous montrerez les particularités et les limites de la justice à l’échelle locale exercée dans le cadre des tribunaux gacaca au Rwanda.
Document 1 :
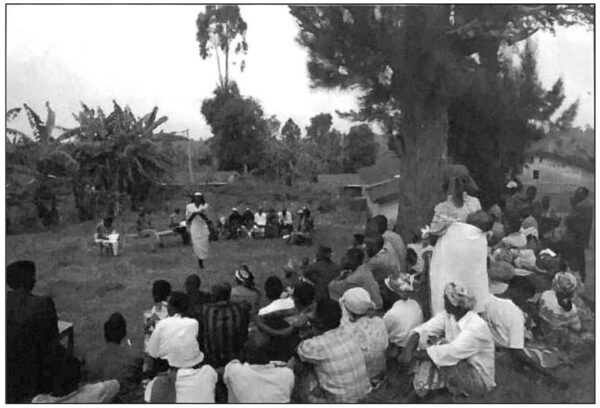
Document 2 :
Le processus gacaca a-t-il atteint ses objectifs déclarés ? A-t-il révélé la vérité sur ce qui s’est passé pendant le génocide, accéléré les procès, éradiqué la culture de l’impunité, réconcilié les Rwandais, et prouvé que le Rwanda a la capacité de régler ses propres problèmes ? […] Sur une période de cinq ans, Human Rights Watch* a interrogé un large éventail de personnes impliquées dans le processus gacaca, notamment des victimes, des rescapés du génocide, des criminels, des témoins, d’autres membres de la communauté, des juges, des autorités gouvernementales locales et nationales, et des organisations non gouvernementales. Ces rwandais ont expliqué à Human Rights Watch comment ils percevaient le système gacaca et son rôle dans les répercussions du génocide. Bien que leur point de vue ait été spécifiquement lié aux procès gacaca, certaines de leurs préoccupations auraient pu s’avérer tout aussi pertinentes pour les tribunaux classiques. […] Certains ont estimé que les aveux étaient incomplets ou manquaient de précision, souvent parce que les aveux étaient principalement destinés à obtenir la sortie de prison. Certains rescapés du génocide ont expliqué qu’ils se sentaient forcés de pardonner publiquement à ceux qui leur avaient fait du tort, même si dans leur cœur, ils ne leur avaient pas pardonné. Ainsi que l’a dit une femme : « Il s’agit de réconciliation imposée par le gouvernement. Le gouvernement a forcé les gens à demander et donner le pardon. Personne ne le fait volontairement… Le gouvernement a gracié les tueurs, pas nous. » . D’autres ont parlé de « l’insistance » du gouvernement sur la réconciliation, mais ont rappelé à quel point les situations économiques des rescapés du génocide sont demeurées terribles. Un certain nombre de rescapés du génocide ont exprimé leur amertume quant à l’incapacité du gouvernement à leur donner une aide financière et à assurer leur sécurité. Selon de nombreux rescapés du génocide, la réconciliation est demeurée précaire. Nombre d’entre eux ont évoqué la nécessité de vivre en paix et de coexister avec leurs voisins hutus, mais la plupart ont admis qu’ils voyaient encore les gens à travers le prisme du « hutu » et « tutsi ». Source : extrait du rapport de l’ONG Human Rights Watch , « Justice compromise. L’héritage des tribunaux communautaires gacaca du Rwanda », mai 2011. * Organisation non gouvernementale qui œuvre pour la défense des droits de l’Homme.
Amérique du Sud, jour 2 (2022)
Mémoires et histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie. En analysant le document et en vous appuyant sur vos connaissances, vous mettrez en évidence les différences entre les approches mémorielles et historiques de la guerre d’Algérie.
Contrairement à ce que l’on entend souvent, la guerre d’Algérie n’a jamais été totalement occultée […]. Très tôt, plusieurs films ont été projetés. […] En 1977, Laurent Heynemann, soutenu par Bertrand Tavernier, adapte le livre d’Henri Alleg La Question , qui dénonce les tortures qu’il a subies ; le film est présenté sur Antenne 2 par Michel Drucker aux Rendez-vous du dimanche , émission de grande écoute – l’animateur invite les téléspectateurs à voir le film lors d’une séquence relativement longue de huit minutes. Cependant, les décennies 1970 et 1980 furent fort tranquilles, à peine troublées par la grève de la faim de harkis en novembre 1974. Sans aucune difficulté, la guerre d’Algérie est mise au programme des classes de Terminales en 1983. Je me permets un souvenir personnel : l’Association des professeurs d’histoire-géographie avait organisé à Marseille, en octobre 1983, dans le cadre des premières Journées de l’histoire-géographie, un atelier sur le thème : « Peut-on enseigner la guerre d’Algérie ? », […] tout se passa dans la sérénité et le calme le plus absolu. […] Notons cependant qu’officiellement le terme de « guerre » n’était toujours pas employé ! Cette mémoire tiède se réchauffe dans les années 1990 avec la création de l’association Au nom de la mémoire visant notamment à recueillir des témoignages sur la répression de la manifestation du FLN (Front de libération nationale) du 17 octobre 1961. [En 1991] Benjamin Stora analyse, dans La Gangrène et l’Oubli , « l’ensemble subtil de mensonges et de refoulement » qui a fait de la guerre d’Algérie un nouveau passé qui ne passe pas. Il prolonge sa réflexion par le film qu’il réalise la même année avec Philippe Alfonsi, Les Années algériennes , entièrement fondé sur les mémoires, y compris celle de sa mère qui revient en Algérie vingt-huit ans après et se rend sur les tombes de son père et de son grand-père. Des mémoires, souvent antagonistes, se retrouvent parfois autour de la culture du Sud. À travers la mise en images de ces mémoires dévoilées, Stora espère guérir la société française du poids de ce passé non reconnu. L’année suivante, Bertrand Tavernier et Patrick Rotman font l’histoire de cette guerre uniquement à partir du témoignage d’appelés ou de rappelés, en utilisant même leurs photos. Beaucoup précisent qu’ils n’ont jamais voulu en parler jusque-là ; tous sont revenus meurtris. Le procès de Maurice Papon, en 1998, sur son rôle dans la déportation des Juifs à Bordeaux, renvoie à son attitude de préfet de police en octobre 1961. La notion de massacre fut alors reconnue par la justice pour qualifier le 17 octobre. En 1999, le Parlement décide de remplacer l’expression « opérations de maintien de l’ordre en Afrique du Nord » par celle de « guerre d’Algérie ». Cependant, la tension remonte avec les violentes polémiques autour de la torture en 2000 et 2001, à partir de la confirmation tranquille du fait par l’un des principaux acteurs, le général Aussaresses, dans la presse, à la télévision et finalement dans un livre. Ce que certains s’obstinent malgré tout à nier. Début décembre 2007, Nicolas Sarkozy effectue un voyage en Algérie ; Libération 5 décembre titre « France-Algérie, la guerre des mémoires » et signale : « Selon Bernard Kouchner, Nicolas Sarkozy et son homologue Abdelaziz Bouteflika ont eu « un début de dialogue fort, nécessaire, mais très douloureux » sur les questions de mémoire ». […] Juste après sa désignation comme candidat à la présidence de la République, François Hollande participe à la commémoration du 17 octobre. Il reconnaîtra, le 17 octobre 2012, la responsabilité de la République dans la sanglante répression par un communiqué très court, non sans susciter encore des réactions hostiles. Source : Philippe Joutard, Histoire et mémoires, conflits et alliances , Paris, La Découverte, 2013
Centres étrangers, Afrique, jour 2 (2022)
Juger les génocides. En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, répondez à la question suivante : comment la justice peut-elle contribuer à la compréhension de l’histoire et à l’apaisement des mémoires ?
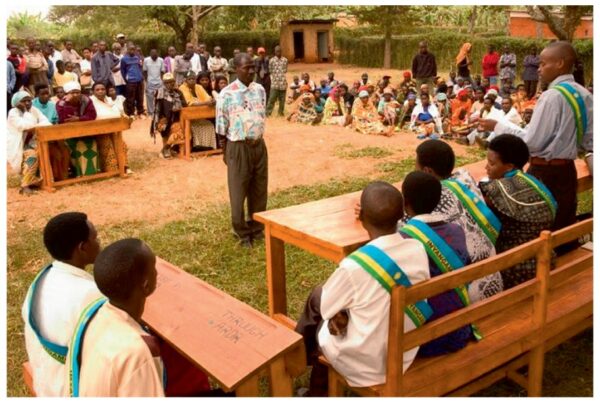
Simone Veil. – Pour ma part, le sort de Barbie*, cela ne m’intéresse pas. Beaucoup se sont réjouis de son procès simplement pour qu’il paie ses fautes. Or, je ne crois pas qu’un procès soit la réponse adéquate, car la peine encourue, au maximum la prison à vie, est sans commune mesure avec les atrocités commises. Ce que j’avais prévu, il y a trois ans, dans vos colonnes, est en train de se vérifier. Dès l’arrivée de Barbie en France, le procès a reposé sur une ambiguïté fondamentale qui ne pouvait entraîner qu’une grande confusion et conduire à des débats de procédure propres à nuire à la connaissance de l’Histoire. Pour certains, le procès de Barbie, c’était celui de l’un des responsables de l’extermination des juifs. Pour d’autres, et cela se comprend, c’était le procès de l’assassin de Jean Moulin. Pendant trois ans, l’instruction ne s’est intéressée qu’au premier aspect. La décision récente** de la Cour de Cassation élargit considérablement le procès en faisant entrer l’action de Barbie contre les résistants dans la catégorie des crimes contre l’humanité. Nouvel Observateur – Et c’est cet arrêt de la Cour de Cassation qui vous choque ? S.V. – Oui. C’est une affaire grave et lourde de conséquence, même sur le plan international. C’est cela, la banalisation de l’aspect spécifique des horreurs de l’idéologie nazie. Des atrocités, hélas ! il y en a toujours eu au cours des guerres, des révolutions et des occupations, hier comme aujourd’hui. Je ne pense pas que ce soit à cela que le concept de « crime contre l’humanité » ait fait référence, car il y a une différence de nature entre le crime de guerre et les crimes contre l’humanité. Le vrai problème de cette affaire, c’est de savoir si le procès aura été un atout dans la lutte contre l’idéologie nazie. Eh bien, le résultat est catastrophique. Il est clair qu’il n’aboutit qu’à une banalisation de l’idéologie nazie qui avait, on l’oublie trop, une spécificité : la volonté délibérée d’exterminer deux catégories de population, les tziganes et les juifs, volonté mise en œuvre de façon systématique, quasi scientifique. Le procès Barbie était raté d’avance, puisqu’il devait créer les difficultés de procédure que souligne maintenant l’arrêt de la Cour de Cassation. […] N.O. – Voulez-vous dire qu’il n’y a pas besoin de procès ? S.V. – Ce que je veux dire, c’est que contrairement au procès d’Eichmann, maître d’œuvre de l’extermination, le procès de Barbie – qui, en ce domaine, fut un exécutant parmi d’autres – n’avait pas de sens. Le vrai procès qui pourrait éclairer l’histoire, ce serait, sans doute, celui de l’assassin d’un criminel de guerre qui assumerait et expliquerait son geste. En ce cas, la défense, au lieu d’obscurcir le débat comme elle le fait dans le procès Barbie en récusant les témoins ou en niant les faits, ferait elle-même le procès du nazisme. Alors la vérité gagnerait… Si je soutiens ce paradoxe, ce n’est pas pour le souhaiter mais pour démontrer l’absurdité du procès actuel, conduit comme il l’a été. Le résultat, aujourd’hui, c’est que l’on va pouvoir assimiler toutes les exactions des guerres et des répressions aux génocides commis par les nazis, ou par d’autres. Je pense notamment à celui commis contre les Arméniens ou contre le peuple cambodgien. * Klaus Barbie était le chef de la Gestapo de Lyon entre 1943 et 1944. ** La décision récente : décision de la cour de cassation qui le 20 décembre 1985 étend la notion de crime contre l’humanité, réservée initialement aux seules victimes juives, aux déportations de résistants. Source : interview de Simone Veil à propos du procès Barbie, publiée le 10 janvier 1986 dans Le Nouvel Observateur
Nouvelle-Calédonie, jour 2 (2022)
Juger les crimes de masse. En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, expliquez la création des tribunaux spécifiques pour juger les crimes de masse.
« L’accent mis sur le volet judiciaire de la réconciliation nationale au Rwanda après le génocide ressort d’un double impératif, à la fois juridique et historique. En effet, la nature même du crime commande une réponse de type judiciaire dont témoigne, à l’échelle internationale, la mise en place du TPIR en novembre 1994. Ce dernier est chargé de poursuivre et juger les principaux instigateurs du génocide et c’est pourquoi son activité demeure marginale au regard de la masse des exécutants impliqués dans le génocide. Son impact sur la réconciliation nationale est également sujet à caution dans la mesure où son travail est peu connu au Rwanda. Le travail du TPIR, dont les compétences sont réduites à la poursuite et au jugement des grands responsables politiques, militaires ou médiatiques, interfère peu sur les activités des tribunaux gacaca. Enfin, le TPIR voit son intérêt décroître à mesure que le terme de son mandat approche à la fin de cette année. D’autre part, l’une des justifications qui préside à la mise en place des juridictions gacaca réside dans la volonté affichée d’éradiquer la « culture de l’impunité ». La loi du 20 mai 1963 est éclairante de ce point de vue. Elle octroie l’amnistie à tous les auteurs des crimes commis en 1959 et présente les massacres commis contre les Tutsi comme un événement fondamental dans la lutte pour l’indépendance du pays. Il s’agit ici de l’acte fondateur d’une « culture de l’impunité » nourrie dès l’indépendance et qui perdure jusqu’au génocide de 1994, sous des formes plus ou moins atténuées. Ainsi, la mise en place des juridictions gacaca vient rompre avec des pratiques tendant à légitimer les massacres. C’est d’ailleurs un leitmotiv qui ressort de propos tenus tant par les prisonniers, les rescapés ou encore les juges de gacaca. Un détenu de la prison centrale de Kigali interrogé en 2004 rend compte de la banalisation des crimes commis contre les Tutsi : « Nous avons confiance en gacaca. Le bas peuple a été manipulé, c’était une coutume de faire des tueries, on ne comptait pas à ce qu’il y aurait des poursuites. » Autre écho, venu lui d’un procès : un juge interpelle un accusé : « Tu n’avais pas d’appréhension, tu ne savais pas qu’il arriverait ce moment où tu te tiendrais debout ici devant nous, et tu ne pouvais pas savoir non plus qu’il arriverait ce moment où tu serais amené à être questionné ». La lutte contre l’impunité informe ainsi en partie la dimension punitive des juridictions gacaca. » Source : Dumas Hélène, « Histoire, justice et réconciliation : les juridictions gacaca au Rwanda », Mouvements, 2008/1 (n° 53) , p. 110-117.
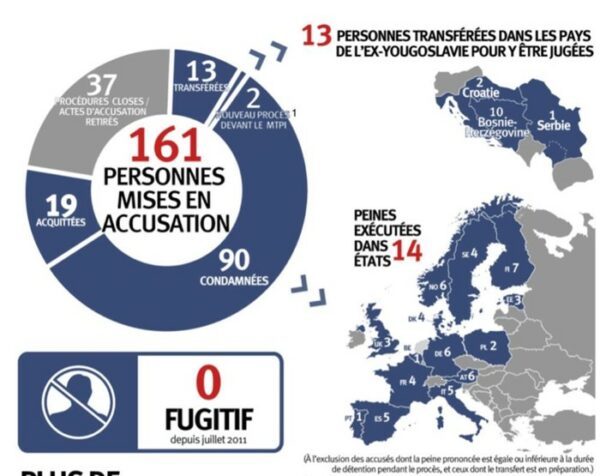
Les conventions de Genève sont des traités internationaux qui définissent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés (protection des civils, des blessés et des membres de l’aide humanitaire).
Source : Site internet du tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (consulté en novembre 2021)
Articles Similaires

Annales du Bac HGGSP – Environnement
20 Mar 2023

HGGSP Épreuves – Sujets Baccalauréat 2021 –
30 Jan 2021

La bataille d’Iwo Jima

Joséphine Baker
30 Nov 2021
Laisser une réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
COMMENTAIRE
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
CONFÉRENCE VIRTUELLE
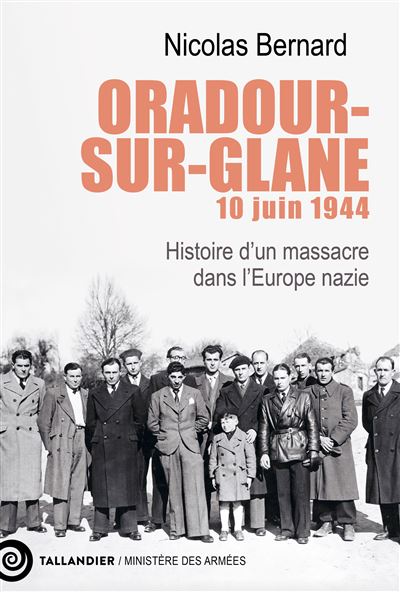
Oradour-sur-Glane Nicolas BERNARD
Mardi 11 juin 2024 de 18h30 à 20h00 Limite des inscriptions le 10 Juin 20H00
S’inscrire
ANNALES HGGSP

- De nouveaux espaces de conquête
- Faire la guerre, faire la paix
- Le patrimoine
- Environnement
- La connaissance
Vos contacts

Dernières séquences

La Galaxie des Clionautes
- Qui sommes-nous ?
- Comment adhérer ?
- Histoire de l'association
- Les statuts de l'association
- Le Contrat d'Engagement Républicain
- Mentions Légales
- Politique de confidentialité
- Cookies et consentement
- Accès rédacteur
La galaxie Clionautes
Communiquer
Votre nom (obligatoire)
Votre adresse de messagerie (obligatoire)
Votre message
J'ai pris connaissance et j'accepte les mentions légales et la politique de confidentialité .
- Les Clionautes | Google Actualités
- Le Groupe | Facebook
- Les Clionautes | Linkedin
- Les Clionautes | Twitter
- La Cliothèque | Twitter
- Les Clionautes | Youtube
Clio Boutique
- Cotisations
La naissance de la justice internationale : de Nuremberg à La Haye
Copyright de l'image décorative: © AFP

Niveaux et disciplines
À l'occasion du 75e anniversaire de la clôture du procès de Nuremberg, voici un tour d'horizon des grandes étapes qui ont jalonné la construction de la justice internationale.
Présentation
Il y a 75 ans, les 30 septembre et 1er octobre 1946, au procès de Nuremberg, il est fait lecture du verdict aux 24 accusés. Parmi ces hommes - parmi les plus hauts dignitaires du IIIe Reich -, 12 sont condamnés à mort, 7 sont condamnés à des peines de prison, 3 sont acquittés. Le procès de Nuremberg se termine là, presque un an après son ouverture.
Nuremberg reste dans les esprits comme le procès où est appliquée pour la première fois la notion de « crime contre l'humanité ». C’est aussi une étape fondamentale dans la construction d’une justice internationale après-guerre. Aujourd’hui, celle-ci s’incarne dans des juridictions permanentes, avec la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas.
Voici les principales étapes qui, de Nuremberg à La Haye, ont jalonné la construction de la justice internationale.
Chaque partie est illustrée par des vidéos, transcrites et contextualisées par un enseignant d’histoire (onglets contexte » et « transcription », à droite de la visionneuse). Vous retrouverez également, en lien avec certaines parties, des propositions de pistes pédagogiques.
1. L’inauguration du droit pénal international
8 août 1945 : institution du tribunal militaire international de nuremberg par l’accord de londres.
À la fin de la guerre, après la découverte des atrocités commises par les nazis dans les camps, l’accord de Londres, signé le 8 août 1945 par les États-Unis, l’URSS, le Royaume-Uni et la France, décide de mettre en place un Tribunal militaire international afin de traduire en justice les grands criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise .
Le procès a lieu en Bavière, à Nuremberg. Cette ville, où se tenaient les gigantesques rassemblements du parti nazi, conserve malgré les bombardements plusieurs bâtiments capables d’accueillir le tribunal et de loger toutes les personnes liées au procès, pendant plus de 10 mois, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946.
À Nuremberg, les accusés sont jugés selon 4 chefs d’accusation : complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l’humanité. Cette dernière notion, appliquée pour la première fois, forme une nouvelle catégorie juridique internationale qui couvre l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre.
Durée de la vidéo: 02:46
Date de la vidéo: 1945 Collection: - Les Actualités françaises
Ouverture du procès de Nuremberg
Première séance du procès de Nuremberg contre les grands criminels de guerre nazis. Après la lecture de l'acte d'accusation, se tient la première audience des accusés. 400 journalistes venus du monde entier assistent à ces débats.
Nuremberg est un procès international : la procédure suivie est de tradition anglo-saxonne, les quatre juges sont issus des quatre nations signataires de l’accord de Londres, les débats sont traduits simultanément dans les quatre langues du procès : anglais, français, allemand et russe.
Le 21 novembre, les accusés doivent décider s’ils plaident coupable ou non coupable. Tous plaident « non coupable ».
Durée de la vidéo: 03:40
Date de la vidéo: 1946 Collection: - Les Actualités françaises
La déposition de Marie-Claude Vaillant-Couturier au procès de Nuremberg
Au cours du procès de Nuremberg, le juriste François de Menthon est chargé, au nom de la France, de prononcer le réquisitoire introductif. Marie-Claude Vaillant-Couturier, résistante - déportée, décrit ensuite à la barre le processus de sélection et d’extermination systématique d’une grande partie des hommes, femmes et enfants arrivant par convois à Auschwitz.
À partir du 17 janvier 1946, c’est l’accusation française qui est chargée de détailler les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité pour toute l’Europe occidentale. Parmi les témoins cités à comparaître, Marie-France Vaillant-Couturier délivre un témoignage direct sur le fonctionnement des chambres à gaz.
19 janvier 1946 : institution du Tribunal militaire international pour l’Extrême Orient (Tokyo)
Pour juger les grands criminels de guerre japonais, et sur le modèle de celui de Nuremberg, un procès est organisé à Tokyo, du 3 mai 1946 au 12 novembre 1948.
28 prévenus y comparaissent pour crimes de guerre, crimes contre la paix, et crimes contre l’humanité.
Le tribunal est composé de juges issus de onze nations ayant fait la guerre au Japon : aux quatre pays (URSS, États-Unis, Royaume-Uni et France) dont les représentants avaient siégé à Nuremberg s’ajoutent l’Australie, la Chine, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, les Pays-Bas et le Canada.
Au terme du procès, 25 des 28 accusés sont condamnés, dont 7 à la peine de mort. Mais l’absence de l’empereur du Japon Hirohito parmi les accusés explique, en partie, que le procès de Tokyo ait moins marqué les esprits que celui de Nuremberg, alors qu’il constituait lui aussi une expérience de mise en place d’une justice pénale internationale.
Durée de la vidéo: 03:18
Date de la vidéo: 1948 Collection: - Flash sur le passé
Procès de Tokyo en 1948 : condamnation à mort d’Hideki Tojo
Hideki Tojo, Premier ministre du Japon de 1941 à 1944, a comparu devant le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, réuni à Tokyo entre 1946 et 1948. Le 10 septembre 1948, il a été condamné à mort pour crimes de guerre.
10 décembre 1948 : adoption par les 58 États membres de l’Assemblée générale de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Après la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations unies est créée. Elle adopte la Charte des Nations unies, qui affirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine , et engage tous les États membres à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion .
Mais face aux atrocités commises par le régime nazi, il apparaît que la Charte ne définit pas suffisamment précisément les droits de l’Homme. C’est pour remédier à cela que la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est rédigée, et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, au palais de Chaillot.
Durée de la vidéo: 01:14
Date de la vidéo: 1948 Collection: - Résistances
René Cassin présente la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU
Ce document d'archive de l'ONU permet d'entendre le discours de René Cassin présentant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dont il est un des principaux rédacteurs.
Durée de la vidéo: 05:02
Date de la vidéo: 1963 Collection: - Edition spéciale
La Déclaration universelle des droits de l'homme
Cette émission spéciale de l'ORTF revient sur les circonstances de l'élaboration et les principes constitutifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
En définissant précisément les droits fondamentaux de l'individu, leur reconnaissance, et leur respect par la loi, la DUDH contribue à l’édification d’une idée de justice internationale.
Cependant, quelques années seulement après la fin de la guerre, l’entrée des grandes puissances dans une logique de guerre froide freine le processus de création d’une justice pénale internationale. Il faut attendre les années 1990 pour que la construction soit relancée.
2. L’affirmation de la justice pénale internationale
25 mai 1993 : institution du tribunal pénal international pour l’ex-yougoslavie (tpiy).
Au début des années 1990, l’opinion publique internationale prend conscience des actes atroces qui sont en train d’être commis en ex-Yougoslavie : politique de « purification ethnique », viols, déplacements forcés de populations, massacres.
En conséquence, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte à l'unanimité, le 22 février 1993, la résolution 808 par laquelle il décide la création d’un Tribunal indépendant. Le statut de ce tribunal est adopté 3 mois plus tard, le 25 mai 1993, par l’adoption de la résolution 827. Un Tribunal international (TPIY) est créé dans le but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
Le TPIY est une étape essentielle dans la construction d’une justice pénale internationale, les seuls précédents remontant aux tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Entre 1993 et sa dissolution en 2017, il a inculpé 161 individus, dont 90 ont été condamnés pour génocide, crimes de guerre ou crimes contre l’humanité. C’est en outre le premier tribunal à poursuivre un ancien chef d’État (Milošević) pour ces faits.
Durée de la vidéo: 02:17
Date de la vidéo: 2001 Collection: - Journal de 13 heures
Le procès Milosevic au TPIY
Le procès de Slobodan Milosevic par le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie créé par l’ONU en 1993, est une nouvelle expression de la justice internationale à l’encontre des crimes de guerre.
La piste pédagogique ci-dessous a été conçue pour le thème 3 « Histoire et mémoires » du programme de Terminale, spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques.
Connexion requise pour consulter cette ressource
Copyright de l'image décorative: © Ed Oudenaarden Anp AFP
Niveaux: Lycée général et technologique
Le TPIY, une étape importante dans la construction d’une justice pénale internationale
À travers l'écoute d'un documentaire audio de RFI, cette piste pédagogique propose de réfléchir à la question suivante : Pourquoi la création du TPIY est-elle une étape essentielle dans la construction d’une justice pénale internationale ?
8 novembre 1994 : institution du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)
Afin de juger les personnes responsables d'actes de génocide des Tutsi au Rwanda, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) est créé le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations unies. Ses compétences sont limitées au territoire du Rwanda et des États voisins pour des crimes commis au cours de l’année 1994. Il siège à Arusha en Tanzanie.
Comme le TPIY, le TPIR est un tribunal ad hoc : une instance temporaire, chargée de poursuivre et de juger les individus tenus responsables des crimes du droit international commis dans le cadre d’un conflit donné. Son mandat est donc circonscrit dans le temps et dans l’espace.
Durée de la vidéo: 03:01
Date de la vidéo: 1999 Collection: - Journal de 20 heures
Le Tribunal pénal international (TPI) d'Arusha pour le Rwanda
Cinq ans après sa création, ce reportage dresse un bilan assez positif de l'action du Tribunal pénal international pour le Rwanda siégeant à Arusha, en Tanzanie. Il est chargé de juger les responsables du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.
La piste pédagogique ci-dessous, conçue pour le thème 3 « Histoire et mémoires » du programme de Terminale, spécialité HGGSP, a été réalisée par Florent Piton, docteur en Histoire de l’Afrique, auteur de plusieurs ouvrages sur le génocide des Tutsi au Rwanda.
Copyright de l'image décorative: © Gerard Julien AFP
Le génocide des Tutsi au Rwanda
À travers l'écoute d'un documentaire audio de RFI, cette piste pédagogique propose de réfléchir à la question suivante : Comment la transformation des imaginaires historiques et de l’organisation sociale au Rwanda à l’époque coloniale a-t-elle pu être l’un des creusets du génocide des Tutsi en 1994 ?
Après le TPIY et le TPIR, on ne crée plus de tribunaux internationaux ad hoc , mais des tribunaux « mixtes » : des juridictions d’exception créées au sein des systèmes nationaux, et soumises à un contrôle international des Nations unies. Il semble en effet que l'association de juges nationaux et internationaux rende une justice plus efficace et plus proche des mentalités nationales.
Parmi ces tribunaux « mixtes » : le Tribunal spécial pour la Sierra-Leone (2002), le Tribunal spécial pour le Cambodge (2003), le Tribunal Spécial pour le Liban (2007).
3. L’institutionnalisation de la justice pénale internationale
17 juillet 1998 : conférence des nations unies à rome : signature de la convention portant statut de la création d’une cour pénale internationale, 11 avril 2002 : naissance de la cour pénale internationale.
Dès sa création en 1945, l’ONU souhaite créer une Cour pénale internationale et des commissions commencent à travailler sur un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité . Mais ces travaux sont mis en sommeil durant la Guerre froide.
Après la chute du mur de Berlin (1989) et la chute de l’URSS (1991), ils reprennent. Ils aboutissent à la signature du Statut de Rome en 1998, qui définit les pouvoirs et obligations de la Cour pénale internationale (CPI).
Après qu’un quorum minimum d’États a ratifié le Statut, il entre en vigueur : c’est chose faite le 11 avril 2002. C’est désormais à la CPI qu’appartient le rôle de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d'agression et de crime de guerre. Et bien que créée sous l’égide de l’ONU, la CPI en est indépendante : sa crédibilité est ainsi renforcée.
Sur le même thème

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
Plus de soixante-dix ans après le procès des nazis à Nuremberg, la justice internationale ne s'est toujours pas imposée comme instrument de réparation des dégâts causés par les conflits ...
Cette contribution retrace les idéaux de la justice pénale internationale comme étant des idéaux politiques libéraux issus de la philosophie de la paix par le droit et de l'utilitarisme. Elle montre comment leur mise en œuvre les confronte, d'une part, à la politique comprise comme rapport de puissances, d'autre part, à la réactivation d'une critique de l'universalisme ...
Ce document présente les compétences et les limites de la Cour internationale de justice, une institution de l'ONU spécialisée en matière judiciaire. Il aborde les différences entre la compétence contentieuse et la compétence consultative, ainsi que l'inexistence d'une auto-saisine.
Les limites de la Cour internationale de justice D'après le professeur Louis Aledo, droit international public c'est le droit des États, produit par eux et à destination d'eux-mêmes ». Cette définition tout à fait générale et générique du droit des gens, le jus gentium, trouve parfaitement à s'appliquer à la problématique relative ...
La justice internationale a pour but de faire asseoir la paix dans le monde. Nous pouvons dire que jusque-là cela a été une réussite, car depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde n'a pas connu une situation de cette ampleur. Si plusieurs mécanismes ont été mis en place, jusqu'à aujourd'hui l'impunité et les crimes continuent et la ...
céline celik groupe relations internationales limites de la justice internationale la justice consiste mesurer la peine et la faute de des lois, montesquieu. ... TD N°1 Dissertation « De quelle manière les nouveaux acteurs ont bouleversé les relations internationales. Relations internationales. Travaux dirigés. 100% (10) 4.
Dans le temps de la guerre. Institution post-Guerre froide, le TPIY a introduit la justice internationale dans le temps même de la guerre. Un audacieux pari aux résultats mitigés. En réalité ...
Progrès et limites de la justice internationale. 4 décembre 2006 Rédaction. Séance du lundi 4 décembre 2006. par M. Gilbert Guillaume. Pendant longtemps le droit international fut un droit dont l'observation reposait exclusivement sur la parole donnée. Les différends entre Etats, quelle qu'en soit la nature, se réglaient par la ...
Mireille Delmas-Marty 1La justice pénale internationale est une création du xx e siècle. Bien qu'on puisse en exhumer des prémices plus anciennes , la possibilité d'y recourir n'a été mentionnée la première fois qu'en 1919-1920 dans les traités de Versailles et de Sèvres.Il y a un siècle exactement, c'est-à-dire encore trop tôt puisque le projet restera une simple ...
1993, pp. 1-38. Le texte de la Convention est reproduit dans la même revue, pp. 213-227. 4. M.O HUDSON. , La Cour Permanente de Justice Internationale, Paris, Pedone, 1936. Le texte du Statut fut adopté par le Conseil de la SDN le 28 Octobre, puis par l'Assemblée le 13 Décembre ;
Le principe du consentement des Etats à la compétence de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI), est un principe fondamental du procès international. Selon la Cour, appuyée par la doctrine, la compétence de la Cour serait même entièrement gouvernée par ce principe. Affirmer l'existence de limites induit un ...
Guillaume Gilbert. La justice internationale à l'aube du XXIe siècle: Conférence faite à l'Institut du droit de la paix et du développement le 3 novembre 2004. Perspectives internationales et européennes, 2005, Perspectives internationales et européennes, 1. �halshs-03277939�. - 1 -.
S'agissant de « crimes internationaux », entendus au double sens, formel (d'infraction établie par une norme internationale) et matériel (d'infraction portant atteinte à l'ordre public de la société internationale), l'élaboration d'un droit pénal commun est lente, complexe et évolutive. En 1979, le professeur Lombois ...
pénale au sein de la justice transitionnelle, dont les difficultés pratiques révéleront les limites de lidée de la complémentarité théorique développée à cette occasion (II). Il semblerait enfin que lon assiste au développement dune troisième approche, positionnant la justice internationale pénale aux côtés de la justice ...
Pour cette raison, les négateurs du droit intemational en contestent la juridicité. Le présent mémoire étudie l'ensemble des mesures qui tendent à l'exécution volontaire et forcée des décisions de la Cour internationale de Justice. Pour ce faire, il analyse principalement l'article 94 de la Charte des Nations Unies qui est le siège de ...
Appréhender la lutte contre l\'impunité oblige à analyser la branche du droit où elle est la plus omniprésente : le droit international pénal. Mis en place après Nuremberg et stabilisé dans les années 90 pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l\'humanité et les crimes de génocide, la justice internationale pénale est présentée/se présente comme visant principalement ...
Vadim Shishimarin, un soldat russe de 21 ans, est le premier à être jugé par la justice ukrainienne pour crimes de guerre. Accusé d'avoir tiré à bout…. Publié le 17 mars 2022. International.
Ce faisant la Cour rejette chaque argument de la Société financière . internationale et l'interprétation retenue par d'autres juridictions. Aussi tant la technique que la rhétorique interprétative de la Cour sont-elles particulièrement intéressantes. B. Les fondements de la solution : le choix interprétatif retenu
Une étape est franchie en 1998, avec la création de la Cour pénale internationale (CPI) : non plus un tribunal ad hoc, lié à un conflit donné, mais une juridiction permanente, pour juger des ...
Dissertations sur Histoire et mémoires. ... vous montrerez les particularités et les limites de la justice à l'échelle locale exercée dans le cadre des tribunaux gacaca au Rwanda. Document 1 : ... à l'échelle internationale, la mise en place du TPIR en novembre 1994. Ce dernier est chargé de poursuivre et juger les principaux ...
C'est aussi une étape fondamentale dans la construction d'une justice internationale après-guerre. Aujourd'hui, celle-ci s'incarne dans des juridictions permanentes, avec la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Voici les principales étapes qui, de Nuremberg à La Haye, ont jalonné la construction de la justice ...
de l'ordre juridique international qui constitue le gage de l'efficacité de la réglementation internationale»4. Petrovskyi Yu. remarque que «toutes les actions des Etats sont dirigées vers le but d'atteindre l'accord sur les questions pratiques de la réalisation de la responsabilité internationale de l'Etat coupable»5.
MISE À JOUR Samedi, 1 juin 2024 00:55. Ignorée par la Russie et Israël, la Cour internationale de Justice est la victime impuissante d'un système multilatéral polarisé où les États ...
Extrait n° 1. Statut de la Cour internationale de Justice, 1945. Article 38 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige;