Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser .
Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.
- We're Hiring!
- Help Center


Méthodologie de la dissertation de philosophie (mise à jour, 2024)

Related Papers
Alexis Delamare
Exercice académique franco-français par excellence, la dissertation a de quoi surprendre. N’est-ce pas une folie que de prétendre régler en quelques heures une question philosophique discutée depuis des siècles ? L’énoncé même de certains sujets (« La connaissance ») apparaît presque ridicule comparé au temps dont on dispose pour le traiter. La dissertation traduirait ainsi une forme de mégalomanie philosophique. Une seconde critique régulièrement évoquée se concentre sur la totale liberté laissée aux étudiants : comment comparer entre elles des productions qui auront fait usage de thèses, d’auteurs, de références, totalement différents ? On comprend bien comment l’on note un commentaire : on met en regard le sens du texte et ce qu’en a compris l’étudiant. Mais pour la dissertation ? Sur quelle norme devrait-on se fonder pour juger la copie ? Enfin, on pourra encore ajouter ceci, que la dissertation, parce qu’elle nous pousse à défendre des thèses pour mieux les rejeter par la suite, est une forme d’absurdité. Pourquoi ne pas simplement défendre notre point de vue ? Pourquoi s’embarrasser de ces longs détours avant de parvenir enfin, épuisés, à la vérité de la dernière partie ?
wajdi hajlaoui
Méthodologie pour rédiger bonnement les bons sujet de mémoire ,littérature ,philosophie pour pouvoir réussir les grands concours tels l'agrégation et l'admission à l'école normale supérieure .
Lamiaa Khaldoune
Michael D Rosenfeld
Le séminaire proposé n’est pas un séminaire de recherche sur la théorie de la littérature. Son ambition est de montrer au public visé (doctorants surtout, étudiants de deuxième année de master aussi) quel intérêt pratique (méthodologique) la théorie de la littérature a pour leur propre recherche : la théorie permet de définir des problématiques plus pertinentes, plus cohérentes, plus rigoureuses que l’approche empirique. La théorie est abordée ici comme un outil, non comme un objet en soi, ni, surtout, comme un obstacle à surmonter. Les textes servant de base aux séances ont été choisis pour leur intérêt méthodologique, mais aussi pour leur clarté et leur accessibilité intellectuelle. Ils sont en général assez courts, et on les trouve facilement. Il est demandé aux étudiants de choisir et d’orienter leurs exposés de façon à faire ressortir ce que le corpus théorique étudié peut apporter à leur propre recherche. À côté d’un travail d’élucidation, les interventions des enseignants ont pour objectif de partager une expérience. Elles indiquent en particulier en quoi telle ou telle ressource théorique (tel ouvrage, tel concept, telle idée) a pu susciter leur questionnement, étayer leurs travaux (à commencer par leurs propres thèses de doctorat et habilitation à diriger des recherches), résoudre telle ou telle difficulté rencontrée dans la conduite d’une recherche. Les trois responsables du séminaire assistent ensemble à la totalité des séances. Équipe : Serge Rolet (Lille 3), Vincent Vivès (Valenciennes), Damien Zanone (UCL)
Raphaël Verchère
Cet ouvrage permet aux élèves de Terminale de s’approprier de façon autonome, concrète et directement utilisable les connaissances et les compétences attendues pour l’épreuve de philosophie au Bac : - des fiches méthodologiques sur les deux épreuves : dissertation et explication de texte ; - des fiches de cours sur les notions au programme ; - des exercices variés et ciblés avec les commentaires du prof ; - des sujets d’annales commentés et corrigés ; - des conseils et astuces. En bonus - Les repères du programme expliqués - Les clés de l’oral de rattrapage
Comme pour la dissertation, l’introduction est un moment absolument fondamental du commentaire. L’on pourrait penser, à première vue, que la tâche de l’introduction du commentaire est moins significative que celle de la dissertation, en disant à peu près : dans la dissertation, il s’agit d’inventer un problème, tandis que, dans le commentaire, le texte, donc le problème, est déjà devant nous : il n’y a rien à inventer, seulement à découvrir. Une telle conception est erronée. On a vu, dans la dissertation, que même les sujets-question devaient être problématisés : il fallait montrer en quoi la question constituait un problème, il fallait transformer la question en problème. La tâche est assez similaire pour le commentaire : il faut montrer en quoi le texte pose un problème, en quoi la question abordée par le texte ne va pas de soi et exige donc une résolution. Le développement du commentaire, de même que pour la dissertation, va consister à montrer comment le texte répond au problème que l’on aura identifié en introduction.
Boris Barraud
La dissertation est, au sein des facultés de droit françaises, l'un des exercices les plus anciens et les plus classiques. À travers lui, l'enseignant cherche à évaluer non les connaissances de l'étudiant mais sa capacité à comprendre, à penser et à synthétiser le droit. Surtout, parce que, en droit, la forme compte autant que le fond, l'enseignant cherche à mesurer l'acceptation et la compréhension par l'étudiant de certains canons en vigueur parmi les facultés de droit françaises, canons qui ont pour seule justification le fait qu'ils sont des canons, i.e. des usages, loin de toute légitimité scientifique. L'objectif de la dissertation est, à partir d'un sujet donné, d'isoler une problématique (non la problématique qui n'existe pas) dans une introduction et d'y répondre dans un plan et dans des développements objectifs mais aussi personnels. Cet exercice fait appel à de nombreuses qualités qu'il faut cultiver : capacité d'analyser le sujet, esprit de synthèse, capacité de communication des connaissances, habileté de présentation et d'exposition de celles-ci. Les sujets des dissertations peuvent être de toutes sortes, des plus théoriques aux plus attachés au droit positif. Mais, quel que soit le sujet, l'étudiant ne doit en aucun cas se borner à présenter l'état du droit positif, à l'instar d'un manuel. La bonne dissertation est celle qui consiste en une réflexion ou, mieux, en une démonstration. Et son rédacteur doit, notamment à travers le plan et les intitulés, exprimer une position personnelle, sans toutefois verser par trop dans les jugements de valeur ou, pis, dans les considérations politiques. Tout d'abord, il convient de prendre connaissance du sujet et, sur papier libre, de noter la définition de ses termes ainsi que toutes les idées (ou pistes d'idées) venant à l'esprit en séparant celles qui pourraient constituer des parties ou des sous-parties et celles qui pourraient seulement servir le propos au sein des sous-parties. Même si le sujet est court concernant les dissertations, il convient de le lire à plusieurs reprises et de s'assurer de la bonne compréhension de ses termes afin d'éviter le hors-sujet, lequel emporte toujours des conséquences très dommageables. Parfois, la ponctuation ou certains mots de liaison sont décisifs en ce qu'ils influencent le sens du sujet et donc la problématique et les réponses qu'il est possible d'en tirer. Une fois un premier point autour du sujet effectué, il s'agit de rechercher, en consultant manuels, ouvrages et revues juridiques, mais aussi toute source offerte par le Web (à condition que sa fiabilité soit avérée et de pouvoir ensuite la citer en note de bas de page), d'autres idées et informations, toujours en notant au brouillon les parties et sous-parties potentielles et les autres données non-exploitables en termes de plan. Une fois qu'il apparaît que les recherches autour du sujet ne peuvent plus être productives (ou du moins seulement marginalement), reste à reprendre toutes les notes du brouillon et à les ordonner sur un nouveau papier libre en séparant cette fois ce qui sera l'introduction, ce que seront le plan et les intitulés et ce que sera le propos tenu en chaque sous-partie. Éventuellement, mais non-nécessairement, quelques éléments peuvent être conservés en vue de la rédaction d'une conclusion. Il s'agit à cet instant de regrouper par affinités les idées et informations qui se complètent, qui s'opposent, également celles qui doivent finalement être exclues de la démonstration, afin de concevoir progressivement ce qui sera le plan (sans alors chercher à affiner les intitulés, ce qui est un exercice d'abord formel et intervenant en dernier lieu). Il importe de ne surtout pas s'engager trop vite dans la rédaction et dans la conception du plan. Tout cela ne vient qu'à la fin, validant le travail en quelque sorte. Le plan, notamment, est le fruit naturel des recherches et des réflexions ; il serait désastreux de vouloir ab initio concevoir un plan pour ensuite rechercher quelques éléments susceptibles de la garnir substantiellement. Deux éléments sont centraux dans la dissertation : son introduction (1) et son plan (2). Il n'est pas davantage à dire du contenu de chaque sous-partie. Simplement faut-il préciser que, systématiquement, des annonces de sous-plans (des chapeaux introductifs) doivent précéder et annoncer les A et B et des phrases de transition doivent permettre le passage de I à II et de A à B. Tant les chapeaux que les transitions permettent de renforcer et de traduire la logique du raisonnement. Quant au contenu, simplement faut-il inviter l'étudiant à ne pas se borner à exposer de manière excessivement descriptive les données et, sans néanmoins bannir toute description, à adopter également une approche critique, si ce n'est polémique à propos des éléments en cause.
El haouary ouadie
Michel Weber
« […] D’épreuve en épreuve, la philosophie affronterait des rivaux de plus en plus insolents, de plus en plus calamiteux, que Platon lui-même n’aurait pas imaginés dans ses moments les plus comiques. Enfin le fond de la honte fut atteint quand l’informatique, le marketing, le design, la publicité, toutes les disciplines de la communication s’emparèrent du mot concept lui-même, et dirent : c’est notre affaire, c’est nous les créatifs, nous sommes les concepteurs ! » L’épreuve dernière qu’évoquent Deleuze et Guattari a trouvé au XXe siècle un développement assez inattendu, en l’espèce de la transformation de ce qui n’était somme toute qu’une bataille d’arrière-garde — la dénonciation active du « fond de la honte » — en la guerre intestine qu’institue potentiellement le « conseil philosophique privé ». Il s’agit en effet ni plus ni moins de la réactualisation de la lutte que se livrèrent — selon Platon, il y a 2500 ans — Socrate et les sophistes . À nouveau, on marchande l’idéal philosophique.
RELATED PAPERS
Carlo Regoli
The New phytologist
Alison Snow
Dwi Yuni Awali
BMC Proceedings
Frank Nygaard
Papers. Revista de Sociologia
Richard Gott
Journal of Hypertension
Carmine Sessa
British Journal of Psychiatry
Steve Joseph
Jacques Elion
Thomas Dyllick
Daniel Portioli Sampaio
Indic Heritage & Culture An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed, Yearly Multidisciplinary Journal
Dr. Indrajeet Bhattacharya (Ph.D.)
Boletin Cultural Y Bibliografico
Hector Abad
Isabelle Lelarge
Pusat Grosir Legging Panjang
Composite Structures
sanaz hassanzadeh
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD
33 - Đặng Trang
Laval Lavallée
Annals of PIMS-Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University
Muhammad Junaid
Value in Health
Richard Steyn
Academic Medicine
Frank Cerra
Pharmacology & Toxicology
Seppo Alahuhta
RELATED TOPICS
- We're Hiring!
- Help Center
- Find new research papers in:
- Health Sciences
- Earth Sciences
- Cognitive Science
- Mathematics
- Computer Science
- Academia ©2024
- Philosophie
- Méthodologie : Réussir la dissertation de philosophie
Réussir la dissertation de philosophie Méthodologie
La dissertation est un travail d'argumentation et de rédaction. Il s'agit de développer, selon un plan précis, une réponse argumentée et structurée autour d'une problématique philosophique portant sur l'un des objets d'étude au programme. Il faut pour cela s'appuyer sur un certain nombre de références et de connaissances philosophiques approfondies et précises apprises durant l'année.
Il y a des critères d'évaluation à respecter. La réponse est notée sur 20 points pour les séries générales. On évalue :
- la compréhension du sujet
- l'analyse et la reformulation de la question
- les connaissances personnelles
- la maîtrise des notions abordées en cours
- la qualité de la rédaction
- la clarté de la rédaction
- la clarté de l'argumentation
- la capacité à structurer un plan précis et solide
Analyse du sujet (15 min)
Cette étape se fait sur la feuille de brouillon.
- lire plusieurs fois le sujet et en surligner les mots-clés
- définir tous les termes de l'énoncé afin de comprendre les implications possibles du sujet
- reformuler le sujet pour faire apparaître une problématique
- définir le type de sujet proposé : réfuter une thèse, l'étayer ou la discuter, ou encore réfléchir sur une notion au programme
Lister les arguments et les exemples et faire un plan (30 min)
- Pour réfuter une thèse, il convient de faire la liste des arguments en faveur de la thèse adverse et de trouver des contre-arguments.
- Pour étayer une thèse, il convient au contraire de la défendre et de présenter les arguments de la partie adverse pour mieux les rejeter.
- Trouver un exemple précis et clair pour illustrer chaque argument. Il faut donner des références détaillées. On utilise sa culture générale, les thèmes abordés en classe et les auteurs et textes étudiés.
Organiser les arguments pour former un plan (30 min)
- On écrit son plan détaillé au brouillon. Celui-ci doit comprendre deux ou trois parties chacune composée de deux ou trois sous-parties. Chaque sous-partie comporte un argument et son exemple.
- On relit le plan pour vérifier qu'il est complet et logique, et qu'il répond bien à la problématique. On ne rédige pas intégralement la dissertation au brouillon, on ne note que le plan détaillé.
Pour discuter une thèse, on utilise en général un plan en trois parties dans lequel on défend d'abord une thèse avant de la nuancer et enfin de dépasser l'idée d'opposition, de contradiction radicale avec son antithèse.
Au brouillon, rédiger une introduction (15 min)
Cette étape se fait sur la feuille de brouillon. On rédige intégralement l'introduction au brouillon. On la retranscrira ensuite sur la copie. Cette introduction est composée de trois parties :
- une accroche, destinée à retenir et soutenir l'attention du lecteur.
- une explication et une reformulation du sujet avec présentation de la problématique
- l'annonce du plan
Au brouillon, rédiger une conclusion (15 min)
Cette étape se fait sur la feuille de brouillon. On rédige intégralement la conclusion au brouillon. On la retranscrira ensuite sur la copie. Cette conclusion est composée de deux parties :
- reprise des éléments principaux du développement
- ouverture de la réflexion vers un autre sujet, qu'on ne traite pas évidemment, mais dont on laisse entendre qu'il "prend la suite" de celui qu'on a traité (généralisation, mise en perspective, autre problématique possible).
Rédiger la dissertation en entier directement sur la copie (2h)
Il faut prendre en compte les points suivants :
- L'introduction et la conclusion ont déjà été rédigées au brouillon, il suffit de les recopier. Quelques modifications peuvent s'imposer à ce stade, mais il ne faut pas changer l'esprit du texte initial.
- Les grandes parties sont séparées par une transition d'une à deux lignes. Les deux ou trois parties doivent faire à peu près la même longueur.
- La structure des sous-parties est toujours la même : une idée, une citation ou un exemple et un commentaire sur cet exemple. On commence chaque sous-partie par un alinéa. Il doit y avoir une progression d'une sous-partie à l'autre : importance du problème abordé, réflexion plus contemporaine, paradoxes qui ont pu surgir en cours de réflexion, etc..
- On attend un travail qui fait au moins une copie double.
Se relire (15 min)
Cette étape est importante, il faut vérifier que la syntaxe et la grammaire sont justes. L'examinateur peut enlever des points s'il y a trop de fautes (jusqu'à 4, ce qui peut être décisif : c'est le même écart qu'il y a de 8 (seuil d'admissibilité) à 12 (admission avec mention), si on applique ce critère à toutes les épreuves, même, théoriquement, dans un bac scientifique : un raisonnement mathématique correct, mais mal exposé, perd de sa force, voire, des équivoques peuvent apparaître : imaginez, par exemple, que vous appeliez "égaux" des triangles qui sont seulement "semblables". En philosophie, cet effet est démultiplié, puisqu'il s'agit d'analyser des idées à l'aide du langage ordinaire, avec toutes ses contraintes de grammaire et de syntaxe.

Philo: Exemple de Dissertation
Le cas d’une dissertation philo rédigée et corrigée.
La dissertation en philosophie est un exercice difficile car elle suppose la maîtrise d’une méthode et d’une structure déterminée.
Nous vous donnons donc un exemple de dissertation rédigée et corrigée par un professeur , tant d’un point de vue méthodologique (forme) qu’éditorial (fond).
Nous avons volontairement choisi un sujet de dissertation très classique en terminale philo : “La liberté est-elle une illusion ?” (fréquent pour les terminales littéraires )
La liberté est-elle une illusion ?
Travail préparatoire.
A) L’analyse des termes du sujet :
1) La liberté : Il s’agit de toujours partir de la conception spontanée, immédiate que l’on se fait de la liberté, celle de l’ « homme de la rue » qu’aurait pu interroger Socrate. Ainsi, la liberté, c’est « faire ce que l’on veut », elle correspond, semble-t-il à la toute-puissance de la volonté de chacun. Spontanément, tout individu se sent libre dès lors qu’il peut accomplir tous ses désirs , toutes ses envies.
Or l’expérience ordinaire de la vie montre aussi, paradoxalement, l’être humain soumis à de nombreuses contraintes à la fois externes (physiques, sociales, politiques) et internes (instincts, habitudes, passions) qui pèsent sur sa liberté et qu’il lui est difficile voire impossible de surmonter totalement de sa propre initiative. Dès lors, le sentiment de liberté ne serait-il qu’illusoire ?
2) l’illusion : Il s’agit de saisir l’importance de ce terme à distinguer de l’erreur . L’illusion procède certes de l’erreur en ce qu’elle trompe l’individu, mais elle procède également de la mystification . Qu’est-ce à dire ? Tout individu est responsable de ses erreurs et dispose du pouvoir de les corriger. En revanche, dans l’illusion, qui peut être à la fois individuelle et collective, nous serions victimes d’une puissance trompeuse impossible à vaincre .
La question qui s’impose est donc la suivante : Quel type de désir proprement humain se trouve à la racine d’une illusion ? Ou bien quel besoin l’homme cherche-t-il à satisfaire dans la pérennité d’une illusion ?
B) Repérer les notions du programme en jeu dans le sujet : la liberté, la conscience et l’inconscient, le désir.
C) Problématiser le sujet : Si tout individu éprouve un sentiment immédiat de liberté, cette conviction renvoie-t-elle à une croyance illusoire ou à une véritable connaissance de soi ? L’objectif consistera donc à faire la part de ce qui relève d’une liberté réelle, repérable, de ce qui relève d’un désir infondé de liberté, dans un souci de lucidité et de vérité.
D) Mobiliser des références utilisables :
– Platon, dans le Gorgias , dénonce la confusion commune entre la liberté du sage et la réalisation impulsive de tous ses désirs.
– Descartes, dans La Méditation quatrième , donne une définition du libre arbitre qui apparente l’homme à Dieu.
– Spinoza, dans L’Ethique , montre que la conscience d’exister n’implique pas nécessairement la liberté humaine.
E) Elaboration du plan : elle doit obéir à la règle du « plus proche au plus lointain », c’est-à-dire aller de l’explicite à l’implicite, du plus évident au moins évident.
Exemple de plan possible :
I) La liberté est un sentiment immédiat : la thèse du libre arbitre
II) La critique déterministe du libre arbitre
Iii) la liberté est à conquérir : de la libération à la quête d’autonomie, introduction à la dissertation.
1) Amorce : Il nous faut partir de ce constat de départ que le sentiment commun et immédiat éprouvé par tout homme est de se sentir libre : en effet, chaque homme peut faire l’expérience, du moins intérieure, d’une liberté de penser et d’agir, indépendamment de toute contrainte extérieure. Cette conviction intérieure est donc profondément ancrée en chacun de nous.
2) Annonce du sujet et problématisation : Cependant, la liberté ne serait-elle pas une illusion ? Ou pour le dire autrement, le fait de se sentir libre n’est-il pas susceptible de ne renvoyer qu’à une croyance illusoire ? Le sentiment immédiat de notre liberté est-il vrai, c’est-à-dire renvoie-t-il à une véritable connaissance de soi-même ?
3) Annonce du plan d’étude : elle doit être suffisamment explicite sans en dire trop, sans être trop « lourde » : Nous tenterons, tout d’abord, d’évaluer la pertinence et les limites du sentiment spontané de liberté, commun à tous les hommes. Puis nous tâcherons de montrer que cette expérience immédiate du libre arbitre est susceptible de camoufler à l’homme une méconnaissance de lui-même. Enfin, une nouvelle tâche se dressera face à nous : la nécessité de reconstruire une nouvelle approche de la liberté humaine, si tant est qu’elle soit possible.
Développement de la dissertation : 1ère partie
I) Le sentiment immédiat de notre liberté : la théorie du libre arbitre
a) Tout homme se juge spontanément libre
Dans le langage courant, la liberté renvoie au pouvoir que possède tout homme de n’obéir qu’à lui-même, qu’à sa propre volonté, et d’agir uniquement en fonction de ses désirs, indépendamment de toute contrainte ou de toute pression extérieure.
Tout homme se sent donc spontanément libre, tout simplement parce qu’il se croit capable de faire des choix de petite ou de grande importance, de prendre des décisions , de petite ou de grande ampleur.
Autrement dit, tout homme, lorsqu’il porte un regard réflexif sur lui-même, se juge spontanément libre, c’est-à-dire en mesure d’agir simplement en fonction de sa volonté .
La plupart des philosophes qui se sont prononcés en faveur de la liberté humaine, en faveur de l’existence du libre arbitre, ont accordé une grande valeur à l’expérience intime , immédiate que nous aurions, selon eux, de notre liberté : « La liberté de notre volonté, écrit Descartes ( Principes de la Philosophie , I, art.39), se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons ».
Transition : Faire le point et formuler une ou plusieurs questions permettant de poursuivre la réflexion : La liberté correspondrait donc à un sentiment intérieur , à une expérience immédiate en chaque homme. Or peut-on se contenter de cette expérience immédiate ou pour reprendre la formulation de Bergson , de cette « donnée immédiate de la conscience » ? Autrement dit, peut-on se contenter du sentiment de notre liberté pour en déduire son existence certaine ? Est-il donc possible de faire une expérience de notre liberté qui puisse justifier ce sentiment ?
b) Peut-on prouver l’existence du libre arbitre ?
1) Première tentative de preuve : l’expérience de l’ âne de Buridan et la mise à jour de la « liberté d’indifférence »
Jean Buridan, philosophe français du quatorzième siècle, aurait, selon la légende, conçu une expérience imaginaire afin de prouver l’existence du libre arbitre : la situation serait celle d’un animal, en l’occurrence un âne, ayant également faim et soif, et qui, placé à égale distance d’une botte de foin et d’un seau d’eau, hésite, se montre incapable de choisir, et finalement se laisse mourir.
Ce « protocole expérimental métaphysique » aurait donc pour objectif de prouver l’existence de la « liberté d’indifférence » proprement humaine. En effet, nous avons tous déjà vécu une situation où les mobiles ou motifs en faveur d’un acte ou d’un autre étaient si équivalents , ou aussi contraignants l’un que l’autre, que nous nous sommes retrouvés incapables de faire un choix.
En effet, que se passe-t-il lorsqu’un individu se retrouve face à deux possibilités aussi équivalentes l’une que l’autre, lorsque rien ne puisse permettre de déterminer son choix ? Or ce qui permet à l’homme d’échapper à la situation absurde de l’âne mourant de faim et de soif entre une botte de foin et un seau d’eau, c’est qu’il dispose de cette liberté d’indifférence, c’est-à-dire de cette liberté par laquelle notre volonté a le pouvoir de choisir spontanément et de sa propre initiative.
Cette situation d’indifférence du choix prouve donc que l’homme est doté d’un libre arbitre, c’est-à-dire d’une capacité de choisir pouvant échapper à tout déterminisme . Pour Descartes, cette liberté d’indifférence, bien que considérée comme « le plus bas degré de la liberté », témoigne en même temps d’un pur libre arbitre qui apparente l’homme à Dieu ( Méditation quatrième ).
2) Seconde tentative de preuve du libre arbitre : le crime de Lafcadio dans Les Caves du Vatican d’André Gide
André Gide, dans Les Caves du Vatican , cherche à illustrer la possibilité pour un être humain de réaliser un acte gratuit , c’est-à-dire un acte accompli sans raison, par le seul effet de sa liberté.
Dans le roman, le « héro » Lafcadio se rend à Rome par le train et se retrouve seul dans la nuit, ne partageant son compartiment qu’avec un vieux monsieur. Lafcadio se prend alors d’une idée folle :
« Là sous ma main, la poignée. Il suffirait de la tirer et de le pousser en avant. On n’entendrait même pas un cri dans la nuit. Qui le verrait…Un crime immotivé, quel embarras pour la police ».
Lafcadio se dit en effet, et à juste titre, que s’il n’a pas de mobiles pour réaliser ce crime, il n’a donc pas de motivations . Le lien entre l’acteur et l’acte commis est inexistant . Lafcadio prend d’ailleurs un soin tout particulier à renforcer la gratuité de son crime : il remet tout au hasard et se met à compter pour soumettre sa décision de passer à l’acte ou de ne pas passer à l’acte à l’apparition d’un feu dans la nuit. Or le hasard, c’est précisément ce qui est fortuit , c’est-à-dire dépourvu de toute intention consciente , donc de motivation intrinsèque… Et le crime a lieu.
3) Peut-on dire que l’acte de Lafcadio est un acte gratuit ?
Le mérite du roman d’André Gide est d’aborder la question suivante : Un acte gratuit est-il possible ? Or deux critiques permettent d’être avancées pour remettre en cause cette possibilité :
La première critique consistera à remarquer que Lafcadio fait reposer son passage à l’acte sur des signes extérieurs , en l’occurrence l’apparition ou la non apparition d’un feu dans la campagne. Son acte serait donc déterminé par une extériorité .
La seconde critique consistera à remarquer que l’absence de motivations dans l’acte de Lafcadio est tout sauf évidente : l’une de ses premières motivations ne serait-elle pas le désir même de se prouver à lui-même sa liberté ? Si bien qu’il est tout-à fait envisageable de soupçonner Lafcadio de prendre pour une absence de motifs ce qui ne serait au fond qu’une ignorance profonde des motifs de son acte.
L’ « acte gratuit » est donc une notion philosophiquement problématique : la volonté de prouver sa liberté par un acte supposé sans mobile constitue, par elle-même , un mobile.
Transition : Une nouvelle question se pose dès lors : le sentiment de liberté ou la volonté de réaliser un acte non déterminé ne seraient-ils pas qu’une croyance ? Ne semble-t-il pas que ce ne soit que de façon illusoire et superficielle que je fasse l’ « expérience » de ma liberté, par ignorance des déterminations qui sont pourtant en jeu ?
Développement de la dissertation : 2ème partie
a) L’illusion anthropocentrique du libre arbitre : « L’homme n’est pas un empire dans un empire » (Spinoza)
Le projet philosophique de B.Spinoza, dans le sillage des travaux scientifiques de Laplace, est de dénoncer les illusions du libre arbitre .
C’est ainsi que dans la troisième partie de l’Ethique , dans la section intitulée De l’origine et de la nature des affections , Spinoza rejette totalement l’idée selon laquelle l’homme occuperait une place privilégiée au sein de la nature.
Spinoza critique notamment Descartes qui conçoit l’homme comme « un empire dans un empire », ainsi que tous les philosophes qui croient que « l’homme trouble l’ordre de la Nature plutôt qu’il ne le suit, qu’il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination ».
Or l’objectif de Spinoza est bel et bien de montrer que l’homme suit les lois communes de la Nature , comme toutes les choses de ce monde.
b) L’illusion humaine de la liberté
C’est dans sa lettre à Schuller , extraite de sa Correspondance , que Spinoza dénonce l’illusion du libre arbitre . Il défend ainsi une position philosophique déterministe suivant laquelle tous les événements sont absolument nécessaires et le sentiment que nous avons d’être libres ne serait qu’une illusion naturelle :
« Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d’avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent ».
Et Spinoza d’ajouter un peu plus loin : « Et comme ce préjugé est inné en tous les hommes, ils ne s’en libèrent pas facilement ».
Cette illusion naturelle de l’homme a donc deux causes d’après Spinoza qui justifient que l’homme s’illusionne et qu’il ne fasse pas seulement erreur. Premièrement, la source de l’illusion humaine du libre arbitre est l’ignorance des causes qui nous poussent à agir. Or à prendre les choses rigoureusement, l’homme est tout aussi déterminé à se mouvoir sous l’influence de causes externes qu’une pierre qui reçoit une impulsion. Les hommes se croient libres alors qu’ils sont contraints ou déterminés par leur nature. Deuxièmement, Spinoza précise bien que les hommes « se vantent » d’être libre car le désir d’être libre , même illusoire, est beaucoup plus valorisant pour l’orgueil humain que l’idée d’être totalement déterminé.
c) La liberté désigne alors la nécessité bien comprise
C’est ainsi que Spinoza ne fait pas consister la liberté, dans la lettre à Schuller , dans un libre décret mais dans une libre nécessité ou dans la nécessité bien comprise : « j’appelle libre, quant à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature ».
Tout comme les comportements des animaux sont déterminés par l’instinct, leur environnement ou des déterminations biologiques, les actes et les pensées des hommes le sont eux-mêmes par de multiples facteurs à la fois internes et externes dont on ignore le plus souvent l’existence et la puissance : facteurs d’origine physiologiques, psychologiques, sociales, etc.
Dès lors, l’un des apports essentiels de la critique spinoziste du libre arbitre est de montrer que la croyance en l’existence du libre arbitre est la source d’ aliénation de l’homme. En effet, selon Spinoza, non seulement l’homme est déterminé mais cette illusion naturelle du libre arbitre nous déterminent à ne pas savoir que nous sommes déterminés, et ainsi à l’être d’autant plus sûrement. Or il n’y a pas pire esclave que celui qui se croit libre .
Transition : Il nous faut donc tirer les enseignements de la critique spinoziste du libre arbitre et reconnaîtreque l’idée d’une liberté spontanée ou d’un sentiment immédiat de liberté n’est plus tenable. Est-il dès lors possible de reconstruire une approche de la liberté qui soit accessible à l’homme ?
Développement de la dissertation ; 3ème et dernière partie
a) Être libre, c’est apprendre à se libérer des passions
Platon, dans le Gorgias , pose la question suivante : est-ce la vie de l’homme aux désirs insatiables ou celle guidée par la raison qui est la meilleure ? Dans ce dialogue qui met aux prises Socrate et Calliclès, ce dernier défend le droit au désir , comme un droit à être puissant, autrement dit à être capable de mettre les forces de son énergie et de son intelligence au service des passions , pour leur donner la plus grande ampleur possible.
C’est ainsi que Calliclès préfère les « tonneaux qui fuient » puisque « ce qui fait l’agrément de la vie, c’est de verser le plus possible ». En revanche, Socrate choisit la vie ordonnée , celle où les tonneaux du sage « seraient en bon état ».
Platon cherche ainsi à montrer, dans ce dialogue, l’illusion dans laquelle se trouvent les hommes comme Calliclès, qui croient qu’être libre consiste à faire ce que l’on veut, c’est-à-dire à réaliser tous ses désirs . Or une telle vie, guidée par des désirs multiples , polymorphes et surtout infinis , mène nécessairement au tourment et au malheur. En effet, le risque pour un homme comme Calliclès décidant de mener une vie intempérante et désordonnée est de devenir l’esclave de ses propres passions et désirs .
A cette vie désordonnée, Platon oppose une vie guidée par la raison , incarnée par la sagesse socratique . Socrate incarne, en effet, le sage qui sait distinguer entre les désirs à poursuivre ou à ne pas poursuivre, qui sait se gouverner lui-même et qui est en mesure d’accéder à une véritable autonomie de la volonté.
b) Être libre, c’est être responsable de ses actes
Par conséquent, l’entrée dans la liberté authentique , par opposition avec la liberté illusoire des désirs infinis, c’est l’entrée dans une véritable autonomie et c’est pouvoir devenir responsable de ses actes et pouvoir en répondre.
L’enjeu de l’entrée dans la liberté authentique est donc celui du rapport à soi-même et à autrui . La liberté entre alors dans le champ de la réflexion morale , sociale et politique . C’est ainsi qu’au sens moral et juridique, être libre, c’est pouvoir être reconnu autonome et responsable de ses actes, de ses choix, à la fois devant soi-même et devant la société à laquelle on appartient.
En conséquence, si la liberté est illusoire ou inaccessible, il semble que c’en soit fini de la responsabilité morale et juridique de tout individu, et par là même de la justice . Le fait que nous nous sentions, à tort ou à raison libre, exige donc que l’on agisse comme si on était effectivement libre .
c) La liberté comme condition de l’acte éthique
C’est ainsi que dans la première note de la préface à la Critique de la raison pratique , Kant affirme que la liberté est la condition de possibilité et l’essence (la ratio essendi ) de la vie morale de l’homme, comme la vie morale de l’homme est ce par quoi l’homme connaît la réalité de sa liberté (elle en est la ratio cognoscendi ). Et Kant ajoute pour préciser : « (…) si la loi morale n’était pas d’abord clairement conçue dans notre raison, nous ne nous croirions jamais autorisés à admettre une chose telle que la liberté (…). En revanche, s’il n’y avait pas de liberté, la loi morale ne saurait nullement être rencontrée en nous ».
Ainsi, pour Kant, pour que l’homme soit moral, il faut qu’il soit libre, car s’il était forcé par une nature intelligible à la bonté, à la justice et à l’altruisme, il ne serait qu’un automate spirituel et s’il était forcé par sa nature sensible à l’égoïsme, il ne serait qu’un mécanisme matériel .
Conclusion de notre exemple de dissertation philosophique
1) Faire le bilan de la démarche poursuivie dans le devoir : La liberté humaine est-elle donc possible ? Nous avons pu comprendre, tout au long de notre travail, la difficulté qui existe à pouvoir saisir une véritable « expérience » de la liberté et, par conséquent, la difficulté à en prouver véritablement l’existence.
2) Répondre à la question initiale : La liberté est-elle une illusion ? Notre travail a, en tout cas, cherché à démontrer que si la croyance en une liberté immédiate était illusoire, voire naïve, la critique spinoziste nous a permis d’accéder à une approche de la liberté qui puisse permettre d’en préserver l’espoir : en effet, si l’homme n’est pas libre, il lui est, en revanche, donné d’entrer dans un processus , dans une conquête assimilable à une libération par l’usage de la raison et par son entrée dans la morale et la vie sociale .
3) Si possible, proposer une ouverture à une nouvelle réflexion : Comment penser les conséquences d’une authentique libération de l’homme dans ses interactions morales, sociales et politiques ?
Vincent Boyer , professeur de philosophie à Paris.
> Version PDF de la dissertation corrigée .
Note aux élèves : Ce dissertation vous est donnée à titre d’exemple et à titre gratuit. La copier-coller pour un devoir demandé par votre professeur ne vous aidera pas à obtenir une bonne note au bac philo. De plus, les professeurs sont équipés de logiciels permettant de déceler les copier-coller. Vous seriez donc doublement puni…
Notes aux professeurs: la mission de la-philosophie.com est de promouvoir et démocratiser les enseignements philosophiques, gratuitement, et non de fournir des prêts à copier-coller aux élèves. Le site est un modeste complément aux cours, notamment ceux de terminale.
Vous pouvez nous envoyer votre demande d’aide (gratuite) via le formulaire ci-dessous :
Pour aller plus loin sur le bac philosophie :
Méthode de la dissertation philosophique
Le Commentaire de Philosophie
Article du Monde sur la dissertation (accès réservé aux abonnés)
Aide à la dissertation de Philosophie
You may also like
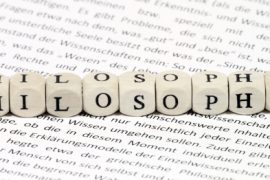
Les Notions au Programme de Philosophie en Terminale et cours associés
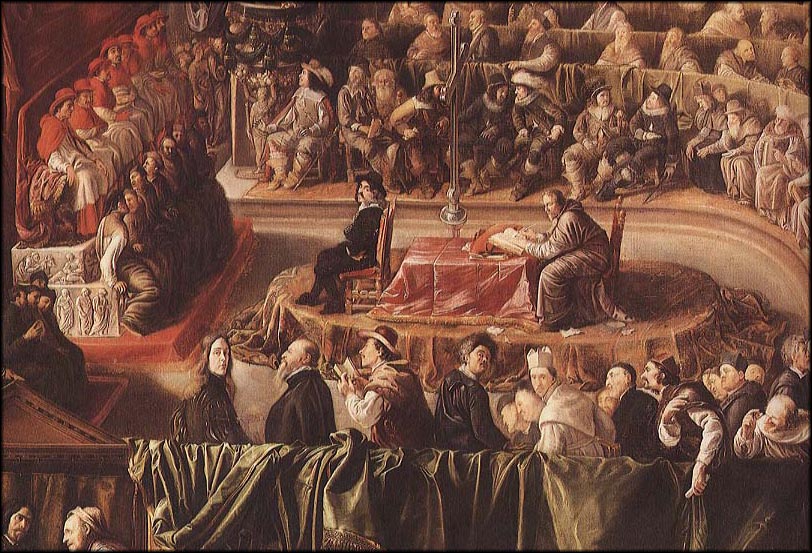
La Justice en Philosophie
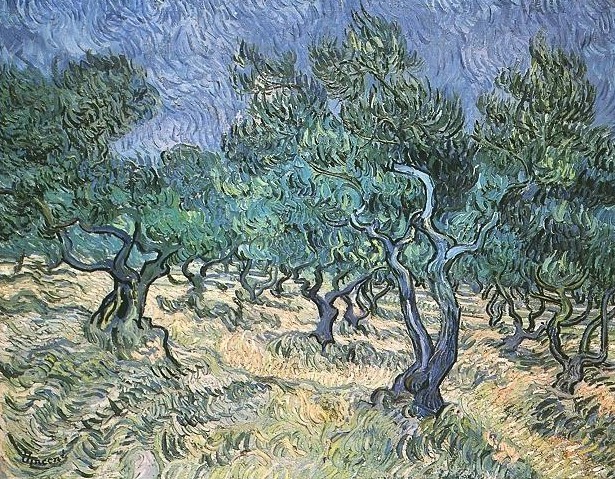
La Nature en philosophie

Méthode de la Dissertation Philosophique

Analyse d’une notion philosophique : la technique


Méthodologie des Questions sur le Texte philosophique (séries technologiques)
71 Comments
le langage animal
je dois reconnaître, moi qui enseigne depuis 10 ans en lycée, que votre exemple est un modèle pour les élèves de terminale philo. Merci donc de l’avoir partagé sur votre site.
Je crois qu’il faut souligner les dimensions politiques et psychologiques des l’explication du sujet.au fait l’individu se sent toujours déçu de ce qu’il en a tant rêve et lotrssu’il parvient a réalisé ce dont il z longtemps rêve et plannifie,il se rend compte que ce qu’il a réalisé n’est pas beaucoup de chose ,n’est pas a la hauteur de ses désirs.l’autre cote politique,tous les peuples qui ont combattu pour le printemps arabe et pour la liberté et au nom de la liberté se sont sentis déçus.de même les régimes comme le socialisme qui ont promis liberté aux peuples ont déçu les peuples
jardelin: merci bcp msr vincent votre dissertation m,a donné le gout de la lire, mrci d l,avoir publiée.
y aurait il la même chose pour le sujet “peut-on se mettre à la place d’autrui?” ??
C est formidable
vraiment bien pourrais-je avoir une copie pour le sujet” les individus ont-il une prise sur le cour de l’histoire?”
une dissertation complète pour le sujet” les individus ont-il une prise sur le cour de l’histoire?”
dans la mesure ou l’homme est un ètre naturellement pensant et doté de raison a la capacité de distingué le bien du mal alors se mettre a la place d’autrui vu qu’il est notre semblable est possible dans ce cas.Mais en outre les sensation et sentiment qu’éprouve l’otre et ses désirs ne peut ètre en aucun cas les mèmes par ailleurs ce mèttre a la place d’autrui ne peut ètre perçu
Elle est vraiment bonne….merci
Merci c’est agréable, pourrais-je avoir la correction de ce sujet la religion limite-t-elle la liberté humaine?
car je ne sais comment vous remercier pour votre illustration. j’aurai encore besoin de vous dans le but de bien comprendre mes textes philosophiques. MERCI
n’ayant pa d citation,pourez t on partir des faits quotiens pour introduire
pourait je avoir une dissertation sur le sujet <<taisez vous les philosophes ici ne parlent que les scientifique»
Peut-on avoir un exemple d’une dissertation comparative svp?
Sujet :l’homme est il un acteurs de l’histoire?
Dissertation : le progrès des sciences entraînent -il la ruine de la philosophie?
merci a vous pour cette belle exemple
Vraiment bonne !je suis en term l, cette dissert est PARFAITE. je cite aussi hobbes, dans la mienne et sartre dans un grand II
votre site est tres benefique!!!! Merci!
Vraiment bien mais j’ais besoin d’une copie pour ” l’homme d’action a t il raison de se moquer du philosophe”
Elle est trop bonne seulmnt si vous pouriez en faire beaucoup dotre sa serai parfait!!!
Faut-il croire sans expérimenté?
Merci pour votre travail conséquent! Celui que mon professeur de philosophie ne remplie pas… Votre exemple clair et précis m’a permis d’enfin comprendre la méthode et de bien me préparer a mes épreuves. Encore merci Un bachelier
Mille fois merci!
mreci professeur
Merci beaucoup pour votre parfaite illustration. Je voudrais savoir un peu d’éclaircissement sur l’idéalisme hegelien, le matérialisme marxiste et le positivisme d’Auguste Comte et en quoi ils s’opposent.
SUJET: Vanité des vanité, tout est vanité
Vous ne mettez pas les parties en rapport, elles sont totalement isolées, et votre conclusion n’aboutit à rien.
Merci prof vincent BOYER
Merci pour les informations
C’est bien
Vraiment j’apprécie beaucoup votre corrigé.
- Ping : COMMENT FAIRE UNE BONNE DISSERTATION PHILOSOPHIQUE – Monlivret
- Ping : Comment faire une bonne dissertation philosophique – Monlivret
la philosophie est elle importante dans la societe humaine?
《la philosophie est indetacharble des preocupation de la vie》Expliquez svp
La philosophie est-elle un système?
merci de nous avoir escplicite ce sujet
merci bien prof vraiment c’est super, ca m’a permi de mieu comprendre certains details.svp je peux avoir de meme pour ce sujet:”toutes les passions sont sans eception mauvaises” svp
Merci beaucoup. ..c’est très bien détaillé. Y a til la même chose pour :《peut on parler de la philosophie en ce 21èm siècle》..merci d’avance
Pas forcément
merci . la conscience est elle la marque de la grandeur de l homme?
l’homme est le seul animal raisonnable , il est conscient de son inconscience et oui la conscience fait sa grandeur .
merci beaucoup de nous facilite les techniques
Je trouve que votre dissertation est très réussie merci…
Est-Ce par la conscience qu’il faut définir l’homme ?
merci beaucoup pour votre site
Merci beaucoup. C’est une méthode très intéressante et belle. Pourtant, je me demande si nos deux heures de composition philosophique suffiront à produire un devoir assimilable à votre chef-d’œuvre
Merci Avec ce site , je serai prêt pour mon exam
Oui je pense que oui c’est la nature d’l être humain
Le cour est bien rédigée
Merci mais puis je avoir de l’aide svp “*la philosophie est elle un dire?”*
Avec cette technique j’ai instrui des centaines de mes candidats pour le Baccalauréat philosophie. Vraiment merci
C’est agréable à lire
La philosophie n’est pas utile ?
J’ai vraiment apprécié!
Bonsoir à vous pour un tel sujet en philosophie La femme est-elle une source de vie ? quelle est la démarche à suivre
Merci beaucoup pour cette bonne démarche très compréhensible.
Svp. Pouvez vous m’aider à ce sujet : l’homme est-il un être de pulsion ?
Svp. Pouvez vous m’aider à ce sujet: doit-on ne pas travailler ? Développement, Conclusion. Merci
Doit-on admettre l’hypothèse de l’inconscient
Une très bonne dissertation
Merci la philosophie.com
La société est-elle une prison ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.
Évitez les fautes dans vos écrits académiques
Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.
- Dissertation
Exemple de dissertation de philosophie
Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.
Voici des exemples complets pour une bonne dissertation de philosophie (niveau Bac).
Vous pouvez les utiliser pour étudier la structure du plan d’une dissertation de philosophie , ainsi que la méthode utilisée.
Conseil Avant de rendre votre dissertation de philosophie, relisez et corrigez les fautes. Elles comptent dans votre note finale.
Table des matières
Exemple de dissertation de philosophie sur le travail (1), exemple de dissertation de philosophie sur le concept de liberté (2), exemple de dissertation de philosophie sur l’art (3).
Sujet de la dissertation de philosophie : « Le travail n’est-il qu’une contrainte ? ».
Il s’agit d’une dissertation de philosophie qui porte sur le concept de « travail » et qui le questionne avec la problématique « est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ? ».
Télécharger l’exemple de dissertation de philosophie
Combien de fautes dans votre document ?
Nos correcteurs corrigent en moyenne 150 fautes pour 1 000 mots . Vous vous demandez ce qui sera corrigé exactement ? Déplacez le curseur de gauche à droite !

Faites corriger votre document
Sujet de la dissertation de philosophie : « Etre libre, est-ce faire ce que l’on veut ? ».
Cette dissertation de philosophie sur la liberté interroge la nature de l’Homme. La problématique de la dissertation est « l’’Homme est-il un être libre capable de faire des choix rationnels ou est-il esclave de lui-même et de ses désirs ? ».
Sujet de la dissertation de philosophie : « En quoi peut-on dire que l’objet ordinaire diffère de l’oeuvre d’art ? ».
Cette dissertation sur l’art et la technique se demande si l’on peut désigner la création artistique comme l’autre de la production technique ou si ces deux mécanismes se distinguent ?
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.
Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation de philosophie. Scribbr. Consulté le 27 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-philosophie/
Cet article est-il utile ?
Justine Debret
D'autres étudiants ont aussi consulté..., exemple de dissertation juridique, la méthode de la dissertation de philosophie , plan d'une dissertation de philosophie.

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans
289 plans rédigés de philosophie à télécharger
Les sujets stars :).
- L’État peut-il être juste ?
- La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?
- L’homme a-t-il nécessairement besoin de religion ?
- L’homme doit-il travailler pour être humain ?
- La conscience est elle ce qui définit l’homme ?
- La conscience fait-elle de l’homme une exception ?
- Changer, est-ce devenir quelqu’un d’autre ?
- L’idée d’inconscient exclut-elle celle de liberté ?
- Peut-on parler pour ne rien dire ?
- L’art nous détourne-t-il de la réalité ?
- Sartre, L'Être et le Néant (1943), Tel, Gallimard, p. 88.
- Faut-il libérer ses désirs ou se libérer de ses désirs ?
- Peut-on renoncer à sa liberté ?
- Est-il raisonnable de croire en Dieu ?
- Annales BAC 2007 - Toute prise de conscience est-elle libératrice ?
Nouveaux sujets publiés
- Annales BAC 2021 - Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?
- Annales BAC 2021 - Sommes-nous responsables de l’avenir ?
- Annales BAC 2021 - L’inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?
- Annales BAC 2021 - Discuter, est-ce renoncer à la violence ?
- Annales BAC 2017 - Peut-on se libérer de sa culture ?
- Annales BAC 2017 - Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?
Sujets tendances
- La nature fait-elle bien les choses ?
Notions les plus demandées
- La conscience et l'inconscient
- Le désir
- La liberté
- Le travail et la technique
Plan rédigé, sujet expliqué
Pour chaque sujet de dissertation ou commentaire de texte, un plan rédigé (le plus souvent en 3 parties avec 3 sous-parties) est disponible en téléchargement.
Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo
Bon à savoir : Tous nos corrigés sont préparés par des professeurs agrégés de philosophie en exercice.
- Sujets corrigés bac français, philosophie
- Réussir le commentaire philosophique, méthode, repérage sur texte. Méthode de la dissertation
La Critique de la raison pratique, Kant. La morale et le bonheur. Commentaire philosophique.
- Le 22/05/2024
- Dans Réussir le commentaire philosophique, méthode, repérage sur texte. Méthode de la dissertation
- 0 commentaire
Commentaire philosophique
Un commandement ordonnant à chacun de chercher à se rendre heureux serait une sottise; car on n’ordonne jamais à quelqu'un ce qu'il veut déjà inévitablement de lui-même. Il faudrait que lui ordonner les lignes de conduite, ou plutôt les lui proposer, parce qu'il ne peut pas tout ce qu'il veut. Au contraire, ordonner la moralité sous le nom de devoir est tout à fait raisonnable, car tout le monde ne consent pas volontiers à obéir à ses préceptes, quand elle est en conflit avec des inclinations; et, quant aux mesures à prendre sur les façons dont on peut obéir à cette loi, on n'a pas à les enseigner ici, car ce qu'un homme veut à cet égard, il le peut aussi. Celui qui a perdu au jeu peut bien s'en vouloir à lui même ainsi qu'en vouloir à son imprudence, mais, s'il a conscience d'avoir triché (encore qu'il ait ainsi gagné), il doit se mépriser lui même nécessairement dès qu'il se compare avec la loi morale. Il faut donc bien que celle-ci soit autre chose que le principe du bonheur personnel. Car, être contraint de se dire soi même "Je suis un misérable, bien que j'aie rempli ma bourse", exige un autre critère de jugement que s'il s'agissait de s'approuver soi-même et de se dire : "Je suis un homme prudent, car j'ai enrichi ma caisse".
Kant, Critique de la raison pratique
la recherche du bonheur est-elle d’ordre moral ? Y-a-t-il un sens à parler d’un devoir de bonheur ? Faut-il, au contraire, que la moralité soit dissociée de la recherche du bonheur et pourquoi ?
Ce texte d’E. Kant a pour thème la relation entre bonheur et moralité. Plus exactement, il s’agit de comparer la recherche du bonheur à la notion de devoir moral en prenant pour critère les principes ou les normes de l’action. L’auteur en arrive ainsi à poser sa thèse selon laquelle le bonheur et la moralité s’opposent du point de vue des principes de l’action, et que donc la recherche du bonheur n’est pas de nature essentiellement morale. Le problème se pose donc de savoir pourquoi le bonheur et la moralité doivent être dissociés : la recherche du bonheur est-elle d’ordre moral ? Y-a-t-il un sens à parler d’un devoir de bonheur ? Faut-il, au contraire, que la moralité soit dissociée de la recherche du bonheur et pourquoi ?
Pour répondre à ce problème, le texte articule deux moments argumentatifs qui se répondent symétriquement : De la ligne 1 à 7, Kant commence par comparer le bonheur et la moralité du point de vue du commandement et en déduit sa thèse selon laquelle seule la moralité, contrairement au bonheur, est de l’ordre d’un devoir. Puis, de la ligne 7 à 13, l’auteur illustre sa thèse et, plus globalement, l’ensemble du raisonnement précédent, en prenant l’exemple du jeu d’argent, où il peut arriver que la recherche du gain (et donc du bonheur) passe par l’immoralité, ce qui confirme la thèse de l’opposition fondamentale entre moralité et bonheur.
Ce premier moment pose la thèse de l’opposition entre moralité et bonheur du point de vue des principes. Pour cela, Kant commence par une sorte de raisonnement par l’absurde partant de l’idée de « commandement » (ligne 1). En effet, l’idée de commander aux hommes de se rendre heureux semble « stupide » (ligne 2) puisque tous les hommes recherchent le bonheur. L’idée d’un devoir de se rendre heureux apparaît donc quasiment comme un non-sens car « on ne commande jamais à quelqu’un ce qu’infailliblement il veut déjà lui-même » (ligne 2). Dans cette optique, le bonheur est tellement désiré ou voulu qu’il ne peut pas être considéré comme un devoir : on n’oblige pas quelqu’un à faire ce qu’il fait déjà spontanément ou naturellement. On peut donc en déduire que l’idée d’un devoir n’a de sens que s’il commande ce que l’on ne désire pas naturellement ou spontanément. Certes, le commandement d’atteindre le bonheur peut avoir une signification, mais c’est dans le sens « d’ordonner les mesures à prendre » (ligne 3), autrement dit conseiller ou proposer les moyens d’y parvenir. Par conséquent, ordonner signifie ici donner des règles de prudence (maximes, méthodes, etc.) en vue du bonheur. Ce cas rejoint d’ailleurs la sagesse antique qui visant à rendre l’homme heureux en l’invitant, par exemple, à « vivre en conformité avec la nature » (Épicure). Kant fait ainsi ressortir une contradiction entre le bonheur et la moralité en montrant que si l’idée de commandement est stupide à propos du bonheur, elle est au contraire « tout à fait raisonnable » (ligne 5) lorsqu’il s’applique à la moralité. C’est parce que le « devoir » (ligne 4) est moral qu’il est très sensé d’en faire un commandement. En effet, on peut supposer que le bonheur est encore de l’ordre des « inclinations » (ligne 6) au sens où tous les hommes ont un tel penchant naturel au bonheur. D’où l’idée que le devoir moral puisse aller jusqu’à entrer « en conflit » (ligne 5) avec l’inclination au bonheur comme Kant le démontrera dans la deuxième partie. Reste que la mise en opposition du bonheur et de la moralité va plus loin, dans la mesure où Kant la justifie non seulement par le commandement mais aussi par l’enseignement. Alors que « les mesures à prendre » en vue du bonheur peuvent s’enseigner par des conseils ou des règles pratiques (l’épicurisme par exemple), la loi morale, en revanche, ne s’enseigne pas au sens où elle dépend uniquement de sa propre volonté. Pour justifier ce point capital, Kant met en perspective deux cas où la volonté humaine intervient : d’une part celui où l’homme « ne peut pas tout ce qu’il veut » (lignes 3-4) et, d’autre part, celui où « ce que, à cet égard, quelqu’un veut, il le peut aussi » (ligne 7). Dans le premier cas, l’écart entre le pouvoir et le vouloir conduit l’homme à rechercher les moyens de se rendre capable d’atteindre le bonheur. Mais il en va tout autrement du devoir moral où il suffit à l’homme de vouloir pour pouvoir au sens où obéir à la loi morale se présente comme un impératif absolu qui ne prend pas en compte les conséquences (bonnes ou mauvaises) pouvant découler de l’obéissance au devoir : l’obligation morale se présente donc comme une loi interne qui m’oblige à agir (ne pas mentir, ne pas tricher, etc.). En ce sens, le devoir moral n’est pas acquis ou enseignable puisqu’il est interne et dépend essentiellement en tout homme de sa conscience morale : personne ne peut m’apprendre à suivre ou écouter la voix de ma conscience. La moralité n’est donc pas tant une question de capacité ou de pouvoir que de volonté ou d’intention. En sorte que la morale selon Kant ne concerne que l’intention (agir par devoir) qui préside à l’action et non pas la conséquence de nos actions (être heureux ou non). En termes plus conceptuels, on peut dire que la morale kantienne est déontologique et non pas téléologique au sens où c’est le devoir (deon) qui prime sur les fins (telos). À plus forte raison, le bonheur s’inscrit justement dans la perspective des fins de l’homme et ne peut donc, aux yeux de Kant, appartenir au domaine de la moralité. Après avoir posé sa thèse de la dissociation entre bonheur et moralité, Kant va s’efforcer dans un second moment d’en tirer les conséquences en prenant l’exemple du jeu d’argent.
En vue de mieux saisir la portée de sa thèse, Kant concentre l’analyse du second moment sur l’exemple du jeu d’argent où l’on va retrouver symétriquement les deux optiques précédentes sur le commandement : ou bien commander renvoie aux « mesures à prendre » en vue du bonheur, ou bien commander se confond avec l’obéissance au devoir moral. Toute l’analyse consiste, comme on va le voir, à adopter une perspective normative sur le raisonnement précédent. L’exemple part du jugement que peut porter un homme sur lui-même dès lors que celui-ci perd ou gagne à un jeu d’argent. Se dessinent alors deux perspectives : la première consiste à perdre et se « fâcher » (ligne 8) contre soi-même à cause de son « manque de prudence » (ligne 8), c’est-à-dire, au sens précédent, regretter de ne pas avoir suivi les règles qu’il fallait pour gagner. Rien de moral dans ce jugement porté sur soi-même puisqu’il consiste uniquement à s’en vouloir de ne pas avoir été assez prudent ou performant. Tout à l’inverse, la seconde perspective consiste à gagner tout en ayant « triché » (ligne 8) et Kant ajoute qu’« il faut » (lignes 9-10), dans ce cas précis, se mépriser moralement. Où l’on voit qu’ici le devoir moral ne signifie aucunement suivre des règles de prudence, ni même adopter la bonne stratégie (moyen/fin) mais uniquement ne pas tricher. Par voie de conséquence, Kant en déduit que la loi morale ne peut se confondre avec « le principe du bonheur personnel » (lignes 10-11). D’ailleurs, le tricheur peut aussi bien être heureux personnellement (d’avoir gagné beaucoup d’argent) et se sentir coupable moralement d’avoir triché (aux yeux de la loi morale). Ce qui confirme la thèse selon laquelle on ne peut assimiler la recherche du bonheur à un devoir moral
Enfin, pour mettre en évidence cette contradiction entre moralité et bonheur, Kant formule à la première personne ce qu’un tricheur peut se dire à lui-même après avoir triché (pour gagner) : d’une part « je suis un être indigne, bien que j’aie rempli ma bourse » (lignes 11-12) et, d’autre part, « je suis un homme prudent, car j’ai enrichi ma caisse » (lignes 13). Le philosophe allemand en tire la conséquence que ces deux jugements, même s’ils semblent en apparence compatibles, ne peuvent pas reposer sur la même « norme du jugement » (ligne 12). La norme du bonheur concerne ici le fait de devoir trouver le moyen, même immoral (tous les moyens sont bons !), de gagner tandis que la norme morale consiste, quant à elle, à se rendre digne (non méprisable) en s’interdisant notamment de tricher (quitte à perdre !). Aussi ces deux principes répondent-ils symétriquement aux deux formes de commandement analysées dans le premier moment ; le premier renvoyant à la moralité et le second à la prudence, la prudence du tricheur pouvant aller, dans cet exemple, jusqu’à désobéir à la loi morale pour se rendre heureux.
Le problème était de savoir en quoi la recherche du bonheur et le devoir moral s’opposaient du point de vue des principes. Kant a d’abord montré que parler d’un devoir moral de se rendre heureux n’a pas de sens dans la mesure où l’homme qui recherche le bonheur n’obéit pas tant à un devoir moral qu’à une simple règle en vue d’atteindre le bonheur (prudence). Au contraire, le devoir moral commande à l’homme ce qu’il doit faire indépendamment des circonstances et donc de l’attente du bonheur qui pourrait en découler. On peut en conclure que, contrairement à toutes les philosophies anciennes comme l’épicurisme ou le socratisme, la recherche du bonheur se trouve exclue par Kant du domaine de la moralité. Le sage sait se rendre heureux mais il n’est qu’un homme prudent et non pas un homme moral. Sa sagesse, aussi parfaite soit-elle, ne nous dit donc encore rien sur sa moralité qui, elle, consiste selon Kant à agir par devoir (la loi morale) et, par suite, se rendre digne d’être heureux - quel que soit par ailleurs le but ou le bonheur escompté.
Peut-il être juste de désobéir aux lois ? Dissertation philosophique corrigée
Peut-il être juste de désobéir aux lois ?
Suis-je le mieux placé pour me connaître ? Dissertation corrigée
Suis-je le mieux placé pour me connaître ?
Questions sur la doctrine de la vertu, Kant. Exercice philosophique corrigé
- Le 08/03/2024
Kant, Doctrine de la vertu
Rousseau, Huitième lettre écrite à la montagne. En quoi l’indépendance est-elle contraire à la liberté politique ?
Thème, thèse, problématique, plan
Commentaire philosophique corrigé :John Rawls, Théorie de la justice - Quelle conception de la justice une société démocratique doit-elle structurer?
- Le 28/02/2024
Commentaire philosophique bac blanc
Suis-je ce que j’ai conscience d’être ? Dissertation corrigée, bac blanc
Correction bac blanc
Husserl, Les rapports entre la vérité et la science. Introduction et première partie du texte
- Le 28/11/2023
Exercice bac, le commentaire
Que gagnons-nous à travailler ? Travailler l'introduction d'une dissertation en philosophie
- Le 10/10/2023
Exercice : l'introduction d'une dissertation
Exercice de philosophie sur les présupposés : méthodologie. Comment disserter sur une question philosophique ouverte ou fermée?
- Le 18/09/2023
Exercices, les présupposés
Expliquer une citation de Kant : "On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher"
- Le 14/09/2023
Expliquer une citation
Exercice de philosophie : reformuler les maximes kantiennes du sens commun
Exercice de philosophie
Comment faire un commentaire philosophique? Méthode pour réussir l'analyse d'un texte et exemple de repérage sur Kant, "Qu'est-ce que les Lumières"?
- Le 12/09/2023
Méthode, repérage
Philosophie - méthode et repérage
Articles similaires
Il est par définition injuste de désobéir à la loi- La loi n’est pas toujours juste, le légal ne se confond pas avec le légitime. La désobéissance peut sembler plus juste que l’obéissance
Suis-je le mieux placé pour me connaître ? existe-t-il une situation privilégiée pour se connaître soi-même ? Suis-je moi-même dans une telle position ? Quel rôle jouent les autres?
Rousseau, Huitième lettre écrite à la montagne. En quoi l’indépendance est-elle contraire à la liberté politique ? Analyse de la lettre. Thème, thèse, problématique, plan
Commentaire philosophique corrigé : Texte de John Rawls, Théorie de la justice - Comment fonder l’autorité politique sur la participation active de chacun à la vie publique et politique ? Quelle conception de la justice doit structurer une société démocratique ?
Suis-je ce que j’ai conscience d’être ? Dissertation corrigée, bac blanc - Le problème se pose de savoir si l’on est ce que l’on a conscience d’être - Avoir conscience d’être suffit-il pour savoir qui l’on est ? Notre identité personnelle coïncide-t-elle avec la conscience que nous avons de nous-mêmes ?
Husserl, Les rapports entre la vérité et la science. Commentaire : Introduction et première partie du texte Exercice bac de philosophie. Deux corrections sont proposées
Que gagnons-nous à travailler ? Travailler l'introduction d'une dissertation en philosophie - Présupposé de l'intitulé
Exercice de philosophie sur les présupposés : méthodologie. Comment disserter sur une question philosophique ouverte ou fermée? Quel plan choisir? Dialectique? Thématique?
Ajouter un commentaire
Commentaire / Dissertation
Méthode simple pour réussir
Le repérage sur texte
- Kant Qu'est-ce que les Lumières?
- Husserl, rapports vérité/science
- Exercice de reformulation
- Exercices de philosophie
Problématiser
- Exercices. Concepts/Repères
- Exercices sur les présupposés
L'existence humaine/ La culture
- Le désir- le besoin / Le langage
- Art et technique
- Nature et Culture
- Conscience/Inconscient
Humanités, Littérature, Philosophie, bac 2021
Modale d'alerte
Rejoindre l’éducation nationale
- M'identifier
Publiée le 22/05/2024 | Réf. MENJ-03-2024-02816
Professeur(e) de Philosophie - Gray - 0700009E
- Temps plein
- Niveau 6 : Licence et diplômes équivalents
- Emploi ouvert uniquement aux contractuels
- Catégorie A
L’établissement
Rectorat - Académie de Besançon
- 10 RUE DE LA CONVENTION 25030 BESANCON CEDEX
Descriptif poste et compétences attendues
L’académie de Besançon recrute UN(E) PROFESSEUR(E) de Philosophie en lycée à Gray.
Le contrat porte au maximum sur 18 heures de cours en classe par semaine.
L’activité liée à cet enseignement comprend en outre la préparation des cours, l’évaluation des élèves, le travail en équipe pédagogique et la relation aux parents d’élèves
Descriptif du profil recherché
Enseigner en lycée général et technologique c’est approfondir les connaissances, développer les capacités d’analyse des élèves et les accompagner dans leur parcours de formation. Pour en savoir plus sur le métier d’enseignant en lycée : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/etre-professeur-en-lycee-general-et-technologique-124
Conditions particulières d'exercice
En tant qu’enseignant(e) contractuel(le) vous bénéficiez :
D’un accompagnement et d’une offre de formations
Du remboursement de vos frais de transports en commun à hauteur de 75%
D’une participation à votre mutuelle
D’un supplément familial de traitement en fonction de votre situation.
D’une rémunération maintenue pendant les congés scolaires si les dates de votre contrat incluent ce type de période.
D’un accès à une restauration collective sur place.
De prestations sociales via la plateforme PREAU :
https://www.preau.education.fr/com/homepage
Rémunération
Rémunération mensuelle brute pour un temps plein : 2188€
Personne à contacter
Descriptif employeur.
L’académie de Besançon forme une communauté professionnelle impliquée pour l’accompagnement de l’égalité des chances, la réussite et le bien-être de chaque élève.
Rejoignez un employeur durablement engagé pour ses personnels, en proximité, pour leur accompagnement quotidien et le développement de leurs compétences.
Rejoignez des femmes et des hommes qui changent la vie pour toute la vie. Découvrez leurs témoignages : https://www.youtube.com/watch?v=pt7_XmKErJU&list=PLUtObikuAspytQ_ss5QCOnNy02duM5ypw
Documents à transmettre

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
La dissertation philosophique est un exercice scolaire qui consiste à poser un problème en fonction d'un sujet donné et à y répondre par une rgumentation a rigoureuse. Elle n'est pas pure technique, aucune série de « conseils » ne saurait constituer le moyen automatique - la « recette infaillible » - pour obtenir une très ...
La dissertation en philosophie est un exercice difficile car elle suppose la maîtrise d'une méthode et d'une structure déterminée. Nous vous donnons donc un exemple de dissertation redigée et corrigée par un professeur, tant d'un point de vue méthodologique (forme) qu'éditorial (fond).
La dissertation en philosophie. Épreuve reine en philosophie, la. dissertation vise à présenter une. réponse argumentée à partir d'un sujet. donné. 6 étapes pour faire une dissertation. Étape 1 : analyser le sujet. Étape 2 : problématiser le sujet. Étape 3 : rédiger le plan. Étape 4 : préparer l'argumentation. Étape 5 : rédiger la dissertation.
Cet ouvrage permet aux élèves de Terminale de s'approprier de façon autonome, concrète et directement utilisable les connaissances et les compétences attendues pour l'épreuve de philosophie au Bac : - des fiches méthodologiques sur les deux épreuves : dissertation et explication de texte ; - des fiches de cours sur les notions au ...
Méthode de la dissertation philosophique Méthode: ensemble de règles générales à mette en œuve. La difficulté vient de ce que chaque sujet est particulier. On ne peut donc appliquer mécaniquement et « bêtement » les ègles. La méthode n'évite pas d'ête intelligent ! Disserter, c'est discute , donc fo mule des thèses, des jugements, u'on expliue et agumente pou les ...
Bac Philo. Méthode de la Dissertation Philosophique. I. Le sujet. La dissertation est l'exercice proposé pour le sujet 1 et le sujet 2 du Baccalauréat de philosophie. Le sujet de dissertation se présente toujours sous la forme d'une question à laquelle vous devez répondre.
* les références philosophiques: - Il est nécessaire de recourir à vos connaissances philosophiques : sans culture philosophique, vous ne faites pas de dissertation philosophique, mais vous bavardez ; souvent, vous ne pouvez même pas trouver le problème - La difficulté, c'est la manière dont vous allez invoquer ce bagage philosophique ...
Étape 3 de la méthode d'une dissertation - Faire un plan. Maintenant que vous avez une problématique, il faut faire un plan qui y répond. Recherchez des idées et notez-les de manière ordonnée. En fonction du sujet de dissertation de philosophie proposé, un type de plan va s'imposer : dialectique, analytique ou thématique.
MÉTHODE DE LA DISSERTATION EN PHILOSOPHIE . Terminales L/ES/S . P. Serange / J.-J. Marimbert - 2009. Les dissertations représentent deux des trois sujets proposés au choix le jour du baccalauréat, soit la majorité. Ces sujets se présentent sous différentes formes, que nous allons essayer d'examiner ici.
Méthode de la dissertation philosophique. I. Préparation. Dans le sujet, il faut trouver un paradoxe (une idée étonnante, qui va contre l'opinion commune), ou un présupposé, toujours un problème. Le mauvais réflexe, c'est de chercher dès l'abord une réponse.
Télécharger en PDF. La dissertation est un travail d'argumentation et de rédaction. Il s'agit de développer, selon un plan précis, une réponse argumentée et structurée autour d'une problématique philosophique portant sur l'un des objets d'étude au programme.
La dissertation en philosophie est un exercice difficile car elle suppose la maîtrise d'une méthodeet d'une structure déterminée. Nous vous donnons donc un exemple de dissertation rédigée et corrigée par un professeur, tant d'un point de vue méthodologique (forme) qu'éditorial (fond).
L'introduction d'une dissertation philosophique Il s'agit de réfléchir sur l'énoncé afin de montrer pourquoi la question se pose : elle est intéressante, importante, … et soulève un réel problème ! Vous devez pour ce faire reformuler l'énoncé en prenant le temps de définir les termes en présence. 3 étapes principales :
Mis à jour le 7 décembre 2020. Une dissertation de philosophie doit suivre un plan spécifique. Nous vous dévoilons ce plan type et vous donnons des exemples. Note. Nous illustrons le plan d'une dissertation de philosophie à partir d'un exemple complet que vous pouvez consulter ici.
Le cours de Méthodologie est animé par une visée pratique : contrairement à bon nombre de cours d'introduction à la philosophie, son objectif n'est pas de transmettre une série de connaissances déterminées - relatives, par exemple, à l'histoire de la philosophie - mais d'aider les participants à acquérir certaines compétences permettant de surmonter les principaux ...
Les cinq étapes de la dissertation : • Analyser le sujet. • Chercher des idées et arguments. • Dégager une problématique. • Bâtir un plan + écrire l'introduction et la conclus. • La rédaction ion au brouillon. La dissertation exige du savoir-faire (maîtrise de la technique) et du savoir (connaissances, références, citations) ANALYSER LE SUJET.
répondre à la question, «qu'est-ce qu'une dissertation philosophique ? » en s'interrogeant seulement sur la nature de la dissertation en général. C'est l'examen du qualificatif «philosophique » qui permet vraiment de déterminer la nature spécifique de la dissertation philosophique.
La méthode de la dissertation comporte quatre étapes : - Analyser le sujet et formuler la problématique ; - Rechercher les idées et les exemples ; - Établir le plan détaillé et préparer l'introduction et la conclusion ; - Rédiger. 1°) L'analyse du sujet Une grille pour bien analyser un sujet de dissertation : les 4 D
Voici des exemples complets pour une bonne dissertation de philosophie (niveau Bac). Vous pouvez les utiliser pour étudier la structure du plan d'une dissertation de philosophie, ainsi que la méthode utilisée. Conseil. Avant de rendre votre dissertation de philosophie, relisez et corrigez les fautes. Elles comptent dans votre note finale.
MÉTHODE DE LA DISSERTATION III. MÉTHODE DE L'EXPLICATION DE TEXTE IV. RAISONNEMENTS, ARGUMENTS, LOGIQUE p. 32 p. 33 p. 37 p. 39 Version numérique du dossier disponible sur le site auphil-delo.fr Héléna Molin - septembre 2022. Notions, Repères, Méthodes - page 2/40 P r o g r a m m e PHILOSOPHIE Programme de Terminale gÉnérale terminales générales LLEESS NOTIONSS Ce sont les ...
Pour chaque sujet de dissertation ou commentaire de texte, un plan rédigé (le plus souvent en 3 parties avec 3 sous-parties) est disponible en téléchargement. Les incontournables du BAC de philosophie : plans rédigés de dissertations et commentaires de texte. Annales corrigées du BAC philo en téléchargement.
de la philosophie de Renée Descartes. « Que la liberté́de notre volonté́se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. Au reste, il est si évident que nous avons une volonté́libre, qui peut donner son consentement ou ne le pas donner quand bon lui semble, que cela peut être comptépour une de nos plus communes notions. Nous en avons eu (…) une preuve bien ...
En philosophie, la science est définie comme un jugement porté sur le monde ou sur un ensemble de propositions logiques via une méthode basée sur la cohérence et/ou la vérification des énoncés. Les vérités établies par la science ont donc été vérifiées et c'est en ce sens que la science se distingue de l'opinion.
Pour des cours de français en ligne. Ma classe de français en ligne - Du CP/ 1ère . Cours sur skype français, candidats libres, scolarisés. Lycées métropole, lycées français à l'étranger, lycées professionnels. Pour des cours de philosophie. Cours sur skype philosophie, candidats libres, scolarisés
L'académie de Besançon recrute UN (E) PROFESSEUR (E) de Philosophie en lycée à Gray. Le contrat porte au maximum sur 18 heures de cours en classe par semaine. L'activité liée à cet enseignement comprend en outre la préparation des cours, l'évaluation des élèves, le travail en équipe pédagogique et la relation aux parents d ...